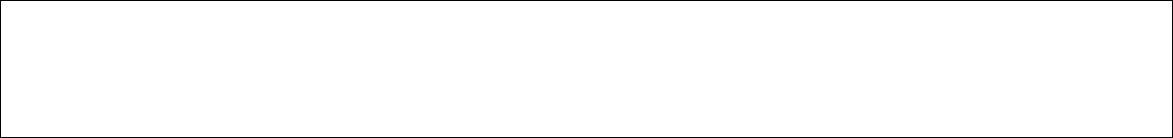L'oubli de Senlecq dans la presse française
Au début du XXe siècle, les citations dans la presse quotidienne deviennent plus rares et sont tributaires de nouvelles contributions françaises telles que celle d'Armengaud en 1908. Le souvenir de l'inventeur est devenu vague et Le Temps, journal de référence de l'époque, se voit obligé de publier un rectificatif pour préciser que Senlecq est français et non américain comme il l'avait écrit.. Si l'on excepte les deux articles que La Nature consacre à ses nouvelles propositions en 1908, ses propositions de 1878-
Le décès du notaire d'Ardres, en janvier 1934, ne retient l'attention que de la presse locale. Il faut attendre 1939 pour que le Conseil municipal d'Ardres, sur proposition du député du Pas de Calais M. de Saint-
Après la Seconde guerre mondiale, l'oubli de Constantin Senlecq est à peu près complet dans la presse française. Durant la IVeme République, il n'est cité qu'une seule fois, en 1950, dans V, le magazine illustré du Mouvement de libération nationale (MLN). Dans Le Monde, il sera cité que dans deux articles : en 1971 à l'occasion d'une dramatique de Pol Quentin, La passion de John Baird, réalisée par Robert Crible. En 1985, dans un article commérant le cinquantième anniversaire des premières diffusions françaises; Jean-
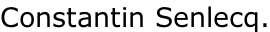
L'imprécision des historiens contemporains
Si la presse française a oublié, durant le XXe siècle, la contribution de Senlecq, celle-
Korn et Glatzel lui consacrent onze pages dans leur solide Handbuch der Phototelegraphie und Telautographie. Il est par contre assez curieux de constater que les deux grands historiens des développements techniques de la télévision, Abramson et Burns, ne semblent pas avoir fait un travail approfondi sur cette période. Champeix, dont la contribution est pourtant la plus détaillée, est assez imprécis sur la chronologie des publications.
Albert Abramson n'a pas eu une connaissance directe de la brochure de de Paiva et, en 1987, ne cite que les articles de English Mechanic et ne publie pas de reproduction du schéma de Senlecq, alors qu'il publie ceux de Carey et de Nipkow.
Ignorant également les sources françaises, R.W. Burns, dans Television. International history of the formative years (1999), de manière bien étonnante, publie le dessin de la brochure de 1881, mais en indiquant comme source, l'article de English Mechanic and World Science du 11 février 1881 ! En fait, il est aisé de voir, grâce à la mention "Original Zeichnung von Senlecq" que reproduit Burns en haut du graphique, qu'il n'utilise ni l'original ni le magazine anglais, mais bien une source allemande ! Cette source allemande n'est autre que l'ouvrage du hongrois Dionys von Mihály, Das elektrische Fernshen und das Telehor, Verlag von M. Krayn, Berlin, 1923. Mihály a le mérite de fournir un historique assez détaillé des premières années de recherche sur la télévision, mais il date le début des travaux de Senlecq de 1872 ! Quant à son jugement sur le fond, il conclut que la proposition de Senlecq est à peine plus élaborée que celle de de Paiva.
Nous nous en tenons ici à la critique des travaux les plus éminents. On n'en finirait pas d'épingler les imprécisions relatives aux travaux du notaire d'Ardres qui circulent dans les ouvrages de vulgarisation, dans les chronologies et dans quelques sites internet consacrés à l'histoire de la télévision ou à l'histoire de la télécopie.
Il faut attendre le début du 21 ème siècle, avec la démarche de collecte systématique des articles publiés, entreprise ici avec la collaboration minutieuse de Jean-
Il apparaît indiscutable que Senlecq a été, avec quelques autres, un pionnier de la recherche sur la transmission des images à distance, mais le qualifier de "père de la télévision" ou d'"inventeur de la télévision" est certainement excessif; Son ambition initiale était probablement plus la transmission de documents que la transmission d'images en mouvement.
Bibliographie
- CHAMPEIX, R., Savants méconnus, inventions oubliées, Dunod, Paris, 1966.
- FOSTER DOTY, M., Selenium, a liSt of references (1817-
1925), compiled by Marion Foster Doty, The Public Library, New York, 1927. - LEDOS, J.J., article "Senlecq Constantin (1842-
1934)" in Dictionnaire historique de télévision, De ABC à Zworylin, L'Harmattan, 2013, pp.482- 485. - SAUVAGE G. Arbre généalogique de Constantin Senlecq, Geneanet, Consulté le 17 janvier 2018.
- 9 octobre 1842 : naissance de Constantin Senlecq, pionnier de la télévision", Les Archives du Pas de Calais, 9 octobre 2017.
- Je remercie M. Jean-
Jacques Ledos qui m'a communiqué plusieurs des articles de Senlecq ici reproduits et a attiré mon attention sur la contribution de Champeix. - André Lange. Première publication décembre 2001. Dernières révisions 27 avril 2023, 6 juin 2023, 25 juillet 2024