| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°627 Mai 1949 > Page 479 | Tous droits réservés |
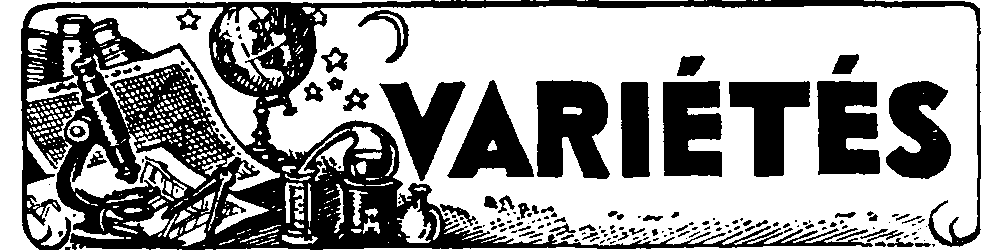
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Notes de voyage

|
Vers les sources du Nil Blanc |

|
|
L’auteur de ce récit a quitté Addis-Abéba, malgré la défense des autorités éthiopiennes, pour traverser l’Abyssinie en direction du Soudan égyptien. Le voici, à mi-route environ, dans une région assez mal connue, peuplée de nègres très arriérés, le pays des Chankallas-Moas. Notre guide Tageyn nous a éveillés avant le jour, et nous sommes partis rapidement. D’habitude, c’est nous qui sommes debout les premiers, et qui crions pour secouer nos dormeurs. La célérité de nos hommes ce matin vient de leur peur innée des fièvres, qu’ils sentent planer, et de la sinistre réputation qui a dû leur être contée, à Lekemti ou en chemin, sur le Didessa. Ils veulent franchir la distance en une seule fois. Donc nous marchons bien dans l’obscurité. La descente est raide, continue, avec des crochets que font les mulets mal guidés. Mais il est préférable de se fier à eux, car, dans le noir, ils y voient mieux que les humains. La piste est un mince ruban nettoyé par les pas, en dehors duquel pierres et racines ont vite fait de vous culbuter. Cependant peu à peu le ciel s’éclaircit. Il rosit, puis s’emplit de feu. Nous ne voyons pas le soleil qui fait sa montée dans notre dos, derrière les montagnes dont nous descendons. La nature, elle aussi, se ranime doucement. Quelques chants d’oiseaux s’élèvent dans les broussailles. Nous entendons un premier saut de singe, ou la plus lourde agitation d’un gros gibier. Le ciel s’embrase d’un seul coup au moment où quelque part derrière nous le soleil se décide à émerger pour de bon. Et, dans le même moment, c’est partout l’égale explosion de la vie : la joie ailée, les vocalises à gorges déployées, les vols multicolores, et, dans la gent quadrupède, toute la série des gambades, des courses et des sauts. À ces minutes initiales du jour, il y a une folle familiarité des animaux. Une portée de phacochères conduite par sa mère laie s’arrête en vrai public pour mieux nous voir passer. Une gazelle, qui se réchauffait en bonds colossaux, manque de sauter Toléra. Bernard a des regards d’envie vers ses armes. Ah ! si nous n’étions pas raisonnables et pressés ! ...
Les sangles scient à vif dans les chairs. Des charges qui ont glissé déséquilibrent la marche, les fouets s’abattent durement, et, d’un implacable aiguillon, il y a un grand diable noir qui harcèle toujours le même mulet épuisé. Qu’on imagine le bruit, la poussière, les odeurs et les cris de cette masse en mouvement. Il nous faut plusieurs minutes pour la remonter en raison de la longueur de piste qu’elle couvre. Les ronces grincent au passage. Quelque part, un spectacle touchant : un petit ânon de six mois qui suit sa mère martyre en gambadant. Je montre à Bernard sa gaîté, ses comiques oreilles de lapin. Le fouet l’évite. Il ignore le sort qui l’attend d’ici peu, lors qu’il sera en âge d’être bâté ... Une rivière se présente en un gué large et aisé. Le Maka, nous disent des Nagadés. C’est l’un des affluents du Didessa, et nous en traverserons plusieurs autres petits et grands, qui coulent presque parallèlement à lui dans cette partie très étalée de sa vallée. Celui-ci est d’une eau assez claire, largement livrée au soleil par la nudité de ses rives, et donc purifiée. Ce ne sera pas toujours le cas. Nous buvons, en commençant à croquer de la quinine avant d’avaler. Comme nous sortons de ce gué, nous voyons s’avancer une caravane sans aucun rapport avec celles déjà rencontrées. Noblesse et richesse caractérisent celle qui vient. Un nombreux personnel à pied précède et encadre des cavaliers vêtus de bure et coiffés du « borsalino », à la mode des grands de ce pays. Les chasse-mouches tournoient. Toutes les mules marchent un amble nerveux, stimulé par la proximité de l’eau. Et la queue de ce brillant cortège, dont tous les dignitaires nous ont successivement dévisagés, nous apporte la plus inattendue et la plus troublante des apparitions. Une princesse abyssine voyage sous l’escorte de ses barons. Elle clôt la marche. Nous la surprenons. Coiffée du même large feutre que ses chevaliers servants, elle a un visage ovale extrêmement racé, des traits européens, italiens, dirais-je, à peine teintés de nuit, et dont la bouche seule nous échappe sous le voile blanc qui l’abrite des poussières. Ses yeux sont un peu étirés en amande. De longues mains de déesse reposent sur le pommeau maroquiné. Droite en selle, infiniment aristocratique, elle est exquise dans l’étonnement que nous lui causons. Les longues routes à la chaleur sont fastidieuses et bercent sans doute les rêves des grandes dames privées d’expansion ... Quel est le mari — s’il y est — parmi ces sombres et bedonnants seigneurs qui ont défilé ? Quel qu’il soit, il ne peut être digne de cette épouse affinée. Est-ce le sentiment de cette disparité conjugale qui ouvre si intensément les yeux de cette dernière sur ces deux hommes nouveaux qui passent, deux Blancs ? Ses prunelles d’antilope m’ont paru livrer une étincelle de regret en nous quittant, au bout des brèves secondes de ce contact écourté ... Quel dommage que ce pays soit si fermé, si austère, si lié à ses ancestrales traditions ! Mais c’est aussi ce qui fait son cachet. Voici notre conversation alimentée ! Et nous devenons lyriques pour le joli sexe éthiopien, quand une nouvelle rencontre, bien différente celle-là, jette bas toutes nos exaltations ! Elle se produit à un tournant de la piste, dans une zone reprise par la végétation. De noires femelles, noires d’encre, poussent des cris aigus en nous découvrant et sautillent chacune vers l’abri d’un tronc. Elles sont nues. Leur peau brille. Leurs vilains seins ballottent. Faces rondes, nez écrasés, bouches lippues. — Chankallas-Moas ! Chankallas-Moas ! claironne Tageyn. Il a la joie du garde-chasse qui avait promis un gibier rare, et qui l’annonce à une battue. Certes, nous connaissions, tout le monde connaît les Chankallas, ces déshérités d’Éthiopie, ces vrais nègres voués immémorialement à la traite, ou, à présent qu’officiellement elle n’existe plus, aux besognes pénibles. Il y a chez ces femmes, apprivoisées depuis qu’elles ne nous craignent plus, une agilité dans la laideur, une espièglerie dans l’animalité, une libre sauvagerie. Les jambes sont fines, les épaules bien moulées. Nous n’avons pas de peine à admettre qu’il s’agisse d’une fraction déterminée, avec des caractères spéciaux. Elles sont là remuantes, luisantes, avec les longs fléaux qu’elles balancent à l’épaule et auxquels pendent deux charges à peu près équilibrées. Dans les calebasses ainsi montées, il y a du grain et des œufs. Elles les portent à quelque marché. Elles semblent être, elles, en corvée. Il est possible qu’elles appartiennent à des maîtres d’un hameau que nous allons, paraît-il, traverser, qu’elles soient esclaves d’Abyssins, colons en pointe dans la savane du Didessa. Mais leur présence dans ces contrées, et surtout leur provenance posent un problème sur lequel nous espérons que la suite de notre route pourra nous éclairer. François BALSAN. |
|
|
Le Chasseur Français N°627 Mai 1949 Page 479 |
|
 Sur le paysage, par contre, le lever du rideau nous
déçoit. Nous ne sommes encore que dans une jungle demi-boisée, qui précède,
évidemment, les zones de forêts aperçues de là-haut. Le sol rouge, poussiéreux,
est planté d’épineux et d’arbustes clairsemés. Depuis que la descente est
achevée, nous voyageons dans une vallée désertique. (C’est cette partie qui
s’appelle le « désert » du Didessa.) Toutes les caravanes se hâtent.
On cherche à se dépasser. Nous en doublons une qui nous inspire pitié pour ses
malheureuses bêtes.
Sur le paysage, par contre, le lever du rideau nous
déçoit. Nous ne sommes encore que dans une jungle demi-boisée, qui précède,
évidemment, les zones de forêts aperçues de là-haut. Le sol rouge, poussiéreux,
est planté d’épineux et d’arbustes clairsemés. Depuis que la descente est
achevée, nous voyageons dans une vallée désertique. (C’est cette partie qui
s’appelle le « désert » du Didessa.) Toutes les caravanes se hâtent.
On cherche à se dépasser. Nous en doublons une qui nous inspire pitié pour ses
malheureuses bêtes.