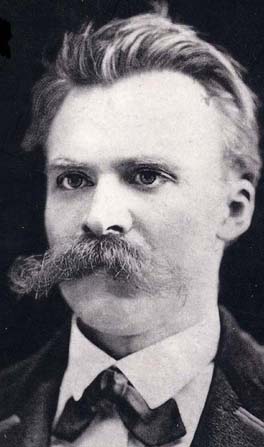
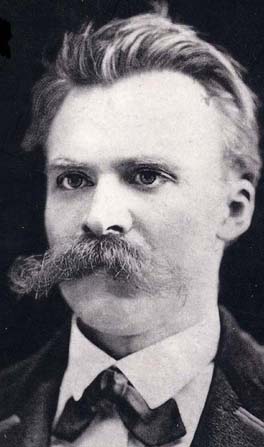
ACTION
On peut promettre des actions, mais non des sentiments, car ceux-ci sont involontaires. Qui promet à quelqu'un de l'aimer toujours, ou de le haïr toujours, ou de lui être toujours fidèle, promet quelque chose qui n'est pas en son pouvoir; ce qu'il peut bien promettre, c'est des actions qui, à la vérité, sont ordinairement les conséquences de l'amour, de la haine, de la fidélité, mais qui peuvent aussi provenir d'autres motifs, car à une seule action mènent des chemins et des motifs divers. La promesse d'aimer quelqu'un toujours signifie donc : tant que je t'aimerai, je te montrerai les actions de l'amour; si je ne t'aime plus, tu continueras néanmoins à recevoir de moi les mêmes actions, quoique pour d'autres motifs : en sorte que dans la tête des autres hommes persiste l'apparence que l'amour serait immuable et toujours le même. – On promet ainsi la persistance de l'apparence de l'amour, lorsque, sans s'aveugler soi-même, on promet à quelqu'un un amour éternel. (HTH/78-§58)
Les hommes d'action manquent ordinairement de l'activité supérieure : je veux dire l'individuelle. Ils agissent à titre de fonctionnaires, de marchands, d'érudits, autrement dit de représentants d'une espèce, mais non à titre d'hommes déterminés, isolés et uniques; à cet égard ils sont paresseux. –C'est le malheur des gens d'action que leur activité est toujours un peu irraisonnée. On ne peut, par exemple, demander au banquier qui amasse de l'argent le but de son incessante activité; elle est irraisonnée. Les gens d'action roulent comme roule la pierre, suivant la loi brute de la mécanique. – Tous les hommes se divisent, et en tout temps et de nos jours, en esclaves et libres; car celui qui n'a pas les deux tiers de sa journée pour lui-même est esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut : politique, marchand, fonctionnaire, savant. (HTH/78-§283)
La fermeté résolue de la pensée et de la recherche, c'est-à-dire la liberté de l'esprit devenue qualité du caractère, rend mesuré dans les actions : car elle affaiblit la convoitise, tire à soi beaucoup de l'énergie dont on dispose, au profit de fins intellectuelles, et montre la demi-utilité ou l'inutilité et le danger de tous les changements brusques. (HTH/78-§464)
Comment nous comportons-nous envers les actions d'un homme de notre entourage? - Tout d'abord nous considérons ce qu'il en résulte pour nous, - nous ne les considérons que sous ce point de vue. Cette conséquence, nous y voyons l'intention de l'action - et pour finir nous attribuons à cet homme comme un caractère permanent le fait d'avoir eu de telles intentions, et désormais nous le qualifions, par exemple, d' " homme nuisible ". Triple erreur! Triple méprise immémoriale! Peut-être est-ce l'héritage des animaux et de leur capacité de jugement! (AUR/81-§102)
Toutes les actions se rattachent à des appréciations de valeur, toutes les appréciations de valeur sont soit personnelles, soit acquises, - ces dernières étant de loin les plus nombreuses. (AUR/81-§104)
Comment doit-on agir? Dans quel but doit-on agir? -Au niveau des besoins les plus immédiats et les plus grossiers de l'individu, il est facile de répondre à ces questions, mais plus on s'élève dans des domaines plus subtils, plus étendus et plus importants de l'action, plus la réponse devient incertaine, et par conséquent arbitraire. Mais là surtout, l'arbitraire doit être exclu des décisions! - ainsi l'exige l'autorité de la morale : une angoisse et une vénération confuses doivent aussitôt guider l'homme dans les actions, justement, dont les buts et les moyens lui sont le moins immédiatement clairs! (AUR/81-§107)
Socrate et Platon, grands douteurs et admirables novateurs (…), étaient pourtant d'une crédulité innocente quant au plus fatal des préjugés, à la plus profonde des erreurs, à savoir que " de la juste connaissance doit résulter l'acte juste ", - avec ce principe ils restaient toujours les héritiers de la folie et de la prétention générales : selon lesquelles il existe une connaissance de l'essence des actions. " Ce serait en effet terrible si de la connaissance parfaite de l'essence de l'acte juste ne résultait pas l'acte juste ", - voilà le seul argument qui semblât nécessaire à ces grands hommes pour prouver cette idée, le contraire leur paraissait impensable et dément - et c'est pourtant le contraire qui est la réalité toute nue, démontrée chaque jour et à chaque heure de toute éternité ! (AUR/81-§116)
Tout ce que l'on peut savoir d'un acte ne suffit jamais pour l'accomplir, en aucun cas on n'a encore pu jeter un pont de la connaissance à l'acte? Les actions ne sont jamais ce qu'elles nous paraissent être! Nous avons eu tant de mal à apprendre que les choses extérieures ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent, - eh bien! Il en va de même du monde intérieur! (AUR/81-§116)
Le contraire était et est encore la croyance générale : nous avons contre nous le plus ancien des réalismes ; jusqu'ici l'humanité pensait : " une action est telle qu'elle nous semble être ". (AUR/81-§116)
De toutes nos actions, celles qui visent certaines fins sont les moins comprises car elles ont toujours passé pour les plus compréhensibles et représentent pour notre conscience le quotidien le plus banal. Les grands problèmes sont à la rue. (AUR/81-§127)
On parle de " combat des mobiles ", mais on désigne ainsi un combat qui n'est pas le combat des mobiles. En effet, avant un acte, notre conscience réfléchissante voit défiler successivement les conséquences de différents actes que nous croyons tous pouvoir exécuter, et nous comparons ces conséquences. Nous croyons être décidés à un acte lorsque nous avons constaté que ses conséquences seront en majorité favorables; avant d'en arriver à cette conclusion de nos évaluations, nous nous sommes souvent bien tourmentés, par suite de la grande difficulté qu'il y a à deviner les conséquences, à les apercevoir dans toute leur force, et surtout dans leur totalité, sans la moindre omission : en outre ce calcul doit faire aussi la part du hasard. (AUR/81-§129)
Sur le chapitre des mœurs, agir même une seule fois à l'encontre de ce qu'on juge préférable ; céder ici, en pratique, tout en réservant sa liberté intellectuelle ; se comporter comme tout le monde et faire ainsi, à tout le monde, une amabilité et un bienfait, pour les dédommager en quelque sorte des écarts de nos opinions : – tout cela est considéré, chez les hommes quelque peu indépendants, non seulement comme admissible, mais encore comme « honnête », « humain », « tolérant », « point pédant », et quels que soient les termes dont on se sert pour endormir la conscience intellectuelle : et c'est ainsi qu'un tel fait baptiser chrétiennement son enfant et n'en est pas moins athée, tel autre fait son service militaire, comme tout le monde, bien qu'il condamne sévèrement la haine entre les peuples, et un troisième se présente à l'église avec une femme parce qu'il a une parenté pieuse, et il fait des promesses devant un prêtre sans avoir honte de son inconséquence. « Cela n'a pas d'importance si quelqu'un de nous fait ce que tout le monde fait et a toujours fait » – ainsi parle le préjugé grossier ! Et l'erreur grossière ! Car rien n'est plus important que de confirmer encore une fois ce qui est déjà puissant, traditionnel et reconnu sans raison, par l'acte de quelqu'un de notoirement raisonnable : c'est ainsi que l'on donne à cette chose, aux yeux de tous ceux qui en entendent parler, la sanction de la raison même ! Respect à vos opinions ! Mais de petites actions divergentes ont plus de valeur ! (AUR/81-§149)
Ce que nous faisons n'est jamais compris, mais toujours simplement loué et blâmé. (LGS/82-§264)
Durant la plus longue période de l'histoire humaine — on l'appelle les temps préhistoriques — on jugeait de la valeur et de la non-valeur d'un acte d'après ses conséquences. L'acte, par lui-même, entrait tout aussi peu en considération que son origine. Il se passait à peu près ce qui se passe encore aujourd'hui en Chine, où l'honneur ou la honte des enfants remonte aux parents. De même, l'effet rétroactif du succès ou de l'insuccès poussait les hommes à penser bien ou mal d'une action. Appelons cette période la période prémorale de l'humanité. L'impératif « connais-toi toi-même » était alors encore inconnu. Mais, durant les derniers dix mille ans, on en est venu, peu à peu, sur une grande surface du globe, à ne plus considérer les conséquences d'un acte comme décisives au point de vue de la valeur de cet acte, mais seulement son origine. C'est, dans son ensemble, un événement considérable qui a amené un grand affinement du regard et de la mesure, effet inconscient du règne des valeurs aristocratiques et de la croyance à l' « origine », signe d'une période que l'on peut appeler, au sens plus étroit, la période morale : ainsi s'effectue la première tentative pour arriver à la connaissance de soi-même. Au lieu des conséquences, l'origine. Quel renversement de la perspective ! Certes, renversement obtenu seulement après de longues luttes et des hésitations prolongées ! Il est vrai que, par là, une nouvelle superstition néfaste, une singulière étroitesse de l'interprétation, se mirent à dominer. Car on interpréta l'origine d'un acte, dans le sens le plus précis, comme dérivant d'une intention, on s'entendit pour croire que la valeur d'un acte réside dans la valeur de l'intention. L'intention serait toute l'origine, toute l'histoire d'une action. Sous l'empire de ce préjugé, on se mit à louer et à blâmer, à juger et aussi à philosopher, au point de vue moral, jusqu'à nos jours. (PDBM/86-§32)
Ne commettez point de lâcheté à l’égard de vos actions ! Ne les laissez pas en plan après coup ! — Le remords de conscience est indécent. (LCI/88-1§10)
ACTIF - PASSIF
« J'ignore tout de ce que je fais ! J'ignore tout de ce que je dois faire ! » — Tu as raison, mais n'en doute pas : tu es fait ! À chaque instant ! De tout temps l'humanité a confondu l'actif et le passif, c'est son éternelle bourde grammaticale. (AUR/81-§120)
AFFAIRES
Vivez en hommes supérieurs et faites sans cesse les affaires de la civilisation supérieure, — alors tout ce qui y vit reconnaîtra vos droits, et l'ordre de la société, dont vous êtes le sommet sera invulnérable à tout maléfice et tout mauvais coup ! (HTH/78-§480)
L'oisif est dangereux pour ses amis; car, n'ayant pas assez à faire lui-même, il parle de ce que font et ne font pas ses amis, il se mêle des affaires des autres et se rend importun : c'est pourquoi il faut être assez sage pour ne se lier qu'avec des gens qui travaillent. (OSM/79-§260)
Les affaires de certain homme riche et distingué sont sa façon de se reposer d'une trop longue oisiveté tournée à l'habitude : c'est pourquoi il les traite avec autant de sérieux et de passion que font d'autres gens de leurs rares loisirs et de leurs occupations d'amateur. (LVO/79-§247)
Vos affaires — c'est votre plus grand préjugé, elles vous lient à votre résidence, à votre société, à vos penchants. Travailleurs en affaires — mais paresseux spirituellement, satisfaits de votre indigence, le tablier du devoir drapé sur cette satisfaction : c'est ainsi que vous vivez, c'est ainsi que vous souhaitez vos enfants ! (AUR/81-§186)
AFFECT - INSTINCT - PULSION
Vouloir combattre la violence d'un instinct, cela n'est pas en notre pouvoir, pas plus que la méthode que nous adoptons par hasard, pas plus que le succès que nous remportons ou non avec elle. Visiblement, dans tout ce processus, notre intellect est bien plutôt l'instrument aveugle d'un autre instinct, rival de celui dont la violence nous tourmente : que ce soit le besoin de repos, ou la peur de la honte et d'autres conséquences fâcheuses, ou l'amour. Tandis que « nous » croyons nous plaindre de la violence d'un instinct, c'est au fond un instinct qui se plaint d'un autre ; ce qui veut dire que la perception de la souffrance causée par une telle violence présuppose qu'il existe un autre instinct tout aussi violent ou plus violent encore et qu'il va s'engager un combat dans lequel notre intellect doit prendre parti. (AUR/81-§109)
Aussi loin que quelqu'un puisse pousser la connaissance de soi, rien pourtant ne peut être plus incomplet que son image de l'ensemble des instincts qui constituent son être. A peine s'il peut nommer les plus grossiers par leur nom : leur nombre et leur force, leur flux et leur reflux, leurs actions et leurs réactions mutuelles et surtout les lois de leur nutrition lui demeurent totalement inconnus.
Peut-être cette cruauté du hasard sauterait-elle encore plus vivement aux yeux si tous les instincts voulaient se montrer aussi fondamentalement intransigeants que la faim, qui ne se contente pas d'aliments rêvés; mais la plupart des instincts et en particulier les instincts dits moraux se satisfont précisément ainsi, — si l'on admet ma supposition selon laquelle la valeur et le sens de nos rêves consistent justement à compenser jusqu'à un certain point ce manque accidentel de nourriture pendant le jour.
La vie éveillée ne dispose pas de la même liberté d'interprétation que la vie en rêve, elle est moins poétique et débridée, — mais dois-je mentionner qu'à l'état de veille nos instincts ne font également rien d'autre qu'interpréter les excitations nerveuses et leur fixer des « causes » adaptées à leurs propres besoins ? Qu’il n'y a pas de différence essentielle entre la veille et les rêves ? Que même, si l'on compare des niveaux très différents de culture, la liberté de l'interprétation éveillée dans l'un ne le cède en rien à la liberté de l'autre en rêve ? Que nos appréciations et nos jugements de valeur moraux ne sont également que des images et des variations fantaisistes sur un processus physiologique qui nous est inconnu, une sorte de langage convenu pour désigner certaines excitations nerveuses ? Que toute notre prétendue conscience n'est que le commentaire plus ou moins fantaisiste d'un texte inconnu, peut-être inconnaissable et seulement ressenti ? (AUR/81-§119)
On peut en user avec ses instincts comme un jardinier et, ce que peu de gens savent, cultiver les semences de la colère, de la pitié, de la ratiocination, de la vanité, de façon aussi féconde et profitable que de beaux fruits en espalier. […] Tout cela nous est loisible : mais combien sommes-nous à le savoir ? La plupart ne croient-ils pas en eux comme en des faits parvenus au terme de leur développement ? De grands philosophes n'ont-ils pas imprimé leur sceau à ce préjugé, avec leur doctrine de l'immutabilité du caractère? (AUR/81-§560)
Que je considère les hommes d'un œil bon ou méchant, je les vois toujours appliqués à une unique tâche, tous et chacun en particulier : faire ce qui sert la conservation de l'espèce humaine. Et ce, à vrai dire, non pas en vertu d'un sentiment d'amour pour cette espèce, mais simplement parce que rien n'est en eux plus ancien, plus fort, plus implacable, plus insurmontable que cet instinct, — parce que cet instinct est précisément l'essence de notre espèce et de notre troupeau. [...] Cette pulsion qui gouverne de la même manière les plus élevés et les plus communs des hommes, la pulsion de conservation de l'espèce, se manifeste de temps en temps sous forme de raison et de passion de l' esprit ; elle s'entoure alors d'une cour brillante de raisons et veut faire oublier à toute force qu'elle est au fond pulsion, instinct, folie, déraison. (LGS/82-§1)
A présent l'on a redécouvert le combat dans tout domaine et l'on ne parle que du combat des cellules, des tissus, des organes, des organismes. Mais l'on peut y retrouver l'ensemble de nos affects conscients — à la fin, une fois ceci constaté, nous retournons la question et déclarons : ce qui se produit réellement au cours de l'activité de nos affects humains ce sont ces mouvements physiologiques, et les affects (lutte, etc.) ne sont autre chose que des interprétations élaborées de l'intellect qui, là même où il ne sait rien, prétend tout savoir. Par les mots « irritation », « amour », « haine » il pense avoir défini le motif du mouvement ; de même que par le mot « volonté », etc. — Nos sciences naturelles à présent cherchent à élucider le moindre processus suivant la leçon de notre sensibilité affective, bref de créer un langage propre à traduire ces processus : fort bien ! Mais l'on ne sort pas d'un langage imagé.
L'instinct de propriété – prolongement de l'instinct de la nourriture et de la chasse. L'instinct de la connaissance aussi n'est qu'un instinct supérieur de propriété.
Je parle de l'instinct lorsqu'un quelconque jugement (le goût à son premier stade) est incorporé, en sorte que désormais il se produira spontanément sans plus attendre d'être provoqué par des excitations. Fort de sa croissance propre, il dispose également du sens de son activité poussant au-dehors. Stade intermédiaire : le demi-instinct qui reste mort s'il ne réagit pas même aux excitations. (FP/81-82-v5)
Être abandonné à ses instincts en un temps comme le nôtre, c’est là une fatalité de plus. Ces instincts se contredisent, se gênent et se détruisent réciproquement. La définition du moderne me paraît être la contradiction de soi physiologique. La raison de l’éducation exigerait que, sous une contrainte de fer, un de ces systèmes d’instincts au moins fût paralysé, pour permettre à un autre de manifester sa force, de devenir vigoureux, de devenir maître. Aujourd’hui on ne pourrait rendre l’individu possible qu’en le circonscrivant : possible, c’est-à-dire entier...
L'homme est conduit par ses instincts : les buts ne sont choisis qu'en fonction du service des instincts. Mais les instincts sont d'anciennes habitudes de l'action, des modes d'épanchement de la force disponible. On ne doit pas appeler « but » le résultat auquel parvient un instinct !
Les animaux obéissent à leurs pulsions et leurs affects : nous sommes des animaux. Agissons-nous autrement ? Le fait que nous obéissions à la morale n'est sans doute qu'une illusion ? En vérité, nous obéissons à nos pulsions, et la morale ne serait que le langage figuré de nos pulsions ? Qu'est-ce que le « devoir », le « droit », le « bien », la « loi » – quelle vie pulsionnelle correspond à ces signes abstraits ?
Il n'y a pas de pulsion morale, mais toutes les pulsions portent l'empreinte de nos évaluations. (FP/82-84-v9)
Ce sont nos besoins qui interprètent le monde : nos instincts, leur pour et leur contre. Chaque instinct est un certain besoin de domination, chacun possède sa perspective qu'il voudrait imposer comme norme à tous les autres instincts. (FP/84-v10)
« Faculté, instincts, hérédité, habitudes » – Celui qui croit expliquer quelque chose avec de tels mots doit être aujourd'hui résigné et de surcroît mal instruit. (FP/84-85-v11)
je ne crois pas que l' « instinct de la connaissance » soit le pire de la philosophie, mais plutôt qu'un autre instinct s'est servi seulement, là comme ailleurs, de la connaissance (et de la méconnaissance) ainsi que d'un instrument. Mais quiconque examinera les instincts fondamentaux de l'homme, en vue de savoir jusqu'à quel point ils ont joué, ici surtout, leur jeu de génies inspirateurs (démons et lutins peut-être — ), reconnaîtra que ces instincts ont tous déjà fait de la philosophie — et que le plus grand désir de chacun serait de se représenter comme fin dernière de l'existence, ayant qualité pour dominer les autres instincts. Car tout instinct est avide de domination : et comme tel il aspire à philosopher. (PDBM/86-§6)
Le vieux problème théologique de la « foi » et du « savoir », ou plus précisément de l'instinct et de la raison, la question de savoir si, pour juger des choses, l'instinct mérite plus d'autorité que la raison — laquelle entend juger et agir selon des motifs, selon un pourquoi, donc en vue d'une utilité et d'une fin —, ce dilemme n'est rien d'autre que l'antique problème moral qui surgit pour la première fois avec la personne de Socrate et qui divisa les esprits bien avant le christianisme. Socrate lui-même, obéissant à son talent — le talent d'un dialecticien supérieur —, s'était rangé d'abord du côté de la raison ; [...] Mais est-ce une raison, se dit-il, de se d@?tacher des instincts ? On doit leur rendre justice, mais aussi à la raison; on doit suivre ses instincts, mais persuader la raison de leur trouver de bons motifs. Telle fut la duplicité de ce grand et mystérieux ironiste; il obligea sa conscience à se contenter d'une sorte d'auto-duperie : au fond, il avait percé à jour ce que les jugements moraux comportent d'irrationnel. (PDBM/86-§191)
La nouveauté se heurte aussi à l'opposition de nos sens, et d'une façon générale on peut dire que les processus sensoriels les plus « simples » sont déjà régis par l'affectivité, peur, amour, haine, sans oublier l'affectivité passive de la paresse. (PDBM/86-§192)
Tous les jugements de l'instinct sont myopes eu égard à la chaîne des conséquences : ils recommandent ce qu'il s'agit de faire de prime abord. L'entendement est essentiellement un appareil freinant la réaction immé-diate au jugement de l'instinct : il retient, il continue de réfléchir, il aperçoit une chaîne de conséquences plus lointaines et plus longues. (FP/87-88-v13)
L'instinct de conservation m'a interdit de pratiquer une philosophie de la pauvreté et du découragement... (EH/88-1§2)
je cherche à montrer quels instincts ont été à l'œuvre derrière tous ces purs théoriciens, — comment, tous, ils se sont précipités, subjugués par leurs instincts, sur quelque chose qui était pour eux vérité. Pour eux et seulement pour eux. Le conflit des systèmes, y compris celui des système épistémologiques, est un conflit d'instincts très précis (formes de la vitalité, du déclin, des classes, des races, etc.).
AFFIRMATION
La brièveté de la vie humaine conduit à maintes affirmations erronées sur les qualités de l'homme. (HTH/78-§41)
Parfois, dans la conversation, le son de notre propre voix nous cause une gêne, et nous mène à des affirmations qui ne répondent pas du tout à nos opinions. (HTH/78-§333)
A la façon dont les hommes émettent maintenant leurs affirmations dans le monde, on reconnaît souvent un écho des temps où ils s'entendaient mieux aux armes qu'à toute autre chose : tantôt ils tiennent leurs affirmations comme des tireurs à la cible leur fusil, tantôt on croit entendre le froissement et le cliquetis des épées; et chez quelques hommes, une affirmation s'abat en sifflant comme une solide matraque. (HTH/78-§342)
Une affirmation a plus de poids qu'un argument, du moins chez la plupart des hommes ; car l'argument éveille la méfiance. C'est pourquoi les orateurs populaires cherchent à assurer les arguments de leurs partis par des affirmations. (OSM/79-§295)
Une des conditions essentielles de l'affirmation c'est la négation et la destruction. (EH/88-4§4)
AIMER - AMOUR
Aux personnes que nous n'aimons pas, nous imputons à crime les gentillesses qu'elles nous font. (HTH/78-§309)
Parfois il suffit déjà de lunettes plus fortes pour guérir l'amoureux ; et qui aurait assez de puissance imaginative pour se représenter un visage, une taille, avec vingt ans de plus, traverserait peut-être la vie sans grand souci. (HTH/78-§413)
L'idolâtrie que les femmes professent à l'égard de l'amour est au fond et originairement une invention de leur adresse, en ce sens que, par toutes ces idéalisations de l'amour, elles augmentent leur pouvoir et se montrent aux yeux des hommes toujours plus désirables. Mais l'accoutumance séculaire à cette estime exagérée de l'amour a fait qu'elles sont tombées dans leur propre filet et ont oublié cette origine. Elles-mêmes sont à présent plus dupes encore que les hommes, et partant souffrent plus aussi de la désillusion qui se produira presque nécessairement dans la vie de toute femme — à supposer qu'elle ait d'ailleurs assez d'imagination et d'esprit pour pouvoir subir illusion et désillusion. (HTH/78-§415)
Comme de deux personnes qui s'aiment, l'une est d'ordinaire la personne aimante, l'autre l'aimée, cette croyance est née qu'il y a dans tout commerce amoureux une quantité constante d'amour, que plus l'une en prend, moins il en reste à l'autre. Par exception, il arrive que la vanité persuade à chacune des deux personnes qu'elle est celle qui doit être aimée; en sorte que l'une et l'autre veulent se laisser aimer : de là, spécialement dans le mariage, proviennent en maintes façons des scènes moitié plaisantes, moitié absurdes. (HTH/78-§418)
L'exigence d'être aimé est la plus grande des prétentions. (HTH/78-§523)
L'amour et la haine ne sont pas aveugles, mais aveuglés par le feu qu'ils portent partout avec eux. (HTH/78-§566)
L'amour désire, la crainte évite. A cela tient que l'on ne peut être ensemble aimé et respecté par la même personne, du moins dans le même temps. Car celui qui respecte reconnaît la puissance, c'est-à-dire qu'il la craint; son état est une crainte respectueuse. Mais l'amour ne reconnaît aucune puissance, rien qui sépare, distingue, établisse supériorité et infériorité de rang. C'est parce qu'il ne respecte pas que les hommes ambitieux ont en secret ou ouvertement de la répugnance contre le fait d'être aimés. (HTH/78-§603)
L'un est vide et veut s'emplir, l'autre déborde et veut s'épancher, — tous deux vont se mettre à la recherche d'un individu qui le leur permette. C'est ce phénomène, pris dans son acception la plus haute, que l'on désigne dans les deux cas par un seul mot : l'amour. — Comment ? L'amour devrait être quelque chose de non égoïste ? (AUR/81-§145)
Les hommes ont, dans l'ensemble, parlé de l'amour avec tant d'emphase et d'idolâtrie parce qu'ils en avaient peu reçu et n'avaient jamais pu se rassasier de cette nourriture : aussi en firent-ils une « nourriture des dieux ». Si un poète voulait montrer un jour réalisé sous forme d'utopie l'amour universel de l'humanité, assurément il devrait décrire une situation douloureuse et ridicule, telle que la terre n'en vit jamais de semblable, — chacun harcelé, importuné et désiré non par un seul être aimant, comme il arrive aujourd'hui, mais par des milliers et même par tout le monde, du fait d'un instinct incoercible que l'on insultera et maudira tout comme l’humanité antérieure a maudit l’égoïsme. (AUR/81-§147)
L'immense attente en matière d'amour sexuel pervertit, chez les femmes, leur vision de toutes les perspectives plus lointaines. (LC/82-LAS)
L'amour est pour les hommes quelque chose de tout à fait différent de ce qu'entendent les femmes. Pour la plupart, l’amour est sans doute une forme d’avidité ; pour le reste des hommes, c’est le culte d’une divinité souffrante et masquée. (LC/82-LAS)
Convoitise et amour : quelle différence dans ce que nous éprouvons en entendant chacun de ces deux mots! — et cependant, il pourrait bien s'agir de la même pulsion, sous deux dénominations différentes, la première fois calomniée du point de vue de ceux qui possèdent déjà, chez qui la pulsion s'est quelque peu apaisée et qui craignent désormais pour leur « avoir »; l'autre fois du point de vue de celui qui est insatisfait et assoiffé, et donc glorifiée sous la forme du « bien ». (LGS/82-§14)
L'amour pardonne à l'aimé jusqu'au désir. (LGS/82-§62)
Lorsque nous sommes amoureux, nous voulons que nos défauts restent cachés, — non par vanité, mais parce que l'être aimé ne doit pas souffrir. L'amoureux voudrait même paraître un dieu, — et pas non plus par vanité. (LGS/82-§263)
Voici ce qui nous arrive dans la musique : on doit commencer par apprendre à entendre une séquence et une mélodie, la dégager par l'ouïe, la distinguer, l'isoler et la délimiter en tant que vie à part ; il faut alors effort et bonne volonté pour la supporter, malgré son étrangeté, il faut faire preuve de patience envers son aspect et son expression, de charité envers ce qu'elle a d'étrange : vient enfin un moment où nous sommes habitués à elle, où nous l'attendons, où nous pressentons qu'elle nous manquerait si elle n'était pas là ; et désormais, elle ne cesse d'exercer sur nous sa contrainte et son enchantement et ne s'arrête pas avant que nous soyons devenus ses amants humbles et ravis qui n'attendent plus rien de meilleur du monde qu'elle et encore elle. —Mais ceci ne nous arrive pas seulement avec la musique : c'est exactement de cette manière que nous avons appris à aimer toutes les choses que nous aimons à présent. Nous finissons toujours par être récompensés pour notre bonne volonté, notre patience, équité, mansuétude envers l'étrangeté en ceci que l'étrangeté retire lentement son voile et se présente sous la forme d'une nouvelle et indicible beauté : — c'est son remerciement pour notre hospitalité. Qui s'aime soi-même l'aura appris aussi en suivant cette voie : il n'y a pas d'autre voie. L'amour aussi doit s'apprendre. (LGS/82-§334)
Votre amour de la femme et l’amour de la femme pour l’homme : oh ! Que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés ! Mais presque toujours c’est une bête qui devine l’autre.
Beaucoup de courtes folies – c’est là ce que vous appelez amour. Et votre mariage met fin à beaucoup de courtes folies, par une longue sottise. (APZ/83-85-p1)
Malheur à tous ceux qui aiment sans avoir une hauteur qui est au-dessus de leur pitié ! (APZ/83-85-p4)
Dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et l'autre qui est joué ; Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre. (FP/84-v10)
L'amour d'un seul est une barbarie, car il s'exerce aux dépens de tous les autres. De même l'amour de Dieu. (PDBM/86-§67)
Une âme qui se sait aimée et qui n'aime pas elle-même trahit son fond. La lie monte à la surface. (PDBM/86-§79)
En dépit de toutes les concessions que je suis prêt à faire au préjugé monogamique, je ne pourrai toutefois jamais admettre que l'on parle de droits égaux en amour pour l'homme et la femme : ceux-ci n'existent pas. Le fait est que l'homme et la femme entendent chacun par amour quelque chose de différent, — et chez les deux sexes, il appartient aux conditions de l'amour qu'un sexe ne présuppose pas chez l'autre le même sentiment, le même concept d'« amour ». Ce que la femme entend par amour est suffisamment clair : un parfait abandon (pas seulement un don) d'âme et de corps, sans réserve, sans retenue, la honte et la peur étant bien plutôt ressenties à l'idée d'un amour négocié, lié à des conditions. Par cette absence de conditions, son amour est précisément une croyance : la femme n'en a pas d'autre. —L'homme, lorsqu'il aime une femme, veut précisément d'elle cet amour, il est par conséquent pour sa personne même aussi éloigné que possible de la présupposition de l'amour féminin; mais à supposer qu'il doive exister également des hommes à qui n'est pas étrangère cette aspiration au don parfait, eh bien, ce ne sont justement pas – des hommes. Un homme qui aime comme une femme devient par là esclave ; mais une femme qui aime comme une femme devient par là une femme plus parfaite... (LGS/86-§363)
L'amour est l'état où l'homme voit le plus les choses comme elles ne sont pas. C'est là que la faculté de s'illusionner atteint des sommets; mais également la faculté d'édulcorer, de transfigurer. En amour, on en supporte plus qu'ailleurs, on tolère tout. Il s'agissait d'inventer une religion où l'on pût aimer : par l'amour on est déjà sauvé de ce qu'il y a de pire dans la vie : on ne le voit même plus. (ANT/88-§23)
ALIMENT
L'alimentation de l'homme moderne. – L'homme moderne s'entend à digérer beaucoup de choses et même à digérer presque tout, – c'est là sa vanité à lui : mais il serait d'une espèce supérieure justement s'il ne s'y entendait pas : homo pamphagus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fin. Nous vivons entre un passé qui avait un goût plus délirant et bizarre que nous et un avenir qui en aura peut-être un plus choisi, – nous vivons trop dans la moyenne. (AUR/81-§171)
Connaît-on les effets normaux des aliments ? Y a-t-il une philosophie de la nutrition ? (L'agitation, que l'on recommence sans cesse, pour et contre le végétarianisme prouve déjà qu'il n'existe pas de pareille philosophie !) (LGS/82-§7)
Là où s'impose un profond déplaisir quant à l'existence, se révèlent les répercussions d'une grave faute de régime alimentaire dont un peuple s'est longtemps rendu coupable.
L'énorme prédominance de la consommation du riz pousse à l'usage de l'opium et des narcotiques, de la même manière que l'énorme prédominance de la consommation de pommes de terre pousse à l'eau de vie — ; mais elle pousse aussi, répercussion plus subtile, à des manières de penser et de sentir qui produisent un effet narcotique. (LGS/82-§145)
La sottise dans la cuisine, la femme en tant que cuisinière, l'effroyable étourderie qui préside à l'alimentation de la famille et de son chef. La femme ne comprend pas l'importance de la nourriture, et elle prétend être cuisinière ! Si elle était une créature pensante, elle aurait dû découvrir les faits fondamentaux de la physiologie, depuis tant de milliers d'années qu'elle apprête les repas, et faire de la médecine son domaine propre ! Ce sont les mauvaises cuisinières, le manque total de raison dans la cuisine qui ont été le frein le plus durable, l'entrave la plus désastreuse au développement de l'humanité : il n'en va guère mieux aujourd'hui. – Avis aux demoiselles. (PDBM/ 86-§234)
ALLEMAND - ALLEMAGNE
Lorsque les Allemands commencèrent à devenir intéressants pour les autres peuples de l'Europe – il n'y a pas si longtemps de cela, – ce fut grâce à une culture qu'ils ne possèdent pas aujourd'hui, qu'ils ont secouée avec une ardeur aveugle, comme si ça avait été une maladie : et pourtant ils ne surent rien mettre de mieux à sa place que la folie politique et nationale. Il est vrai qu'ils ont abouti par là à devenir encore beaucoup plus intéressants pour les autres peuples qu'ils ne l'étaient autrefois pour leur culture : qu'on leur laisse donc cette satisfaction ! Il est cependant indéniable que cette culture allemande a dupé les Européens et qu'elle n'était digne ni d'être imitée ni de l'intérêt qu'on lui a porté, et moins encore des emprunts qu'on rivalisait à lui faire. Que l'on se renseigne donc aujourd'hui sur Schiller, Guillaume de Humboldt, Schleiermacher, Hegel, Schelling, qu'on lise leurs correspondances et qu'on se fasse introduire dans le grand cercle de leurs adhérents : qu'est-ce qui leur est commun, qu'est-ce qui, chez eux, nous impressionne, tels que nous sommes maintenant, tantôt d'une façon si insupportable, tantôt d'une façon si touchante et si pitoyable ? D'une part la rage de paraître, à tout prix, moralement ému ; d'autre part le désir d'une universalité brillante et sans consistance, ainsi que l'intention arrêtée de voir tout en beau (caractères, passions, époques, mœurs), – malheureusement ce « beau » répondait à un mauvais goût vague qui néanmoins se vantait d'être de provenance grecque. C'est un idéalisme, doux, bonasse, avec des reflets argentés, qui veut avant tout avoir des attitudes et des accents noblement travestis, quelque chose de prétentieux autant qu'inoffensif, animé d'une cordiale aversion contre la réalité « froide » ou « sèche », contre l'anatomie, contre les passions complètes, contre toute espèce de continence et de scepticisme philosophique, mais surtout contre la connaissance de la nature, pour peu qu'elle ne puisse pas servir à un symbolisme religieux. Gœthe assistait à sa façon à ces agitations de la culture allemande : se plaçant en dehors, résistant doucement, silencieux, s'affermissant toujours davantage sur son propre chemin meilleur. Un peu plus tard Schopenhauer lui aussi y assista, – selon lui une bonne part du monde véritable et des diableries du monde étaient de nouveau devenus visibles, et il en parlait avec autant de grossièreté que d'enthousiasme : car dans cette diablerie il y avait de la beauté ! (AUR/81-§190)
Passons en revue les contributions que, par leur travail intellectuel, les Allemands de la première moitié de ce siècle ont apportées à la culture générale, et en premier lieu les philosophes allemands : ils sont revenus au degré primitif de la spéculation, car ils se satisfaisaient de concepts au lieu d'explications, pareils aux penseurs des époques rêveuses - ils ranimèrent une espèce de philosophie préscientifique. En deuxième lieu les historiens et les romantiques allemands : leurs efforts généraux visèrent à remettre en honneur des sentiments anciens et primitifs, surtout le christianisme, l'âme populaire, les légendes populaires, les idiomes populaires, le Moyen Age, l'ascétisme oriental, l'hindouisme. En troisième lieu les savants : ils luttèrent contre l'esprit de Newton et de Voltaire, ils essayèrent de redresser, comme Goethe et Schopenhauer, l'idée d'une nature divinisée ou diabolisée, et la signification toute morale et symbolique de cette idée. La grande tendance des Allemands s'opposait dans son ensemble aux Lumières et aussi à la révolution de la société qui, par un grossier malentendu, passait pour en être la conséquence : la piété pour les choses établies cherchait à se transformer en piété pour tout ce qui avait été établi autrefois, rien que pour permettre au caeur et à l'esprit de se gonfler de nouveau et de ne plus laisser d'espace aux vues à venir et novatrices. Le culte du sentiment fut dressé en place du culte de la raison, et les musiciens allemands, étant les artistes de l'invisible, de l'exaltation, de la légende, du désir infini, aidèrent à construire le temple nouveau, avec plus de succès que tous les artistes du verbe et de la pensée. Même en tenant compte que, dans le détail, il a été dit et découvert beaucoup de bonnes choses et que certaines depuis lors ont été jugées plus équitablement que jadis, il faut cependant conclure que l'ensemble constituait un danger public et non des moindres, le danger d'abaisser, sous l'apparence d'une connaissance entière et définitive du passé, la connaissance en général au-dessous du sentiment, et - pour parler avec Kant qui définit ainsi sa propre tâche - « d'ouvrir de nouveau le chemin à la foi, en fixant ses limites au savoir ». Respirons de nouveau le grand air : l'heure de ce danger est passée! Et, chose singulière : les esprits que les Allemands évoquaient justement avec tant d'éloquence sont devenus, à la longue, les adversaires les plus dangereux des intentions de leurs évocateurs, - l'histoire, la compréhension de l'origine et de l'évolution, la sympathie pour le passé, la passion ressuscitée du sentiment et de la connaissance, tout cela, après s'être mis pendant un certain temps au service de l'esprit obscurci, exalté, rétrograde, a revêtu un jour une autre nature, et s'élève maintenant, avec de plus larges ailes, sous les yeux de ses anciens évocateurs, et devient le génie fort et nouveau, justement de ces « Lumières », contre quoi on l'avait évoqué. Ces Lumières, c'est à nous maintenant de les faire progresser, - sans nous soucier de ce qu'il y a eu une « grande révolution » et aussi une « grande réaction » contre celle-ci et que tant la révolution que la réaction existent toujours : ce n'est là en somme que jeu de vagues, en comparaison du flot véritablement grand où nous sommes emportés, où nous voulons l'être ! (AUR/81-§197)
Je n'en veux absolument pas aux Allemands : premièrement il leur manque toute la culture, tout le sérieux pour les problèmes où va mon sérieux, et ensuite – ils sont vraiment trop occupés et toutes leur mains sont trop pleines de choses à faire pour qu'ils aient le temps de s'intéresser à quelque chose qui leur est absolument étranger. (DL/87-FN)
Comme par hasard, j’ai la malchance d'être contemporain d'un appauvrissement et d'une désertification pitoyables de l'esprit allemand. Dans mon cher pays, on me traite comme quelqu'un qui relève de l'asile de fous ; voilà pour la compréhension qu'on a pour moi ! Par ailleurs le crétinisme de Bayreuth se met lui aussi en travers de mon chemin. Bien que mort, ce vieux séducteur de Wagner m'enlève ce qui me resterait éventuellement de gens sur qui je puisse exercer mon influence. (DL/88-MVM)
En Allemagne, bien que je sois dans ma quarante-cinquième année, et que j'aie publié environ quinze ouvrages (et, parmi eux, ce nec plus ultra, mon Zarathoustra), pas un seul de mes livres n'a été soumis à une seule discussion, fût-elle de médiocre intérêt. On s'en tire à présent avec des mots, « excentrique », « pathologique » « psychiatrique ». On ne se prive pas de me vilipender et de me calomnier ; dans les revues, savantes ou non, le ton est ouvertement hostile mais d'où vient que jamais personne ne proteste là contre ? Que jamais personne ne se sente blessé, lorsque je suis outragé ? Et pendant des années durant aucun réconfort, pas une goutte d'humanité, pas un souffle d'amour. (DL/88-RVS)
Devinerez-vous qui, dans Ecce Homo, s’en tire le plus mal ? Car c'est l'espèce d'homme la plus ambiguë, la race dont le rapport au christianisme a été historiquement le plus abominable ? Ces messieurs les Allemands — Je leur ai dit des choses terribles... Les Allemands ont, par exemple, sur la conscience d'avoir privé de son sens la dernière grande époque de l'histoire, la Renaissance — à un moment où les valeurs chrétiennes, les valeurs de la décadence étaient vaincues, où elles étaient dépassées jusque dans les instincts spirituels supérieurs par les instincts contraires, les instincts de la vie !... Agresser l'Église — cela voulait dire reconstruire le christianisme —César Borgia comme pape — tel serait le sens de la Renaissance, son véritable symbole... (DL/88-GB)
Je connais peut-être les Allemands et peut-être ai-je le droit de leur dire quelques vérités. La nouvelle Allemagne représente une forte dose de capacités héritées et acquises, en sorte que, pendant un certain temps, elle peut dépenser sans compter son trésor de forces accumulées. Ce n’est pas une haute culture qui s’est mise à dominer avec elle, encore moins un goût délicat, une noble « beauté » des instincts ; mais ce sont des vertus plus viriles que celles que pourrait présenter un autre pays de l’Europe. Beaucoup de bon courage et de respect de soi-même, beaucoup de sûreté dans les relations et dans la réciprocité des devoirs, beaucoup d’activité et d’endurance — et une sobriété héréditaire qui a plutôt besoin d’aiguillon que d’entrave. J’ajoute qu’ici l’on obéit encore sans que l’obéissance humilie... et personne ne méprise son adversaire... (LCI/88-7§5)
Voyons la question par son autre face : il n’est pas seulement évident que la culture allemande est en décadence, mais encore les raisons suffisantes pour qu’il en soit ainsi ne manquent pas. En fin de compte personne ne peut dépenser plus qu’il n’a : — il en est ainsi pour les individus comme pour les peuples. Si l’on se dépense pour la puissance, la grande politique, l’économie, le commerce international, le parlementarisme, les intérêts militaires, — si l’on dissipe de ce côté la dose de raison, de sérieux, de volonté, de domination de soi que l’on possède, l’autre côté s’en ressentira. La Culture et l’État — qu’on ne s’y trompe pas — sont antagonistes : « État civilisé », ce n’est là qu’une idée moderne. L’un vit de l’autre, l’un prospère au détriment de l’autre. Toutes les grandes époques de culture sont des époques de décadence politique : ce qui a été grand au sens de la culture a été non-politique, et même anti politique... (LCI/88-8§4)
Qui parmi les Allemands connaît encore par expérience ce léger frisson que fait passer dans tous les muscles le pied léger des choses spirituelles ! — La raide balourdise du geste intellectuel, la main lourde au toucher — cela est allemand à un tel point, qu’à l’étranger on le confond avec l’esprit allemand en général. L’Allemand n’a pas de doigté pour les nuances... Le fait que les Allemands ont pu seulement supporter leurs philosophes, avant tout ce cul-de-jatte des idées, le plus rabougri qu’il y ait jamais eu, le grand Kant, donne une bien petite idée de l’élégance allemande. (LCI/88-8§7)
Penser en allemand, sentir en allemand, je suis capable de tout, mais cela dépasse mes forces. (EH/88)
ALTRUISME – ABNÉGATION - DÉSINTÉRESSEMENT - EGOÏSME
Nous nous trouvons certainement à l’heure d’un grand danger : les hommes semblent prêts à découvrir que l’égoïsme des individus, des groupes et des masses a été de tous temps, le levier des mouvements historiques. Mais, en même temps, on n’est nullement inquiété par cette découverte et l’on décrète que l’égoïsme doit être notre dieu. Avec cette foi nouvelle, on s’apprête, sans dissimuler ses intentions, à édifier l’histoire future sur l’égoïsme, on exige seulement que ce soit un égoïsme sage, un égoïsme qui s’impose quelques restrictions pour jeter des bases solides, un égoïsme qui étudie l’histoire précisément pour apprendre à connaître l’égoïsme peu sage. Cette étude a permis d’apprendre qu’à l’État incombe une mission toute particulière dans ce système universel de l’égoïsme qui est à fonder. L’État doit devenir le patron de tous les égoïsmes salués, pour protéger ceux-ci, par sa puissance militaire et policière, contre les excès de l’égoïsme peu sage. C’est pour réaliser le même but que l’histoire — sous forme d’histoire des hommes et d’histoire des animaux — est introduite soigneusement dans les couches populaires et dans les masses ouvrières, lesquelles sont dangereuses parce que sans raison, car l’on sait qu’un petit grain de culture historique est capable de briser les instincts et les appétits obscurs, ou de les amener dans la voie de l’égoïsme affiné. (CI2/73)
Un bon auteur, qui met réellement du cœur à son sujet, souhaite que quelqu'un vienne le réduire lui-même à néant, en exposant plus clairement le même sujet et en donnant une réponse définitive à tous les problèmes qu'il comporte. La jeune fille amoureuse souhaite d'éprouver à l'infidélité de l'aimé la fidélité dévouée de son amour. Le soldat souhaite de tomber sur le champ de bataille pour sa patrie victorieuse : car dans le triomphe de la patrie, il trouve le triomphe de son vœu suprême. La mère donne à l'enfant ce qu'elle-même se refuse, le sommeil, la meilleure nourriture, dans certaines circonstances sa santé, sa fortune. —Mais tout cela, sont-ce des états d'âme altruistes ? Ces actes de moralité sont-ils des miracles, parce que, suivant l'expression de Schopenhauer, ils sont « impossibles et cependant réels » ? N'est-il pas clair que, dans ces quatre cas, l'homme a plus d'amour pour quelque chose de soi, une idée, un désir, une créature, que pour quelque autre chose de soi, que par conséquent il sectionne son être et fait d'une partie un sacrifice à l'autre ? Est-ce quelque chose d'essentiellement différent, lorsqu'une mauvaise tête dit : « J'aime mieux être culbuté que de céder à cet homme-là un pas de mon chemin » ? – L'inclination à quelque chose (souhait, instinct, désir) se trouve dans chacun de ces quatre cas ; y céder, avec toutes les conséquences, n'est pas en tout cas chose « altruiste ». – En morale, l'homme ne se traite pas comme un individuum, mais comme un dividuum. (HTH/78-§57)
L'égoïsme n'est pas méchant, parce que l'idée du « prochain » – le mot est d'origine chrétienne et ne correspond pas à la réalité – est en nous très faible ; et nous nous sentons libres et irresponsables envers lui presque comme envers la plante et la pierre. La souffrance d'autrui est chose qui doit s'apprendre : et jamais elle ne peut être apprise pleinement. (HTH/78-§101)
un être qui serait uniquement capable d'actions pures de tout égoïsme est plus fabuleux encore que l'oiseau Phénix ; on ne peut se le représenter clairement, par la bonne raison déjà que l'idée « d'action non égoïste » à l'analyse exacte, s'évanouit dans l'air. Jamais un homme n'a fait quoi que ce soit qui fût sans rapport à lui, partant sans une nécessité intérieure (laquelle doit cependant avoir toujours sa raison dans un besoin personnel) ? Comment l'égo pourrait-il agir sans ego ? (HTH/78-§133)
Ce fait que, dans le renoncement à soi-même, et non pas seulement dans la vengeance, il y a quelque grandeur, n'a dû être appris à l'humanité que par une longue accoutumance; une divinité qui s'offre elle-même en sacrifice fut le symbole le plus fort, le plus efficace de cette sorte de grandeur. C'est comme la victoire sur l'ennemi le plus difficile à vaincre, comme le soudain assujettissement d'une passion – c'est comme tel qu'apparaît ce renoncement : et c'est ainsi qu'il passe pour le comble de la moralité. En réalité, il s'agit là de la confusion d'une idée avec l'autre, la conscience gardant sa même élévation, son même équilibre. Des hommes de sang-froid, en repos à l'égard de la passion, ne comprennent plus la moralité de ces moments-là, mais l'admiration de tous ceux qui les ont vécus en même temps leur prête un appui; l'orgueil est leur consolation lorsque la passion et l'intelligence de leur acte s'affaiblissent. Ainsi : au fond, même ces actes de renoncement à soi-même ne sont pas non plus moraux, en tant qu'ils ne sont pas expressément accomplis en vue d'autrui; il vaut mieux dire qu'autrui ne donne au cœur surexcité qu'une occasion de se soulager par ce renoncement. (HTH/78-§138)
L’égoïsme apparent. – La plupart des gens, quoi qu’ils puissent penser et dire de leur « égoïsme », ne font rien, leur vie durant, pour leur ego, mais seulement pour le fantôme d’ego qui s’est formé d’eux dans l’esprit de leur entourage avant de se communiquer à eux ; – par conséquent, ils vivent tous dans une nuée d’opinions impersonnelles, d’appréciations fortuites et fictives, l’un à l’égard de l’autre, et ainsi de suite toujours l’un dans l’esprit de l’autre. Singulier monde de fantasmes qui sait se donner une apparence si raisonnable ! Cette brume d’opinions et d’habitudes grandit et vit presque indépendamment des hommes qu’elle entoure ; d’elle dépend la prodigieuse influence des jugements d’ordre général que l’on porte sur « l’homme » – tous ces hommes inconnus l’un à l’autre croient à cette chose abstraite qui s’appelle « l’homme », c’est-à-dire à une fiction ; et tout changement tenté sur cette chose abstraite par les jugements d’individualités puissantes (telles que les princes et les philosophes) fait un effet extraordinaire et insensé sur le grand nombre. – Tout cela parce que chaque individu ne sait pas opposer, dans ce grand nombre, un ego véritable, qui lui est propre et qu’il a approfondi, à la pâle fiction universelle qu’il détruirait par là même. (AUR/81-§105)
Malheur à nous si cette tendance se déchaîne ! – En admettant que la tendance au dévouement et à la sollicitude pour les autres (l’« affection sympathique ») soit doublement plus forte qu’elle ne l’est, le séjour sur la terre deviendrait intolérable. Que l’on songe seulement aux sottises que commet chacun, tous les jours et à toute heure, par dévouement et par sollicitude pour lui-même, et quel insupportable spectacle il offre alors : que serait-ce si nous devenions, pour les autres, l’objet de ces sottises et de ces importunités, dont, jusqu’à présent, ils se sont seulement frappés eux-mêmes ! Ne faudrait-il pas alors prendre aveuglément la fuite, dès qu’un « prochain » s’approcherait de nous ? Et accabler l’affection sympathique des mêmes paroles injurieuses dont nous couvrons aujourd’hui l’égoïsme ? (AUR/81-§143)
Cause de l’« altruisme ». – Les hommes ont en somme parlé de l’amour avec tant d’emphase et d’adoration parce qu’ils n’en ont jamais trouvé beaucoup et qu’ils ne pouvaient jamais se rassasier de cette nourriture : c’est ainsi qu’elle finit par devenir pour eux « nourriture divine ». Si un poète voulait montrer l’image réalisée de l’utopie de l’universel amour des hommes, certainement il lui faudrait décrire un état atroce et ridicule dont jamais on ne vit l’équivalent sur la terre, – chacun serait harcelé, importuné et désiré, non par un seul homme aimant, comme cela arrive maintenant, mais par des milliers, et même par tout le monde, grâce à une tendance irrésistible que l’on insultera alors, que l’on maudira autant que l’a fait l’humanité ancienne avec l’égoïsme ; et les poètes de cet état nouveau, si on leur laisse le temps de composer des œuvres, ne rêveront que du passé bienheureux et sans amour, du divin égoïsme, de la solitude qui jadis était encore possible sur la terre, de la tranquillité, de l’état d’antipathie, de haine, de mépris, et quels que soient les noms que l’on veuille donner à l’infamie de la chère animalité, où nous vivons. (AUR/81-§147)
Se sacrifier avec enthousiasme », « s'offrir soi-même en holocauste » — telles sont les phrases clés de votre morale, et je crois volontiers que, comme vous le dites, vous « êtes de bonne foi » : seulement je vous connais mieux que vous ne vous connaissez, si votre honnêteté peut se promener bras dessus, bras dessous avec une telle morale. De toute sa hauteur, vous regardez avec condescendance cette autre morale terre à terre qui exige maîtrise de soi, sévérité, obéissance, il vous arrive même de la qualifier d'égoïste, et assurément ! — vous êtes sincères avec vous-mêmes en vous en offusquant, — elle doit vous déplaire ! Car tout en vous sacrifiant avec enthousiasme et en vous immolant vous-mêmes, vous jouissez de l'ivresse que procure la pensée de ne plus faire qu'un, désormais, avec le puissant, fût-il dieu ou homme, auquel vous vous consacrez : vous êtes enivrés du sentiment de sa puissance que vient de confirmer un nouveau sacrifice. En vérité vous vous sacrifiez seulement en apparence, car par la pensée vous vous métamorphosez plutôt en dieux, et vous jouissez de vous-mêmes comme si vous étiez des dieux. (AUR/81-§215)
C’est le véritable égoïsme idéaliste de toujours avoir soin, de veiller et de tenir l’âme en repos, pour que notre fécondité aboutisse avec succès. Ainsi nous veillons et nous prenons soin, d’une façon indirecte, pour le bien de tous ; et l’état d’esprit où nous vivons, cet état d’esprit altier et doux est une huile qui se répand au loin autour de nous, même sur les âmes inquiètes. — Mais les femmes enceintes sont bizarres ! Soyons donc comme elles bizarres et ne reprochons pas aux autres de devoir l’être aussi ! Et même si cela tourne au pire et devient dangereux : dans notre vénération devant tout ce qui devient ne demeurons pas en reste sur la justice terrestre qui ne permet pas à un juge ou à un bourreau de porter la main sur une femme enceinte ! (AUR/81-§552)
Le « prochain » fait l'éloge du désintéressement parce qu'il en tire profit ! Si le prochain pensait lui-même de manière « désintéressée », il rejetterait cette destruction de force, ce dommage subi à son profit à lui, il travaillerait à empêcher l'émergence de telles inclinations et surtout il témoignerait de son propre désintéressement en ne les qualifiant pas de bonnes ! — Voilà qui indique la contradiction fondamentale de la morale qui est justement tenue en grand honneur aujourd'hui : les motivations de cette morale sont en contradiction avec son principe !
Le principe « tu dois renoncer à toi-même et te sacrifier », pour ne pas contredire à sa propre morale, ne pourrait être légitimement décrété que par un être qui par là renoncerait lui-même à son propre avantage et causerait peut-être, en exigeant le sacrifice des individus, sa propre perte. Mais dès que le prochain (ou la société) recommande l'altruisme pour raison d'utilité, c'est le principe exactement opposé, « tu dois chercher ton avantage aux dépens de tout autre » qui est mis en application, et l'on prêche donc d'un seul souffle un « tu dois » et « tu ne dois pas » ! (LGS/82-§21)
Il y a dans la générosité le même degré d'égoïsme que dans la vengeance, mais cet égoïsme est d'une autre qualité. (LGS/82-§49)
Tandis que nous ressentons la loi et l'ordonnance comme une contrainte et un dommage, on considérait autrefois l'égoïsme comme une chose pénible, comme un véritable mal. Être soi-même, s'évaluer soi-même d'après ses propres mesures et ses propres poids — cela passait alors pour inconvenant. Un penchant que l'on aurait manifesté dans ce sens aurait passé pour de la folie : car toute misère et toute crainte était liée à la solitude. (LGS/82-§117)
Pas d'altruisme ! — Je remarque chez beaucoup d'êtres un excédent de force et un plaisir à vouloir être fonction ; ils ont le flair le plus subtil pour les positions où c'est précisément eux qui peuvent être fonctions et ils s'empressent de les occuper. Certaines femmes font partie de ces êtres, ce sont celles qui s'identifient avec la fonction d'un homme, une fonction mal développée, et qui deviennent ainsi sa politique, sa bourse, ou sa sociabilité. De pareils êtres se conservent le mieux lorsqu'ils s'implantent dans un organisme étranger ; si cela ne leur réussit pas ils s'irritent, s'aigrissent et finissent par se dévorer eux-mêmes. (LGS/82-§119)
L'égoïsme est la loi perspectiviste de la sensation en vertu de laquelle ce qui est le plus proche apparaît grand et lourd : tandis qu'avec la distance toutes les choses perdent de leur grandeur et de leurs poids. (LGS/82-§162)
Certainement la réprobation de l'égoïsme, croyance prêchée avec tant d'opiniâtreté et de conviction, a en somme nui à l'égoïsme (au bénéfice des instincts de troupeau, comme je le répéterai mille fois !) surtout par le fait qu'elle lui a enlevé la bonne conscience, enseignant à chercher dans l'égoïsme la véritable source de tous les maux. « La recherche de ton propre intérêt est le malheur de ta vie » - voilà ce qui fut prêché pendant des milliers d'années : cela fit beaucoup de mal à l'égoïsme et lui prit beaucoup d'esprit, beaucoup de sérénité, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de beauté, il fut abêti, enlaidi, envenimé ! L'Antiquité philosophique enseigna par contre une autre source principale du mal : depuis Socrate les penseurs ne se sont pas lassés de prêcher : « Votre étourderie et votre bêtise, la douceur de votre vie régulière, votre subordination à l'opinion du voisin, voilà les raisons qui vous empêchent si souvent d'arriver au bonheur, - nous autres penseurs nous sommes les plus heureux parce que nous sommes des penseurs. » Ne décidons pas ici si ce sermon contre la bêtise a de meilleures raisons en sa faveur que cet autre sermon contre l'égoïsme; une seule chose est certaine, c'est qu'il a enlevé à la bêtise sa bonne conscience : - ces philosophes ont nui à la bêtise. (LGS/82-§328)
Comment ? Tu admires l'impératif catégorique en toi ? Cette fermeté de ce que tu appelles ton jugement moral? Ce sentiment « absolu » que « tout le monde porte en ce cas le même jugement que toi »? Admire plutôt ton égoïsme ! Et l'aveuglement, la petitesse et la modestie de ton égoïsme ! Car c'est de l'égoïsme de considérer son propre jugement comme une loi générale; un égoïsme aveugle, mesquin et modeste, d'autre part, puisqu'il révèle que tu ne t'es pas encore découvert toi-même, que tu n'as pas encore créé, à ton usage, un idéal propre, qui n'appartiendrait qu'à toi seul : - car cet idéal ne pourrait jamais être celui d'un autre, et, encore moins celui de tous ! (LGS/82-§335)
Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner.
Et celui qui glorifie le Moi et qui sanctifie l’égoïsme, celui-là en vérité dit ce qu’il sait, le devine « Voici, il vient, il s’approche, le grand midi ! » (APZ/83-85-p3)
Quand on entend l'éloge aujourd'hui si universel de l'homme « désintéressé », il convient de prendre conscience, et peut-être n'est-ce pas sans danger, de ce qui suscite l'intérêt du peuple, de ce qui préoccupe profondément, dans son être même, l'individu ordinaire, y compris les gens cultivés, les savants et peu s'en faut les philosophes, si les apparences ne trompent pas. Ce concert d'éloges provient de ce que la très grande majorité des choses qui intéressent et exaltent les goûts raffinés, exigeants, ainsi que toute nature supérieure, semblent totalement « inintéressantes » à l'homme moyen ; s'il remarque qu'on s'y dévoue néanmoins, il nomme ce dévouement étonne qu'on puisse agir de cette manière. Il y eut même des philosophes qui prêtèrent à cet étonnement une expression spécieuse et mystique en le rattachant à quelque aspiration supraterrestre (faute, peut-être, de savoir par eux-mêmes ce qu'est une nature supérieure?), au lieu d'établir nuement cette vérité très simple : que l'action « désintéressée » est en réalité très intéressante et intéressée, étant admis que... «Et l'amour ?» — Quoi ! Même l'amour devrait agir « sans égoïsme »? Imbéciles ! ... — « Et le sacrifice ? » Mais celui qui a vraiment fait un sacrifice sait qu'il demandait quelque chose en retour et qu'il l'a obtenu : peut-être a-t-il sacrifié une partie de lui-même à une autre partie de lui-même, peut-être a-t-il sacrifié sur tel point pour posséder davantage sur tel autre, pour être davantage ou tout au moins se sentir grandi. Mais c'est là un champ de questions et de réponses auquel un esprit comblé ne s'arrête pas volontiers, tant la vérité, en cette matière, doit étouffer un bâillement quand on la contraint à répondre. Après tout elle est femme; gardons-nous de lui faire violence. (PDBM/86-§220)
« Il m'arrive, disait un moraliste pédant et vétilleux, d'honorer et de respecter un homme désintéressé, non pas à cause de son désintéressement, mais parce qu'il me semble avoir le droit de se rendre utile à autrui à ses propres dépens. En un mot, il s'agit de savoir qui sert et qui est servi. » [..] Toute morale altruiste, qui se donne pour absolue et prétend s'appliquer à chacun, ne pèche pas seulement contre le goût : elle incite au péché de négligence, elle constitue une aberration de plus qui se couvre du masque de l'altruisme, car elle lèse les esprits supérieurs, exceptionnels, privilégiés. (PDBM/86-§221)
Au risque de scandaliser les oreilles naïves, je pose en fait que l'égoïsme appartient à l'essence des âmes nobles ; j'entends affirmer cette croyance immuable qu'à un être tel que « nous sommes » d'autres êtres doivent être soumis, d'autres êtres doivent êtres sacrifiés. L'âme noble accepte l'existence de son égoïsme sans avoir de scrupule, et aussi sans éprouver un sentiment de dureté, de contrainte, de caprice, mais plutôt comme quelque chose qui doit avoir sa raison d'être dans la loi fondamentale des choses. Si elle voulait donner un nom à cet état de fait elle dirait : « C'est la justice même. » Elle s'avoue, dans les circonstances qui d'abord la font h@?siter, qu'il y a des êtres dont les droits sont égaux au siens, dès qu'elle a résolu cette question du rang, elle se comporte envers ses égaux, privilégiés comme elle, avec le même tact dans la pudeur et le respect délicat que dans son commerce avec elle-même, - conformément à un mécanisme céleste qu'elle connait de naissance comme toutes les étoiles. C'est encore un signe de son égoïsme, que cette délicatesse et cette circonspection dans ses rapports avec ses semblables. Chaque étoile est animé de cette égoïsme : elle s'honore elle-même dans les autres étoiles et dans les droits qu'elle leur abandonne ; elle ne doute pas que cet échange d'honneurs et de droits, comme l'essence de tout commerce, n'appartiennent aussi à l'état naturel des choses. L'âme noble prend comme elle donne, par un instinct d'équité passionné et violent qu'elle a au fond d'elle-même. Le concept « grâce » n'a pas de sens, n'est pas un bonne odeur inter pares ; il peut y avoir une manière sublime de laisser sur soi les bienfaits d'en haut et de les boire avidement comme des gouttes de rosée, mais un âme noble n'est pas né pour cet art et pour cette attitude. Son égoïsme ici fait obstacle : elle ne regarde pas volontiers « en haut », mais plutôt devant elle, lentement et en ligne droite, ou vers en bas : - elle sait qu'elle est à la hauteur. (PDBM/86-§265)
il y a une chose que l’on saura dorénavant, j’en suis certain —, la qualité de la volupté qu’éprouve de tout temps celui qui pratique le désintéressement, l’abnégation, le sacrifice de soi, cette volupté est de la même essence que la cruauté. (GM/87-dd§18)
L’amour de soi ne vaut que par la valeur physiologique de celui qui le pratique : il peut valoir beaucoup, il peut être indigne et méprisable. Chaque individu peut être estimé suivant qu’il représente la ligne ascendante ou descendante de la vie. En jugeant l’homme de cette façon on obtient aussi le canon qui détermine la valeur de son égoïsme. S’il représente la ligne ascendante, sa valeur est effectivement extraordinaire, — dans l’intérêt de la vie totale qui avec lui fait un pas en avant, le souci de conservation, de créer son optimum de conditions vitales doit être lui-même extrême. L’homme isolé, l’ « individu », tel que le peuple et les philosophes l’ont entendu jusqu’ici, est une erreur : il n’est rien en soi, il n’est pas un atome, un « anneau de la chaîne », un héritage laissé par le passé, — il est toute l’unique lignée de l’homme jusqu’à lui-même... S’il représente l’évolution descendante, la ruine, la dégénérescence chronique, la maladie (— les maladies, en général, sont déjà des symptômes de dégénération, elles n’en sont pas la cause), sa part de valeur est bien faible, et la simple équité veut qu’il empiète le moins possible sur les hommes aux constitutions parfaites. Il n’est plus autre chose que leur parasite... (LCI/88-9§33)
Une morale « altruiste », une morale où s’étiole l’amour de soi — est, de toute façon, un mauvais signe. Cela est vrai des individus, cela est vrai, avant tout, des peuples. Le meilleur fait défaut quand l’égoïsme commence à faire défaut. (LCI/88-9§35)
AMBITION
L'ambition, succédané du sens moral. – Le sens moral peut ne pas faire défaut dans des natures qui n'ont pas d'ambition. Les ambitieux s'arrangent de leur côté sans lui, presque avec le même résultat. – C'est pourquoi les fils de familles modestes, qui répugnent à l'ambition, s'ils viennent à perdre le sens moral, deviennent d'ordinaire, par un progrès rapide, des chenapans finis. (HTH/78-§78)
L'un a, pour bien parler, besoin de quelqu'un qui lui soit décidément et notoirement supérieur, l'autre ne peut trouver que devant quelqu'un qu'il domine une pleine liberté de parole et d'heureux tours d'élocution : dans les deux cas, la raison est la même; chacun d'eux ne parle bien que quand il parle sans gêne, l'un parce que devant son supérieur il ne sent pas l'aiguillon de la concurrence, de la rivalité, l'autre parce qu'il est dans le même cas devant l'inférieur. – Maintenant, il est une tout autre espèce d'hommes, qui ne parlent bien que s'ils parlent dans l'émulation, avec l'intention de vaincre. Laquelle des deux espèces est la plus ambitieuse, celle qui parle bien quand s'éveille son ambition, ou celle qui, pour le même motif, parle mal ou pas du tout ? (HTH/78-§367)
Tant qu'un homme n'est pas devenu l'instrument de l'intérêt général des hommes, l'ambition peut le tourmenter; mais si son but est atteint, s'il travaille par nécessité comme une machine pour le bien de tous, la vanité peut alors venir; elle l'humanisera en détail, le rendra plus sociable, plus supportable, plus indulgent, alors que l'ambition a achevé en lui le gros oeuvre (le rendre utile). (HTH/78-§593)
Il y a une ambition du poste perdu qui presse un parti à s'aventurer dans un danger extrême. (OSM/79-§312)
Dans le grand art de servir une des tâches les plus subtiles c'est de servir un ambitieux effréné qui, s'il est en toutes choses l'égoïste le plus fieffé, ne veut à aucun prix passer pour tel (c'est là justement une partie de son ambition), qui exige que tout soit fait selon sa volonté et son humeur, et pourtant toujours de façon qu'il ait l'air de se sacrifier et de vouloir rarement quelque chose pour lui-même. (AUR/81-§295)
ÂME
Il y a des âmes serviles qui poussent si loin la reconnaissance des services rendus qu'elles s'étranglent elles-mêmes avec le lacet de la gratitude. (HTH/78-§550)
Si nous voulions, si nous osions construire une architecture conforme à la nature de notre âme (nous sommes trop lâches pour cela !) – le labyrinthe devrait être notre modèle ! (AUR/81-§169)
J’ai en horreur les âmes étriquées ; Là, rien de bon, et presque rien de mauvais. (LGS/82-Prél.§18)
J’aime celui dont l’âme se dépense, celui qui ne veut pas qu’on lui dise merci et qui ne restitue point : car il donne toujours et ne veut point se conserver.
J’aime celui dont l’âme est profonde, même dans la blessure, celui qu’une petite aventure peut faire périr : car ainsi, sans hésitation, il passera le pont.
Jadis l’âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n’était plus haut que ce dédain : elle le voulait maigre, hideux, affamé ! C’est ainsi qu’elle pensait lui échapper, à lui et à la terre !
Je ne suis plus en communion d’âme avec vous. Cette nuée que je vois au-dessous de moi, cette noirceur et cette lourdeur dont je ris – c’est votre nuée d’orage. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l’élévation. Et moi je regarde en bas puisque je suis élevé.
Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d’étoiles. Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. (APZ/83-85-p1)
Il fait nuit : voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes : et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante.
Le « salut de l'âme », traduisez : « c'est moi qui suis le centre de l'univers »... Le poison de la doctrine des « droits égaux pour tous », — c'est le christianisme qui l'a répandu le plus systématiquement. De tous les recoins les plus dissimulés des mauvais instincts, le christianisme déclare une guerre à outrance à tout sentiment de respect et de distance entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire à la seule condition qui permette à la culture de s'élever et de s'épanouir. (ANT/88-§43)
Il faut de la grandeur d’âme pour ne serait-ce que supporter mes écrits. J’ai la chance d’irriter contre moi tout ce qui est faible et vertueux. (DL/88-MVM)
AMI - AMITIÉ
Le manque d'abandon entre amis est une faute qui ne peut être reprise sans devenir irrémédiable. (HTH/78-§296)
Bien souvent, dans nos relations avec un autre homme, le retour au juste équilibre de l'amitié se fait si nous ajoutons dans notre plateau quelques grains de tort. (HTH/78-§305)
Le partage des joies, non des souffrances, fait l'ami. (HTH/78-§499)
On souhaite plutôt avoir pour ennemi l'ami dont on ne peut pas satisfaire les espérances. (AUR/81-§313)
Plutôt une amitié d’une seule pièce,
Il y a bien çà et là sur terre une espèce de prolongement de l'amour dans lequel cette aspiration avide qu'éprouvent deux personnes l'une pour l'autre fait place à un désir et à une convoitise nouvelle, à une soif supérieure et commune d'idéal qui les dépasse : mais qui connaît cet amour ? Qui l'a vécu ? Son véritable nom est amitié. (LGS/82-§14)
Tu ne veux pas dissimuler devant ton ami ? Tu veux faire honneur à ton ami en te donnant tel que tu es ? Mais c’est pourquoi il t’envoie au diable !
L’ami doit être passé maître dans la divination et dans le silence : tu ne dois pas vouloir tout voir. Ton rêve doit te révéler ce que fait ton ami quand il est éveillé.
La femme n’est pas encore capable d’amitié. Des chattes, voilà ce que sont toujours les femmes, des chattes et des oiseaux. Ou, quand cela va bien, des vaches.
… si tu as un ami qui souffre, sois un asile pour sa souffrance, mais sois en quelque sorte un lit dur, un lit de camp : c’est ainsi que tu lui seras le plus utile. (APZ/83-85-p2)
AMOR FATI
Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau : je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati : que ce soit dorénavant mon amour ! Je ne veux pas faire la guerre au laid. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation ! Et somme toute, en grand : je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit oui ! (LGS/82-§276)
Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati. Il ne faut rien demander d'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, pour toute éternité. Il faut non seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins le cacher — tout idéalisme c'est le mensonge devant la nécessité — il faut aussi l'aimer... (EH/88-2§10)
Une philosophie expérimentale telle que celle que je vis anticipe même, à titre d'essai, sur les possibilités du nihilisme radical : ce qui ne veut pas dire qu'elle en reste à un "non", à une négation, à une volonté de nier. Bien au contraire, elle veut parvenir à l'inverse — à un acquiescement dionysiaque au monde tel qu'il est, sans rien en ôter, en excepter, en sélectionner — elle veut le cycle éternel — les mêmes choses, la même logique et non-logique des nœuds. État le plus haut qu'un philosophe puisse atteindre : avoir envers l'existence une attitude dionysiaque : ma formule pour cela est amor fati... (FP/88-v14)
ANIMAL
Peut-être toute l'humanité n'est-elle qu'une phase de l'évolution d'une espèce déterminée d'animaux à durée limitée : en sorte que l'homme est venu du singe et doit redevenir singe, cependant qu'il n'y a personne pour prendre quelque intérêt à ce bizarre dénouement de comédie. De même que, par la ruine de la civilisation romaine et sa cause la plus importante, l'expansion du christianisme, un enlaidissement général de l'homme triompha dans l'empire romain, de même aussi, par la ruine éventuelle de la civilisation terrestre dans son ensemble, pourrait être amené un enlaidissement bien plus grand et enfin un abêtissement de l'homme jusqu'à la nature simiesque. — Précisément parce que nous pouvons embrasser du regard cette perspective, nous sommes en état peut-être de prévenir une telle conclusion de l'avenir. (HTH/78-§247)
Le serpent qui nous mord croit nous faire du mal et s'en réjouit; l'animal le plus bas peut imaginer la douleur d'autrui. Mais imaginer la joie d'autrui et s'en réjouir, c'est là le plus grand privilège des animaux supérieurs, et, parmi ceux-ci, il n'y a que les exemplaires les plus choisis qui y soient accessibles, — c'est-à-dire un humanum rare : en sorte qu'il y a eu des philosophes qui ont nié la joie partagée. (OSM/79-§62)
Ce ne sont que les animaux les mieux organisés et les plus actifs qui commencent à être capables d'ennui. — Quel beau sujet pour un grand poète que l'ennui de Dieu au septième jour de la création. (LVO/79-§56)
La colère et la punition nous ont été léguées par l'espèce animale. L'homme ne s'émancipera qu'en rendant aux animaux ce cadeau de baptême. — Il y a là cachée une des plus grandes idées que les hommes puissent avoir, l'idée d'un progrès unique parmi tous les progrès. (LVO/79-§183)
(Les touristes) : Ils gravissent la montagne comme des animaux, bêtement et ruisselant de sueur ; on a oublié de leur dire qu'il y a en chemin de beaux points de vue. (LVO/79-§202)
On a mis beaucoup de chaînes à l'homme pour qu'il désapprenne de se comporter comme un animal : et, en vérité, il est devenu plus doux, plus spirituel, plus joyeux, plus réfléchi que ne sont tous les animaux. Mais dès lors il souffre encore d'avoir manqué si longtemps d'air pur et de mouvements libres : — ces chaînes cependant, je le répète encore et toujours, ce sont ces erreurs lourdes et significatives des représentations morales, religieuses et métaphysiques. C'est seulement quand la maladie des chaînes sera surmontée que le premier grand but sera entièrement atteint : la séparation de l'homme et de l'animal. (LVO/79-§350)
On peut observer la formation de la morale dans la façon dont nous nous comportons vis-à-vis des animaux. Lorsque l'utilité et le dommage n'entrent pas en jeu, nous éprouvons un sentiment de complète irresponsabilité; nous tuons et nous blessons par exemple des insectes ou bien nous les laissons vivre sans généralement y songer le moins du monde. Nous avons la main si lourde que nos gentillesses à l'égard des fleurs et des petits animaux sont presque toujours meurtrières : ce qui ne gêne nullement le plaisir que nous y prenons. – C'est aujourd'hui la fête des petits animaux, le jour le plus accablant de l'année : voyez comme tout cela grouille et rampe autour de nous, et, sans le faire exprès, mais aussi sans y prendre garde, nous écrasons tantôt par ici, tantôt par là un petit ver ou un petit insecte empenné. – Quand les animaux nous portent préjudice nous aspirons par tous les moyens à leur destruction ; et ces moyens sont souvent bien cruels, sans que ce soit là notre intention : c'est la cruauté de l'irréflexion. Si, par contre, ils sont utiles, nous les exploitons : jusqu'à ce qu'une raison plus subtile nous enseigne que chez certains animaux nous pouvons tirer bénéfice d'un autre traitement, c'est-à-dire des soins et de l'élevage. C'est alors seulement qu'apparaît la responsabilité. On évite de tourmenter l'animal domestique; un homme se révolte lorsqu'il voit quelqu'un se montrer impitoyable envers sa vache, en conformité absolue avec la morale de la communauté primitive qui voit l'utilité générale en danger dès qu'un individu la transgresse. Celui qui, dans la communauté, s'aperçoit d'un délit craint pour lui le dommage indirect : et nous craignons pour la qualité de la viande, de l'agriculture, des moyens de communication lorsque nous voyons maltraiter les animaux. De plus, celui qui est brutal envers les animaux éveille le soupçon qu'il est également brutal vis-à-vis des faibles, des hommes inférieurs et incapables de vengeance; il passe pour manquer de noblesse et de fierté délicate. C'est ainsi que se forme un commencement de jugement et de sens moral : la superstition y ajoute la meilleure part. Certains animaux incitent l'homme par des regards, des sons et des attitudes à se voir transporté en imagination dans le corps de ceux-ci, et certaines religions enseignent à voir parfois dans l'animal le séjour des âmes des hommes et des dieux : c'est pourquoi elles recommandent de nobles précautions et même une crainte respectueuse dans les rapports avec les animaux. Lors même que cette superstition aurait disparu, les sentiments éveillés par elle continuent leurs effets, mûrissent et portent leurs fruits. On sait qu'à ce point de vue le christianisme a montré qu'il est une religion pauvre et rétrograde. (LVO/79-§57)
Les pratiques que l'on exige dans la société raffinée, éviter avec précaution tout ce qui est ridicule, bizarre, prétentieux, réfréner ses vertus tout aussi bien que ses désirs violents, se montrer semblable aux autres, se soumettre à des règles, s'amoindrir, — tout cela, en tant que morale sociale, se retrouve jusqu'à l'échelle la plus basse de l'espèce animale, — et ce n'est qu'à ce degré inférieur que nous voyons les idées de derrière la tête de toutes ces aimables réglementations : on veut échapper à ses poursuivants et être favorisé dans la recherche de sa proie. C'est pourquoi les animaux apprennent à se dominer et à se déguiser au point que certains d'entre eux parviennent à assimiler leur couleur à celle de leur entourage (en vertu de ce que l'on appelle la « fonction chromatique »), à simuler la mort, à adopter les formes et les couleurs d'autres animaux, ou encore l'aspect du sable, des feuilles, des lichens ou des éponges (ce que les naturalistes anglais appellent mimicry). C'est ainsi que l'individu se cache sous l'universalité du terme générique « homme » ou parmi la « société », ou bien encore s'adapte et s'assimile aux princes, aux castes, aux partis, aux opinions de son temps ou de son milieu : et à toutes nos façons subtiles de nous faire passer pour heureux, reconnaissants, puissants, amoureux, on trouvera facilement l'équivalent animal. Le sens de la vérité lui aussi, qui, au fond, n'est pas autre chose que le sens de la sécurité, l'homme l'a en commun avec l'animal : on ne veut pas se laisser tromper, se laisser égarer par soi-même, on écoute avec méfiance les encouragements de ses propres passions, on se domine et l'on demeure méfiant à l'égard de soi-même ; tout cela, l'animal l'entend à l'égal de l'homme ; chez lui aussi la domination de soi tire son origine du sens de la réalité (de l'intelligence). De même l'animal observe les effets qu'il exerce sur l'imagination des autres animaux, il apprend à faire ainsi un retour sur lui-même, à se considérer « objectivement », lui aussi, à posséder, en une certaine mesure, la connaissance de soi. L'animal juge des mouvements de ses adversaires et de ses amis, il apprend par cœur leurs particularités : contre les représentants d'une certaine espèce il renonce, une fois pour toutes, à la lutte, et de même il devine, à l'approche de certaines variétés d'animaux, les intentions pacifiques et conciliantes. Les origines de la justice, comme celles de l'intelligence, de la modération, de la bravoure, — en un mot de tout ce que nous désignons sous le nom de vertus socratiques — sont animales : ces vertus sont une conséquence de ces instincts qui enseignent à chercher la nourriture et à échapper aux ennemis. Si nous considérons donc que l'homme supérieur n'a fait que s'élever et s'affiner dans la qualité de sa nourriture et dans l'idée de ce qu'il considère comme opposé à sa nature, il ne sera pas interdit de qualifier d'animal le phénomène moral tout entier. (AUR/81-§26)
La fierté de l’homme qui se rebiffe contre la thèse de son ascendance animale et qui établit entre la nature et l’homme un grand abîme — cette fierté trouve sa raison dans un préjugé sur la nature de l’esprit, et ce préjugé est relativement récent. Durant la longue période préhistorique de l’humanité, on supposait que l’esprit était partout et l’on ne songeait pas du tout à le vénérer comme une prérogative de l’homme. Parce que l’on considérait au contraire le spirituel (ainsi que tous les instincts, les malices, les penchants) comme appartenant à tout le monde, comme étant, par conséquent, d’essence vulgaire, on n’avait pas honte de descendre d’animaux ou d’arbres (les races nobles se croyaient honorées par de pareilles légendes), l’on voyait dans l’esprit ce qui nous unit à la nature et non ce qui nous sépare d’elle. Ainsi on était élevé dans la modestie — et c’était aussi par suite d’un préjugé. (AUR/81-§31)
Le nouveau sentiment fondamental : notre nature définitivement périssable. — Autrefois, on cherchait à éveiller le sentiment de la souveraineté de l’homme en montrant son origine divine : ceci est devenu maintenant un chemin interdit, car à sa porte se dresse le singe, avec quelque autre gent animale effroyable : — il grince des dents, comme si il voulait dire : pas un pas de plus dans cette direction ! (AUR/81-§49)
Dès qu'un animal en voit un autre il se mesure en esprit avec lui, et les hommes des époques sauvages font de même. Il s'ensuit que presque chaque homme n'apprend à se connaître que par rapport à sa force d'attaque et de défense. (AUR/81-§212)
Si ce que l'on affirme maintenant expressément est vrai, qu'il ne faut pas chercher dans la lumière la cause du pigment noir de la peau : ce phénomène pourrait peut-être rester le dernier effet de fréquents accès de rage accumulés pendant des siècles (et d'afflux de sang sous la peau) ? Tandis que, chez d'autres races plus intelligentes, le phénomène de pâleur et de frayeur, tout aussi fréquent, aurait fini par produire la couleur blanche de la peau ? - Car le degré de crainte est une mesure de l'intelligence : et le fait de s'abandonner souvent à une colère aveugle est le signe que l'animalité est encore toute proche et voudrait de nouveau prévaloir, - gris-brun, ce serait peut-être là la couleur primitive de l'homme, - quelque chose qui tient du singe et de l'ours, comme de juste. (AUR/81-§241)
Pourquoi si sublime ! - Hélas, vous connaissez cette gent animale ! Il est vrai qu'elle se plaît mieux à elle-même lorsqu'elle s'avance sur deux jambes « comme un Dieu », - mais quand elle est retombée sur ses quatre pattes, c'est à moi qu'elle plaît mieux : cela lui est si incomparablement plus naturel ! (AUR/81-§261)
Dans les explosions de la passion et dans les délires du rêve et de la folie, l'homme reconnaît son histoire primitive et celle de l'humanité : l'animalité et ses grimaces sauvages ; alors sa mémoire retourne assez loin en arrière, tandis qu'au contraire son état civilisé s'était développé grâce à l'oubli de ces expériences originelles, c'est-à-dire au relâchement de cette mémoire. Celui qui, homme oublieux d'espèce supérieure, est toujours resté très loin de ces choses, ne comprend pas les hommes, - mais c'est un avantage si, de temps en temps, il y a des individus qui « ne les comprennent pas », des individus engendrés en quelque sorte par la semence divine et mis au monde par la raison. (AUR/81-§312)
Nous ne considérons pas les animaux comme des êtres moraux. Mais pensez-vous donc que les animaux nous tiennent pour des êtres moraux? - Un animal qui savait parler a dit: « L'humanité est un préjugé dont nous autres animaux, au moins, nous ne souffrons pas. » (AUR/81-§333)
L'homme est devenu peu à peu un animal fantasque qui aura à remplir une condition d'existence de plus que tout autre animale : il faut que, de temps en temps, l'homme se figure savoir pourquoi il existe, son espèce ne peut pas prospérer sans une confiance périodique en la vie ! (LGS/82-§1)
Pour vous prouver que l'homme fait au fond partie des animaux gentils, je vous rappellerai à quel point il a été si longtemps crédule. C'est seulement aujourd'hui, extrêmement tard et au terme d'un formidable dépassement de soi, qu'il est devenu un animal méfiant, — oui ! L’homme est aujourd'hui plus méchant qu'il ne l'a jamais été. — C'est un point que je ne comprends pas : pourquoi donc l'homme serait-il aujourd'hui plus méfiant et plus méchant ? — « Parce qu'aujourd'hui, il a une science, — qu'il a besoin d'une science ! » (LGS/82-§33)
L'animal a son bon droit, tout comme l'homme, qu'il se meuve donc librement, et toi, mon cher frère en humanité, tu es toi-même cet animal, malgré tout ! (LGS/82-§77)
Les animaux sacrifiés ont un avis différent des spectateurs sur le sacrifice et l'immolation : mais on ne les a jamais laissés s'exprimer. (LGS/82-§220)
Je crains que les animaux ne considèrent l'homme comme un de leurs semblables qui a perdu le bon sens animal de manière extrêmement dangereuse, comme l'animal délirant, comme l'animal rieur, comme l'animal pleurnichard, comme l'animal malheureux. (LGS/82-§224)
Au prix de souffrances qui nous ont rendus froids et durs, nous avons acquis la conviction que les événements du monde n'ont rien de divin, ni même rien de raisonnable, selon les mesures humaines, rien de pitoyable et de juste ; nous le savons, le monde où nous vivons est sans Dieu, immoral, « inhumain », - trop longtemps nous lui avons donné une interprétation fausse et mensongère, apprêtée selon les désirs et la volonté de notre vénération, c'est-à-dire conformément à un besoin. Car l'homme est un animal qui vénère ! Mais il est aussi un animal méfiant, et le monde ne vaut pas ce que nous nous sommes imaginés qu'il valait, c'est peut-être là la chose la plus certaine dont notre méfiance a fini par s'emparer. Autant de méfiance, autant de philosophie. (LGS/82-§346)
L'Européen se travestit avec la morale parce qu'il est devenu un animal malade, infirme, estropié, qui a de bonnes raisons pour être « apprivoisé », puisqu'il est presque un avorton, quelque chose d'imparfait, de faible et de gauche... Ce n'est pas la férocité de la bête de proie qui éprouve le besoin d'un travestissement moral, mais la bête du troupeau, avec sa médiocrité profonde, la peur et l'ennui qu'elle se cause à elle-même. (LGS/82-§352)
Si du moins vous étiez une bête parfaite, mais pour être une bête il faut l’innocence. (APZ/83-85-p1)
L’homme a déjà pris leurs vertus à toutes les bêtes, c’est pourquoi, de tous les animaux, l’homme a eu la vie la plus dure.
Chez l’homme, comme chez toutes les autres espèces animales, se trouve un excédent d’individus manqués, malades, dégénérés, infirmes, qui souffrent nécessairement. Les cas de réussite sont toujours des exceptions, même chez l’homme, et surtout des exceptions rares, si l’on considère que l’homme est un animal dont les qualités ne sont pas encore fixées. (PDBM/86-§62)
Nous nous sommes corrigés. Nous sommes devenus en tout point plus modestes. Nous ne cherchons plus l'origine de l'homme dans l' « esprit », dans la « nature divine », nous l'avons replacé au rang des animaux. Il est pour nous l'animal le plus fort, parce qu'il est le plus rusé : l'esprit dont il est doué n'en est qu'une conséquence. Nous nous défendons par ailleurs d'une vanité qui, là aussi, pourrait se faire à nouveau indiscrète : celle de croire que l'homme serait la grande finalité secrète de l'évolution animale. Il n'est en rien le « couronnement de la création » : comparé à lui, tout être a atteint le même degré de perfection.
…l'homme est, relativement parlant, l'animal le moins réussi, le plus maladif, celui qui s'est écarté le plus dangereusement de ses instincts — et, il est vrai, malgré tout cela, le plus intéressant de tous! (ANT/88-§14)
Tout le monde sait, il y en a même qui le savent par expérience, quel est l'animal qui a de longues oreilles. Eh bien ! j'ose prétendre que j'ai les plus petites oreilles que l'on puisse voir. Cela ne manquera pas d'intéresser quelque peu les femmes. Il me semble qu'elles se sentiront mieux comprises par moi. Je suis l'anti-âne par excellence, ce qui fait de moi un monstre historique. Je suis en grec —et non pas seulement en grec — l'anti-chrétien...(EH/88-3§2)
ANTISÉMITISME
Je manque toujours et encore du plus petit désir de m’asseoir en compagnie de cet antisémite qu’est Monsieur mon beau-frère. Ses idées et les miennes sont différentes et je ne le regrette pas. (DL/87-FN)
Cher Monsieur, Je vous retourne ci-joint les trois numéros de votre Correspondenz, en vous remerciant de m'avoir permis de jeter un regard sur la confusion des principes qui règne au fondement de cet étonnant mouvement. Néanmoins, je vous prie de ne plus à l'avenir me gratifier de ces envois : je crains que ma patience finisse par céder. Croyez-moi : cette répugnante volonté, propre à de patentés dilettantes, de faire chorus en disant leur mot sur la valeur des hommes et des races, cette soumission à des « autorités » que tout esprit raisonnable rejetterait avec un froid mépris (par ex., E. Dühring, R. Wagner, Ebrard, Wahrmund, P. de Lagarde — qui parmi eux n'est pas, en matière de morale et d'histoire, le moins légitime, le plus injuste ?), ces constantes et absurdes falsifications et manipulations de notions floues telles que « germanique », « sémitique », « aryen », « chrétien », « allemand » — tout cela pourrait, à la longue, me mettre sérieusement en colère et me faire sortir de la bienveillance ironique avec laquelle j'ai, jusqu’a présent, observé les vertueux pharisaïsmes et velléités de l'actuelle Allemagne. — Et, pour finir, que croyez-vous que je ressente lorsque le nom de Zarathoustra se retrouve dans la bouche d'antisémites ?... (LC/87-TF)
C'est toi, mon pauvre lama, qui as fait une des plus grandes bêtises, et pour toi, et pour moi. Ton mariage avec un chef antisémite exprime pour toute ma façon d'être un éloignement qui m'emplit toujours de rancœur et de mélancolie. [...] Car, vois-tu bien, mon bon lama, c'est pour moi une question d'honneur que d'observer envers l'antisémitisme une attitude absolument nette et sans équivoque, savoir : celle de l'opposition, comme je le fais dans mes écrits. On m'a accablé dans les derniers temps de lettres et de feuilles antisémites; ma répulsion pour ce parti (qui n'aimerait que trop se prévaloir de mon nom !) est aussi prononcée que possible, mais ma parenté avec Förster et le contrecoup de l'antisémitisme de Schmeitzner, mon ancien éditeur, ne cessent de faire croire aux adeptes de ce désagréable parti que je dois être un des leurs. Combien cela me nuit et m'a nui, tu ne peux pas t'en faire une idée. La presse allemande étouffe mes écrits sous le silence — et c'est depuis lors, dit Overbeck. Mon abstention éveille la méfiance de tous à l'endroit de mon caractère comme si je reniais en public une chose que je favorise en secret et je ne peux rien faire pour empêcher que les feuilles antisémites utilisent le nom de "Zarathoustra" : cette impuissance m'a déjà presque rendu malade plusieurs fois » (LC/87-EN)
APHORISME - ÉCRITURE – LECTEUR - LIVRE
L'exagération disting ue tous les écrits modernes ; et même lorsqu'ils sont écrits simplement, les mots y sont encore sentis trop excentriquement. Sévère réflexion, concision, sang-froid, simplicité, poussée même volontairement jusqu'aux limites, bref quant-à-soi du sentiment et laconisme, – voilà les seuls remèdes possibles. Au reste cette manière froide d'écrire et de sentir est, à titre de contraste, très attrayante aujourd'hui : et à vrai dire, il y a là un nouveau danger. Car la froideur pénétrante est aussi bien un moyen d'excitation qu'un haut degré de chaleur. (HTH/78-§195)
Le fait d'écrire devrait toujours annoncer une victoire, une victoire remportée sur soi-même, dont il faut faire part aux autres pour leur enseignement. Mais il y a des auteurs dyspepsiques qui n'écrivent précisément que lorsqu'ils ne peuvent pas digérer quelque chose, ils commencent même parfois à écrire quand ils ont encore leur nourriture dans les dents : ils cherchent involontairement à communiquer leur mauvaise humeur au lecteur, pour lui donner du dépit et exercer ainsi un pouvoir sur lui, c'est-à-dire qu'eux aussi veulent vaincre, mais les autres. (OSM/79-§152)
Les livres et les écrits diffèrent selon les différents penseurs : l'un a rassemblé dans son livre les lumières qu'il a su ravir promptement aux rayons d'une connaissance qui s'est mise à flamboyer pour lui, et qu'il a su s'approprier; un autre ne restitue que les ombres, les images en gris et noir de ce qui s'édifiait dans son âme le jour précédent. (LGS/82-§90)
Qu'importe un livre qui ne sait même pas nous transporter au-delà de tous les livres ? (LGS/82-§247)
De tout ce qui est écrit, je n’aime que ce que l’on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit.
Il n’est pas facile de comprendre du sang étranger : je haïs tous les paresseux qui lisent.
Que chacun ait le droit d’apprendre à lire, cela gâte à la longue, non seulement l’écriture, mais encore la pensée.
Celui qui écrit en maximes avec du sang ne veut pas être lu, mais appris par cœur. (APZ/83-85-p1)
Hélas, mes pensées, qu'êtes-vous devenues, maintenant que vous voilà écrites et peintes ! Il n'y a pas longtemps, vous étiez si diaprées, si jeunes, si malignes, pleines de piquants et de secrètes épices qui me faisaient éternuer et rire — et à présent ? Déjà vous avez perdu la fleur de votre nouveauté, et quelques-unes d'entre vous, je le crains, sont en passe de devenir des vérités : elles ont déjà l'air si impérissable, si mortellement inattaquable, si ennuyeux! Et en fut-il jamais autrement ? Qu'écrivons-nous, que peignons-nous avec nos pinceaux chinois, nous autres mandarins, éterniseurs de choses qui peuvent s'écrire, que sommes-nous capables de reproduire ? Hélas, seulement ce qui va se faner et commence à s'éventer! Hélas, seulement des orages qui s'éloignent et s'épuisent, des sentiments ternes et tardifs! Hélas, seulement des oiseaux las de voler, égarés, qui se laissent prendre dans la main — dans notre main! Nous éternisons ce qui ne peut plus vivre ni voler très longtemps, des choses exténuées et trop mûres! Et ce n'est que pour votre après-midi, ô mes pensées écrites et peintes, que je possède des couleurs, beaucoup de couleurs peut-être, beaucoup de teintes délicates, cinquante jaunes, bruns, verts, rouges : mais nul, à vous voir, ne devinera votre éclat matinal, étincelles subites et merveilles de ma solitude, mes vieilles, mes chères — mes mauvaises pensées ! (PDBM/86-§296)
On ne veut pas seulement être compris, quand on écrit, mais encore, de manière tout aussi certaine, ne pas être compris. Ce n'est encore nullement une objection contre un livre, que le premier venu le trouve incompréhensible : cela entrait peut-être justement dans l'intention de son auteur, — il ne voulait pas être compris par le premier venu. Tout esprit et tout goût vraiment noble choisit aussi, lorsqu'il veut se communiquer, ses auditeurs; en les choisissant, il trace simultanément ses limites à l'égard « des autres «. Toutes les lois affinées d'un style ont là leur origine : elles maintiennent en même temps au loin, elles créent de la distance, elles interdisent « l'accès », la compréhension, comme on l'a — tandis qu'elles ouvrent les oreilles à ceux qui ont avec nous une parenté d'oreille. Et soit dit entre nous, et dans mon cas, — je ne veux pas que mon ignorance ni ma vivacité de tempérament m'empêchent d'être compréhensible pour vous, mes amis : ni ma vivacité, si fort qu'elle me contraigne à me saisir d'une chose avec rapidité, si je veux m'en saisir tout court. Car j'en use avec les problèmes profonds comme avec un bain froid — vite entré, vite ressorti. Que de la sorte on n'atteigne pas le fond, que l'on ne descende pas assez profondément, c'est la superstition de ceux qui ont peur de l'eau, des ennemis de l'eau froide ; ils parlent sans en avoir l'expérience. Oh ! le grand froid rend rapide ! (LGS/86-§381)
Un aphorisme dont la fonte et la frappe sont ce qu’elles doivent être n’est pas encore « déchiffré » parce qu’on l’a lu ; il s’en faut de beaucoup, car l’interprétation ne fait alors que commencer et il y a un art de l’interprétation. [...] Il est vrai que, pour élever ainsi la lecture à la hauteur d’un art, il faut posséder avant tout une faculté qu’on a précisément le mieux oubliée aujourd’hui — et c’est pourquoi il s’écoulera encore du temps avant que mes écrits soient « lisibles » —, d’une faculté qui exigerait presque que l’on ait la nature d’une vache et non point, en tous les cas, celle d’un « homme moderne » : j’entends la faculté de ruminer… (GM/87-pref-§8)
On me demande souvent pourquoi j’écris en allemand ; car nulle part je ne serai plus mal lu que dans ma patrie. Mais enfin qui sait si je désire être lu aujourd’hui ? — Créer des choses sur quoi le temps essaie en vain ses dents, tendre par la forme et par la substance, à une petite immortalité — je n’ai jamais été assez modeste pour exiger moins de moi. L’aphorisme, la sentence, où le premier je suis passé maître parmi les Allemands, sont les formes de « l’éternité »; mon orgueil est de dire en dix phrases ce que tout autre dit en un volume, — ce qu’un autre ne dit pas en un volume... (LCI/88-9§51)
Il me semble que c'est un des plus rares hommages que quelqu'un puisse se rendre à lui-même que de prendre en main un de mes livres. J'admets même qu'il se déchausse, ou peut-être ira-t-il encore jusqu'à ôter ses bottes. Un jour le docteur Henri de Stein se plaignit loyalement à moi de ne pas comprendre un mot à mon Zarathoustra. Je lui répondis que c'était tout à fait dans les règles : En comprendre six phrases, ce qui veut dire les avoir vécues, cela suffirait à vous élever parmi les mortels à un degré supérieur à celui que les hommes « modernes » pourraient atteindre. Comment, avec un pareil sentiment de la distance, pourrais-je seulement souhaiter d'être lu par les « modernes » que je connais !
Bref, personne ne peut trouver dans les choses, sans en excepter les livres, plus qu'il n'en sait déjà. On ne saurait entendre exactement ce à quoi des événements antérieurs ne vous donnent point accès. Imaginons dès lors un cas extrême : qu'un livre ne parle que d'événements qui se trouvent complètement en dehors des possibilités qui se présentent fréquemment, ou même rarement seulement, dans la vie de quelqu'un ; que c'est la première fois que le livre en question parle un langage qui prépare une série de possibilité nouvelles. Dans ce cas, il se produit un phénomène extrêmement simple: on n'entend rien de ce que dit l'auteur et l'on a l'illusion de croire que là où l'on n'entend rien il n'y a rien... C'est l'expérience que j'ai faite dans la plupart des cas et c'est, si l'on veut, ce que mon expérience personnelle présente d'original. Celui qui croit avoir compris quelque chose dans mon œuvre s'en fait une idée à sa propre image, une idée qui, le plus souvent, est en contradiction absolue avec moi-même. On fait de moi, par exemple, un « idéaliste ». Quand on n'a rien compris du tout, on se contente de nier ma valeur, on dit que je n'entre pas en ligne de compte.
Je connais quelque peu mes privilèges, en tant qu'écrivain. Dans des cas déterminés, je me suis aperçu à quel point le goût se « corrompt » au contact de mes écrits. On en arrive à ne plus pouvoir supporter d'autres livres, les livres philosophiques moins que tous les autres.
On m'a dit qu'il n'était pas possible de laisser inachevé un de mes livres, je trouble même le repos de la nuit. Il n'existe nulle part une espèce de livres plus fière et plus raffinée tout à la fois. Ils atteignent çà et là le maximum de ce qui peut être atteint sur la terre : le cynisme. Il faut les conquérir en se servant à la fois des doigts les plus délicats et des poings les plus courageux. Toute décrépitude de l'âme en éloignera nécessairement une fois pour toutes, et même la moindre atteinte de dyspepsie ; il ne faut pas avoir de nerfs, il faut posséder de joyeuses entrailles. Ce n'est pas seulement la pauvreté de l'âme, l'atmosphère des recoins qui interdit l'approche de mes livres, c'est davantage encore la lâcheté, la malpropreté, le ressentiment secret qui se cachent au fond des intestins. (EH/88-3§1)
Les conditions nécessaires pour me comprendre, et qui, alors, me feront nécessairement comprendre, — je ne les connais que trop bien. Il faut être, dans les choses de l'esprit, intègre jusqu'à la dureté, pour pouvoir seulement supporter mon sérieux, ma passion. II faut être exercé à vivre sur les cimes — à se sentir au-dessus du misérable bavardage contemporain de politique et d'égoïsmes nationaux. Il faut être devenu indifférent, il faut ne jamais demander si la vérité sert à quelque chose, ou si elle peut vous être fatale... Il faut la prédilection des forts pour les questions dont personne aujourd'hui n'a le courage ; le courage des choses défendues ; être prédestiné au labyrinthe. Une expérience tirée de sept solitudes... Des oreilles neuves pour une musique nouvelle; des yeux neufs pour les plus lointains horizons. Une conscience nouvelle pour des vérités restées jusqu'à présent muettes. Plus la volonté d'une économie de grand style : garder le contrôle de sa force, de son enthousiasme... Le respect de soi, l'amour de soi, une absolue liberté envers soi...
J’ai donné à l’humanité le livre le plus profond qu’elle possède, comparés à quoi la plupart des livres ne sont que de la littérature. Que ne faut-il pas expier pour ça ? (DL/88-MVM)
APOLLINIEN – DIONYSIAQUE
Ces deux instincts si différents marchent côte à côte, le plus souvent en état de conflit ouvert, s'excitant mutuellement à des créations nouvelles et plus vigoureuses, afin de perpétuer entre eux ce conflit des contraires que recouvre en apparence seulement le nom d'art qui leur est commun ; jusqu'à ce qu'enfin, par un miracle métaphysique du « vouloir » hellénique, ils apparaissent unis, et dans cette union finissent par engendrer l'œuvre d'art à la fois dionysiaque et apollinienne, la tragédie attique.
Sous le charme de Dionysos, non seulement le lien se renoue d’homme à homme, mais même la nature qui nous est devenue étrangère, hostile ou asservie, fête sa réconciliation avec l’homme, son fils prodigue. La terre offre d'elle-même ses dons, les bêtes fauves des rochers et des déserts approchent pacifiées. Le char de Dionysos se couvre de fleurs et de guirlandes, la panthère et le tigre marchent accouplés sous son joug. Qu'on transforme en un tableau le triomphal Hymne à la Joie de Beethoven et qu'on tâche d'égaler cette imagination qui voit les millions d'êtres se prosterner dans la poussière : on aura alors une idée approchante du dionysisme. L’esclave devient un homme libre, toutes les barrières rigides et hostiles que la nécessité, l’arbitraire ou « la mode insolente » ont mises entre les hommes cèdent à présent. Dans cet évangile de l'harmonie universelle, non seulement chacun se sent uni, réconcilié, fondu avec son prochain, mais il se sent identique à lui, comme si le voile de Maïa se déchirait et ne flottait plus qu'en lambeaux autour du mystère de l'Unité originelle. (LNT/72-§1)
Nous avons jusqu'à présent envisagé l'apollinisme et son contraire, le dionysisme, comme des énergies d'art qui jaillissent directement de la nature sans l'intermédiaire de l'artiste humain ; ainsi la nature commence par satisfaire directement ses instincts esthétiques, et cela de deux manières : dans le monde imagé du rêve, dont la perfection est sans aucun rapport avec le niveau intellectuel ou la culture esthétique de l'individu, et dans la réalité enivrée qui néglige à son tour l'individu, et cherche même à l'annihiler ou à le libérer grâce au sentiment de l'unité mystique. (LNT/72-§2)
L'être chez qui l'abondance de vie est la plus grande, Dionysos, l'homme dionysien, se plaît non seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation ; la méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte, par suite d'une surabondance qui est capable de faire, de chaque désert, un pays fertile. C'est au contraire l'homme le plus souffrant, le plus pauvre en force vitale, qui aurait le plus grand besoin de douceur, d'aménité, de bonté, en pensée aussi bien qu'en action, et, si possible, d'un Dieu qui serait tout particulièrement un Dieu de malades, un « Sauveur », il aurait aussi besoin de logique, d'intelligibilité abstraite de l'existence - car la logique tranquillise, donne de la confiance -, bref d'une certaine intimité étroite et chaude qui dissipe la crainte, et d'un emprisonnement dans des horizons optimistes. (LGS/86-§370)
Que signifie les oppositions d’idées entre apollinien et dionysien, que j’ai introduites dans l’esthétique, toutes deux considérées comme des catégories de l’ivresse ? — L’ivresse apollinienne produit avant tout l’irritation de l’œil qui donne à l’œil la faculté de vision. Le peintre, le sculpteur, le poète épique sont des visionnaires par excellence. Dans l’état dionysien, par contre, tout le système émotif est irrité et amplifié : en sorte qu’il décharge d’un seul coup tous ses moyens d’expression, en expulsant sa force d’imitation, de reproduction, de transfiguration, de métamorphose, toute espèce de mimique et d’art d’imitation. […] L’homme dionysien est incapable de ne point comprendre une suggestion quelconque, il ne laisse échapper aucune marque d’émotion, il a au plus haut degré l’instinct compréhensif et divinatoire, comme il possède au plus haut degré l’art de communiquer avec les autres. Il sait revêtir toutes les enveloppes, toutes les émotions : il se transforme sans cesse. (LCI/88-9§10)
« O Dionysos, divin, pourquoi me tires-tu les oreilles ? » demanda un jour Ariane à son philosophique amant, dans un de ces célèbres dialogues sur l’île de Naxos. « Je trouve quelque chose de plaisant à tes oreilles, Ariane : pourquoi ne sont-elles pas plus longues encore ? » (LCI/88-9§19)
Goethe concevait un homme fort, hautement cultivé, habile à toutes les choses de la vie physique, se tenant lui-même bien en main, ayant le respect de sa propre individualité, pouvant se risquer à jouir pleinement du naturel dans toute sa richesse et toute son étendue, assez fort pour la liberté ; homme tolérant, non par faiblesse, mais par force, parce qu’il sait encore tirer avantage de ce qui serait la perte des natures moyennes ; homme pour qui il n’y a plus rien de défendu, sauf du moins la faiblesse, qu’elle s’appelle vice ou vertu... Un tel esprit libéré, apparaît au centre de l’univers, dans un fatalisme heureux et confiant, avec la foi qu’il n’y a de condamnable que ce qui existe isolément, et que, dans l’ensemble, tout se résout et s’affirme. Il ne nie plus... Mais une telle foi est la plus haute de toutes les fois possibles. Je l’ai baptisée du nom de Dionysos. (LCI/88-9§49)
Je fus le premier qui, pour la compréhension de cet ancien instinct hellénique riche encore et même débordant, ai pris au sérieux ce merveilleux phénomène qui porte le nom de Dionysos : il n’est explicable que par un excédent de force. Celui qui a étudié les Grecs, comme ce profond connaisseur de leur culture, le plus profond de tous, Jacob Burckhardt à Bâle, a su de suite l’importance que cela avait : Burckhardt a intercalé dans sa Culture des Grecs un chapitre spécial sur ce phénomène. Si l’on veut se rendre compte de l’opposé il suffira de voir la pauvreté d’instinct presque réjouissante chez le philologue allemand quand il s’approche de l’idée dionysienne.
… ce n’est que par les mystères dionysiens, par la psychologie de l’état dionysien que s’exprime la réalité fondamentale de l’instinct hellénique — sa « volonté de vie ». Qu’est-ce que l’Hellène se garantissait par ces mystères ? La vie éternelle, l’éternel retour de la vie ; l’avenir promis et sanctifié dans le passé ; l’affirmation triomphante de la vie au-dessus de la mort et du changement ; la vie véritable comme prolongement collectif par la procréation, par les mystères de la sexualité. C’est pourquoi le symbole sexuel était pour les Grecs le symbole vénérable par excellence, le véritable sens profond dans toute la piété antique. Toutes les particularités de l’acte de la génération, de la grossesse, de la naissance éveillent les sentiments les plus élevés et les plus solennels. Dans la science des mystères la douleur est sanctifiée : le « travail d’enfantement » rendant la douleur sacrée, — tout ce qui est devenir et croissance, tout ce qui garantit l’avenir nécessite la douleur... Pour qu’il y ait la joie éternelle de la création, pour que la volonté de vie s’affirme éternellement par elle-même il faut aussi qu’il y ait les « douleurs de l’enfantement »... Le mot Dionysos signifie tout cela : je ne connais pas de symbolisme plus élevé que ce symbolisme grec, celui des fêtes dionysiennes. Par lui le plus profond instinct de la vie, celui de la vie à venir, de la vie éternelle est traduit d’une façon religieuse, — la voie même de la vie, la procréation, comme la voie sacrée... Ce n’est que le christianisme, avec son fond de ressentiment contre la vie, qui a fait de la sexualité quelque chose d’impur : il jette de la boue sur le commencement, sur la condition première de notre vie... (LCI/88-10§4)
L’affirmation de la vie, même dans ses problèmes les plus étranges et les plus ardus ; la volonté de vie, se réjouissant dans le sacrifice de ses types les plus élevés, à son propre caractère inépuisable — c’est ce que j’ai appelé dionysien, c’est en cela que j’ai cru reconnaître le fil conducteur vers la psychologie du poète tragique. […] L’origine de la Tragédie fut ma première transmutation de toutes les valeurs : par là je me replace sur le terrain d’où grandit mon vouloir, mon savoir — moi le dernier disciple du philosophe Dionysos, — moi le maître de l’éternel retour.. (LCI/88-10§5)
Je suis un disciple du philosophe Dionysos ; je préférerais encore être considéré comme un satyre que comme un saint. (EH/88-pref§2)
(parlant de « L'origine de la tragédie ») - Une « idée » — l'opposition entre dionysien et apollinien — y est traduite métaphysiquement ; l'histoire elle-même y est considérée comme le développement de cette idée ; dans la tragédie, l'antithèse avec l'unité est supprimée ; sous cette optique, des choses qui ne s'étaient jamais vues face à face sont opposées l'une à l'autre, éclairées et comprises l'une par l'autre. L'Opéra, par exemple, et la Révolution... […] Dans le livre tout entier, il y a un silence profond et hostile pour tout ce qui touche le christianisme. Celui-ci n'est ni apollinien ni dionysien ; il nie toutes les valeurs esthétiques, les seules que reconnaisse l'Origine de la Tragédie ; il est nihiliste au sens le plus profond, alors que dans le symbole dionysien la limite extrême de l'affirmation est atteinte. (EH/88-3OT§1)
Celui qui non seulement comprend le terme « dionysien », mais encore se comprend dans ce terme, n'a pas besoin d'une réfutation de Platon, du christianisme ou de Schopenhauer. — Il flaire la décomposition... (EH/88-3OT§2)
L'affirmation de la vie même dans ses problèmes les plus étranges et les plus ardus ; la volonté de vie, se réjouissant de faire le sacrifice de ses types les plus élevés, au bénéfice de son propre caractère inépuisable — c'est ce que j'ai appelé dionysien, c'est en cela que j'ai cru reconnaître le fil conducteur qui mène à la psychologie du poète tragique. Non pour se débarrasser de la crainte et de la pitié, non pour se purifier d'une passion dangereuse par sa décharge véhémente — c'est ainsi que l'a entendu Aristote —, mais pour personnifier soi-même, au-dessus de la crainte et de la pitié, l'éternelle joie du devenir, — cette joie qui porte encore en elle la joie de l'anéantissement..»
Je n'ai après tout aucune raison de renoncer à l'espoir que je place en un avenir dionysien de la musique. Projetons nos regards à un siècle en avant. Admettons que mon attentat contre vingt siècles de contre-nature et de violation de l'humanité réussisse. Ce nouveau parti, qui sera le parti de la vie et qui prendra en mains la plus belle de toutes les tâches, la discipline et le perfectionnement de l'humanité, y compris la destruction impitoyable du tout ce qui présente des caractères dégénérés et parasitaires, ce parti rendra de nouveau possible la présence sur cette terre de cet excédent de vie, d'où sortira certainement de nouveau la condition dionysienne. (EH/88-3OT§4)
Pour une tâche dionysienne, la dureté du marteau, la joie même de la destruction, font partie, de la façon la plus décisive, des conditions premières. L'impératif « devenez durs ! », la certitude fondamentale que tous les créateurs sont durs, voilà le véritable signe distinctif d'une nature dionysienne. (EH/88-3APZ§8)
M'a-t-on compris ?— Dionysos en face du Crucifié.. (EH/88-4§9)
Expériences psychologiques fondamentales : le nom d' « apollinien » désigne l'immobilisation ravie devant un monde inventé et rêvé, devant le monde de la belle apparence en tant qu'il libère du devenir : du nom de Dionysos est baptisé, d'autre part, le devenir conçu activement, ressenti subjectivement en tant que volupté furieuse du créateur qui connaît simultanément la rage du destructeur. Antagonisme de ces deux expériences et des désirs qui en constituent le fondement : le premier veut éterniser l'apparence, devant elle l'homme devient calme, sans désirs, semblable à une mer d'huile, guéri, en accord avec soi et avec toute l'existence : le second désir aspire au devenir, à la volupté du faire devenir, c'est-à-dire du créer et du détruire. (FP /12)
APPARENCE
Dans quelle situation merveilleuse et inédite, et en même temps terrible et ironique je me sens, avec ma connaissance, à l'égard de l'ensemble de l'existence ! J'ai découvert quant à moi que l'ancienne humanité et animalité, voire même que l'ensemble de l'ère primitive et du passé de tout être sensible, continue à poétiser en moi, continue à aimer, continue à haïr, continue à tirer des conclusions, - je me suis soudain réveillé au beau milieu de ce rêve, mais seulement pour prendre conscience que je suis en train de rêver, et que je dois continuer à rêver si je ne veux pas périr : tout comme le somnambule doit continuer à rêver pour ne pas s'écraser au sol. Qu'est-ce pour moi à présent que l'" apparence "! Certainement pas le contraire d'une quelconque essence, - que puis-je énoncer d'une quelconque essence sinon les seuls prédicats de son apparence ! Certainement pas un masque mort que l'on pourrait plaquer sur un X inconnu, et tout aussi bien lui ôter ! (LGS/82-§54)
Voici ce qui m'a coûté et ne cesse de continuer à me coûter les plus grands efforts : me rendre compte que la manière dont on nomme les choses compte indiciblement plus que ce qu'elles sont. La réputation, le nom et l'apparence, le crédit, la mesure et le poids usuels d'une chose - à l'origine le plus souvent une erreur et une décision arbitraire jetées sur les choses comme un vêtement, et totalement étrangères à son essence et même à sa peau -, à la faveur de la croyance qu'on leur accorde et de leur croissance de génération en génération, prennent en quelque sorte racine dans la chose et s'y incarnent progressivement pour devenir son corps même : l'apparence initiale finit presque toujours par se transformer en essence et agit comme essence ! (LGS/82-§58)
Mais n'oublions pas non plus ceci : il suffit de créer de nouveaux noms, appréciations et vraisemblances pour créer à la longue de nouvelles " choses ". (LGS/82-§58)
L'apparence, au sens où je l'entends, est la véritable et l'unique réalité des choses - ce à quoi seulement s'appliquent tous les prédicats existants et qui dans une certaine mesure ne saurait être mieux défini que par l'ensemble des prédicats, c'est-à-dire aussi par les prédicats contraires. Or ce mot n'exprime rien d'autre que le fait d'être inaccessible aux procédures et aux distinctions logiques : donc une " apparence " si on le compare à la " vérité logique " - laquelle n'est elle-même possible que dans un monde imaginaire. Je ne pose donc pas l' " apparence " en opposition à la " réalité ", au contraire, je considère que l'apparence, c'est la réalité, celle qui résiste à toute transformation en un imaginaire " monde vrai ". Un nom précis pour cette réalité serait " la volonté de puissance ", ainsi désignée d'après sa structure interne et non à partir de sa nature protéiforme, insaisissable et fluide. (FP/84-85-v11)
APPLAUDISSEMENT
Dans l'applaudissement, il y a toujours une espèce de vacarme : même dans l'applaudissement que nous nous décernons nous-mêmes. (LGS/82-§201)
APPRENDRE
Pour voir beaucoup de choses il faut apprendre à voir loin de soi : - cette dureté est nécessaire pour tous ceux qui gravissent les montagnes. (APZ/83-85-p3)
« Qui apprend beaucoup, désapprend tous les désirs violents » – c’est ce qu’on se murmure aujourd’hui dans toutes les rues obscures.
Et c’est aussi de moi seulement qu’il vous faut apprendre à apprendre, à bien apprendre ! – Que celui qui a des oreilles entende.(APZ/83-85-p3)
ART - ARTISTE
L’art est la tâche suprême et l’activité véritablement métaphysique de cette vie ; (LNT/72-pref.)
L’évolution de l’art est liée au dualisme de l’apollinisme et du dionysisme, comme la génération est liée à la dualité des sexes, à leur lutte continuelle, coupée d’accords provisoires.
Les deux divinités protectrices de l’art, Apollon et Dionysos nous suggèrent que dans le monde grec il existe un contraste prodigieux, dans l’origine et dans les fins, entre l’art du sculpteur, ou art apollinien, et l’art non sculptural de la musique, celui de Dionysos. Ces deux instincts si différents marchent côte à côte, le plus souvent en état de conflit ouvert, s’excitant mutuellement à des créations nouvelles et plus vigoureuses, afin de perpétuer entre eux ce conflit des contraires que recouvre en apparence seulement le nom d’art qui leur est commun.
Nous aurons fait en esthétique un grand pas lorsque nous serons parvenus non seulement à la compréhension logique mais à l'immé-diate certitude intuitive que l'entier développement de l'art est lié à la dualité de l'apollinien et du dionysiaque comme, analogiquement, la génération — dans ce combat perpétuel où la réconciliation n'intervient jamais que de façon périodique — dépend de la diffé-rence des sexes. Ces noms, nous les empruntons aux Grecs, lesquels, pour qui les comprend, ont donné à entendre le sens profond et la doctrine secrète de leur intuition esthétique non pas, certes, dans des concepts, mais dans les figures incisives et nettes de leur panthéon. C'est à leurs deux divinités de l'art, Apollon et Dionysos, que se rattache la connaissance que nous pouvons avoir, dans le monde grec, d'une formidable opposition, quant à l'origine et quant au but, entre l'art plastique — l'art apollinien — et l'art non plastique qui est celui de Dionysos. Ces deux pulsions si différentes marchent de front, mais la plupart du temps en conflit ouvert.(LNT/72-§1)
Tout artiste est un « imitateur », qu’il soit l’artiste apollinien du rêve ou l’artiste dionysiaque de l’ivresse ou même, comme dans la tragédie grecque, l’artiste du rêve et de l’ivresse à la fois. (LNT/72-§2)
L’histoire et les sciences de la nature furent nécessaires contre le Moyen Age : le savoir contre la croyance. Contre le savoir nous dirigeons maintenant l’art : retour à la vie ! Maitrise de l’instinct de la connaissance ! Renforcement des instincts moraux et esthétiques ! (LDP/72-75-ch.1§43)
Notre époque a une haine pour l’art comme pour la religion. Elle ne veut capituler ni par la promesse de l’au-delà ni par la promesse d’une transfiguration artistique du monde. Elle tient cela pour de la « poésie » superflue, pour une plaisanterie, etc. nos poètes sont à l’avenant. Mais l’art comme sérieux redoutable ! La nouvelle métaphysique comme sérieux redoutable ! Nous voulons transposer pour vous le monde en des images telles que vous en frémissiez. C’est en notre pouvoir ! (LDP/72-75-ch.1§56)
Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. (LDP/72-75-ch.1§62)
Qu’on imagine les natures anti-artistiques ou douées d’un faible tempérament artistique, armées et équipées d’idées empruntées à l’histoire monumentale de l’art. Contre qui ces natures dirigeront-elles leurs armes ? Contre leurs ennemis héréditaires : les tempéraments artistiques fortement doués, par conséquent contre ceux qui sont seuls capables d’apprendre quelque chose dans les événements historiques ainsi présentés, capables d’en tirer parti pour la vie et de transformer ce qu’ils ont appris en une pratique supérieure. C’est à ceux-là que l’on barre le chemin, à ceux-là que l’on obscurcit l’atmosphère, lorsque l’on se met à danser servilement et avec zèle autour d’un glorieux monument du passé, quel qu’il soit et sans l’avoir compris, comme si l’on voulait dire : « Voyez, ceci est l’art vrai et véritable. Que vous importent ceux qui sont encore prisonniers dans le devenir et dans le vouloir ! » Cette foule qui danse possède même, en apparence, le privilège du « bon goût », car toujours le créateur s’est trouvé en désavantage vis-à-vis de celui qui ne faisait que regarder sans mettre lui-même la main à la pâte, de même que, de tous temps, l’orateur de café paraissait plus sage, plus juste et plus réfléchi que l’homme d’État qui gouverne. Si l’on s’avise même de transporter sur le domaine de l’art l’usage du suffrage populaire et de la majorité du nombre, pour forcer en quelque sorte l’artiste à se défendre devant un forum d’esthétisants oisifs, on peut jurer d’avance qu’il sera condamné. Non point, comme on pourrait le croire, malgré le canon de l’art monumental, mais parce que ses juges ont proclamé solennellement ce canon (celui de l’art qui, d’après les explications données, a « fait de l’effet » de tous temps). Au contraire, pour l’art qui n’est pas encore monumental, c’est-à-dire pour celui qui est contemporain, il leur manque premièrement le besoin, en second lieu la vocation, en troisième lieu précisément l’autorité de l’histoire. Par contre, leur instinct leur apprend que l’on peut tuer l’art par l’art. À aucun prix, pour eux, le monumental ne doit se former à nouveau et ils se servent comme argument de ce qui tire du passé son autorité et son caractère monumental. De la sorte, ils apparaissent comme connaisseurs d’art, parce qu’ils voudraient supprimer l’art ; ils se donnent des allures de médecins, tandis qu’au fond ils se comportent en empoisonneurs. (CI2/73)
L'art relève la tête quand les religions perdent du terrain. Il recueille une foule de sentiments et de tendances produites par la religion, il les prend à cœur et devient alors lui-même plus profond, plus rempli d'âme, au point qu'il peut communiquer l'élévation et l'enthousiasme, chose qu'auparavant il ne pouvait pas encore. Le trésor de sentiment religieux grossi en torrent déborde toujours de nouveau et veut conquérir de nouveaux royaumes ; mais le progrès des lumières a ébranlé les dogmes de la religion et inspiré une défiance fondamentale : alors le sentiment, chassé par les lumières de la sphère religieuse, se jette dans l'art ; en quelques cas aussi dans la vie politique, voire même directement dans la science. Partout où dans les efforts humains on aperçoit une coloration supérieure plus sombre, on peut conjecturer que la crainte des esprits, le parfum de l'encens et les ombres de l'Église y sont restés attachés. (HTH/78-§150)
Les artistes ont un intérêt à ce qu'on croie aux intuitions soudaines, aux soi-disant inspirations ; comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel comme un rayon de la grâce. En réalité, l'imagination du bon artiste ou penseur produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé, exercé, rejette, choisit, combine; ainsi, l'on se rend compte aujourd'hui d'après les Carnets de Beethoven qu'il a composé peu à peu ses plus magnifiques mélodies et les a en quelque sorte tirées d'ébauches multiples. Celui qui discerne moins sévèrement et s'abandonne volontiers à la mémoire reproductrice pourra, dans certaines conditions, devenir un grand improvisateur; mais l'improvisation artistique est à un niveau fort bas en comparaison des idées d'art choisies sérieusement et avec peine. Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables non seulement à inventer, mais encore à rejeter, passer au crible, modifier, arranger. (HTH/78-§155)
Ce sont précisément, parmi les artistes, les cerveaux originaux, créant d'eux-mêmes, qui peuvent, le cas échéant, produire le vide et le néant complets, tandis que les natures plus dépendantes, les talents, comme on dit, abondent en souvenirs de tout le bon possible et même en état de faiblesse produisent quelque chose de passable. Mais si les originaux sont abandonnés d'eux-mêmes, le souvenir ne leur donne aucune aide : ils tournent à vide. (HTH/78-§165)
Il en va toujours comme d'Achille et d'Homère : l'un a la vie, le sentiment, l'autre les décrit. Un véritable écrivain ne donne la parole qu'à la passion et à l'expérience d'autrui ; il est artiste pour savoir, du peu qu'il a ressenti, tirer beaucoup par divination. Les artistes ne sont pas le moins du monde les hommes de la grande passion, mais fréquemment ils se donnent pour tels, avec le sentiment inconscient que l'on accordera plus de créance à leur passion peinte, si leur propre vie parle en faveur de leur expérience en la matière. (HTH/78-§211)
Le désir incessant de créer, propre à l'artiste, et son regard sans cesse à l'affût de l'extérieur, l'empêchent de devenir plus beau et meilleur dans sa personne, c'est-à-dire de se créer lui-même —à moins que son ambition ne soit assez grande pour le forcer à se montrer toujours, dans ses rapports avec les autres, l'égal de la beauté grandissante et de la sublimité de son œuvre. Dans tous les cas il ne possède qu'une mesure déterminée de forces : ce qu'il en emploie pour sa propre personne, comment pourrait-il en faire bénéficier son œuvre ? Et vice versa. (OSM/79-§102)
Il y a désavantage pour les bonnes idées à se suivre de trop près ; elles se bouchent mutuellement la vue – C'est pourquoi les plus grands artistes et les plus grands écrivains ont fait un usage abondant de moyens termes. (OSM/79-§120)
Le peuple possède bien quelque chose que l'on peut appeler des aspirations artistiques, mais celles-ci sont minimes et faciles à satisfaire. Au fond, les déchets de l'art y suffisent : il faut se l'avouer sans ambages. Considérez, par exemple, quelles sont les mélodies et les chansons qui font maintenant toute la joie des couches vigoureuses de la population, les moins gâtées et les plus naïves, vivez parmi les bergers, les métayers, les paysans, les chasseurs, les soldats, les matelots, et vous serez édifiés sur ce sujet. Dans les petites villes encore, dans les maisons où est le siège des héréditaires vertus bourgeoises, n'aime-t-on et ne cultive-t-on pas la plus mauvaise musique qui ait jamais été produite ? […] Et qu'exigent-ils en somme de l'art ? Qu'il chasse, pendant quelques heures ou quelques instants, le malaise, l'ennui, la conscience vaguement mauvaise, et interprète, si possible, dans un sens élevé, le défaut de leur vie et de leur caractère, pour le transformer en un défaut dans la destinée du monde, – à la grande différence des Grecs qui voyaient, dans leur art, l'expansion de leur propre bien-être et de leur propre santé, et qui aimaient à voir encore une fois leur propre perfection en dehors d'eux-mêmes : – ils ont été conduits à l'art par le contentement d'eux-mêmes, nos contemporains y sont venus – par le dégoût d'eux-mêmes. (OSM/79-§169)
Un art tel qu'il rayonne d'Homère, de Sophocle, de Théocrite, de Calderon, de Racine, de Goethe, comme l'excédent d'une conduite de vie sage et harmonieuse — c'est là la vraie conception, à quoi nous finirons par recourir, lorsque nous serons devenus nous-mêmes plus sages et plus harmonieux : et non point ce jaillissement barbare, quoique si charmant, de choses ardentes et bariolées, ce jaillissement hors d'une âme chaotique et non domptée que nous considérions jadis, lorsque nous étions des jeunes gens, comme de l'art. Mais il va de soi que, pour certaines époques de la vie, un art de l'exaltation et de l'émotion répond à un besoin naturel, de même que la répugnance contre tout ce qui est réglé, monotone, simple et logique, que cet art doit nécessairement correspondre à l'artiste, pour que l'âme de ce moment de la vie n'aille pas faire explosion sur une autre voie, par toutes sortes d'excès et de désordres. C'est ainsi que les jeunes gens, tels qu'ils sont généralement, pleins d'exubérance et tourmentés par l'ennui plus que toute autre chose, comme les femmes, faute d'un bon travail qui remplit l'âme, ont besoin de cet art du désordre ravissant : mais avec d'autant plus de violence s'enflammera un jour leur désir d'une satisfaction sans changement, d'un bonheur sans ivresse et sans léthargie. (OSM/79-§173)
L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et agréables si possible : ayant cette tâche en vue, il nous modère et nous tient en bride, crée des formes de civilité, lie ceux dont l'éducation n'est pas faite à des de convenance, de propriété, de politesse, leur apprend à parler et à se taire au bon moment. De plus, l'art doit cacher et transformer tout ce qui est laid, ces choses pénibles, épouvantables et dégoûtantes qui, malgré tous les efforts, à cause des origines de la nature humaine, viendront toujours de nouveau à la surface : il doit agir ainsi surtout pour ce qui en est des passions, des douleurs de l'âme et des craintes, et faire transparaître, dans la laideur inévitable ou insurmontable, ce qui y est significatif. Après cette tâche, dont la grandeur va jusqu'à l'énormité, l'art que l'on appelle véritable, l'art des œuvres d'art n'est qu'accessoire. L'homme qui sent en lui un excédent de ces forces qui embellissent, cachent, transforment, finira par chercher à s'alléger de cet excédent par l'œuvre d'art ; dans certaines circonstances c'est tout un peuple qui agira ainsi. – Mais on a l'habitude maintenant de commencer l'art par la fin, on se suspend à sa queue, avec l'idée que l'art des œuvres d'art est le principal et que c'est, en partant de cet art, que la vie doit être améliorée et transformée – fous que nous sommes ! Si nous commençons le repas par le dessert, goûtant à un plat sucré après l'autre, quoi d'étonnant si nous nous gâtons l'estomac et même l'appétit pour le bon festin, fortifiant et nourrissant, à quoi l'art nous convie ? (OSM/79-§174)
A quoi un art des œuvres d'art doit-il de survivre ? Au fait que la plupart des gens qui ont des heures de loisirs (et pour ceux-ci seulement, il y a un pareil art) ne croient pas pouvoir venir à bout de leur temps sans faire de la musique, aller au théâtre, visiter les expositions, lire des romans et des vers. En admettant que l'on puisse les détourner de cette satisfaction, ils aspireraient moins avidement à avoir des loisirs et l'envie que l'on porte aux riches deviendrait plus rare – ce serait un avantage pour la stabilité de la société ; ou bien ils continueraient à avoir des loisirs, mais apprendraient à réfléchir (ce que l'on peut apprendre et désapprendre), à réfléchir sur leur travail par exemple, sur leurs relations, sur les joies qu'ils pourraient procurer : dans les deux cas, le monde entier, sauf les artistes, en tirerait des avantages. (OSM/79-§175)
Le pain neutralise le goût des autres aliments, il l'efface; c'est pourquoi il fait partie de tous les repas. Dans toutes les œuvres d'art il faut qu'il y ait quelque chose comme du pain, pour que celles-ci puissent réunir des effets différents : des effets qui, s'ils se succédaient immédiatement sans un de ces repos et arrêts momentanés, épuiseraient rapidement et provoqueraient de la répugnance : ce qui rendrait un long repas de l'art impossible. (LVO/79-§98)
Nous avons la conscience morale d'une époque laborieuse : cela ne nous permet pas de réserver à l'art les meilleures heures et les meilleurs matins, quand même cet art serait le plus grand et le plus digne. Il est à nos yeux affaire de loisir, de récréation : nous lui vouons les restes de notre temps, de nos forces. –Tel le fait principal qui a changé la situation de l'art par rapport à la vie : lorsque l'art fait valoir ses grandes exigences sur le temps et les forces des amateurs il a contre lui la conscience des laborieux et des hommes capables, il en est réduit aux gens indolents et sans conscience qui, de par leur nature, ne sont précisément pas portés vers le grand art et qui ressentent ses exigences comme de l'insolence. Il se pourrait donc très bien que c'en fût fait du grand art parce qu'il manque d'air et de libre respiration; à moins qu'il n'essaie de s'acclimater dans cette autre atmosphère (ou du moins de pouvoir y survivre), qui n'est à vrai dire que l'élément naturel de l'art mineur, de l'art du repos, de la distraction amusante. Il en est ainsi presque partout maintenant ; (LVO/79-§170)
… les artistes, une espèce d'hommes de la vie contemplative plus rare que la religieuse, mais encore assez fréquente; en tant qu'individus ils ont généralement été insupportables, capricieux, envieux, violents, querelleurs : cette impression est à déduire de l'impression rassérénante et exaltante de leurs œuvres. (AUR/81-§41)
Si nos sculpteurs, peintres et musiciens veulent rendre le sens de leur époque, ils doivent donner à la beauté l'aspect de l'enflure, du gigantisme et de la nervosité : tout comme les Grecs, sous l'empire de leur morale de la mesure, voyaient et représentaient la beauté sous la forme de l'Apollon du Belvédère. Nous devrions, en fait, le déclarer laid ! Mais les « classicistes » imbéciles nous ont enlevé toute loyauté ! (AUR/81-§161)
Il n'est rien que les artistes, les poètes et les écrivains redoutent plus que cet œil qui voit leur petite tromperie, qui perçoit après coup le nombre de fois où ils se sont trouvés à la croisée des chemins qui mènent soit à un innocent plaisir pris à soi-même, soit au goût de l'effet ; qui vérifie les comptes, s'ils ont voulu vendre cher ce qui valait peu, s'ils ont cherché à élever et à embellir sans être situés eux-mêmes assez haut ; cet œil qui, par-delà toutes les tromperies de leur art, voit la pensée telle qu'elle s'est d'abord présentée à eux, peut-être comme une ravissante forme de lumière, peut-être aussi comme un vol perpétré aux dépens de tous, comme une pensée banale qu'ils ont dû étirer, raccourcir, colorier, envelopper, épicer pour en faire quelque chose — au lieu que la pensée fasse quelque chose d'eux — oh, cet oeil qui reconnaît dans votre oeuvre toute votre instabilité, vos espionnages et vos envies, vos contrefaçons et vos surenchères (qui ne sont qu'envieuses contrefaçons), qui connaît aussi bien les rougeurs de vos hontes que votre art de dissimuler ces rougeurs et de les interpréter autrement pour vous-mêmes ! (AUR/81-§223)
Contre toute espèce d'affliction et de détresse spirituelle, on doit d'abord essayer un changement de régime et un dur travail physique. Mais les hommes sont habitués dans ce cas à recourir à des moyens qui donnent l'ivresse : par exemple à l'art, — pour leur malheur et celui de l'art ! Ne remarquez-vous pas que si vous en appelez à l'art en qualité de malades, vous rendez les artistes malades ? (AUR/81-§269)
Les régions sans prétentions sont faites pour les grands peintres paysagistes, les régions curieuses et insolites, par contre, pour les petits peintres. Autrement dit : les grandes choses de la nature et de l'humanité doivent intercéder en faveur de tous ceux qui, parmi leurs admirateurs, sont petits, médiocres et ambitieux, — alors que le grand artiste intercède en faveur des choses simples. (AUR/81-§434)
Quoi! Il faudrait comprendre une œuvre exactement comme l'époque qui l'a produite ? Mais on en tire plus de joie, plus d'étonnement et même plus d'enseignement si on ne la comprend justement pas ainsi ! N'avez-vous pas remarqué que toute œuvre nouvelle et belle possède sa moindre valeur tant qu'elle reste exposée à l'atmosphère humide de son temps, — précisément parce qu'elle est encore trop chargée de l'odeur du marché, de la polémique, des plus récentes opinions et de tout l'éphémère qui périt du jour au lendemain. Plus tard elle se dessèche, son « actualité » se dissipe — alors seulement elle reçoit son éclat profond et son parfum et même, si elle y est destinée, son calme regard d'éternité. (AUR/81-§506)
Je crois que les artistes ignorent souvent ce qu'ils savent le mieux faire parce qu'ils sont trop vaniteux et qu'ils dirigent leur esprit vers un plus grand sujet de fierté que de paraître ces petites plantes qui, nouvelles, rares et belles, savent pousser avec une véritable perfection sur leur sol. Ils apprécient de manière superficielle ce qu'il y a en fin de compte de bon dans leur jardin et leur vigne, et chez eux, amour et compréhension ne sont pas de même force. (LGS/82-§87)
Qu'importe tout l'art de nos œuvres d'art si nous laissons échapper cet art supérieur, l'art des fêtes! Autrefois, toutes les œuvres d'art se dressaient sur la grande voie triomphale de l'humanité, en marques commémoratives et témoignages de ses moments d'élévation et de félicité. Aujourd'hui, on veut, au moyen des œuvres d'art, attirer les malheureux épuisés et malades à l'écart de la grande voie des souffrances de l'humanité pour une fraction de seconde de concupiscence; on leur offre une petite ivresse et une petite folie. (LGS/82-§89)
Si nous n'avions pas donné notre approbation aux arts et inventé cette espèce de culte du non-vrai : la compréhension de l'universalité du non-vrai et du mensonge que nous offrent à présent les sciences — la compréhension de l'illusion et de l'erreur comme condition de l'existence connaissante et percevante —, nous seraient totalement insupportables. La probité entraînerait le dégoût et le suicide. Mais aujourd'hui notre probité possède une contre-puissance qui nous aide à éluder de telles conséquences : l'art, entendu comme la bonne disposition envers l'apparence. Nous n'interdisons pas toujours à notre œil d'arrondir, de parachever par l'imagination : et ce n'est plus alors l'éternelle imperfection que nous transportons sur le fleuve du devenir — nous pensons alors porter une déesse et nous accomplissons ce service avec de la fierté et une innocence enfantine.(LGS/82-§107)
Cet artiste est ambitieux et rien de plus : son œuvre n'est en fin de compte qu'un verre grossissant qu'il offre à tout homme regardant dans sa direction. (LGS/82-§241)
L'artiste choisit sa matière : c'est sa manière de louer. (LGS/82-§245)
Quelle est la première distinction à faire avec les œuvres d'art. — Tout ce qui est pensé, créé en matière poétique, peint, composé, même construit et modelé, appartient soit à l'art de monologue, soit à l'art devant témoins. Dans ce dernier, il faut inclure également cet art apparemment de monologue qui comprend la croyance en Dieu, toute la lyrique de la prière : car pour un homme pieux, il n'existe plus de solitude, — cette invention, c'est nous seuls qui l'avons créée, nous les sans-dieu. Je ne connais pas, pour toute l'optique d'un artiste, de distinction plus profonde que celle-ci : considère-t-il son œuvre en devenir (se considère-t-il « lui-même » —) du point de vue du témoin ou bien a-t-il « oublié le monde »? ce qui est l'élément essentiel de tout art de monologue, — lequel repose sur l'oubli, est la musique de l'oubli. (LGS/86-§367)
Un créateur permanent, un homme « mère », au sens fort du mot, un homme qui ne connaît et ne veut plus entendre parler de rien d'autre que des grossesses et des accouchements de son esprit, qui n'a même plus de temps pour se soucier de lui-même et de son œuvre, pour les comparer, qui n'a même plus envie d'exercer son goût, et l'oublie facilement, c'est-à-dire le laisse debout, ou par terre, ou le laisse tomber, — peut-être un tel homme finit-il par produire des œuvres à la hauteur desquelles son jugement ne lui permet plus de parvenir depuis longtemps : de sorte qu'il dit des sottises à propos d'elles et de lui, — en dit et en pense. Voilà qui me semble presque la situation normale des artistes féconds, — nul ne connaît plus mal un enfant que ses parents — et ceci vaut même, pour prendre un exemple considérable, par rapport à l'ensemble du monde poétique et artistique grec : il n'a jamais « su » ce qu'il a fait... (LGS/86-§369)
Tout art, toute philosophie peut être considéré comme un remède et un secours au service de la vie en croissance, en lutte : ils présupposent toujours de la souffrance et des êtres qui souffrent. (LGS/86-§370)
Quel est donc le sens de tout idéal ascétique ? Dans le cas de l’artiste, nous commençons à le comprendre : il n’y en a aucun !... Ou bien il est si multiple qu’il vaut autant dire qu’il n’y en a pas !... Eliminons tout d’abord les artistes : leur indépendance dans le monde et à l’égard du monde n’est pas assez grande pour que leurs appréciations et les changements dans ces appréciations méritent, par eux-mêmes, de l’intérêt ! Ils furent de tout temps les humbles valets d’une morale, d’une philosophie ou d’une religion ; sans compter que trop souvent, hélas! ils ont été les courtisans dociles de leurs admirateurs et de leurs fidèles, les flatteurs éhontés des puissances d’ancienne et de fraîche date. Tout au moins leur faut-il toujours un rempart, une réserve, une autorité sur quoi ils puissent se fonder : les artistes ne vont jamais seuls, l’allure de l’indépendance est contraire à leurs instincts essentiels. (GM/87-td§5)
l’art sanctifiant précisément le mensonge et mettant la volonté de tromper du côté de la bonne conscience, est, par principe, bien plus opposé à l’idéal ascétique que la science... (GM/87-td§25)
Les artistes se mettent à estimer et à surestimer leurs œuvres quand ils cessent de se respecter eux-mêmes. Leur désir frénétique de gloire masque souvent un triste secret. L'œuvre ne fait pas partie de leur norme, ils la ressentent comme leur exception. — Peut-être veulent-ils aussi que leurs œuvres témoignent en leur faveur, ou peut-être que d'autres les trompent sur eux-mêmes. En fin de compte : peut-être veulent-ils du tapage en eux, pour ne plus s'« entendre » eux-mêmes.
A quelle profondeur l'art pénètre-t-il l'intimité du monde ? Et y a-t-il, en dehors de l'artiste, d'autres formes artistiques ? Cette question fut, comme on sait, mon point de départ : et je répondis Oui à la seconde question ; et à la première « le monde lui-même est tout entier art ». La volonté absolue de savoir, de vérité et de sagesse m'apparut, dans ce monde d'apparence, comme un outrage à la volonté métaphysique fondamentale, comme contre nature : et, avec raison, la pointe de la sagesse se retourne contre le sage. Le caractère contre nature de la sagesse se révèle dans son hostilité à l'art : vouloir connaître là où l'apparence constitue justement le salut — quel renversement, quel instinct de néant ! (FP/85-87-v12)
L'on est artiste au prix de ressentir ce que tous les non-artistes nomment « forme » en tant que contenu, que «la chose même ». De ce fait l'on appartient sans doute à un monde à l'envers : car dès lors le contenu devient pour nous quelque chose de purement formel, — y compris notre vie.
L'art et rien que l'art. Il est le grand possibilisateur de la vie, le grand séducteur qui entraîne à la vie, le grand stimulant pour vivre...
« La vie doit inspirer confiance » : la tâche ainsi définie est énorme. Pour la résoudre, il faut que l'homme soit déjà par nature un menteur, il faut que plus que tout autre chose, il soit artiste... (FP/87-88-v13)
Voilà un artiste comme je les aime. Il est modeste dans ses besoins : il ne demande, en somme, que deux choses : son pain et son art, — Panem et Circen... (LCI/88-1§17)
L’artiste tragique n’est pas un pessimiste, il dit oui à tout ce qui est problématique et terrible, il est dionysien... (LCI/88-3§6)
Pour qu’il y ait de l’art, pour qu’il y ait une action ou une contemplation esthétique quelconque, une condition physiologique préliminaire est indispensable : l’ivresse. Il faut d’abord que l’ivresse ait haussé l’irritabilité de toute la machine : autrement l’art est impossible. (LCI/88-9§8)
La lutte contre la fin en l’art est toujours une lutte contre les tendances moralisatrices dans l’art, contre la subordination de l’art sous la morale. L’art pour l’art veut dire : « Que le diable emporte la morale ! » — Mais cette inimitié même dénonce encore la puissance prépondérante du préjugé. Lorsque l’on a exclu de l’art le but de moraliser et d’améliorer les hommes, il ne s’ensuit pas encore que l’art doive être absolument sans fin, sans but et dépourvu de sens, en un mot, l’art pour l’art — un serpent qui se mord la queue. « Être plutôt sans but, que d’avoir un but moral ! » ainsi parle la passion pure. (LCI/88-9§24)
L'art vaut plus que la vérité.
La grandeur d'un artiste ne s'évalue pas aux «beaux sentiments» qu'il suscite : cela, c'est ce que croient les bonnes femmes. Mais, à la mesure dans laquelle il approche du grand style dans laquelle il est capable du grand style. Ce style a ceci de commun avec la grande passion qu'il dédaigne de plaire ; qu'il oublie de persuader ; qu'il commande, qu'il veut... Maîtriser le chaos que l'on est : contraindre son chaos à devenir forme ; devenir nécessité dans la forme : devenir logique, simple, non équivoque, mathématique ; devenir loi—: c'est là la grande ambition. Par elle, on repousse ; plus rien n'éveille l'amour pour de tels hommes de violence — un désert s'établit autour d'eux, un silence, une peur comme devant un grand sacrilège...
Il est indigne pour un philosophe de déclarer : le bon et le beau ne sont qu'un ; si en plus il ajoute « le vrai également » il mérite la bastonnade. La vérité est laide : nous avons l'art afin que la vérité ne nous tue pas. (FP/88-v14)
ATHÉE - ATHÉISME
Pourquoi aujourd’hui de l’athéisme ? — Le « père » en Dieu est foncièrement réfuté, de même le « juge », le « dispensateur ». De même son « libre arbitre » : il n’entend pas, et, s’il entendait, il ne saurait pourtant pas venir en aide. Ce qu’il y a de pire c’est qu’il paraît incapable de se communiquer clairement. Est-il obscur ? — Voilà ce que j’ai recueilli de plusieurs entretiens pris à droite et à gauche, en questionnant, en écoutant çà et là, au sujet de la ruine du théisme européen et de sa cause. Il me semble que l’instinct religieux, bien qu’il se développe puissamment, rejette le théisme avec une profonde méfiance. (PDBM/86-§53)
Les jugements moraux et les condamnations morales constituent la vengeance favorite des esprits bornés à l'encontre de ceux qui le sont moins ; ils y trouvent une sorte de dédommagement pour avoir été mal partagés par la nature ; enfin, c'est pour eux une occasion d'acquérir de l' esprit et de s'affiner : la méchanceté rend intelligent. Ils se réjouissent au fond de leur cœur de penser qu'il existe un plan où les individus comblés des biens et des privilèges de l'esprit demeurent leurs égaux : ils luttent pour l' « égalité de tous devant Dieu » et, ne fût-ce que pour cela, ils ont besoin de croire en Dieu. C'est parmi ces gens que se recrutent les adversaires les plus acharnés de l'athéisme. (PDBM/86-§219)
Schopenhauer fut, en tant que philosophe le premier athée convaincu et inflexible que nous ayons eu, nous autres Allemands : c'est là le fond de son inimitié contre Hegel. Il considérait la non-divinité de l'existence comme quelque chose de donné, de palpable, d'indiscutable; il perdait chaque fois son sang-froid de philosophe et se mettait dans tous ses états lorsqu'il voyait quelqu'un hésiter ici et faire des périphrases. C'est sur ce point que repose toute sa droiture : car l'athéisme absolu et loyal est la condition première à la position de son problème, il est pour lui une victoire, définitive et difficilement remportée, de la conscience européenne, l'acte le plus fécond d'une éducation de deux mille ans dans le sens de la vérité, qui finalement s'interdit le mensonge de la foi en Dieu... (LGS/86-§357)
L’avènement du Dieu chrétien, l’expression la plus haute du divin atteinte jusque-là, a aussi fait éclore sur la terre le maximum du sentiment d’obligation. À supposer que nous ayons commencé à entrer dans le mouvement contraire, il serait permis de conclure, avec quelque vraisemblance, du déclin irrésistible de la foi au dieu chrétien, à un déclin de la conscience de la dette (faute) chez l’homme, déclin déjà fort rapide aujourd’hui ; on pourrait même prévoir que le triomphe complet et définitif de l’athéisme libérerait l’humanité de tout sentiment d’une obligation envers son origine, sa causa prima. L’athéisme et une sorte de seconde innocence sont liés l)
Pour le moment il me suffira d’avoir indiqué ceci : l’idéal ascétique, même dans les plus hautes sphères de l’intelligence, n’a pour l’instant qu’une seule espèce d’ennemis vraiment nuisibles : ce sont les comédiens de cet idéal — car ils éveillent la défiance. Partout ailleurs, dès que l’esprit est à l’œuvre avec sérieux, énergie et probité, il se passe absolument d’idéal, — l’expression populaire de cette abstinence est « athéisme » — : à cela près qu’il veut la vérité. Mais cette volonté, ce reste d’idéal est, si l’on veut m’en croire, cet idéal ascétique même sous sa forme la plus sévère, la plus spiritualisée, la plus purement ésotérique, la plus dépouillée de toute enveloppe extérieure ; elle est par conséquent, moins un reste que le noyau solide de cet idéal. L’athéisme absolu, loyal (— et c’est dans son atmosphère seulement que nous respirons à l’aise, nous autres esprits spirituels de ce temps!) n’est donc pas en opposition avec cet idéal, comme il semble au premier abord ; il est au contraire une phase dernière de son évolution, une de ses formes finales, une de ses conséquences intimes, — il est la catastrophe imposante d’une discipline deux fois millénaire de l’instinct de vérité, qui, en fin de compte, s’interdit le mensonge de la foi en Dieu. (GM/87-td§27)
L'athéisme n'est pas chez moi le résultat de quelque chose et encore moins un événement de ma vie : chez moi il va de soi, il est une chose instinctive. (EH/88-2§1)
Peut-être suis-je même jaloux de Stendhal ? II m'a enlevé l'une des meilleures plaisanteries d'athée que j'aurais pu faire : « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas »... Moi-même j'ai dit quelque part : Quelle fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence ? Dieu... (EH/88-2§3)
Je voulus me rendre à Aquila, cet endroit qui incarne l'idée contraire de Rome et qui fut fondé par inimitié contre Rome, de même que je fonderai un jour un lieu, en souvenir d'un athée et d'un ennemi de l'Église comme il faut à qui me lie une parenté très proche, le grand empereur de Hohenstaufen Frédéric II. (EH/88-3APZ§4)
AU-DELA
L'au-delà, volonté de nier toute réalité ; (ANT/88-§62)
AUTRUI - PROCHAIN
Nous craignons une disposition hostile chez le prochain, parce que nous avons peur que, par cette disposition, il ne pénètre nos secrets. (HTH/78-§335)
Les mauvais propos d'autrui sur nous ne s'adressent souvent pas proprement à nous, mais sont l'expression d'un dépit, d'une maussaderie provenant de raisons tout autres. (HTH/78-§562)
Que comprenons-nous donc de notre prochain, sinon ses frontières, je veux dire ce qui lui permet en quelque sorte de s'inscrire et de s'imprimer sur nous et en nous? Nous ne comprenons rien de lui, sinon les modifications qu'il provoque en nous, — la connaissance que nous avons de lui ressemble à un espace de forme creuse. Nous lui prêtons les sensations que ses actions suscitent en nous et nous lui attribuons ainsi une fausse positivité inversée. Nous lui donnons forme à partir de notre connaissance de nous-mêmes afin d'en faire un satellite de notre propre système : et quand il s'éclaire ou s'assombrit pour nous et que nous en sommes dans les deux cas la cause dernière, — nous croyons tout le contraire! Monde de fantômes où nous vivons! Monde renversé, culbuté, vide, et pourtant plein et droit en rêves! (AUR/81-§118)
La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l’amour du prochain. Ce n’est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu’à présent les victimes.
Vous vous empressez auprès du prochain et vous exprimez cela par de belles paroles. Mais je vous le dis : votre amour du prochain, c’est votre mauvais amour de vous-mêmes.
Regardez, voici une nouvelle table : mais où sont mes frères qui la porteront avec moi dans la vallée et dans les cœurs de chair ? –
AVENIR - PASSÉ - PRÉSENT
Quand on a beaucoup de choses à y mettre, la journée a cent poches. (HTH/78-§527)
Il y a de grands avantages à se retirer un jour de son temps dans une forte mesure, et pour ainsi dire à se laisser entraîner loin de son rivage sur l'océan des conceptions passées du monde. De là, regardant vers le rivage, on en embrasse pour la première fois sans doute la configuration d'ensemble, et quand on s'en rapproche, on a l'avantage de le comprendre mieux en totalité que ceux qui ne l'ont jamais quitté. (HTH/78-§616)
L'oiseau Phénix montra au poète un rouleau enflammé et presque carbonisé. « Ne t'effraye pas ! Dit-il, c'est ton œuvre ! Elle n'a pas l'esprit du temps, et encore moins l'esprit de ceux qui sont contre le temps : par conséquent, elle doit être brûlée. Mais c'est bon signe. Il y a maintes sortes d'aurores. » (AUR/81-§568)
Ceci est ma pitié à l’égard de tout le passé que je le vois abandonné, – abandonné à la grâce, à l’esprit et à la folie de toutes les générations de l’avenir, qui transformeront tout ce qui fut en un pont pour elles-mêmes !
Pendant ces dernières années, je me suis contenté de faire le décompte, le bilan, d'additionner le passé, j'en ai enfin fini avec les hommes et les choses, et j'ai tiré un trait dessus. Qui dois-je garder et quoi, à présent qu'il me faut passer à l'enjeu véritable de mon existence (que je suis condamné à y passer), voilà à présent la question essentielle. Car, soit dit entre nous, la tension dans laquelle je vis, la pression exercée par la grandeur de ma tâche et de ma passion sont choses trop grandes pour que des gens nouveaux puissent m'approcher désormais. Et de fait, autour de moi, le désert est terrible ; je ne supporte plus, à dire vrai, que les parfaits étrangers et les rencontres de hasard, et, sinon, ceux qui m’ont appartenu de tout temps, et depuis mon enfance. (DL/87-CVG)
Au fond, tout maintenant fait époque en moi ; tout mon passé s'émiette autour de moi ; et quand je fais le compte de ce que j'ai fait, notamment pendant les deux dernières années, cela m'apparaît désormais toujours comme un seul et même travail pour m'isoler de mon passé, pour trancher le cordon ombilical entre moi et lui. J'ai tant vécu, voulu et peut-être obtenu, que j'ai besoin d'une sorte d'arrachement pour de nouveau m'éloigner et me séparer de tout cela. (DL/88-PD)
Désormais et pour les années à venir, je ne demande qu’une seule chose : le calme, l’oubli, l’indulgence du soleil et de l’automne pour quelque chose qui veut mûrir, pour ce qui sera la sanction et justification à posteriori de tout mon être (d’un être qui par ailleurs a mille raisons de demeurer éternellement problématique !). (DL/88-PD)
… il est certain que je me limite actuellement à penser au jour le jour, que je décide aujourd'hui ce qui doit arriver demain — et pas pour un jour de plus ! Il est possible que ce soit irrationnel, incommode, peu chrétien même peut-être — le bon pasteur dans son sermon sur la montagne interdisait précisément « ce souci du lendemain » — mais cela me semble au plus haut point philosophique. (DL/88-GB)
BEAUTÉ - LAIDEUR
La plus noble sorte de beauté est celle qui ne ravit pas d'un seul coup, qui ne livre pas d'assauts orageux et enivrants (celle-là provoque facilement le dégoût), mais qui lentement s'insinue, qu'on emporte avec soi presque à son insu et qu'un jour, en rêve, on revoit devant soi, mais qui enfin, après nous avoir longtemps tenu modestement au cœur, prend de nous possession complète, remplit nos yeux de larmes, notre cœur de désir. – Que désirons-nous donc à l'aspect de la beauté ? C'est d'être beaux : nous nous figurons que beaucoup de bonheur y est attaché. – Mais c'est une erreur. (HTH/ 78-§149)
On peut douter si un grand voyageur a trouvé quelque part dans le monde des sites plus laids que sur la face humaine. (HTH/78-§320)
Avec la beauté des femmes augmente en général leur pudeur. (HTH/78-§398)
On souffre peu de souhaits inexaucés si l'on a exercé son imagination à enlaidir le passé. (HTH/78-§563)
Pour qu’il y ait beauté du visage, clarté de la parole, bonté et fermeté du caractère, l’ombre est nécessaire autant que la lumière. Ce ne sont pas des adversaires : elles se tiennent plutôt amicalement par la main, et quand la lumière disparaît, l’ombre s’échappe à sa suite. (LVO/79-§1)
Je déteste ces prétendues beautés de la nature qui n'ont en somme une signification qu'au point de vue de nos connaissances, surtout de nos connaissances géographiques et qui demeurent imparfaites, lorsque nous les apprécions au point de vue de notre sens du beau : voici, par exemple, l'aspect du mont Blanc vu de Genève — c'est quelque chose d'insignifiant quand on n'appelle pas en aide les joies cérébrales de la science; les montagnes voisines sont toutes plus belles et plus expressives, — mais « elles sont loin d'être aussi hautes », ajoute, pour les diminuer, ce savoir absurde. Dans ce cas l'œil contredit le savoir : comment saurait-il se réjouir vraiment dans la contradiction ? ((LVO/79-§201)
Il ne faut pas passer sous silence cet argument en faveur des mœurs que chez chacun de ceux qui s'y soumettent entièrement, de tout cœur et dès l'origine, les organes d'attaque et de défense — tant physiques qu'intellectuels — s'atrophient : ce qui permet à cet individu de devenir toujours plus beau. Car c'est l'exercice de ces organes, et le sentiment correspondant, qui rendent laid et qui conservent la laideur. C'est pourquoi le vieux babouin est plus laid que le jeune et c'est pourquoi le jeune babouin femelle ressemble le plus à l'homme et se trouve donc être le plus beau. — Que l'on tire de là une conclusion sur l'origine de la beauté chez la femme ! (AUR/81-§25)
La puissante beauté et la finesse des princes de l'Église ont toujours démontré chez le peuple la vérité de l'Église; une brutalisation momentanée du clergé (comme du temps de Luther) amène toujours la croyance au contraire. — Et ce résultat de la beauté et de la finesse humaines, dans l'harmonie de la figure, de l'esprit et de la tâche, serait anéanti en même temps que finissent les religions ? Et il n'y aurait pas moyen d'atteindre quelque chose de plus haut, ni même d'y songer ? (AUR/81-§60)
Si nos sculpteurs, nos peintres et nos musiciens voulaient saisir le sens de l'époque, il leur faudrait montrer la beauté bouffie, gigantesque et nerveuse : tout comme les Grecs, sous la contrainte de leur morale de la mesure, voyaient et figuraient la beauté dans l'Apollon du Belvédère. Nous devrions, en somme, le trouver laid ! Mais les « classicistes » pédants nous ont enlevé toute loyauté ! (AUR/81-§161)
Que signifie notre bavardage sur les Grecs ! Qu'entendons-nous donc à leur art, dont l'âme est la passion pour la beauté virile nue ! – Ce n'est qu'en partant de là qu'ils avaient le sentiment de la beauté féminine. Ils avaient donc, pour celle-ci, une tout autre perspective que nous. Et il en était de même de leur amour de la femme : ils vénéraient autrement, ils méprisaient autrement. (AUR/81-§170)
Cette femme est belle et intelligente; hélas ! combien elle serait devenue plus intelligente si elle n'était pas belle ! (AUR/81-§282)
La tempérance se voit elle-même en beau ; elle n'y peut rien si, aux yeux des intempérants, elle paraît grossière et insipide, par conséquent laide. (AUR/81-§361)
Voici la mer, ici nous pouvons oublier la ville. Il est vrai que les cloches sonnent encore l’Ave Maria — c’est ce bruit funèbre et insensé, mais doux, au carrefour du jour et de la nuit — attendez un moment encore ! Maintenant tout se tait ! La mer s’étend pâle et brillante, elle ne peut pas parler. Le ciel joue avec des couleurs rouges, jaunes et vertes son éternel et muet jeu du soir, il ne peut pas parler. Les petites falaises et les récifs qui courent dans la mer, comme pour y trouver l’endroit le plus solitaire, tous ils ne peuvent pas parler. Cet énorme mutisme qui nous surprend soudain, comme il est beau, et cruel à dilater l’âme ! — Hélas ! quelle duplicité il y a dans cette muette beauté ! Comme elle saurait bien parler, et mal parler aussi, si elle le voulait ! Sa langue liée et le bonheur souffrant empreint sur son visage, tout cela n’est que malice pour se moquer de ta compassion ! — Qu’il en soit ainsi ! Je n’ai pas honte d’être la risée de pareilles puissances. (AUR/81-§423)
De même que nous nous promenons dans la nature, subtils et contents, pour surprendre dans toute chose sa beauté propre, comme en flagrant délit, de même que, tantôt au soleil, tantôt sous un ciel orageux, nous faisons un effort pour voir tel espace de la côte, avec ses rochers, ses haies, ses oliviers et ses pins, sous un aspect de perfection et de maîtrise : de même nous devrions aussi nous promener parmi les hommes, tels des explorateurs et des inquisiteurs, leur faisant du bien et du mal pour que se révèle la beauté qui leur est propre, ensoleillée chez celui-ci, orageuse chez celui-là, ne s’épanouissant chez un troisième que dans le demi-jour et sous un ciel de pluie. Est-il donc interdit de jouir de l’homme méchant comme d’un paysage sauvage, qui possède ses propres lignes audacieuses et ses effets de lumière, alors que ce même homme, tant qu’il se donne pour bon et conforme à la loi, apparaît à notre regard comme une erreur de dessin et une caricature et nous fait souffrir comme une tache dans la nature ? — Certainement, cela est interdit : jusqu’à présent il n’était permis de chercher la beauté que dans ce qui est moralement bon, — ce fut une raison suffisante pour trouver si peu de choses et pour être forcé de s’enquérir de beautés imaginaires sans chair ni os ! — De même qu’il existe certainement cent espèces de bonheur parmi les méchants, dont les vertueux ne se doutent pas, de même il existe chez eux cent espèces de beautés : et beaucoup d’entre elles ne sont pas encore découvertes. (AUR/81-§468)
Cherches-tu des hommes avec une belle culture ? Il te faudra accepter alors, comme lorsque tu cherches de belles contrées, des points de vue et des perspectives limités. — Certes, il y a aussi des hommes panoramiques, ils sont instructifs et étonnants : mais dépourvus de beauté. (AUR/81-§513)
Pourquoi la beauté s’accroît-elle avec la civilisation ? Parce que chez les hommes civilisés, les trois motifs de laideur se présentent toujours plus rarement : en premier lieu les passions dans leurs explosions les plus sauvages, en deuxième lieu l’effort physique poussé à l’extrême, en troisième lieu la nécessité d’inspirer la crainte par son aspect, cette nécessité qui, aux échelons inférieurs et mal établis dans la culture, est si grande et si fréquente qu’elle fixe même les attitudes et les cérémonies et fait de la laideur un devoir. (AUR/81-§515)
C’est à coups de tonnerre et de feux d’artifice célestes qu’il faut parler aux sens flasques et endormis.
En vérité, ce n’est pas dans la satiété que son désir doit se taire et sombrer, mais dans la beauté.
La beauté est insaisissable pour tout être violent.
Quand la puissance se fait clémente, quand elle descend dans le visible : j’appelle beauté une telle condescendance.
Tu dois imiter la vertu de la colonne : elle devient toujours plus belle et plus fine à mesure qu’elle s’élève, mais plus résistante intérieurement.
Où a-t-il de la beauté ? Là où il faut que je veuille de toute ma volonté ; où je veux aimer et disparaître, afin qu’une image ne reste pas image seulement. (APZ/83-85-p2)
Rien n’est plus confidentiel, disons plus restreint que notre sens du beau. Celui qui voudrait se le figurer, dégagé de la joie que l’homme cause à l’homme, perdrait pied immédiatement. Le « beau en soi » n’est qu’un mot, ce n’est pas même une idée. Dans le beau l’homme se pose comme mesure de la perfection ; dans des cas choisis il s’y adore. Une espèce ne peut pas du tout faire autrement que de s’affirmer de cette façon. Son instinct le plus bas, celui de la conservation et de l’élargissement de soi, rayonne encore dans de pareilles sublimités. L’homme se figure que c’est le monde lui-même qui est surchargé de beautés, — il s’oublie en tant que cause de ces beautés. Lui seul l’en a comblé, hélas ! d’une beauté très humaine, rien que trop humaine !... En somme, l’homme se reflète dans les choses, tout ce qui lui rejette son image lui semble beau : le jugement « beau » c’est sa vanité de l’espèce... Un peu de méfiance cependant peut glisser cette question à l’oreille du sceptique : le monde est-il vraiment embelli parce que c’est précisément l’homme qui le considère comme beau ? Il l’a représenté sous une forme humaine : voilà tout. Mais rien, absolument rien, ne nous garantit que le modèle de la beauté soit l’homme. Qui sait quel effet il ferait aux yeux d’un juge supérieur du goût ? Peut-être paraîtrait-il osé ? peut-être même réjouissant ? peut-être un peu arbitraire ?... (LCI/88-9§19)
Je prends un cas isolé. Schopenhauer parle de la beauté avec une ardeur mélancolique. — Pourquoi en agit-il ainsi ? Parce qu’il voit en elle un pont sur lequel on peut aller plus loin, ou bien sur lequel on prend soif d’aller plus loin... Elle est pour lui la délivrance de la « volonté » pour quelques moments — elle attire vers une délivrance éternelle... Il la vante surtout comme rédemptrice du « foyer de la volonté », de la sexualité, — dans la beauté il voit la négation du génie de la reproduction... Saint bizarre ! Quelqu’un te contredit, je le crains bien, et c’est la nature. Pourquoi y a-t-il de la beauté dans les sons, les couleurs, les parfums, les mouvements rythmiques de la nature ? Qu’est-ce qui pousse la beauté au dehors ? Heureusement qu’il est aussi contredit par un philosophe, et non des moindres. Le divin Platon (— ainsi l’appelle Schopenhauer lui-même) soutient de son autorité une autre thèse : que toute beauté pousse à la reproduction, que c’est là précisément l’effet qui lui est propre, depuis la plus basse sensualité jusqu’à la plus haute spiritualité... (LCI/88-9§22)
La beauté d’une race, d’une famille, sa grâce, sa perfection dans tous les gestes est acquise péniblement : elle est, comme le génie, le résultat final du travail accumulé des générations. Il faut avoir fait de grands sacrifices au bon goût, il faut à cause de lui avoir fait et abandonné bien des choses ; le XVIIe siècle, en France, mérite d’être admiré sous ce rapport, — on avait alors un principe d’élection pour la société, le milieu, le vêtement, les satisfactions sexuelles ; il fallut préférer la beauté à l’utilité, à l’habitude, à l’opinion, à la paresse. Règle supérieure : on ne doit pas « se laisser aller » même devant soi-même. (LCI/88-9§47)
BESOIN
Le besoin passe pour la cause de l'apparition : en vérité, il n'est souvent qu'un effet de la chose apparue. (LGS/82-§205)
BÊTISE - SOTTISE
Tout homme qui a décidé que l'autre est un imbécile, un sale individu, se fâche quand l'autre montre enfin qu'il ne l'est pas. (HTH/78-§90)
Dans la lutte avec la sottise, les plus modérés et les plus doux des hommes finissent par devenir brutaux. Peut-être sont-ils par là dans la véritable voie de défense; car au front stupide, l'argument qui convient de droit est le poing fermé. Mais parce que, comme j'ai dit, leur caractère est doux et modéré, ils souffrent par ce moyen de défense légitime plus qu'ils ne font souffrir. (HTH/78-§362)
BIBLE
Et en fin de compte : que doit-on attendre des effets ultérieurs d'une religion qui dans les siècles où elle fut fondée s'est livrée à une bouffonnerie philologique inouïe sur l'Ancien Testament : je parle de la tentative d'escamoter aux Juifs sous leur nez l'Ancien Testament, en prétendant qu'il ne contient que des enseignements chrétiens et qu'il appartient aux chrétiens en tant que véritable peuple d'Israël : alors que les Juifs n'auraient fait que se l'arroger. Ensuite on s'abandonna à un délire d'interprétation et d'interpolation qui ne pouvait absolument pas s'allier à la bonne conscience : les savants juifs avaient beau protester, il devait, dans l'Ancien Testament, être partout question du Christ, et seulement du Christ, et particulièrement de sa croix, et partout où il était question d'un morceau de bois, d'une verge, d'une échelle, d'un rameau, d'un arbre, d'un saule, d'un bâton, cela devait être une prophétie du bois de la croix : même l'érection de la licorne et du serpent d'airain, même Moïse lorsqu'il étend les bras pour prier, et jusqu'aux épieux sur lesquels on rôtit l'agneau pascal, — tout cela ne serait qu'allusions et pour ainsi dire préludes à la croix ! Un seul de ceux qui l'affirmaient y a-t-il jamais cru ? Souvenons-nous que l'Église n'a pas hésité à allonger le texte des Septante (par ex. au psaume 96, verset 10) pour exploiter ensuite le passage frauduleusement interpolé dans le sens d'une prophétie chrétienne. C'est que l'on était en guerre et que l'on pensait aux adversaires et non à l'honnêteté. (AUR/81-§84)
A-t-on vraiment compris la fameuse histoire qui se trouve au commencement de la Bible – celle de la peur « infernale » que Dieu a de la science ?... On ne l’a pas comprise. (ANT/88-§48)
L'obligation de croire que toutes choses se trouvent dans les meilleures mains, qu'un seul livre, la bible, rassure définitivement au sujet du gouvernement divin et de la sagesse dans les destinées de l'humanité, si on la transcrit dans la réalité, équivaut à la volonté d'étouffer la vérité qui démontrerait exactement le contraire, à savoir cette conviction lamentable que jusqu'à présent l'humanité a été en de mauvaises mains, qu'elle a été gouvernée par les déshérités qu'anime la ruse et la vengeance, par ceux que l'on appelle les « saints », ces calomniateurs du monde qui souillent la race humaine. (EH/88)
BIEN - MAL
Le concept de bien et de mal a une double préhistoire : d'abord dans l'âme des races et des castes dirigeantes. Qui a le pouvoir de rendre la pareille, bien pour bien, mal pour mal, et qui la rend en effet, qui par conséquent exerce reconnaissance et vengeance, on l'appelle bon ; qui est impuissant et ne peut rendre la pareille, compte pour mauvais. On appartient, en qualité de bon, à la classe des « bons », à un corps qui a un esprit de corps, parce que tous les individus sont, par le sentiment des représailles, liés les uns aux autres. On appartient, en qualité de mauvais, à la classe des « mauvais », à un ramassis d'hommes assujettis, impuissants, qui n'ont point d'esprit de corps. Les bons sont une caste, les mauvais une masse pareille à la poussière. Bon et mauvais équivalent pour un temps à noble et vilain, maître et esclave. (HTH/78-§45)
Là où la faible faculté visuelle de l'œil ne permet plus de voir la pulsion mauvaise en raison de sa finesse, l'homme établit l'empire du bien, et le sentiment d'avoir désormais pénétré dans l'empire du bien stimule toutes les pulsions qui étaient menacées et restreintes par les pulsions mauvaises, comme le sentiment de sécurité, de bien-être, de bienveillance. Donc : plus l'œil manque d'acuité, plus le bien est étendu! D'où l'éternelle gaieté d'esprit du peuple et des enfants ! D'où le caractère sombre et la tristesse apparentée à la mauvaise conscience des grands penseurs ! (LGS/82-§53)
« Bien et mal sont les préjugés de Dieu » — dit le serpent. (LGS/82-§259)
Qu’est-ce qui est bien ? Demandez-vous. Être brave, voilà qui est bien. Laissez dire les petites filles : « Bien, c’est ce qui est en même temps joli et touchant. » (APZ/83-85-p1)
En vérité, je vous le dis : le bien et le mal qui seraient impérissables – n’existent pas ! Il faut que le bien et le mal se surmontent toujours de nouveau par eux-mêmes.
Lorsque je suis venu auprès des hommes, je les ai trouvés assis sur une vieille présomption. Ils croyaient tous savoir, depuis longtemps, ce qui est bien et mal pour l’homme.
Quand il y a des planches jetées sur l’eau, quand des passerelles et des balustrades passent sur le fleuve : en vérité, alors on n’ajoutera foi à personne lorsqu’il dira que « tout coule ».
Il y a une vieille folie qui s’appelle bien et mal. La roue de cette folie a tourné jusqu’à présent autour des devins et des astrologues.
BIENVEILLANCE
Parmi les petites choses, mais infiniment fréquentes et par là très efficaces, auxquelles la science doit donner plus d'attention qu'aux grandes choses rares, il faut compter la bienveillance ; j'entends ces manifestations de dispositions amicales dans les relations, ce sourire de ces poignées de main, cette bonne humeur, dont pour l'ordinaire presque tous les actes humains sont enveloppés. Tout professeur, tout fonctionnaire fait cette addition à ce qui est un devoir pour lui; c'est la forme d'activité constante de l'humanité, c'est comme les ondes de sa lumière, dans lesquelles tout se développe ; particulièrement dans le cercle le plus étroit, à l'intérieur de la famille, la vie ne verdoie et ne fleurit que par cette bienveillance. La cordialité, l'affabilité, la politesse de cœur sont des dérivations toujours jaillissantes de l'instinct altruiste et ont contribué bien plus puissamment à la civilisation que ces manifestations beaucoup plus fameuses du même instinct que l'on appelle sympathie, miséricorde et sacrifice. Mais on a coutume de les estimer peu : et le fait est qu'il n'y entre pas beaucoup d'altruisme. La somme de ces doses minimes n'en est pas moins considérable, leur force totale constitue une des forces les plus fortes. – De même, on trouvera bien plus de bonheur dans le monde que n'en voient des yeux sombres : je veux dire si l'on fait bien son compte, et si seulement on n'oublie pas ces moments de bonne humeur dont toute journée est riche dans toute vie humaine, même dans la plus tourmentée. (HTH/78-§49)
Dans les relations du monde civilisé, chacun se sent supérieur à un autre en une chose au moins ; c'est là-dessus que repose la bienveillance générale, parce que chacun est capable à l'occasion de rendre service, par conséquent, peut sans honte accepter un service. (HTH/78-§509)
Puisque tu es bienveillant et juste, tu dis : « Ils sont innocents de leur petite existence. » Mais leur âme étroite pense : « Toute grande existence est coupable. »
BLASPHÈME
Autrefois le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème, mais Dieu est mort et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre ! (APZ/83-85-p1)
BLESSER - MORTIFIER
Ne vouloir mortifier, ne vouloir blesser personne, peut être aussi bien une marque de justice que de timidité. (HTH/78-§314)
BON - MAUVAIS - MÉCHANT
La méchanceté n'a pas pour but en soi la souffrance d'autrui, mais sa propre jouissance, sous forme par exemple d'un sentiment de vengeance ou d'une forte excitation nerveuse. Rien que la taquinerie montre quel plaisir il y a à exercer sa puissance sur autrui et à en arriver au sentiment agréable de la supé-riorité. Maintenant, l'immoralité consiste-t-elle à prendre du plaisir au déplaisir d'autrui ? La joie de nuire est-elle diabolique, comme le dit Schopenhauer? Le fait est que nous prenons plaisir dans la nature à rompre des branches, à briser des pierres, à combattre les animaux sauvages, et cela, pour en tirer la conscience de notre force. Le fait de savoir qu'un autre souffre par nous rendrait donc immorale ici la même chose à l'égard de laquelle nous nous sentons autrement irresponsables ? Mais si on ne le savait pas, on n'y trouverait pas non plus le plaisir de sa supériorité ; celle-ci ne peut se manifester que dans la souffrance d'autrui, par exemple dans la taquinerie. Tout plaisir en lui-même n'est ni bon ni mauvais ; d'où viendrait alors cette distinction que, pour prendre plaisir à soi-même, on n'a pas le droit d'exciter le déplaisir d'autrui ? Uniquement du point de vue de l'utilité, c'est-à-dire de la considération des conséquences, d'un déplaisir éventuel, au cas où l'homme lésé, ou l'Etat qui le représente, ferait attendre un châtiment et une vengeance : cela seul peut à l'origine avoir fourni le motif pour s'interdire de tels actes. (HTH/78-§103)
Les bonnes actions sont de mauvaises actions sublimées : les mauvaises actions sont de bonnes actions grossièrement, sottement accomplies. (HTH/78-§107)
Seul invente une amélioration celui qui sait ressentir : « Ceci n'est pas bon. (LGS/82-§243)
Mais ceci est ma troisième sagesse humaine que je ne laisse pas votre timidité me dégoûter de la vue des méchants.
Je n’ai pas été attaché à cette croix, qui est de savoir que l’homme est méchant, mais j’ai crié comme personne encore n’a crié :
Être véridique : peu de gens le savent ! Et celui qui le sait ne veut pas l'être ! Moins que tous les autres, les bons.
Ô ces bons ! – Les hommes bons ne disent jamais la vérité ; être bon d’une telle façon est une maladie pour l’esprit.
Ô mes frères ! où est le plus grand danger de tout avenir humain ? N’est-ce pas chez les bons et les justes ! –
Ô mes frères, avez-vous aussi compris cette parole ? Et ce que j’ai dit un jour du « dernier homme » ? –
… le jugement « bon » n’émane nullement de ceux à qui on a prodigué la « bonté » ! Ce sont bien plutôt les « bons » eux-mêmes, c’est-à-dire les hommes de distinction, les puissants, ceux qui sont supérieurs par leur situation et leur élévation d’âme qui se sont eux-mêmes considérés comme « bons », qui ont jugé leurs actions « bonnes », c’est-à-dire de premier ordre, établissant cette taxation par opposition à tout ce qui était bas, mesquin, vulgaire et populacier. C’est du haut de ce sentiment de la distance qu’ils se sont arrogé le droit de créer des valeurs et de les déterminer : que leur importait l’utilité ! Le point de vue utilitaire est tout ce qu’il y a de plus étranger et d’inapplicable au regard d’une source vive et jaillissante de suprêmes évaluations, qui établissent et espacent les rangs : ici le sentiment est précisément parvenu à l’opposé de cette froideur qui est la condition de toute prudence intéressée, de tout calcul d’utilité — et cela, non pas pour une seule fois, pour une heure d’exception, mais pour toujours. La conscience de la supériorité et de la distance, je le répète, le sentiment général, fondamental, durable et dominant d’une race supérieure et régnante, en opposition avec une race inférieure, avec un « bas-fond humain » — voilà l’origine de l’antithèse entre « bon » et « mauvais ». (GM/87-pd§2)
L’indication de la véritable méthode à suivre m’a été donnée par cette question : Quel est exactement, au point de vue étymologique, le sens des désignations du mot « bon » dans les diverses langues ? C’est alors que je découvris qu’elles dérivent toutes d’une même transformation d’idées, — que partout l’idée de « distinction », de « noblesse », au sens du rang social, est l’idée mère d’où naît et se développe nécessairement l’idée de « bon » au sens « distingué quant à l’âme », et celle de « noble », au sens de « ayant une âme d’essence supérieure », « privilégié quant à l’âme ». Et ce développement est toujours parallèle à celui qui finit par transformer les notions de « vulgaire », « plébéien », « bas » en celle de « mauvais ». L’exemple le plus frappant de cette dernière métamorphose c’est le mot allemand schlecht (mauvais) qui est identique à schlicht (simple) — comparez schlechtweg (simplement), schlechterdings (absolument) — et qui, à l’origine, désignait l’homme simple, l’homme du commun, sans équivoque et sans regard oblique, uniquement en opposition avec l’homme noble. Ce n’est que vers l’époque de la guerre de Trente Ans, assez tardivement comme on voit, que ce sens, détourné de sa source, est devenu celui qui est aujourd’hui en usage. — Voilà une constatation qui me paraît être essentielle au point de vue de la généalogie de la morale ; (GM/87-pd§4)
le problème de l’autre origine du concept bon, du concept bon tel que l’homme du ressentiment se l’est forgé, attend une solution concluante. Que les agneaux aient l’horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n’étonnera personne mais ce n’est point une raison d’en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu’ils ravissent les petits agneaux. Et si les agneaux se disent entre eux : « Ces oiseaux de proie sont méchants ; et celui qui est un oiseau de proie aussi peu que possible, voire même tout le contraire, un agneau — celui-là ne serait-il pas bon ? » — il n’y aura rien à objecter à cette façon d’ériger un idéal, si ce n’est que les oiseaux de proie lui répondront par un coup d’œil quelque peu moqueur et se diront peut-être « Nous ne leur en voulons pas du tout, à ces bons agneaux, nous les aimons même : rien n’est plus savoureux que la chair tendre d’un agneau. » — Exiger de la force qu’elle ne se manifeste pas comme telle, qu’elle ne soit pas une volonté de terrasser et d’assujettir, une soif d’ennemis, de résistance et de triomphes, c’est tout aussi insensé que d’exiger de la faiblesse qu’elle manifeste de la force. Une quantité de force déterminée répond exactement à la même quantité d’instinct, de volonté, d’action — bien plus, la résultante n’est pas autre chose que cet instinct, cette volonté, cette action même, et il ne peut en paraître autrement que grâce aux séductions du langage (et des erreurs fondamentales de la raison qui s’y sont figées) qui tiennent tout effet pour conditionné par une cause efficiente, par un « sujet » et se méprennent en cela. (GM/87-pd§13)
Les hommes bons ne disent jamais la vérité. Les hommes bons vous enseignent de faux arts et de fausses certitudes. Vous êtes nés et vous avez été abrités dans les mensonges des bons. Tout a été foncièrement déformé et perverti par les bons. (EH/88-4§4)
dans la notion de l'homme bon, on prend parti pour tout ce qui est faible, malade, mal venu, pour tout ce qui souffre de soi-même, pour tout ce qui doit disparaître. La loi de la sélection est contrecarrée. De l'opposition à l'homme fier et d'une bonne venue, à l'homme affirmatif qui garantit l'avenir, on fait un idéal. Cet homme devient l'homme méchant... Et l'on a ajouté foi à tout cela, sous le nom de morale ! — Écrasez l'infâme ! (EH/88-4§8)
Les hommes qui s'efforcent de parvenir à la grandeur sont en général méchants : c'est leur seule façon de se supporter eux-mêmes. (aphorisme rédigé à l'attention de Lou Salomé)
BONHEUR
Une ère de bonheur est absolument impossible par la raison que les hommes ne veulent que la souhaiter sans la vouloir vraiment, et tout individu, lorsque lui viennent d'heureux jours, apprend littéralement à demander au ciel le trouble et la misère. Le destin des hommes est disposé pour d'heureux moments — toute vie en a de tels — mais non pour des époques heureuses. (HTH/78-§471)
Tout près de la douleur du monde et souvent sur son sol volcanique, l'homme a établi son petit jardin de bonheur. Que l'on considère la vie avec l'œil de l'homme qui ne demande à la vie que la connaissance, ou de celui qui s'abandonne et se résigne, ou de celui qui prend son plaisir à la difficulté vaincue, — partout on trouve quelque bonheur poussé à côté de l'infortune — et d'autant plus de bonheur que le sol est plus volcanique; seulement il serait ridicule de dire que par ce bonheur la souffrance elle-même est justifiée. (HTH/ 78-§591)
Qu'est-ce qui a le plus contribué au bonheur de l'humanité, les choses véritables ou les choses imaginées? Il est certain que la distance séparant l'extrême bonheur du malheur le plus profond n'a pris toute son ampleur qu'à la faveur des choses imaginées. Cette sorte de sentiment de l'espace se réduit par suite constamment sous l’action de la science : de même celle-ci nous a appris et nous apprend encore à éprouver que la terre est petite et que le système solaire lui-même n'est qu'un point. (AUR/81-§7)
Dans la mesure où il recherche son bonheur, on ne doit donner à l'individu aucun précepte sur la façon d'atteindre le bonheur : car le bonheur individuel jaillit selon ses lois propres, ignorées de tous, il ne peut être qu'embarrassé et entravé par des préceptes extérieurs. — Les préceptes que l'on nomme « moraux » sont en vérité dirigés contre les individus et ne veulent absolument pas leur bonheur. Ces préceptes se rapportent tout aussi peu au « bonheur et à la prospérité de l'humanité », — termes auxquels il est de toute façon impossible de lier des concepts rigoureux, bien loin qu'on puisse les utiliser comme des étoiles qui nous guideraient sur le sombre océan des aspirations morales. (AUR/81-§108)
Un sage demanda à un fou quel était le chemin du bonheur. Celui-ci répondit à l'instant, comme quelqu'un à qui l'on demande le chemin de la ville la plus proche : « Admire-toi toi-même et vis dans la rue ! » « Halte, cria le sage, tu en exiges trop, il est bien suffisant de s'admirer soi-même ! » Le fou répliqua : « Mais comment admirer constamment si l'on ne méprise pas constamment ? » (LGS/82-§213)
Il suffit d'un unique homme triste pour répandre une morosité permanente et un ciel chargé sur une famille entière ; et il faut un miracle pour que cet unique individu n'existe pas ! — Le bonheur est loin d'être une maladie aussi contagieuse, — d'où cela vient-il ? (LGS/82-§239)
Voyez-les grimper, ces singes agiles ! Ils grimpent les un sur les autres et se poussent ainsi dans la boue et dans l’abîme.
Depuis qu’il y a des hommes, l’homme s’est trop peu réjoui. Ceci seul, mes frères, est notre péché originel. (APZ/83-85-p2)
Nous avons découvert le bonheur, nous connaissons le chemin, nous avons trouvé l’issue de ces milliers d’années de labyrinthe. … (ANT/88-§1)
Nous avions soif d’éclairs et d’actions d’éclat, nous nous tenions le plus loin possible du bonheur des débiles, de la « soumission »… Notre air était chargé d’orages, la nature, en nous, s’assombrissait – car nous n’avions pas trouvé notre voie. Formule de notre bonheur : un seul « oui » un seul « non », une ligne droite, un but… (ANT/88-§1)
Qu’est-ce que le Bonheur ? Le sentiment que la puissance croît, qu’une résistance est en voie d’être surmontée. (ANT/88-§2)
Formule de mon bonheur : un oui, un non, une ligne droite, un but... (LCI/88-1§44)
BONTÉ
La bonté et la pitié sont heureusement indépendantes du dépérissement et de la réussite d'une religion : par contre les bonnes actions sont bien déterminées par des impératifs religieux. La majeure partie des bonnes actions conformes au devoir n'a aucune valeur éthique, mais est obtenue par contrainte. (LDP/72-75-ch.1§45)
Les hommes bons de toute époque sont ceux qui enfouissent profondément les pensées anciennes, et leur font produire leurs fruits, les cultivateurs de l'esprit. (LGS/82-§4)
Garde-toi des bons et des justes ! Ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leur propre vertu, - ils haïssent le solitaire. (APZ/83-85-p1)
La bêtise des bons est insondable. (APZ/83-85-p3)
Voyez les bons et les justes ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise leurs tables des valeurs, le destructeur, le criminel : - mais c'est celui-là le créateur. (APZ/83-85-p1)
BOUDDHA - BOUDDHISME
Bouddha dit : N'adule pas ton bienfaiteur! " Qu'on répète cette sentence dans une église chrétienne : - elle purifie instantanément l'air de tout ce qu'il contient de chrétien. (LGS/82-§142)
Par ma condamnation du christianisme, je ne voudrais pas avoir porté tort à une religion qui lui est apparentée, et qui la surpasse même par le nombre des fidèles : je veux parler du bouddhisme - Toutes deux ont en commun d'être des religions nihilistes - ce sont des religions de décadence -, mais ce qui les sépare est saisissant. (ANT/88-§20)
Le bouddhisme est cent fois plus réaliste que le christianisme - il a dans le sang l'habitude acquise de poser les problèmes froidement et objectivement, il vient après un mouvement philosophique qui a duré des centaines d'années - la notion de " Dieu " est déjà abolie quand il survient. Le bouddhisme est la seule religion positiviste que nous montre l'Histoire, et même dans sa théorie de la connaissance (un strict phénoménisme) - il ne dit plus : " guerre au péché ", mais, rendant à la réalité ce qui lui est dû : " guerre à la souffrance ". (ANT/88-§20)
Dans la doctrine du Bouddha, l'égoïsme devient un devoir, c'est la chose dont il est dit qu' " il est besoin " et la question : " Comment échapperas-tu, toi, à la douleur ? ", règle et délimite tout le régime imposé à l'esprit (- il n'est peut-être pas illégitime d'évoquer ici cet Athénien qui fit également la guerre au " pur esprit scientifique ", Socrate, qui, lui aussi, dans le domaine des problèmes, élevait l'égoïsme individuel au rang de morale.) (ANT/88-§20)
Le bouddhisme suppose un climat très doux, des mœurs d'une grande aménité et d'une grande tolérance, pas trace de militarisme; et aussi que le foyer du mouvement se trouve dans les classes supérieures et même savantes. On s'assigne comme but suprême la sérénité, la paix, l'extinction de tout désir, et l'on atteint ce but. Le bouddhisme n'est pas une religion dans laquelle on aspire seulement à la perfection; le parfait y est le cas normal. (ANT/88-§21)
Le bouddhisme est une religion pour hommes tardifs, pour des races débonnaires, douces, devenues hypercérébrales, qui ressentent trop aisément la souffrance (l'Europe est encore loin d'être mûre pour cela) : il les ramène à la paix et à la sérénité, à la diète dans l'ordre mental et à un certain endurcissement dans l'ordre physique. (ANT/88-§22)
Le bouddhisme ne promet pas, mais tient ; le christianisme promet tout, mais ne tient rien. (ANT/88-§42)
BUT
C'est seulement si l'humanité avait un but universellement reconnu que l'on pourrait proposer : " il faut agir comme ceci et comme cela " : pour l'instant il n'existe aucun but de ce genre. On ne doit donc pas rapporter à l'humanité les exigences de la morale, c'est déraison et enfantillage. - Recommander un but à l'humanité représente quelque chose de tout différent : le but est alors conçu comme quelque chose qui dépend de notre bon plaisir ; (AUR/81-§108)
Avec un grand but, on est même supérieur à la justice, pas seulement à ses actes et à ses juges. (LGS/82-§267)
CARACTÈRE – TEMPÉRAMENT
Nous cherchons inconsciemment les principes et les doctrines appropriés à notre tempérament, si bien qu'à la fin il semble que ce soient ces principes et ces doctrines qui aient créé notre caractère. Notre pensée et notre jugement sont censés, après coup, d'après les apparences, être la cause de notre être mais dans le fait c'est notre être qui est cause que nous pensons et jugeons de telle ou telle manière. – Et qu'est-ce qui nous détermine à cette comédie presque inconsciente? L'indolence et le laisser-aller, et, non pour la moindre part, le désir de notre vanité d'être trouvé logique d'un bout à l'autre, uniforme en être et en pensée; car cela procure de la considération, donne de la confiance et de la puissance. (HTH/78-§608)
Le caractère désagréable, qui est plein de méfiance, qui ressent avec envie tout heureux succès de ses confrères et de ses proches, qui est violent et furieux contre les opinions dissidentes, montre qu'il appartient à un stade antérieur de la civilisation, qu'il est donc une survivance; car la manière dont il a commerce avec les hommes convenait aux conditions d'un âge où régnait le droit du plus fort; c'est un homme arriéré. Un autre caractère, qui est riche de sympathie, se fait partout des amis, ressent avec cordialité tout ce qui croît et grandit, partage tous les plaisirs de l'honneur et des succès d'autrui, et ne prétend pas au privilège de connaître seul le vrai, mais est rempli d'une confiance modeste — c'est un homme avancé, qui lutte pour une civilisation supérieure. Le caractère désagréable dérive des temps où les grossiers fondements de la société humaine étaient encore à jeter ; l'autre vit à des étages plus hauts, aussi éloigné que possible de l'animal sauvage, qui, enfermé dans les caves, sous les assises de la civilisation, se démène et hurle sa rage. (HTH/78-§614)
CAS DE CONSCIENCE
Tu cours devant les autres ? — Fais-tu cela comme berger ou bien comme exception ? Un troisième cas serait le déserteur... Premier cas de conscience. (LCI/88-1§37)
Es-tu vrai ? Ou n’es-tu qu’un comédien ? Es-tu un représentant ? Ou bien es-tu toi-même la chose qu’on représente ? En fin de compte tu n’es peut-être que l’imitation d’un comédien... Deuxième cas de conscience. (LCI/88-1§38)
Es-tu de ceux qui regardent ou de ceux qui mettent la main à la pâte ? — ou bien encore de ceux qui détournent les yeux et se tiennent à l’écart ?... Troisième cas de conscience. (LCI/88)
Veux-tu accompagner ? ou précéder ? ou bien encore aller de ton côté ?... Il faut savoir ce que l’on veut et si l’on veut. — Quatrième cas de conscience. (LCI/88-1§40)
CAUSE - EFFET
Sur ce miroir — et notre intellect est un miroir — il se passe quelque chose qui offre de la régularité, à chaque fois une certaine chose fait de nouveau suite à certaine autre chose, — c'est ce que nous nommons, lorsque nous le percevons et voulons lui donner un nom, cause et effet, insensés que nous sommes! Comme si nous y avions compris et pouvions y comprendre quelque chose ! Nous n'avons rien vu d'autre que des images de « causes et d'effets »! Et cette représentation imagée empêche justement d'apercevoir un rapport plus essentiel que celui de la succession ! (AUR/81-§121)
Cause et effet : probablement n'existe-t-il jamais une telle dualité, — en vérité nous sommes face à un continuum dont nous isolons quelques éléments ; de même que nous ne percevons jamais un mouvement que sous forme de points isolés, que donc nous ne voyons pas véritablement mais que nous inférons. La soudaineté avec laquelle de nombreux effets se dessinent nous induit en erreur; mais ce n'est qu'une soudaineté pour nous. Il y a dans cette seconde de soudaineté une quantité infinie de processus qui nous échappent. Un intellect qui verrait cause et effet comme un continuum, non à notre manière, comme une partition et une fragmentation arbitraires, qui verrait le flux du devenir, — rejetterait le concept de cause et d'effet et nierait tout conditionnement. (LGS/82-§112)
Avant l'effet, on croit à d'autres causes qu'après l'effet. (LGS/82-§217)
La croyance dans la cause et l'effet à son siège dans le plus puissant des instincts, la vengeance. (FP/82-84-v9)
Il ne faut pas réduire faussement « cause » et « effet » à des substances, comme font les naturalistes (et quiconque, pareil à eux, fait aujourd'hui du naturalisme dans les idées — ), conformément à la commune balourdise mécanique qui laisse la cause pousser et heurter jusqu'à ce qu'elle « agisse ». Il convient de ne se servir de la « cause » et de l' « effet » que comme concepts purs, c'est-à-dire comme actions conventionnelles, commodes pour déterminer et pour s'entendre, et non pas pour expliquer quelque chose. Dans l'« en soi » il n'y a point de « lien causal », de « nécessité absolue », de « déterminisme psychologique » ; là l'« effet » ne suit point la «cause », là ne règne point la « loi ». C'est nous seuls qui avons inventé les causes, la succession, la finalité, la relativité, la contrainte, le nombre, la loi, la liberté, la modalité, le but ; et lorsque nous nous servons de ce système de signes pour introduire ceux-ci dans les choses, comme « en soi », pour les y mêler, nous ne procédons pas autrement que comme nous l'avons déjà fait, c'est-à-dire mythologiquement. (PDBM/86-§21)
Il n’y a pas d’erreur plus dangereuse que de confondre l’effet avec la cause : j’appelle cela la véritable perversion de la raison. Néanmoins cette erreur fait partie des plus anciennes et des plus récentes habitudes de l’humanité : elle est même sanctifiée parmi nous, elle porte le nom de « religion » et de « morale ». (LCI/88-6§1)
CERTITUDE – INCERTITUDE
Il y a encore des observateurs assez naïfs pour croire qu'il existe des « certitudes immédiates », par exemple « je pense », ou, comme ce fut la superstition de Schopenhauer, « je veux ». Comme si la connaissance parvenait à saisir son objet purement et simplement, sous forme de « chose en soi », comme s'il n'y avait altération ni du côté du sujet, ni du côté de l'objet. Mais je répéterai cent fois que la « certitude immédiate », de même que la « connaissance absolue », la « chose en soi » renferment une contradictio in adjecto : il faudrait enfin échapper à la magie fallacieuse des mots. (PDBM/86-16)
La croyance en des « certitudes immédiates » est une naïveté morale qui nous fait honneur, à nous autres philosophes. Mais, une fois pour toutes, il nous est interdit d'être des hommes « exclusivement moraux » ! Abstraction faite de la morale, cette croyance est une absurdité qui nous fait peu d'honneur ! Dans la vie civile la méfiance toujours aux aguets peut être la preuve d'un « mauvais caractère » et passer dès lors pour peu habile, mais, lorsque nous sommes entre nous, au delà du monde bourgeois et de ses appréciations, qu'est-ce qui devrait nous empêcher d'être déraisonnables et de nous dire : le philosophe a acquis le droit au « mauvais caractèreprésent a été le plus dupé sur la terre ? Il a aujourd'hui le devoir de se méfier, de regarder toujours de travers, comme s'il voyait des abîmes de suspicion. — On me pardonnera ce tour d'esprit macabre, car j'ai appris moi-même, depuis longtemps, à penser autrement, à avoir une évaluation différente sur le fait de duper quelqu'un et d'être dupé, et je tiens en réserve quelques bonnes bourrades pour la colère aveugle des philosophes qui se défendent d'être dupés. Eh pourquoi pas ! (PDBM/86-§34)
Quelques-uns ont encore besoin de métaphysique; mais aussi cette impétueuse aspiration à la certitude qui se décharge aujourd'hui chez la grande majorité sous une forme scientifique et positiviste, l'aspiration qui veut détenir quelque chose de manière stable (alors qu'on se montre, en raison de la chaleur de cette aspiration, plus souple et plus indolent pour ce qui est de la fondation de la certitude) : cela aussi est encore l'aspiration à un appui, un soutien, bref cet instinct de faiblesse qui, certes, ne crée pas les religions, les métaphysiques, les convictions de toutes sortes, mais – les conserve. (LGS/86-§347)
CHAOS
Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance.
CHÂTIMENT
Le châtiment a pour but d'améliorer celui qui châtie, — tel est l'ultime refuge des défenseurs du châtiment. (LGS/82-§219)
Grâce au châtiment infligé au débiteur, le créancier prend part au droit des maîtres : il finit enfin, lui aussi, par goûter le sentiment ennoblissant de pouvoir mépriser et maltraiter un être comme quelque chose qui est « au-dessous de lui » — ou, du moins dans le cas où le vrai pouvoir exécutif et l’application de la peine ont déjà été délégués à l’ « autorité », de voir du moins mépriser et maltraiter cet être. La compensation consiste donc en une assignation et un droit à la cruauté. (GM/87-dd§5)
Deux mots encore sur l’origine et le but du châtiment — deux problèmes distincts ou qui du moins devraient l’être, mais que par malheur on confond généralement. Comment, dans ce cas, les généalogistes de la morale ont-ils procédé jusqu’ici ? Comme toujours, ils ont été naïfs —. ils découvrent dans le châtiment un « but » quelconque, par exemple la vengeance ou l’intimidation, et placent alors avec ingénuité ce but à l’origine, comme causa fiendi du châtiment — et voilà ! Or, il faut se garder par-dessus tout d’appliquer à l’histoire des origines du droit le « but dans le droit » : et, en tout genre d’histoire, rien n’est plus important que ce principe dont on s’est pénétré si difficilement, mais qui devrait être accepté comme une vérité inattaquable, — je veux dire que la cause originelle d’une chose et son utilité finale, son emploi effectif, son classement dans l’ensemble d’un système des causes finales, sont deux points séparés toto cœlo ; que quelque chose d’existant, quelque chose qui a été produit d’une façon quelconque est toujours emporté, par une puissance qui lui est supérieure, vers de nouveaux desseins, toujours mis à réquisition, armé et transformé pour un emploi nouveau ; que tout fait accompli dans le monde organique est intimement lié aux idées de subjuguer, de dominer et, encore, que toute subjugation, toute domination équivaut à une interprétation nouvelle, à un accommodement, où nécessairement le « sens » et le « but » qui subsistaient jusque-là seront obscurcis ou même effacés complètement. (GM/87-dd§12)
Pour en revenir à notre sujet, c’est-à-dire au châtiment, il faut distinguer deux choses en lui : d’une part ce qu’il a de relativement permanent, l’usage, l’acte, le « drame », une certaine suite de procédures strictement déterminées, d’autre part la fluidité, le sens, le but, l’attente, toutes choses qui se rattachent à la mise en œuvre de ces procédures. Il faut admettre ici, sans plus, par analogie, conformément aux points de vue principaux de la méthode historique développés tout à l’heure, que la procédure elle-même est quelque chose de très ancien, d’antérieur à son utilisation pour le châtiment, que le châtiment a été introduit, par interprétation, dans la procédure (qui existait depuis longtemps, mais dont l’emploi avait un autre sens), bref qu’il n’en va pas ici comme l’ont imaginé tous nos naïfs généalogistes du droit et de la morale, pour qui la procédure a été inventée avec le châtiment pour but, comme autrefois on s’imaginait que la main avait été créée pour saisir. Pour ce qui en est de l’autre élément du châtiment, l’élément mobile, le « sens », dans un état de civilisation très avancé (celui de l’Europe contemporaine par exemple), le concept châtiment n’a plus un sens unique mais est une synthèse de « sens » : tout le passé historique du châtiment, l’histoire de son utilisation à des fins diverses, se cristallise finalement en une sorte d’unité difficile à résoudre, difficile à analyser, et, appuyons sur ce point, absolument impossible à définir. (Il est impossible de dire aujourd’hui pourquoi l’on punit en somme : tous les concepts où se résume un long développement d’une façon sémiotique échappent à une définition ; n’est définissable que ce qui n’a pas d’histoire.)
Pour qu’on puisse se représenter quelque peu combien incertain, surajouté, accidentel est le « sens » du châtiment, combien une même procédure peut être utilisée, interprétée, façonnée dans des vues essentiellement différentes, voici l’aperçu que j’ai pu donner grâce à des matériaux relativement peu nombreux et tous fortuits : Châtiment, moyen d’empêcher le coupable de nuire et de continuer ses dommages. Châtiment, moyen de se libérer vis-à-vis de l’individu lésé et cela sous une forme quelconque (même celle d’une compensation sous forme de souffrance). Châtiment en tant que restriction et limitation d’un trouble d’équilibre pour empêcher la propagation de ce trouble. Châtiment, moyen d’inspirer la terreur en face de ceux qui déterminent et exécutent le châtiment. Châtiment, moyen de compensation pour les avantages dont le coupable a joui jusque-là (par exemple lorsqu’on l’utilise comme esclave dans une mine). Châtiment, moyen d’éliminer un élément dégénéré (dans certaines circonstances toute une branche, comme le prescrit la législation chinoise : donc moyen d’épurer la race ou de maintenir un type social). Châtiment, occasion de fête pour célébrer la défaite d’un ennemi en l’accablant de railleries. Châtiment, moyen de créer une mémoire, soit chez celui qui subit le châtiment, — c’est ce qu’on appelle la « correction », — soit chez les témoins de l’exécution. Châtiment, paiement d’honoraires fixés par la puissance qui protège le malfaiteur contre les excès de la vengeance. Châtiment, compromission avec l’état primitif de la vengeance, en tant que cet état primitif est encore maintenu en vigueur par des races puissantes qui le revendiquent comme un privilège. Châtiment, déclaration de guerre et mesure de police contre un ennemi de la paix, de la loi, de l’ordre, de l’autorité, que l’on considère comme dangereux pour la communauté, violateur des traités qui garantissent l’existence de cette communauté, rebelle, traître et perturbateur, et que l’on combat par tous les moyens dont la guerre permet de disposer. (GM/87-dd§13)
CHEMIN
Et je sais une chose encore : je suis maintenant devant mon dernier sommet et devant ce qui m’a été épargné le plus longtemps. Hélas ! il faut que je suive mon chemin le plus difficile ! Hélas ! J’ai commencé mon plus solitaire voyage !
CHOSE
On dit « se complaire à une chose », mais c'est en réalité se complaire à soi-même par le moyen de cette chose. (HTH/78-§501)
L'absurdité d'une chose n'est pas une raison contre son existence, c'en est plutôt une condition. (HTH/78-§515)
On prend la chose obscure non expliquée pour plus considérable que la chose claire expliquée. (HTH/78-§532)
Qu'on pense trop de bien ou trop de mal des choses, on y trouve toujours l'avantage de recueillir une plus grande satisfaction : car avec une trop bonne opinion préconçue, nous mettons d'ordinaire plus de douceur dans les choses (les événements) qu'elles n'en contiennent réellement. (HTH/78-§622)
Bien des hommes sont si accoutumés à être seuls avec eux-mêmes qu'ils ne se comparent pas du tout à d'autres, mais qu'ils déroulent le monologue de leur existence dans un état d'esprit paisible et gai, en bonnes conversations avec eux-mêmes, et même en rires. (HTH/78-§625)
C’est l’homme qui mit des valeurs dans les choses, afin de se conserver, – c’est lui qui créa le sens des choses, un sens humain ! C’est pourquoi il s’appelle « homme », c’est-à-dire, celui qui évalue.
Celui qui ne sait pas mettre sa volonté dans les choses veut du moins leur donner un sens : ce qui le fait croire qu’il y a déjà une volonté en elles (Principe de la « foi »). (LCI/88-1§18)
CHRÉTIEN - CHRISTIANISME
Le christianisme a un flair de chasseur pour détecter tous ceux qui, par un biais quelconque, peuvent être acculés au désespoir, - seule une élite humaine en est capable. Il leur donne constamment la chasse, les épie. Pascal fit une tentative pour voir s'il n'était pas possible, à l'aide de la connaissance la plus aiguisée, d'acculer tout homme au désespoir; - la tentative échoua, à son nouveau désespoir. (AUR/81-§64)
" En faveur de la vérité du christianisme, on avait pour témoignage la vertueuse conduite des chrétiens, leur constance dans la souffrance, la fermeté de leur foi et surtout la diffusion et la croissance du christianisme en dépit de toutes ses tribulations ", - c'est ainsi qu'aujourd'hui encore vous parlez! C'est à faire pitié! Apprenez donc que tout cela ne témoigne ni pour ni contre la vérité, que la vérité se prouve autrement que la véracité, et que la seconde n'est absolument pas un argument en faveur de la première! (AUR/81-§73)
Le christianisme aussi a largement contribué aux Lumières : il enseigna le scepticisme moral de manière très pénétrante et très efficace : en accusant, en rendant aigre, mais avec une patience et une finesse infatigables : il anéantit la foi de tout individu en ses " vertus " : il fit disparaître à tout jamais de la terre ces grands vertueux dont l'Antiquité n'était pas pauvre, ces hommes du peuple qui, tout à la foi en leur perfection, déambulaient avec une majesté de toréador. (LGS/82-§122)
La décision chrétienne de trouver le monde laid et mauvais a rendu le monde laid et mauvais. (LGS/82-§130)
Désormais, c'est notre goût qui condamne le christianisme, non plus nos raisons. (LGS/82-§132)
Rien ne sert d'embellir et de farder le christianisme : il a livré une lutte à mort à ce type supérieur d'humanité, il a jeté l'anathème sur tous les instincts élémentaires de ce type. (ANT/88-§5)
Le christianisme a pris le parti de tout ce qui est bas, vil, manqué, il a fait un idéal de l'opposition à l'instinct de conservation de la vie forte. Même aux natures les mieux armées intellectuellement, il a perverti la raison, en leur enseignant à ressentir les valeurs suprêmes de l'esprit comme entachées de péché, induisant en erreur, comme des tentations. (ANT/88-§5)
On appelle le christianisme la religion de la compassion. La compassion est l'opposé des émotions toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital : elle a un effet déprimant. C'est perdre de sa force que compatir. Par la compassion s'augmente et s'amplifie la déperdition des forces que la souffrance, à elle seule, inflige à la vie. (ANT/88-§7)
Dans le christianisme, ni la morale, ni la religion n'a aucun point de contact avec la réalité. - Il n'y a que des causes imaginaires (Dieu, âme…) - Il n'y a que des effets imaginaires (péché, rédemption, grâce, expiation, rémission des péchés) - Il n'y a qu'un commerce entre des êtres imaginaires (Dieu, esprits, âmes) - Il n'y a qu'une science imaginaire de la nature (absence totale de la notion de cause naturelle) - Il n'y a qu'une psychologie imaginaire … (contrition, remords de conscience, tentation du Malin, proximité de Dieu) - Il n'y a qu'une téléologie imaginaire (le royaume de Dieu, le Jugement Dernier, la vie éternelle). (ANT/88-§15)
Chrétienne est la haine envers l'esprit, la fierté, le courage, la liberté, le libertinage de l'esprit ; chrétienne, la haine envers les sens, les joies des sens, la joie en général… (ANT/88-§21)
Chrétiens sont aussi un certain penchant à la cruauté envers soi-même et les autres; la haine de ceux qui pensent différemment; la volonté de persécution. Des représentations sombres et troublantes sont mises au premier plan : les états les plus ardemment convoités, ceux auxquels on donne les plus beaux noms, sont des états épileptoïdes; le régime alimentaire est choisi de manière à favoriser les phénomènes morbides et à surexciter les nerfs… Chrétienne est la haine envers l'esprit, la fierté, le courage, la liberté, le libertinage de l'esprit ; chrétienne, la haine envers les sens, les joies des sens, la joie en général... (ANT/88-§21)
Dans le christianisme, ce sont les instincts des asservis et des opprimés qui viennent au premier plan : ce sont les classes les plus basses qui cherchent en lui leur salut. Là, on pratique la casuistique du péché, l'autocritique, l'examen, l'inquisition de conscience comme passe-temps, pour lutter contre l'ennui. Là, on entretient constamment (par la prière) la ferveur envers un être tout-puissant nommé " Dieu " : là, on tient que le suprême bien ne peut être " atteint ", que c'est un don, une " grâce ". Là, le caractère public fait aussi complètement défaut : la cachette, la pièce obscure, voilà qui est typiquement chrétien. Là, le corps est méprisé, l'hygiène récusée pour cause de sensualité; (ANT/88-§21)
Le christianisme avait besoin de notions et de valeurs barbares, afin de se rendre maître des Barbares : telle sont l'offrande des prémices, le sang bu dans la Cène, le mépris de l'esprit et de la culture; la torture physique et morale sous toutes ses formes; la grandiose pompe du culte. (ANT/88-§22)
Le christianisme entend venir à bout de fauves : sa méthode consiste à les rendre malades - l'affaiblissement est la recette chrétienne de l'apprivoisement, de la " civilisation ". (ANT/88-§22)
Le christianisme repose sur quelques subtilités qui appartiennent en propre à l'Orient. En premier lieu, il sait qu'il est en soi parfaitement indifférent de savoir si une chose " est " vraie, mais qu'elle devient de la plus haute importance dans la mesure où on la croit vraie. (ANT/88-§23)
Pour la ferveur des femmes, il faut mettre au premier plan un saint de belle apparence, pour celle des hommes, une Vierge Marie. Cela si l'on admet que le christianisme veut établir son règne sur un terrain où des cultes d'Aphrodite ou d'Adonis ont déjà conditionné la conception même du culte. L'obligation de la chasteté accentue la véhémence et l'intériorité de l'instinct religieux, elle rend le culte plus ardent, plus passionné, plus intense. (ANT/88-§23)
C'est sur un terrain aussi faux, où toute nature, toute valeur naturelle, toute réalité avait contre elle les instincts les plus profonds de la classe au pouvoir, que s'est développé le christianisme, forme d'hostilité mortelle à la réalité qui n'a pas été surpassé jusqu'à présent. (ANT/88-§27)
Ce qui, autrefois, était simplement morbide, est devenu maintenant indécent : il est indécent d'être chrétien de nos jours. Et c'est là que commence mon dégoût. Je regarde autour de moi; il n'est rien resté, pas un seul mot, de ce qui s'appelait autrefois " vérité ". (ANT/88-§38)
Qui donc le christianisme nie-t-il? Qu'est-ce donc qu'il appelle " monde "? Le fait d'être soldat, d'être juge, d'être patriote; de se défendre; de tenir à son honneur, de chercher son avantage; d'être fier... Toute pratique de chaque instant, tout instinct, tout jugement de valeur qui se traduit en acte est aujourd'hui antichrétien. Quel monstre de fausseté faut-il que l'homme moderne soit, pour ne pas avoir honte malgré cela de se dire encore chrétien ! (ANT/88-§38)
Au fond, il n'y a jamais eu qu'un chrétien, et il est mort sur la croix. L' " Évangile " est mort sur la croix. (ANT/88-§39)
En fait, il n'y a jamais eu de chrétiens. Le " chrétien ", ou ce qui, depuis deux millénaires, se dit chrétien, repose sur une mécompréhension psychologique de soi-même. A y regarder de plus près, malgré toute sa foi, seuls dominaient en lui les instincts, - et quels instincts! (ANT/88-§39)
Dans le monde des représentations du chrétien, il n'y a rien qui risquerait seulement d'effleurer la réalité; bien au contraire, nous avons reconnu dans la haine instinctive contre toute réalité l'élément moteur, le seul élément moteur à l'origine du christianisme. Que peut-on en conclure? Qu'en psychologie aussi, l'erreur est ici radicale, c'est-à-dire qu'elle détermine l'être, qu'elle est " substance " . Otons ici un seul concept, mettons une réalité à la place, et tout le christianisme roule au Néant ! (ANT/88-§39)
Chaque parole que prononce un "Premier chrétien" est un mensonge, chaque action qu'il fait, une imposture instinctive, - toutes ses valeurs, tous ses buts sont nuisibles, mais ceux qu'il hait, ce qu'il hait, voilà qui à de la valeur. (ANT/88-§46)
Une religion telle que le christianisme, qui n'a aucun point de contact avec la réalité, qui s'écroule dès que la réalité reprend ses droits, ne serait-ce qu'en un seul point, ne peut, et c'est normal, qu'être mortellement hostile à la "sagesse du monde" - lisez : la science -. (ANT/88-§47)
Le christianisme a besoin de la maladie, à peu près comme l'hellénisme a besoin d'un excès de santé - rendre malade est la véritable intention cachée de toute la thérapeutique du salut pratiquée par l'église. Et l'église elle-même, n'est-elle pas l'asile d'aliénés catholique conçu comme suprême idéal ? (ANT/88-§51)
Le "monde intérieur" de l'homme religieux ressemble à s'y méprendre au "monde intérieur" du surexcité et de l'épuisé ; les états les plus "sublimes" que le christianisme a suspendus au-dessus de l'humanité comme "valeurs des valeurs" sont des formes épileptoïdes. L'église n'a canonisé … que des fous ou de grands simulateurs. (ANT/88-§51)
La base du christianisme, c'est la rancune des malades, leur instinct dirigé contre les bien-portants, contre la santé. Tout ce qui est achevé, fier, exubérant, et avant tout la beauté, lui fait mal aux oreilles et aux yeux. (ANT/88-§51)
Personne n'est libre de devenir chrétien à son gré; on n'est pas " converti " au christianisme, - il faut être assez malade pour le devenir... Nous autres, qui avons le courage de la santé, et aussi du mépris, combien nous avons le droit de mépriser une religion qui a enseigné la mécompréhension du corps! - qui ne veut pas se débarrasser de la superstition de l'âme! - qui fait un " mérite " d'une alimentation insuffisante! -qui combat dans la santé une espèce d'ennemi, de diable, de tentation! - qui s'est persuadée que l'on pouvait promener une âme " parfaite " dans un corps cadavérique, et qui, pour cela, a eu besoin de se forger une nouvelle conception de la " perfection ", celle d'un être blafard, souffreteux, fumeux et hébété, - bref, la prétendue " sainteté " - une sainteté qui n'est qu'accumulation de symptômes d'un corps appauvri, énervé, incurablement ruiné!... (ANT/88-§51)
Le mouvement chrétien, en tant que mouvement européen, est d'emblée un mouvement rassemblant sans exclusive toute la lie, tout le rebut de l'humanité (et c'est ce rassemblement qui, par le christianisme, aspire au pouvoir). Il n'exprime pas le déclin d'une race, il est un conglomérat de formes de décadence venues de partout, qui se pressent et se cherchent. (ANT/88-§51)
Le christianisme est également opposé à tout épanouissement intellectuel - seule une raison malade peut lui tenir lieu de raison chrétienne; il prend le parti de tout ce qui est idiot, il jette l'anathème sur l' " esprit ", sur la " superbe " de l'esprit sain. (ANT/88-§52)
Comme la maladie est inhérente au christianisme, il faut nécessairement que l'état le plus typiquement chrétien, la " foi ", soit une forme de maladie, il faut nécessairement que toutes les voies honnêtes et scientifiques d'accès à la connaissance soient rejetées par l'Église comme des voies interdites. (ANT/88-§52)
Le christianisme et l'alcool, les deux plus grands agents de corruption. "Ce qui rend malade est bien ; ce qui vient de la plénitude, de la surabondance, de la puissance est mal" : c'est ce que sent le croyant. (ANT/88-§60)
J'appelle Chrétienté la seule grande malédiction, la seule intérieure et énorme perversion ; le seul grand instinct de revanche pour lequel aucun moyen n'est trop venimeux, trop clandestin, trop souterrain et trop mesquin. (ANT/88-§62)
Je condamne le christianisme, j'élève contre l'Eglise chrétienne l'accusation la plus terrible qu'accusateur ait jamais prononcée. Elle est pour moi la pire des corruptions concevables, elle a voulu sciemment le comble de la pire corruption possible. La corruption de l'église chrétienne n'a rien épargné, elle a fait de toute valeur une non valeur, de toute vérité un mensonge, de toute sincérité une bassesse d'âme. (ANT/88-§62)
Les bienfaits "humanitaires" du christianisme ! Arriver à produire à partir de l'humanitas une autocontradiction , un art de s'auto-avilir, une volonté de mensonge à tout prix, une aversion et un mépris pour tous les instincts bons et francs ! (ANT/88-§62)
Cette éternelle mise en accusation du christianisme, je la veux afficher sur tous les murs, partout où il y a des murs - j'ai pour cela des lettres qui rendraient la vue aux aveugles. .. J'appelle le christianisme l'unique grande malédiction, l'unique grande corruption intime, l'unique grand instinct de vengeance, pour qui aucun moyen n'est assez venimeux, assez secret, assez souterrain, assez mesquin - je l'appelle l'immortelle flétrissure de l'humanité… (ANT/88-§62)
Cette dénonciation éternelle du christianisme, je l'écrirai sur tous les murs, tant que je trouverai des murs à noircir. J'ai à ma disposition des lettres qui rendent la vue aux aveugles. J'appelle le christianisme le fléau grand entre tous, la perversion intérieure grande entre toutes, l'instinct de vengeance grand entre tous, pour lequel aucun moyen n'est assez venimeux, secret, souterrain, petit. Le christianisme, je l'appelle la tache honteuse, ineffaçable entre toutes, de l'humanité… (ANT/88-§62)
Être chrétien s'avère comme une indécence. (DL/88-PD)
A présent, je me suis raconté moi-même avec un cynisme qui va devenir historique : le livre s'appelle Ecce Homo, c'est un attentat contre le Crucifié commis sans la moindre considération ; il finit en roulements et en coups de tonnerre contre tout ce qui est chrétien ou infecté de christianisme, on en sort tout étourdi. Je suis finalement le premier psychologue du christianisme, et je suis capable, en vieil artilleur que je suis, de sortir une pièce de gros calibre dont aucun adversaire du christianisme n'aura seulement pressenti l'existence. L'ensemble forme le prélude à l'inversion de toutes les valeurs, à l'œuvre qui est devant moi, prête : je vous promets que dans deux ans nous aurons toute la terre en convulsions. Je suis une fatalité. (DL/88-GB)
CIVILISATION
Le problème d’une civilisation a rarement été correctement compris. Sa fin n’est ni le plus grand bonheur possible d’un peuple ni le libre développement de tous ses dons : mais elle se montre dans la juste mesure de ces développements. Sa fin tend à dépasser le bonheur terrestre : la production de grandes œuvres est son but. (LDP/72-75-ch.1§46)
Le peuple auquel on attribue une civilisation doit être, en toute réalité, quelque chose de vivant et de coordonné. Il ne doit point diviser misérablement sa culture en intérieure et extérieure, contenu et forme. Que celui qui veut atteindre et encourager la civilisation d’un peuple, atteigne et encourage cette unité supérieure et travaille à la destruction de cette culture chaotique moderne, en faveur d’une véritable culture. Qu’il ose réfléchir à la façon de rétablir la santé d’un peuple entamée par les études historiques, à la façon de retrouver son instinct, et par là son honnêteté. (CI2/73)
C'est la marque d'une plus haute civilisation, de faire des petites vérités discrètes, sans apparence, qui ont été trouvées par une méthode sévère, plus d'estime que des erreurs bienfaisantes et éblouissantes qui dérivent d'âges et d'hommes métaphysiques et artistiques. (HTH/78-§3)
On peut dire par métaphore que les époques de la civilisation répondent aux zones des divers climats, sauf que celles-là sont à la suite les unes des autres et non, comme les zones géographiques, à côté les unes des autres. En comparaison de la zone tempérée de civilisation, dans laquelle notre tâche est de passer, la dernière fait en gros l'impression d'un climat tropical. Violents contrastes, brusque succession du jour et de la nuit, chaleur et magnificence de coloris, adoration de tout ce qui est soudain, mystérieux, effrayant, soudaineté des orages qui éclatent, partout le prodigue débordement des cornes d'abondance de la nature : et au contraire, dans notre civilisation, un ciel clair, quoique non lumineux, un air assez stable, de la fraîcheur, du froid même à l'occasion : ainsi les deux zones s'opposent l'une à l'autre. Quand nous voyons là-bas comment les passions les plus furieuses sont domptées et brisées avec une étrange force par des conceptions métaphysiques, cela nous fâche comme si, sous les tropiques, des tigres sauvages étaient étouffés devant nos yeux entre les anneaux de monstrueux serpents; notre climat manque de pareils phénomènes, notre imagination est modérée, même en rêve il ne nous arrive pas ce que des peuples antérieurs voyaient à l'état de veille. Mais faudrait-il ne point nous féliciter de ce changement, avouer même que les artistes ont essentiellement perdu à la disparition de la civilisation tropicale et nous trouvent, nous autres non-artistes, un peu trop de sang-froid? En ce sens, les artistes ont peut-être raison de nier le « progrès », car en effet : on peut mettre en doute si les trois derniers millénaires montrent une marche progressive dans les arts. De même un philosophe métaphysicien, comme Schopenhauer, n'aura pas de motif de reconnaître le progrès, s'il considère les quatre derniers millénaires au point de vue de la philosophie métaphysique et de la religion. – Mais à notre sens l'existence de la zone tempérée de la civilisation est par elle-même un progrès. (HTH/78-§236)
Quand toute l'histoire de la civilisation se déroule devant le regard, comme un réseau de conceptions méchantes et nobles, vraies et fausses, et qu'au spectacle de ces fluctuations, on se sent souffrir presque du mal de mer, on comprend quelle consolation se trouve dans la conception d'un dieu en devenir : celui-ci se dévoile toujours de plus en plus dans les transformations et les destinées de l'humanité, tout n'est pas mécanisme aveugle, jeu réciproque de forces n'ayant ni sens ni but. – La divinisation du devenir est une perspective métaphysique – comme du haut d'un phare au bord de la mer de l'histoire –, où une génération d'érudits trop historiens trouvaient leur consolation; là-dessus on n'a pas le droit de s'irriter, quelque erronée que puisse être cette conception. Seul, un homme qui, comme Schopenhauer, nie l'évolution, ne sent rien non plus de la misère de cette fluctuation historique, et peut donc, ne sachant, ne sentant rien de ce dieu en devenir et du besoin de l'admettre, exercer sa raillerie avec justice. (HTH/78-§238)
La civilisation est née comme une cloche, à l'intérieur d'un moule de matière plus grossière, plus commune : fausseté, violence, extension illimitée de tous les individus, de tous les peuples, formaient ce moule. Est-il temps de l'ôter aujourd'hui? La coulée s'est-elle figée, les bons instincts utiles, les habitudes de la conscience noble sont-ils devenus si assurés et si géréraux qu'on n'ait plus besoin d'aucun emprunt à la métaphysique et aux erreurs des religions, d'aucunes duretés ni violences comme des plus puissants liens entre homme et homme, peuple et peuple? — Pour répondre à cette question, aucun signe de tête d'un dieu ne peut nous servir : c'est notre propre discernement qui doit en décider. Le gouvernement de la terre en somme doit être pris en main par l'homme lui-même, c'est son « omniscience » qui doit veiller d'un oeil pénétrant sur la destinée ultérieure de la civilisation. (HTH/78-§245)
Le génie de la civilisation opère comme Cellini, fondant sa statue de Persée : la masse en fusion menaçait de ne pas prendre, mais elle le devait : il y jeta donc des plats et des assiettes, et tout ce qui lui tombait sous la main. Et de même ce génie-là jette à la fonte des erreurs, des vices, des espérances, des illusions, et d'autres choses, de métal vil comme de métal précieux, car il faut que la statue de l'humanité réussisse et s'achève; qu'importe que çà et là quelque matière médiocre y soit employée ? (HTH/78-§258)
La civilisation grecque de l'époque classique est une civilisation d'hommes. En ce qui concerne les femmes, Périclès, dans son Discours funèbre, dit tout en ces mots : le mieux est pour elles qu'il soit parlé d'elles le moins possible entre hommes. – Les relations érotiques des hommes avec les adolescents furent, à un point que notre intelligence ne peut comprendre, la condition nécessaire, unique, de toute éducation virile (à peu près de même que toute éducation élevée des femmes ne fut longtemps chez nous amenée que par l'amour et le mariage). Tout l'idéalisme de la force dans la nature grecque se porta sur ces relations, et probablement jamais les jeunes gens n'ont été traités avec autant de sollicitude, d'affection, et d'égard absolu à leur plus grand bien (virtus), qu'aux sixième et cinquième siècles, ainsi conformément à la belle maxime d'Hôlderlin : « Car c'est en aimant que le mortel produit le plus de bien. » Plus s'élevait la conception de ces relations, plus s'abaissait le commerce avec la femme : le point de vue de la procréation des enfants et de la volupté – rien de plus n'y entrait en considération; il n'y avait point commerce intellectuel, encore moins amour véritable. Si l'on considère encore qu'elles-mêmes étaient exclues des jeux et des spectacles de toute sorte, il ne restait que les cultes religieux comme moyen de culture supérieure des femmes. –S'il est vrai pourtant que dans la tragédie on représentait Électre et Antigone, c'est qu'on tolérait cela dans l'art, quoiqu'on n'en voulût pas dans la vie : de même qu'aujourd'hui tout pathétique nous est insupportable dans la vie, bien que dans l'art le spectacle nous en plaise. – Les femmes n'avaient au reste d'autre devoir que d'enfanter de beaux corps puissants, où le caractère du père revivait autant que possible sans interruption, et par là d'opposer une résistance à la surexcitation nerveuse croissante d'une civilisation supérieurement développée. C'est ce qui maintint la civilisation grecque dans une jeunesse relativement si longue; car, dans les mères grecques, le génie de la Grèce revenait toujours à la nature. (HTH/78-§259)
Le plus grand fait de la civilisation grecque reste toujours le rayonnement si précoce d'Homère sur tout le monde hellénique. Toute la liberté intellectuelle et humaine où parvinrent les Grecs revient à ce fait. Mais ce fut en même temps la fatalité propre de la civilisation grecque, car Homère aplanissait en centralisant et dissolvait les plus sérieux instincts d'indépendance. De temps en temps s'éleva du fond le plus intime de l'hellénisme la protestation contre Homère; mais il resta toujours vainqueur. Toutes les grandes puissances spirituelles, à côté de leur action libératrice, en exercent une autre, déprimante; mais, à la vérité, cela fait une différence que ce soit Homère ou la Bible ou la science qui tyrannise les hommes. (HTH/78-§262)
C'est en lui-même que l'homme fait les meilleures découvertes sur la civilisation, quand il y trouve agissantes deux puissances hétérogènes. Supposé qu'un homme vive autant dans l'amour de l'art plastique ou de la musique qu'il est entraîné par l'esprit de la science, et qu'il considère comme impossible de faire disparaître cette contradiction par la suppression de l'un et l'affranchissement complet de l'autre : il ne lui reste qu'à faire de lui-même un édifice de culture si vaste qu'il soit possible à ces deux puissances d'y habiter, quoique à des extrémités éloignées, tandis qu'entre elles deux des puissances conciliatrices auront leur domicile, pourvues d'une force prééminente, pour aplanir en cas de nécessité la lutte qui s'élèverait. Or, un tel édifice de culture dans l'individu isolé aura la plus grande ressemblance avec l'édifice de la civilisation d'époques entières et fournira par analogie des leçons perpétuelles à son sujet. Car, partout où s'est développée la grande architecture de la civilisation, sa tâche a consisté à forcer à l'entente les puissances opposées, par le moyen d'une très forte coalition des autres forces moins irréconciliables, sans pourtant les assujettir ni les charger de chaînes. (HTH/78-§276)
Une civilisation supérieure ne peut naître que là où il y a deux castes distinctes de la société; celle des travailleurs et celle des oisifs, capables d'un loisir véritable ; ou en termes plus forts, la caste du travail forcé et la caste du travail libre. Le partage du bonheur n'est pas essentiel, quand il s'agit de la production d'une culture supérieure; mais le fait est que la caste des oisifs est la plus capable de souffrances, la plus souffrante, son contentement de l'existence est moindre, son devoir plus grand. Que s'il se produit un échange entre les deux castes, de sorte que les familles les plus basses, les moins intelligentes, tombent de la caste supérieure dans l'inférieure et qu'au rebours les hommes les plus libres de celle-ci réclament l'accès à la caste supérieure : un état se trouve atteint au-dessus duquel on ne voit plus que la pleine mer des aspirations vagues et illimitées. — Ainsi nous parle la voix expirante des temps antiques; mais où y a-t-il maintenant des oreilles pour l'entendre?Une civilisation supérieure ne peut naître que là où il y a deux castes distinctes de la société; celle des travailleurs et celle des oisifs, capables d'un loisir véritable ; ou en termes plus forts, la caste du travail forcé et la caste du travail libre. Le partage du bonheur n'est pas essentiel, quand il s'agit de la production d'une culture supérieure; mais le fait est que la caste des oisifs est la plus capable de souffrances, la plus souffrante, son contentement de l'existence est moindre, son devoir plus grand. Que s'il se produit un échange entre les deux castes, de sorte que les familles les plus basses, les moins intelligentes, tombent de la caste supérieure dans l'inférieure et qu'au rebours les hommes les plus libres de celle-ci réclament l'accès à la caste supérieure : un état se trouve atteint au-dessus duquel on ne voit plus que la pleine mer des aspirations vagues et illimitées. — Ainsi nous parle la voix expirante des temps antiques; mais où y a-t-il maintenant des oreilles pour l'entendre ? (HTH/78-§439)
Nous sommes d'un temps dont la civilisation est en danger de périr par les moyens de civilisation. (HTH/78-§520)
C'est un de ces vieux braves : il se fâche contre la civilisation, parce qu'il croit que celle-ci vise à rendre accessibles toutes les bonnes choses, – honneurs, trésors, belles femmes – aux lâches comme aux braves. (AUR/81-§153)
S'il est vrai que notre civilisation est, par elle-même, quelque chose de déplorable : vous avez le choix de poursuivre dans vos conclusions avec Rousseau : « Cette civilisation déplorable est cause de notre mauvaise moralité », ou de conclure en renversant la formule de Rousseau : « Notre bonne moralité est cause de cette déplorable civilisation. Nos conceptions sociales du bien et du mal, faibles et efféminées, leur énorme prépondérance sur le corps et l'âme, ont fini par affaiblir tous les corps et toutes les âmes et par briser les hommes indépendants, autonomes, sans préjugés, les véritables piliers d'une civilisation forte : partout où l'on rencontre aujourd'hui encore la mauvaise moralité, on voit les dernières ruines de ces piliers. » Il y a donc paradoxe contre paradoxe ! La vérité ne peut, à aucun prix, être des deux côtés : est-elle en général de l'un ou de l'autre ? Qu'on examine !(AUR/81-§163)
Ce que l'on observe lors du contact entre peuples civilisés et barbares : que régulièrement la civilisation inférieure commence par adopter les vices, les faiblesses et les excès de la supérieure, puis, partant de là, tandis qu'elle en éprouve la séduction, finit par faire passer sur elle, au moyen des faiblesses et des vices acquis, quelque chose de la force que renferme la civilisation supérieure - on peut le constater aussi dans son entourage, et sans voyager parmi les peuples barbares; il est vrai que c'est mêlé d'un peu plus de finesse et de spiritualité et sans qu'il soit aussi facile de s'en rendre compte. (LGS/82-§99)
Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers ? Ils le nomment civilisation, c’est ce qui les distingue des chevriers. (APZ/83-85-p1)
J’ai volé trop loin dans l’avenir : un frisson d’horreur m’a assailli.
Presque tout ce que nous nommons « civilisation supérieure » repose sur la spiritualisation et l'approfondissement de la cruauté: telle est ma thèse. Cette « bête féroce » n'a pas du tout été abattue, elle vit, elle prospère, elle s'est seulement... divinisée. Ce qui fait la volupté douloureuse de la tragédie est cruauté; ce qui agit agréablement dans ce qu'on nomme pitié tragique, et même dans tout ce qui est sublime, s'agît-il du plus haut, du plus subtil frisson de la métaphysique, ne tire sa douceur que de l'ingrédient de cruauté qui s'y mêle. (PDBM/86-229)
Qu'on nomme « civilisation » ou « humanisation » ou « progrès » ce que l'on tient maintenant pour la marque distinctive des Européens; que, recourant à un terme politique qui n'implique ni louange ni blâme, on nomme simplement cette évolution le mouvement démocratique de l'Europe, on voit se dérouler, derrière les phénomènes moraux et politiques exprimés par ces formules, un immense processus physiologique qui ne cesse de gagner en ampleur : les Européens se ressemblent toujours davantage, ils s'émancipent toujours plus des conditions qui font naître des races liées au climat et aux classes sociales, ils s'affranchissent dans une mesure accrue de tout milieu déterminé, générateur de besoins identiques, pour l'âme et le corps, durant le cours des siècles; ils donnent naissance peu à peu à un type d'humanité essentiellement supranationale et nomade qui, pour employer un terme de physiologie, possède au plus haut degré et comme un trait distinctif le don et le pouvoir de s'adapter. Ce processus d'européanisation, dont le rythme sera peut-être ralenti par d'importantes régressions, mais qui de ce fait même croîtra peut-être en violence et en profondeur — les furieuses poussées de « sentiment national » qui sévissent encore font partie de ces régressions, de même que la montée de l'anarchisme —, ce processus aboutira vraisemblablement à des résultats que ses naïfs promoteurs et ses thuriféraires, les apôtres des « idées modernes », étaient très loin d'escompter.(PDBM/86-242)
La merveilleuse civilisation maure d’Espagne, au fond plus proche de nous, parlant plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds (et je préfère ne pas penser par quels pieds !) – Pourquoi ? Parce qu’elle devait le jour à des instincts aristocratiques, à des instincts virils, parce qu’elle disait oui à la vie, avec en plus, les exquis raffinements de la vie maure !… Les croisés combattirent plus tard quelque chose devant quoi ils auraient mieux fait de se prosterner dans la poussière [...] Voyons donc les choses comme elles sont ! Les croisades ? Une piraterie de grande envergure, et rien de plus ! (ANT/88-§60)
CLIMAT
Cher ami, votre test psychologique quant à l'influence de Venise est exact. Ici (à Nice), où parmi les nombreux hôtes et patients l'on entend constamment parler de l'effet spécifique de certains climats, j'ai progressivement compris le caractère primordial de cette question. Le souci de l'optimum, des conditions les meilleures pour la réalisation de nos désirs les plus personnels (nos " œuvres ") doit nous amener à écouter cette voix de la nature : certaines musiques poussent aussi mal sous un ciel humide que certaines plantes. (DL/88-HK)
En Engadine je me suis entretenu de cette question capitale avec des médecins : cela vient de ce que le même climat en tant qu'il stimule et fait contraste - qu'il est donc indiqué pendant un certain laps de temps - a précisément l'influence opposée quand il est pratiqué comme climat permanent ; de sorte que par exemple l'habitant de l'Engadine devient, sous l'influence constante de son climat, sérieux, flegmatique, quelque peu anémique, tandis que l'hôte de ce climat en retire un extraordinaire surcroît de force et de vitalité pour l'ensemble de son être animal. (DL/88-HK)
CODE
Un code tel celui de Manou naît comme tout bon code : il résume l'expérience, la sagesse et la morale empirique de nombreux siècles, il achève et conclut, il ne crée plus rien. Une telle codification suppose que l'on comprenne à quel point les moyens qui donnent l'autorité à une vérité acquise patiemment et à grands frais sont fondamentalement différents de ceux par lesquels on pourrait la démontrer. Un code n'expose jamais l'utilité, les raisons, la casuistique de la préhistoire d'une loi : c'est justement ce qui lui ferait perdre son ton impératif de " tu dois ", condition nécessaire pour qu'il soit obéi. Tout le problème est là. (ANT/88-§57)
CŒUR
COMÉDIEN
Quelqu'un se fait par la réflexion une opinion ingénieuse sur un thème, afin de l'exposer dans une compagnie. On pourrait alors se faire une comédie d'entendre et de voir comment il met toutes voiles dehors pour arriver à ce point et embarquer toute la compagnie vers l'endroit où il pourra faire sa remarque; comment il pousse continuellement l'entretien vers un seul but, parfois perd la direction, la reprend, enfin saisit le moment : le souffle lui manque presque – et là, quelqu'un lui prend la remarque de la bouche. (HTH/78-§345)
Le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles : - il tourne invisiblement. Mais autour des comédiens tourne le peuple et la gloire : ainsi " va le monde ".
COMMERCE
On assiste aujourd'hui en plusieurs endroits à l'apparition de la culture d'une société dont le commerce constitue l'âme tout autant que la rivalité individuelle chez les anciens Grecs et que la guerre, la victoire et le droit chez les Romains. Celui qui pratique un commerce s'entend à tout taxer sans le fabriquer et, très précisément, à taxer d'après les besoins du consommateur, non d'après ses propres besoins les plus personnels : " Quels gens et combien de gens consomment cela? ", voilà pour lui la question des questions. Ce type d'estimation, il l'applique dès lors instinctivement et constamment : à tout, et donc aussi aux productions des arts et des sciences, des penseurs, savants, artistes et hommes d'État, des peuples et des partis, des époques tout entières : à propos de tout ce qui se crée, il s'informe de l'offre et de la demande, afin de fixer pour lui-même la valeur d'une chose. (AUR/81-§175)
COMPASSION - PITIÉ
La Rochefoucauld met certainement le doigt sur le vrai dans le passage le plus remarquable de son portrait fait par lui-même (imprimé pour la première fois en 1658), lorsqu'il met en garde toutes les personnes qui ont de la raison contre la pitié, lorsqu'il conseille de la laisser aux gens du peuple, qui ont besoin des passions (n'étant pas déterminés par la raison) pour être portés à venir en aide à celui qui souffre et à intervenir fortement en présence d'un malheur; cependant que la pitié, selon son jugement (et celui de Platon), énerve l'âme. On devrait, dit-il, à la vérité témoigner de la pitié, mais se garder d'en avoir; car les malheureux sont en un mot si sots, que le témoignage de pitié fait chez eux le plus grand bien du monde. – Peut-être peut-on mettre plus fortement encore en garde contre ce sentiment de pitié, si au lieu de concevoir ce besoin des malheureux, non pas comme une sottise et un défaut d'intelligence, comme une espèce de dérangement d'esprit que le malheur porte avec soi (et c'est ainsi que La Rochefoucauld semble le concevoir), on y voit quelque chose de tout autre et de plus digne de réflexion. Que l'on observe plutôt des enfants qui pleurent et crient afin d'être objets de pitié, et pour cela guettent le moment où leur situation peut tomber sous les yeux; qu'on vive dans l'entourage de malades et d'esprits déprimés et qu'on se demande si les plaintes et les phrases de lamentation, l'exhibition de l'infortune, ne poursuivent pas au fond le but de faire mal aux spectateurs : la pitié que ceux-ci expriment alors est une consolation pour les faibles et les souffrants en tant qu'ils y reconnaissent avoir au moins encore un pouvoir, en dépit de leur faiblesse : le pouvoir de faire mal. Le malheureux prend une espèce de plaisir à ce sentiment de supériorité dont lui donne conscience le témoignage de pitié; son imagination s'exalte, il est toujours assez puissant encore pour causer de la douleur au monde. Ainsi, la soif de pitié est une soif de jouissance de soi-même, et cela aux dépens de ses semblables ; elle montre l'homme dans toute la brutalité de son cher moi : mais non pas précisément dans sa « sottise », comme le pense La Rochefoucauld. (HTH/78-§50)
La pitié a aussi peu le plaisir d'autrui pour but que, comme j'ai dit, la méchanceté ne se propose la douleur d'autrui en soi. Car elle cache au moins deux éléments (peut-être bien plus) de plaisir personnel et n'est sous cette forme que le contentement de soi : d'abord il y a le plaisir de l'émotion, telle qu'est la pitié dans la tragédie, puis, lorsqu'on passe à l'acte, le plaisir de se contenter en exerçant sa puissance. Pour peu qu'en outre une personne qui souffre nous soit très proche, nous nous ôtons à nous-mêmes une souffrance en accomplissant des actes de pitié. – Hormis quelques philosophes, les hommes ont toujours mis la pitié à un rang assez bas dans l'@?chelle des sentiments moraux : à bon droit. (HTH/78-§103)
Les natures compatissantes, à chaque instant prêtes à secourir dans l'infortune, sont rarement en même temps les conjouissantes : dans le bonheur d'autrui, elles n'ont que faire, sont superflues, ne se sentent pas en possession de leur supériorité et montrent pour cela facilement du dépit. (HTH/78-§321)
Il y a des hommes qui, lorsqu'ils entrent en courroux et offensent les autres, exigent avec cela premièrement qu'on ne prenne rien mal avec eux, et secondement qu'on ait pitié d'eux, parce qu'ils sont sujets à des paroxysmes si violents. Tant va loin la prétention humaine. (HTH/78-§358)
La pitié s'accompagne d'une insolence particulière : voulant aider à tout prix, elle ne s'embarrasse ni des moyens de guérison ni de l'origine de la maladie, et elle tombe allègrement, avec ses drogues, sur la santé et la réputation de son malade. (OSM/79-68)
Les coups de timbale avec lesquels de jeunes écrivains se plaisent au service d'un parti ressemblent, pour celui qui n'appartient pas au parti, à un cliquetis de chaînes et éveillent plutôt la pitié que l'admiration. (OSM/79-308)
Manifester de la pitié est regardé comme un signe de mépris, car on a visiblement cessé d'être un objet de crainte, dès que l'on vous témoigne de la pitié. On est alors tombé au-dessous du niveau d'équilibre, alors qu'en réalité ce niveau ne suffit point à la vanité humaine et que seule la prééminence et la crainte que l'on inspire procurent à l'âme le sentiment le plus désiré. C'est pourquoi il faut se poser le problème de savoir comment est née l'estime de la pitié et expliquer comment on est venu aujourd'hui à louer l'altruisme : à l'origine, il est méprisé ou redouté comme perfide. (LVO/79-§50)
« On ne devient sage que par son propre malheur, on ne devient bon que par le malheur des autres » – c'est ainsi que parle cette philosophie singulière qui fait découler toute moralité de la pitié et toute intellectualité de l'isolement de l'homme : par là elle intercède inconsciemment pour tous les maux terrestres. Car la pitié a besoin de la souffrance et l'isolement du mépris des autres. (LVO/79-§62)
Si toutes les aumônes n'étaient données que par pitié, tous les mendiants seraient déjà morts de faim. (LVO/79-§239)
Les revers de la compassion chrétienne devant la souffrance du prochain, c’est la profonde suspicion devant toutes les joies du prochain, devant la joie qu’il prend à tout ce qu’il veut et peut. (AUR/81-§80)
« On n’est bon que par la pitié : il faut donc qu’il y ait quelque pitié dans tous nos sentiments » – c’est la morale du jour ! Et d’où cela vient-il ? – Le fait que l’homme qui accomplit des actions sociales sympathiques, désintéressées, d’un intérêt commun, est considéré maintenant comme l’homme moral, – c’est peut-être là l’effet le plus général, la transformation la plus complète que le christianisme ait produit en Europe : bien malgré lui peut-être et sans que ce soit là sa doctrine. Mais ce fut le résidu des sentiments chrétiens qui prévalut lorsque la croyance fondamentale, très opposée et foncièrement égoïste, à la « seule chose nécessaire », à l’importance absolue du salut éternel et personnel, ainsi que les dogmes sur quoi reposait cette croyance se retirèrent peu à peu, et que la croyance accessoire à « l’amour », à « l’amour du prochain », en conformité de vue avec la pratique monstrueuse de la charité ecclésiastique, fut ainsi poussée au premier plan. (AUR/81-§132)
Il faudrait y réfléchir sérieusement : pourquoi saute-t-on à l’eau pour repêcher quelqu’un que l’on voit se noyer, quoique l’on n’ait pour lui aucune sympathie particulière ? Par pitié : l’on ne pense plus qu’à son prochain, – répond l’étourderie. Pourquoi éprouve-t-on la douleur et le malaise de celui qui crache du sang, tandis qu’en réalité on lui veut même du mal ? Par pitié : on ne pense plus à soi, – répond la même étourderie. La vérité c’est que dans la pitié, – je veux dire dans ce que l’on a l’habitude d’appeler pitié, d’une façon erronée – nous ne pensons plus à nous consciemment, mais que nous y pensons encore très fortement d’une manière inconsciente, comme quand notre pied glisse, nous faisons, inconsciemment, les mouvements contraires qui rétablissent l’équilibre, en y mettant apparemment tout notre bon sens. L’accident d’une autre personne nous offense, il nous ferait sentir notre impuissance, peut-être notre lâcheté, si nous n’y portions remède. Ou bien il amène déjà, par lui-même, un amoindrissement de notre honneur devant les autres ou devant nous-mêmes. Ou bien encore nous trouvons dans l’accident et la souffrance un avertissement du danger qui nous guette aussi ; et ne fût-ce que comme indices de l’incertitude et de la fragilité humaines ils peuvent produire sur nous un effet pénible. Nous repoussons ce genre de misère et d’offense et nous y répondons par un acte de compassion, où il peut y avoir une subtile défense et aussi de la vengeance. On devine que nous pensons au fond beaucoup à nous-mêmes en voyant la décision que nous prenons dans tous les cas où nous pouvons éviter l’aspect de ceux qui souffrent, gémissent et sont dans la misère : nous décidons de ne pas l’éviter lorsque nous pouvons nous approcher en hommes puissants et secourables, certains des approbations, voulant éprouver ce qui est l’opposé de notre bonheur, ou bien encore espérant nous divertir de notre ennui. Nous prêtons à confusion en appelant compassion (Mittleid) la souffrance (Leid) que nous cause un tel spectacle et qui peut être d’espèce très variée, car en tous les cas, c’est là une souffrance dont est indemne celui qui souffre devant nous : elle nous est propre comme lui est particulière sa souffrance à lui. Nous ne nous délivrons donc que de cette souffrance personnelle, en nous livrant à des actes de compassion. Toutefois, nous n’agissons jamais ainsi pour un seul motif : de même qu’il est certain que nous voulons nous délivrer d’une souffrance, il est certain aussi que, pour la même action, nous cédons à une impulsion de plaisir, – plaisir provoqué par l’aspect d’une situation contraire à la nôtre, à l’idée de pouvoir aider si nous le voulions, à la pensée des louanges et de la reconnaissance que nous récolterions, dans le cas où nous aiderions ; par l’activité même d’aider, à condition que l’acte réussisse (et comme il réussit progressivement il fait plaisir par lui-même à l’exécutant), mais surtout par le sentiment que notre intervention met un terme à une injustice révoltante (donner cours à son indignation suffit déjà à soulager). Tout cela, y compris des choses plus subtiles encore, est de la « pitié » : – combien lourdement le langage assaille avec ce mot un organisme aussi complexe ! – Que par contre la pitié ne fasse qu’un avec la souffrance dont l’aspect la provoque, ou qu’elle ait pour celle-ci une compréhension particulièrement pénétrante et subtile – cela est en contradiction avec l’expérience, et celui qui a glorifié la pitié sous ces deux rapports manque d’expérience suffisante dans le domaine de la morale. (AUR/81-§133)
La compassion, pour peu qu’elle crée véritablement de la souffrance – et cela doit être ici notre seul point de vue – est une faiblesse comme tout abandon à une affection préjudiciable. Elle augmente la souffrance dans le monde : si, çà et là, par suite de la compassion, une souffrance est indirectement amoindrie ou supprimée, il ne faut pas se servir de ses conséquences occasionnelles, tout à fait insignifiantes dans leur ensemble, pour justifier les façons de la pitié qui portent dommage. À supposer que ces façons prédominent, ne fût-ce que pendant un seul jour, elles pousseraient immédiatement l’humanité à sa perte. Par elle-même la compassion ne possède pas plus un caractère bienfaisant que tout autre instinct : c’est seulement quand on l’exige et la vante – et cela arrive lorsqu’on ne comprend pas ce qui porte préjudice en elle, mais que l’on y découvre une source de plaisir – qu’elle revêt une sorte de bonne conscience ; seulement alors on s’abandonne volontiers à elle et on ne craint pas ses conséquences.
Celui qui a déjà fait l’expérience de rechercher intentionnellement pendant un certain temps les occasions de pitié dans sa vie pratique et qui se représente, dans son for intérieur, toute la misère dont son entourage peut lui offrir le spectacle, devient inévitablement malade et mélancolique. Mais celui qui, dans un sens ou dans un autre, veut servir de médecin à l’humanité, devra être plein de précautions à l’égard de ce sentiment – qui le paralyse dans tous les moments décisifs, entrave sa science et sa main subtile et secourable. (AUR/81-§134)
Parmi les sauvages, on songe avec un frisson moral que l’on pourrait être plaint : ce serait la preuve que l’on est privé de toute vertu. Compatir équivaut à mépriser : on ne veut pas voir souffrir un être méprisable, cela ne procure aucune jouissance. Voir souffrir par contre un ennemi, que l’on considère comme son égal en fierté, mais que la torture ne fait pas abandonner son attitude, et, en général, voir souffrir tout être qui refuse d’en appeler à la pitié, c’est-à-dire à l’humiliation la plus honteuse et la plus profonde, c’est là la jouissance des jouissances, l’âme du sauvage s’y édifie jusqu’à l’admiration : il finit par tuer un pareil brave, lorsque cela est en son pouvoir, et il lui rend, à lui l’inflexible, les derniers honneurs. S’il avait gémi, si son visage avait perdu son expression de froid dédain, s’il s’était montré digne de mépris, – eh bien ! il aurait pu continuer à vivre comme un chien, – il n’aurait plus excité la fierté du spectateur et la pitié aurait remplacé l’admiration. (AUR/81-§135)
Lorsque, comme les Indiens, on place le but de toute activité intellectuelle dans la connaissance de la misère humaine, et lorsque, à travers plusieurs générations, on demeure fidèle à cet épouvantable précepte, la pitié finit par avoir, aux yeux de tels hommes du pessimisme héréditaire, une valeur nouvelle en tant que valeur conservatrice de la vie, qui aide à supporter l’existence quand bien même celle-ci mériterait d’être rejetée avec dégoût et effroi. La pitié devient l’antidote du suicide, en tant qu’elle recèle un plaisir et fait goûter par petites doses un sentiment de supériorité : elle nous détourne de nous-mêmes, fait déborder le cœur, chasse la crainte et l’engourdissement, incite aux paroles, aux plaintes et aux actions, – c’est un bonheur relatif, si on la compare à la misère de la connaissance qui met, de tous les côtés, l’individu à l’étroit, le pousse dans l’obscurité, et lui coupe le souffle. Le bonheur, quel qu’il soit, donne de l’air, de la lumière et de libres mouvements. (AUR/81-§136)
Vous dites que la morale de la pitié est une morale supérieure à celle du stoïcisme ? Prouvez-le! Mais notez bien qu'il ne faut pas mesurer derechef le « supérieur « et l'« inférieur » en morale avec une toise morale : car il n'y a pas de morale absolue. Allez donc chercher vos critères ailleurs et — soyez sur vos gardes! (AUR/81-§139)
La comédie de la pitié. - Quelle que soit la part que nous prenions au sort d'un malheureux, en sa présence nous jouons toujours un peu la comédie, nous ne disons pas beaucoup de choses que nous pensons et telles que nous les pensons, avec la circonspection d'un médecin au chevet d'un malade en danger de mort. (AUR/81-§383)
On vante la pitié comme étant la vertu des filles de joie. (LGS/82-§13)
La pitié est essentiellement la première chose, une émotion agréable de l'instinct d'assimilation à l'aspect du plus faible : il faut d'ailleurs songer que « fort » et « faible » sont des concepts relatifs. (LGS/82-§118)
Où résident tes plus grands dangers ? — Dans la pitié. (LGS/82-§271)
Vous avez des yeux trop cruels et, pleins de désirs, vous regardez vers ceux qui souffrent. Votre lubricité ne s’est-elle pas travestie pour s’appeler pitié ? (APZ/83-85-p1)
Mais c’est cette vertu que les petites gens tiennent aujourd’hui pour la vertu par excellence, la compassion : ils n’ont point de respect de la grande infortune, de la grande laideur, de la grande difformité.
Mon regard passe au-dessus de tous ceux-là, comme le regard du chien domine les dos des grouillants troupeaux de brebis. Ce sont des êtres petits, gris et laineux, pleins de bonne volonté et d’esprit moutonnier. (APZ/83-85-p4)
« Pitié pour tous » — ce serait cruauté et tyrannie pour toi, monsieur mon voisin ! (PDBM/86-§82)
Pour peu que l'on mesure la compassion à la valeur des réactions qu'elle suscite habituellement, le danger qu'elle fait courir à la vie apparaît sous un jour encore plus cru.
La compassion contrarie en tout la grande loi de l'évolution, qui est la loi de la sélection. Elle préserve ce qui est mûr pour périr, elle s'arme pour la défense des déshérités et des condamnés de la vie, et, par la multitude des ratés de tout genre qu'elle maintient en vie, elle donne à la vie même un aspect sinistre et équivoque.
On a osé appeler la compassion une vertu (dans toute morale aristocratique, elle passe pour une faiblesse). On est même allé plus loin : on en a fait la vertu par excellence, la source et l'origine de toutes les vertus, dans l'optique, il est vrai, — et c'est un point à ne jamais oublier — d'une philosophie qui était nihiliste et qui avait pris pour devise la négation de la vie.
Schopenhauer était dans le vrai : par la compassion, c'est la vie qui se trouve niée, qui mérite d'autant plus d'être niée. La compassion est la praxis du nihilisme. Répétons-le : cet instinct dépressif et contagieux contrarie les instincts qui visent à conserver et à valoriser la vie : tant comme multiplicateur de la misère que comme conservateur de tout misérable, il est l'instrument principal de l'aggravation de la décadence.
La compassion vous gagne à la cause du néant !... On ne dit pas « néant » : à la place, on dit « au-delà », ou « Dieu », ou « vraie vie », ou bien « nirvâna », « rédemption », « béatitude Cette innocente rhétorique née de l'idiosyncrasie religieuse et morale apparaît beaucoup moins innocente dès que l'on comprend quelle tendance se drape ici dans le manteau des grands mots : c'est celle de l'hostilité à la vie.
Schopenhauer était hostile à la vie : c'est pour cela qu'il fit de la compassion une vertu... Aristote voyait dans la compassion, c'est bien connu, un état maladif et dangereux, dont il fallait, de temps à autre se purger : il concevait la tragédie comme un purgatif.
Rien n'est plus malsain, au milieu de notre malsaine modernité, que la compassion chrétienne. C'est là qu'il nous faut être médecins, c'est là qu'il nous faut être impitoyables, c'est là qu'il nous faut porter le scalpel. (ANT/88-§7)
La pitié n'est une vertu que chez les décadents. Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de respect, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend en un clin d'oeil l'odeur de la populace et ressemble à s'y méprendre aux mauvaises manières. Des mains apitoyées peuvent avoir une action destructive sur les grandes destinées, elles s'attaquent à une solitude blessée, au privilège que donne une lourde faute. Surmonter la pitié c'est pour moi une vertu noble. (EH/88-1§4)
COMPRÉHENSION
Les hommes posthumes — moi, par exemple — sont moins bien compris que ceux qui sont conformes à leur époque, mais on les entend mieux. Pour m’exprimer plus exactement encore : on ne nous comprend jamais — et c’est de là que vient notre autorité... (LCI/88-1§15)
CONCEPT
Repensons particulièrement au problème de la formation des concepts. Chaque mot devient immédiatement un concept par le fait que, justement, il ne doit pas servir comme souvenir pour l'expérience originelle, unique et complètement singulière à laquelle il doit sa naissance, mais qu'il doit s'adapter également à d'innombrables cas plus ou moins semblables, autrement dit, en toute rigueur, jamais identiques, donc à une multitude de cas différents. Tout concept naît de l'identification du non-identique. Aussi sûr que jamais une feuille n'est entièrement identique à une autre feuille, aussi sûrement le concept de feuille est-il formé par abandon délibéré de ces différences individuelles, par oubli du distinctif, et il éveille alors la représentation, comme s'il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque chose comme « la feuille », une sorte de forme originelle sur le modèle de quoi toutes les feuilles seraient tissées, dessinées, mesurées, colorées, frisées, peintes, mais par des mains inexpertes au point qu'aucun exemplaire correct et fiable n'en serait tombé comme la transposition fidèle de la forme originelle. Nous appelons un homme « honnête » ; nous demandons : « Pourquoi a-t-il agi honnêtement aujourd'hui ? » Nous répondons habituellement : « en raison de son honnêteté ». L'honnêteté ! Autant répéter que la feuille est la cause des feuilles. Mais nous ne savons absolument rien sur une qualité essentielle qui s'appellerait « l'honnêteté », nous n'avons affaire qu'à un grand nombre d'actions individualisées et par conséquent dissemblables, que nous assimilons par abandon de la dissemblance et désignons dorénavant comme des actions honnêtes ; en fin de compte nous extrayons d'elles la formule d'une qualitas occultas portant le nom de « l'honnêteté ». L'omission de l'élément individuel et réel nous fournit le concept, comme elle nous donne aussi la forme, tandis que la nature au contraire ne connaît ni formes ni concepts, et donc pas non plus de genres, mais seulement un X qui reste pour nous inaccessible et indéfinissable.
Tout ce qui distingue l'homme de l'animal dépend de cette capacité à subtiliser en un schéma les métaphores intuitives, donc à dissoudre une image dans un concept. Dans le domaine de ces schémas quelque chose en effet est possible qui ne pourrait jamais réussir au milieu des premières impressions intuitives : édifier un ordre pyramidal selon des castes et des grades, créer un monde nouveau de lois, de privilèges, de subordinations, de délimitations, qui fait face désormais à l'autre monde, intuitif, des premières impressions, comme étant ce qu'il y a de plus stable, de plus général, de mieux connu, de plus humain, et donc en tant qu'instance régulatrice et imp@?rative. Tandis que chaque métaphore de l'intuition est individuelle et sans égale, et par conséquent s'arrange toujours pour échapper à toute classification, le vaste édifice des concepts affiche l'abrupte uniformité d'un colombarium romain et exhale dans la logique cette rigueur et cet air froid qui sont le propre de la mathématique. Quiconque éprouvera le contact de ce froid sur sa peau croira à peine que le concept aussi, octogonal et osseux comme un dé et, autant que lui, interchangeable, ne persiste pourtant qu'en tant que le résidu d'une métaphore, et que l'illusion de la transposition artificielle d'une excitation nerveuse en images est, sinon la mère, du moins la grand-mère de tout concept. Mais à l'intérieur de ce jeu de dés des concepts on parle de « vérité » lorsque chaque dé est utilisé conformément à sa désignation, que l'on compte exactement ses points, que l'on forme les rubriques correctes et qu'on ne pèche jamais contre le système des castes et la hiérarchie des grades. (VMEM/73-§1)
Il faut ici admirer l'homme pour ce qu'il est un puissant génie de l'architecture qui réussit à ériger, sur des fondements mouvants et en quelque sorte sur l'eau courante, un dôme conceptuel infiniment compliqué : - en vérité, pour trouver un point d'appui sur de tels fondements, il faut que ce soit une construction comme faite de fils d'araignée, assez fine pour être transportée avec le flot, assez solide pour ne pas être dispersée au souffle du moindre vent. Pour son génie de l'architecture, l'homme s'élève loin au-dessus de l'abeille : celle-ci bâtit avec la cire qu'elle recueille dans la nature, lui avec la matière bien plus fragile des concepts qu'il doit ne fabriquer qu'à partir de lui-même. (LDP/72-75-ch.3§1)
Comme l'abeille travaille en même temps à construire les cellules et à remplir ces cellules de miel, ainsi la science travaille sans cesse à ce grand columbarium des concepts, au sépulcre des intuitions, et construit toujours de nouveaux et de plus hauts étages, elle façonne, nettoie, rénove les vieilles cellules, elle s'efforce surtout d'emplir ce colombage surélevé jusqu'au monstrueux et d'y ranger le monde empirique tout entier, c'est-à-dire le monde anthropomorphique. (LDP/72-75-ch.3§2)
CONFIANCE - MÉFIANCE
Les gens qui nous donnent leur pleine confiance croient par là avoir un droit sur la nôtre. C'est une erreur de raisonnement ; des dons ne sauraient donner un droit. (HTH/78-§311)
CONNAISSANCE
L'instinct de la connaissance sans discernement est semblable à l'instinct sexuel aveugle - signe de bassesse ! (LDP/72-75-ch.1§20)
En quelque coin écarté de l'univers répandu dans le flamboiement d'innombrables systèmes solaires, il y eut une fois une étoile sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus arrogante et la plus mensongère de l'" histoire universelle " : mais ce ne fut qu'une minute. A peine quelques soupirs de la nature et l'étoile se congela, les animaux intelligents durent mourir. (LDP/72-75-ch.3§1)
Tout savoir naît de la séparation, de la délimitation, de la restriction ; aucun savoir absolu d’un tout ! (LDP/72-75-ch.1§109)
L'espèce d'orgueil lié au connaître et au sentir, et qui amasse d'aveuglantes nuées sur les yeux et les sens des hommes, les illusionne quant à la valeur de l'existence parce qu'il véhicule la plus flagorneuse évaluation du connaître. Son effet général est l'illusion – mais ce caractère se retrouve aussi dans ses effets les plus particuliers. (VMEM/73-§1)
Il faut, en vue de la connaissance, savoir utiliser ce courant intérieur qui nous porte vers une chose, et à son tour celui qui, après un temps, nous en éloigne. (HTH/78-§500)
Le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet : il voit les choses plus simples qu'elles ne sont, et par là en donne une idée plus compréhensible et plus convaincante. (HTH/78-§578)
D'ordinaire on fait des efforts pour procurer à toutes les situations et à tous les événements de la vie une seule direction de conscience, une seule espèce de points de vue – c'est ce qu'on appelle principalement avoir l'esprit philosophique. Mais pour l'enrichissement de la connaissance, il peut y avoir plus d'intérêt à ne pas s'uniformiser de la sorte, mais à écouter la voix légère des diverses situations de la vie ; celles-ci portent avec elles leur point de vue propre. C'est ainsi qu'on prend une part reconnaissante à la vie et à l'existence de beaucoup, en ne se traitant pas soi-même comme un individu fixé, consistant, un. (HTH/78-§618)
Ce n'est qu'au terme de la connaissance de toutes choses que l'homme se connaîtra. Car les choses ne sont que les frontières de l'homme. (AUR/81-§48)
Depuis que je me suis fatigué à chercher,
La force des connaissances ne tient pas à leur degré de vérité mais à leur ancienneté, au fait qu'elles sont incorporées, à leur caractère de condition de vie. Là où vivre et connaître semblaient entrer en contradiction, on n'a jamais livré de combat sérieux; la contestation et le doute passaient alors pour de la folie. (LGS/82-§110)
Les traînards de la connaissance pensent que la lenteur fait partie de la connaissance. (LGS/82-§231)
Si grande que soit l'avidité de ma connaissance : je ne peux rien tirer d'autre des choses que ce qui m'appartient déjà, — la propriété d'autrui demeure rivée aux choses. Comment est-il possible qu'un homme soit voleur ou brigand ? (LGS/82-§242)
Oh terrible avidité que la mienne ! Nulle abnégation n'habite cette âme, — mais bien plutôt un moi qui convoite tout, qui à travers une foule d'individus voudrait voir comme de ses propres yeux, saisir comme de ses propres mains, — un moi qui va jusqu'à récupérer tout le passé, qui ne veut rien perdre de ce qui pourrait lui appartenir ! Oh cette terrible flamme de mon avidité ! oh, puissé-je renaître en une centaine d'êtres !– Qui ne connaît pas ce soupir par expérience ne connaît pas non plus la passion de l'homme de connaissance. (LGS/82-§249)
J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître afin qu'un jour vive le Surhomme. Car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. (APZ/83-85-p1)
Mes amis, des paroles moqueuses sont venues aux oreilles de votre ami : « Voyez donc Zarathoustra ! Ne passe-t-il pas au milieu de nous comme si nous étions des bêtes ? »
Et voici ce que j’appelle l’immaculée connaissance de toutes choses : ne rien demander aux choses que de pouvoir s’étendre devant elles, ainsi qu’un miroir aux cent regards. (APZ/83-85-p2)
Mais celui qui cherche la connaissance avec des yeux indiscrets, comment saurait-il voir autre chose que les idées de premier plan !
À côté de la mauvaise conscience, naquit jusqu’à présent toute science ! Brisez, brisez-moi les vieilles tables, vous qui cherchez la connaissance !
Connaître : c’est une joie pour celui qui a la volonté du lion. Mais celui qui est fatigué est sous l’empire d’une volonté étrangère, toutes les vagues jouent avec lui.
Plutôt ne rien savoir que de savoir beaucoup de choses à moitié ! (APZ/83-85-p4)
On ne peut pas connaître du tout. (FP/85-87-v12)
C'est affaire du peuple de croire que la connaissance est le fait de connaître une chose jusqu'au bout. (PDBM/86-§16)
Tant que tu considères les étoiles comme quelque chose qui est « au-dessus de toi », il te manque le regard de celui qui cherche la connaissance. (PDBM/86-§71)
J'emprunte l'explication qui va suivre à la rue ; j'entendis une personne du peuple dire « il m'a reconnu » — ce qui m'a fait me demander : qu'entend au juste le peuple par connaissance ? que veut-il lorsqu'il veut de la « connaissance »? Rien de plus que ceci : quelque chose d'étranger doit être ramené à quelque chose de bien connu. Et nous, philosophes — avons-nous véritablement entendu par connaissance quelque chose de plus ? Le connu, cela veut dire : ce à quoi nous sommes suffisamment habitués pour ne plus nous en étonner, notre quotidien, une règle quelconque dans laquelle nous sommes plongés, absolument tout ce en quoi nous nous sentons chez nous : – comment ? notre besoin de connaître n'est-il justement pas ce besoin de bien connu, la volonté de découvrir dans tout ce qui est étranger, inhabituel, problématique, quelque chose qui ne nous inquiète plus ? Ne serait-ce pas l'instinct de peur qui nous ordonne de connaître ? La jubilation de l'homme de connaissance ne serait-elle pas justement la jubilation du sentiment de sécurité retrouvée ?
Oh, qu'ils sont faciles à satisfaire, les hommes de connaissance ? (LGS/86-§355)
Savoir à fond cinq ou six choses et refuser poliment de savoir autre chose... (ANT/88-§53)
Une fois pour toutes, il y a beaucoup de choses que je ne veux point savoir. — La sagesse trace des limites, même à la connaissance. (LCI/88-1§5)
CONNAISSANCE DE SOI
Que sait à vrai dire l'homme de lui-même ? Et pourrait-il même se percevoir intégralement tel qu'il est, comme exposé dans une vitrine illuminée ? La nature ne lui cache-t-elle pas la plupart des choses, même sur son corps, afin de le retenir enfermé à l'écart des replis de ses boyaux, du courant rapide de son sang, des vibrations complexes de ses fibres, dans une conscience fière et chimérique ? Elle a jeté la clé : malheur à la curiosité fatale qui aimerait regarder par une fente bien loin hors de la chambre de la conscience et pressentirait alors que c'est sur ce qui est impitoyable, avide, insatiable, meurtrier, que repose l'homme dans l'indifférence de son ignorance, accroché au rêve comme sur le dos d'un tigre. (LDP/72-75-ch.3§2)
Hélas ! l'homme, au fond, que sait-il de lui-même ? Et serait-il même capable une bonne fois de se percevoir intégralement, comme exposé dans la lumière d'une vitrine ? La nature ne lui cache-t-elle pas l'immense majorité des choses, même sur son corps, afin de l'enfermer dans la fascination d'une conscience superbe et fantasmagorique, bien loin des replis de ses entrailles, du fleuve rapide de son sang, du frémissement compliqué de ses fibres ? Elle a jeté la clé : et malheur à la funeste curiosité qui voudrait jeter un œil par une fente hors de la chambre de la conscience et qui, dirigeant ses regards vers le bas, devinerait sur quel fond de cruauté, de convoitise, d'inassouvissement et de désir de meurtre l'homme repose, indifférent à sa propre ignorance, et se tenant en équilibre dans des rêves pour ainsi dire comme sur le dos d'un tigre. D'où diable viendrait donc, dans cette configuration, l'instinct de vérité ! (VMEM/73-§1)
Ce que les hommes ont tant de peine à comprendre, c'est leur ignorance sur eux-mêmes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours! Non seulement sous le rapport du bien et du mal, mais sous des rapports beaucoup plus essentiels! L'antique illusion selon laquelle on saurait, on saurait très précisément et dans tous les cas comment se produisent les actions humaines, est toujours vivante. (AUR/81-§116)
Nous avons tous en nous des jardins et des plantations cachés ; et pour utiliser une autre image, nous sommes tous des volcans en formation qui connaîtrons leur heure d'éruption ; - mais celle-ci est-elle proche ou est-elle lointaine ? Nul ne le sait, assurément, pas même le bon Dieu. (LGS/82-§9)
Combien donc y a-t-il d'hommes qui sachent observer ! Et parmi les rares qui le sachent, — combien y en a-t-il qui s'observent eux-mêmes ? « Chacun est à soi-même le plus éloigné » — voilà ce que savent tous ceux qui sondent les reins, et ce qui cause leur malaise ; et la sentence « connais-toi toi-même ! » proférée par un dieu et adressée à des hommes, est presque une méchanceté. Mais que la situation soit si désespérée pour ce qui est de l'observation de soi, rien n'en témoigne davantage que la manière dont presque chacun discourt sur l'essence d'une action morale, cette manière précipitée, empressée, convaincue, bavarde, avec son regard, son sourire, son ardeur obligeante ! On semble vouloir te dire : « Mais, mon cher, voilà justement ma spécialité ! Tu t'adresses avec ta question à celui qui a le droit de répondre : il se trouve que je ne suis en rien aussi expert qu'en ceci. Donc : si l'homme juge "voici qui est juste", s'il en conclut "c'est pourquoi il faut nécessairement que cela se produise !" et qu'il fait désormais ce qu'il a reconnu pour juste et caractérisé comme nécessaire, — alors l'essence de son acte est morale ! » (LGS/82-§335)
Veux-tu, mon frère, aller dans l’isolement ? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même ? Hésite encore un peu et écoute-moi.
Nous ne nous connaissons pas, nous qui cherchons la connaissance ; nous nous ignorons nous-mêmes : et il y a une bonne raison pour cela. Nous ne nous sommes jamais cherchés — comment donc se pourrait-il que nous nous découvrions un jour ? On a dit justement : « La où est votre trésor, là aussi est votre cœur » ; et notre trésor est là où bourdonnent les ruches de notre connaissance. C’est vers ces ruches que nous sommes sans cesse en chemin, en vrais insectes ailés qui butinent le miel de l’esprit, et, en somme, nous n’avons à cœur qu’une seule chose — « rapporter » quelque butin. En dehors de cela, pour ce qui concerne la vie et ce qu’on appelle ces « événements » — qui de nous sérieusement s’en préoccupe ? Qui a le temps de s’en préoccuper ? Pour de telles affaires jamais, je le crains, nous ne sommes vraiment « à notre affaire » ; nous n’y avons pas notre cœur, — ni même notre oreille ! Mais plutôt, de même qu’un homme divinement distrait, absorbé en lui-même, aux oreilles de qui l’horloge vient de sonner, avec rage, ses douze coups de midi, s’éveille en sursaut et s’écrie : « Quelle heure vient-il donc de sonner ? » de même, nous aussi, nous nous frottons parfois les oreilles après coup et nous nous demandons, tout étonnés, tout confus : « Que nous est-il donc arrivé ? » Mieux encore : ite, les douze coups d’horloge, encore frémissants de notre passé, de notre vie, de notre être — hélas ! et nous nous trompons dans notre compte… C’est que fatalement nous nous demeurons étrangers à nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas, il faut que nous nous confondions avec d’autres, nous sommes éternellement condamnés à subir cette loi : « Chacun est le plus étranger à soi-même », — à l’égard de nous-mêmes nous ne sommes point de ceux qui « cherchent la connaissance »… (GM/87-pref-§1)
Je ressemble à un vieux château fort, battu par les intempéries, possédant beaucoup de caves et de sous-sols cachés ; je ne suis pas encore descendu dans mes souterrains les plus obscurs ; je n'ai pas encore pénétré dans mes chambres les plus profondes. Ne forment-elles pas le soubassement de tout ? Ne devrions-nous pas pouvoir nous élever de nos ultimes profondeurs, pour surgir sur n'importe quel point de la surface terrestre ? Et chacun de ces couloirs ténébreux ne devrait-il pas nous ramener toujours à nous-mêmes ? (LC/LAS)
Il me semble que je suis trop doux, trop attentif avec les hommes, je suis même, là où j'ai simplement vécu, aussitôt tellement préoccupé des gens qu'à la fin je ne sais plus me défendre d'eux. (DL/87-FO)
Progressivement ce que nous avons de plus tourné vers l'intérieur nous discipline en nous ramenant à l'unité ; cette passion pour laquelle pendant longtemps nous n'avons pas de nom nous sauve de toutes les digressions, de toutes les dispersions, cette tâche dont nous sommes sans le vouloir le missionnaire. (DL/87-CF)
A force de lutte implacable et souterraine contre tout ce que les hommes ont jusqu'ici honoré et aimé, (ma formule pour désigner cela est " l'inversion de toutes les valeurs ") je suis moi-même devenu, imperceptiblement, quelque chose comme un terrier, quelque chose de caché que l'on ne trouve plus, même quand on s'y épuise plus… (DL/88-RVS)
CONSCIENCE - MAUVAISE CONSCIENCE
Les hommes qui parlent de leur importance pour l'humanité ont à l'égard de la justice commune, du respect des engagements, de la parole donnée, une conscience peu exigeante. (HTH/78-§522)
La conscience est la dernière et la plus tardive évolution de l'organique et par conséquent aussi ce qu'il y a en lui de plus inachevé et de moins solide. La conscience suscite d'innombrables méprises qui provoquent la disparition d'un animal, d'un homme, plus tôt qu'il ne serait nécessaire, « au-delà du destin », comme le dit Homère. Si le groupe conservateur des instincts ne la surpassait pas infiniment en puissance, s'il n'exerçait pas dans l'ensemble un rôle régulateur : l'humanité périrait inéluctablement de ses jugements à contresens et de sa manière de rêvasser les yeux ouverts, de son manque de profondeur et de sa crédulité, bref précisément de sa conscience : ou plutôt, sans cela, elle n'existerait plus depuis longtemps !
Avant d'être parfaitement élaborée et mûre, une fonction constitue un danger pour l'organisme : tant mieux si elle est vigoureusement tyrannisée pendant aussi longtemps ! La conscience est ainsi vigoureusement tyrannisée — et la fierté avec laquelle on la considère n'est pas le moindre de ses tyrans ! On pense trouver ici le noyau de l'homme ; sa nature permanente, éternelle, ultime, absolument originaire ! On considère la conscience comme une grandeur stable donnée ! On nie sa croissance, ses intermittences ! On la tient pour l'« unité de l'organisme » ! — Cette surestimation et cette méconnaissance ridicules de la conscience ont pour conséquence éminemment bénéfique d'avoir empêché son élaboration trop rapide. Les hommes croyant déjà posséder la conscience, ils se sont moins donné de mal pour l'acquérir — et il en va encore de même aujourd'hui ! S'incorporer le savoir et le rendre instinctif, cela demeure toujours une tâche absolument neuve, que l'œil humain commence tout juste à apercevoir, que l'on peut à peine identifier avec clarté, — une tâche qu'aperçoivent seuls ceux qui ont compris que nous ne nous sommes incorporé jusqu'à présent que nos erreurs et que toute notre conscience ne concerne que des erreurs ! (LGS/82-§11)
Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements parviennent à notre conscience - du moins en partie - est la conséquence d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme : étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible - et pour tout cela il lui fallait d'abord la « conscience », pour « savoir » lui-même ce qui lui manquait, « savoir » quelle était sa disposition d'esprit, « savoir » ce qu'il pensait. Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle; - car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication, par quoi l'origine même de la conscience se révèle. En un mot, le développement du langage et le développement de la conscience (non de la raison, mais seulement de la raison qui devient consciente d'elle-même) se donnent la main. (LGS/82-§354)
Après avoir passé assez de temps à scruter les philosophes, à les lire entre les lignes, je finis par me dire que la plus grande partie de la pensée consciente doit être, elle aussi, mise au nombre des activités instinctives, je n'excepte même pas la méditation philosophique.
De même que l'acte de la naissance n'entre pas en ligne de compte dans l'ensemble du processus de l'hérédité : de même le fait de la « conscience » n'est pas en opposition, d'une façon décisive, avec les phénomènes instinctifs, - la plus grande partie de la pensée consciente chez un philosophe est secrètement menée par ses instincts et forcée à suivre une voie tracée. Derrière la logique elle-même et derrière l'autonomie apparente de ses mouvements, il y a des évaluations de valeurs, ou, pour m'exprimer plus clairement, des exigences physiques qui doivent servir au maintien d'un genre de vie déterminé. Affirmer, par exemple, que le déterminé, a plus de valeur que l'indéterminé, l'apparence moins de valeur que la « vérité » : de pareilles évaluations, malgré leur importance régulative pour nous, ne sauraient être que des évaluations de premier plan, une façon de niaiserie, utile peut-être pour la conservation d'êtres tels que nous. En admettant, bien entendu, que ce n'est pas l'homme qui est la « mesure des choses »... (PDBM/86-§3)
Le problème de la conscience (ou plus exactement : de la conscience de soi) ne se présente à nous que lorsque nous commençons à comprendre en quelle mesure nous pourrions nous passer de la conscience : la physiologie et la zoologie nous placent maintenant au début de cette compréhension (il a donc fallu deux siècles pour rattraper la précoce défiance de Leibnitz). Car nous pourrions penser, sentir, vouloir, nous souvenir, nous pourrions également agir dans toutes les acceptions du mot, sans qu'il soit nécessaire que nous « ayons conscience » de tout cela. La vie tout entière serait possible sans qu'elle se vît en quelque sorte dans une glace : comme d'ailleurs, maintenant encore, la plus grande partie de la vie s'écoule chez nous sans qu'il y ait une pareille réflexion -, et de même la partie pensante, sensitive et agissante de notre vie, quoiqu'un philosophe ancien puisse trouver quelque chose d'offensant dans cette idée. Pourquoi donc la conscience si, pour tout ce qui est essentiel, elle est superflue!
la nature de la conscience animale implique que le monde dont nous pouvons avoir conscience n'est qu'un monde de surfaces et de signes, un monde généralisé, vulgarisé, — que tout ce qui devient conscient devient par là même plat, inconsistant, stupide à force de relativisation, générique, signe, repère pour le troupeau, qu'à toute prise de conscience est liée une grande et radicale corruption, falsification, superficialisation et généralisation. Enfin, la conscience en cours de croissance est un danger ; et qui vit parmi les Européens les plus conscients sait même que c'est une maladie. (LGS/86-§354)
« Combien la conscience avait à ronger autrefois ! Quelles bonnes dents elle avait ! — Et maintenant ? Qu’est-ce qui lui manque ? » — Question d’un dentiste. (LCI/88-1§29)
Nous nions que l'on puisse faire quoi que ce soit de parfait tant qu'on le fait consciemment. (ANT/88-§14)
Mauvaise conscience
Je considère la mauvaise conscience comme le profond état morbide où l’homme devait tomber sous l’influence de cette transformation, la plus radicale qu’il ait jamais subie, — de cette transformation qui se produisît lorsqu’il se trouva définitivement enchaîné dans le carcan de la société et de la paix. Tels des animaux aquatiques contraints de s’adapter à la vie terrestre ou à périr, ces demi-animaux si bien accoutumés à la vie sauvage, à la guerre, aux courses vagabondes et aux aventures, — virent soudain tous leurs instincts avilis et « rendus inutiles ». On les forçait, dès lors, d'aller sur leurs pieds et à « se porter eux-mêmes », alors que jusqu’à présent l’eau les avait portés : un poids énorme les écrasait. Ils se sentaient inaptes aux fonctions les plus simples ; dans ce monde nouveau et inconnu ils n’avaient pas leurs guides d’autrefois, ces instincts régulateurs, inconsciemment infaillibles, — ils en étaient réduits à penser, à déduire, à calculer, à combiner des causes et des effets, les malheureux ! ils en étaient réduits à leur « conscience », à leur organe le plus faible et le plus maladroit ! Je crois que jamais sur terre il n’y eut pareil sentiment de détresse, jamais malaise aussi pesant ! — Ajoutez à cela que les anciens instincts n’avaient pas renoncé d’un seul coup à leurs exigences ! Mais il était difficile et souvent impossible de les satisfaire : ils furent en somme forcés de se chercher des satisfactions nouvelles et souterraines. Tous les instincts qui n’ont pas de débouché, que quelque force répressive empêche d’éclater au-dehors, retournent en dedans — c’est là ce que j’appelle l’intériorisation de l’homme : de cette façon se développe en lui ce que plus tard on appellera son « âme ». Tout le monde intérieur, d’origine mince à tenir entre cuir et chair, s’est développé et amplifié, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur, lorsque l’expansion de l’homme vers l’extérieur a été entravée. Ces formidables bastions que l’organisation sociale a élevés pour se protéger contre les vieux instincts de liberté — et il faut placer le châtiment au premier rang de ces moyens de défense — ont réussi à faire se retourner tous les instincts de l’homme sauvage, libre et vagabond — contre l’homme lui-même. La rancune, la cruauté, le besoin de persécution — tout cela se dirigeant contre le possesseur de tels instincts : c’est là l’origine de la « mauvaise conscience ». (GM/87-dd§16)
C’est une maladie, la mauvaise conscience, la chose n’est que trop certaine, mais une maladie du genre de la grossesse. (GM/87-dd§19)
On aura déjà deviné ce qui se passa avec tout cela et sous le voile de tout cela : cette tendance à se torturer soi-même, cette cruauté rentrée de l’animal homme refoulé dans sa vie intérieure, se retirant avec effroi dans son individualité, enfermé dans l’ « État » pour être domestiqué, et qui inventa la mauvaise conscience pour se faire du mal, après que la voie naturelle de ce désir de faire le mal lui fut coupée, — cet homme de la mauvaise conscience s’est emparé de l’hypothèse religieuse pour pousser son propre supplice à un degré de dureté et d’acuité effrayant. Une obligation envers Dieu : cette pensée devint pour lui un instrument de torture. Il saisit en « Dieu » les derniers contrastes qu’il peut imaginer à ses propres instincts animaux irrémissibles, il transmue ces instincts mêmes en fautes envers Dieu (hostilité, rébellion, révolte contre le « maître », le « père », l’ancêtre et le principe du monde), il se plante au beau milieu de l’antithèse entre « Dieu » et le « diable », il jette hors de lui-même toutes les négations, tout ce qui le pousse à se nier soi-même, à nier la nature, le naturel, la réalité de son être pour en faire l’affirmation de quelque chose de réel, de vivant, de véritable, Dieu, Dieu saint, Dieu juste, Dieu bourreau, l’Au-delà, le supplice infini, l’enfer, la grandeur incommensurable de la punition et de la faute. C’est là une espèce de démence de volonté dans la cruauté psychique, dont à coup sûr on ne trouvera pas d’équivalent : cette volonté de l’homme à se trouver coupable et réprouvé jusqu’à rendre l’expiation impossible, sa volonté de se voir châtié sans que jamais le châtiment puisse être l’équivalent de la faute, sa volonté d’infester et d’empoisonner le sens le plus profond des choses par le problème de la punition et de la faute, pour se couper une fois pour toutes la sortie de ce labyrinthe d’ « idées fixes », sa volonté enfin d’ériger un idéal — celui du « Dieu très saint » — pour bien se rendre compte en présence de cet idéal de son absolue indignité propre. O triste et folle bête humaine ! À quelles imaginations bizarres et contre nature, à quel paroxysme de démence, à quelle bestialité de l’idée se laisse-t-elle entraîner dès qu’elle est empêchée quelque peu d’être bête de l’action ! […] Il n’est pas douteux que nous ne nous trouvions en présence d’une maladie, la plus terrible qui ait jamais sévi parmi les hommes : — et celui qui est encore capable d’entendre (mais de nos jours on n’a plus d’oreilles pour entendre où il faudrait —), d’entendre retentir dans cette nuit de torture et d’absurdité, le cri d’amour, le cri de l’extase, enflammé de désir, le cri de la rédemption par l’amour, celui-là se retournera saisi d’une invincible horreur... En l’homme il y a tant de choses effroyables ! — Trop longtemps la terre fut un asile d’aliénés !... (GM/87-dd§22)
CONSERVATION DE L'ESPÈCE
J’ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil, je les trouve toujours occupés, tous et chacun en particulier, à une même tâche : à faire ce qui est utile à la conservation de l’espèce. Et ce n’est certes pas à cause d’un sentiment d’amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n’est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct, - puisque cet instinct est précisément l’essence de notre espèce et de notre troupeau. […] L’homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l’espèce ; car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l'humanité serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s'appelle le mal cela fait partie de l'extraordinaire économie dans la conservation de l'espèce, une économie coûteuse, prodigue et, en somme, excessivement insensée : - mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu'à présent notre espèce. Je ne sais plus, mon cher frère en humanité, si, en somme, tu peux vivre au détriment de l'espèce, c'est-à-dire d'une façon « déraisonnable » et « mauvaise » ; ce qui aurait pu nuire à l'espèce s'est peut-être éteint déjà depuis des milliers d'années et fait maintenant partie de ces choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. (LGS/82-§1)
CONSIDÉRATION
Celui-ci désire se rendre intéressant par ses jugements, celui-là par ses sympathies et ses aversions, le troisième par ses connaissances, un quatrième par son isolement – et ils se méprennent tous. Car celui devant qui le spectacle se donne pense lui-même être le seul spectacle qui mérite considération. (HTH/78-§364)
CONSTRUCTION
C'est nous , les hommes qui sentent en pensant, qui ne cessons de construire réellement quelque chose qui n'existe pas encore : tout le monde éternellement en croissance des appréciations, des couleurs, des poids, des perspectives, des gradations, des acquiescements et des négations. Ce poème que nous avons composé est constamment assimilé à force d'étude et d'exercice, traduit en chair et en réalité, et même en quotidienneté par ceux qu'on appelle les hommes pratiques (nos acteurs, ainsi que nous l'avons dit). (LGS/82-§301)
CONTENTEMENT DE SOI
La toison d'or du contentement de soi-même protège des horions, mais non contre les coups d'épingle. (HTH/78-§569)
CONVICTION
Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. (HTH/78-§483)
L'ensemble de son être ne convainc pas — cela vient de ce qu'il n'a jamais su taire une bonne action qu'il ait accomplie. (LGS/82-§230)
Pour être fort, il faut être libre de toute conviction, savoir regarder librement... La grande passion, assise et puissance de son être, encore plus éclairée, plus despotique qu'il n'est lui-même, requiert tout son intellect; elle lui ôte tout scrupule : elle lui donne même le courage de moyens peu édifiants : le cas échéant, elle lui permet des convictions. La conviction est un moyen : il est bien des choses que l'on n'atteint qu'au moyen d'une conviction. (ANT/88-§54)
CORPS
Derrière tes pensées et tes sentiments, il y a ton corps, et ton soi dans le corps : la terra incognita. Dans quel but as-tu telles pensées et tels sentiments ? Ton soi, dans ton corps, veut, par ce biais, quelque chose. (FP/82-84-v9)
Sans le fil conducteur du corps je ne crois à la validité d'aucune recherche.
le corps humain est un composé bien plus parfait que n'importe quel système de pensées et de sentiments, et même à mettre beaucoup plus haut qu'une œuvre d'art .
Notre corps est plus sage que notre esprit.
Le but : l'évolution vers un stade supérieur du corps tout entier et pas seulement du cerveau ! (FP/84-v10)
Je connais trop bien ceux qui sont semblables à Dieu : ils veulent qu’on croie en eux et que le doute soit un péché. Je sais trop bien à quoi ils croient eux-mêmes le plus.
Et ce moi, l’Être le plus loyal – parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s’exalte en voletant de ses ailes brisées.
Ce furent des malades et des décrépits qui méprisèrent le corps et la terre, qui inventèrent les choses célestes et les gouttes du sang rédempteur : et ces poisons doux et lugubres, c’est encore au corps et à la terre qu’ils les ont empruntés !
Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps guéri : c’est une voix plus loyale et plus pure.
C’est aux contempteurs du corps que je veux dire leur fait. Ils ne doivent pas changer de méthode d’enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps – et ainsi devenir muets.
Le corps est un grand système de raison, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger.
Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. (APZ/83-85-p1)
Depuis que je connais mieux le corps, – disait Zarathoustra à l’un de ses disciples – l’esprit n’est plus pour moi esprit que dans une certaine mesure ; et tout ce qui est « impérissable » – n’est aussi que symbole. (APZ/83-85-p2)
Ce qui est plus surprenant, c'est bien plutôt le corps : on ne se lasse pas de s'émerveiller à l'idée que le corps humain est devenu possible ; que cette collectivité inouïe d'êtres vivants, tous dépendants et subordonnés, mais en un autre sens dominants et doués d'activité volontaire, puisse vivre et croître à la façon d'un tout, et subsister quelque temps.
ces êtres vivants microscopiques qui constituent notre corps (ou plutôt dont la coopération ne peut être mieux symbolisée que par ce que nous appelons notre « corps » —) ne sont pas pour nous des atomes spirituels, mais des êtres qui croissent, luttent, s'augmentent ou dépérissent : si bien que leur nombre change perpétuellement et que notre vie, comme toute vie, est en même temps une mort perpétuelle.
de tout temps l'homme a vécu dans un rapport de profonde méconnaissance à l'égard de son corps et s'est contenté de quelques formules pour s'exprimer sur ses états [...] on s'en tient fermement, sur son propre compte, à quelques signes extérieurs et accessoires et on ne sent pas à quel point nous sommes profondément inconnus et étrangers à nous-mêmes.
[...] même les philosophes et les croyants qui dans leur logique ou dans leur piété avaient les raisons les plus convaincantes de tenir ce qui est corporel pour une illusion, et pour une illusion dépassée et révolue, n'ont pu s'empêcher de reconnaître le fait stupide que leur corps n'avait pas disparu.
Interroger directement le sujet sur le sujet et les reflets que l'esprit saisit de lui-même, ce procédé a ses dangers, il se pourrait qu'il fût utile et important pour l'activité du sujet de donner une fausse interprétation de lui-même. C'est pourquoi nous nous adresserons au corps et nous répudierons le témoignage des sens aiguisés : nous épierons, pourrait-on dire, si les subordonnés eux-mêmes ne voudraient pas entrer en relation avec nous.
… à supposer que l'« âme » fût une pensée attirante et mystérieuse dont les philosophes ont eu raison de ne se détacher qu'à regret — peut-être que ce qu'ils apprennent à accepter désormais en échange est plus attirant encore, plus mystérieux. [...] le corps est une pensée plus surprenante que jadis l' « âme ».
[...] de tout temps l'homme a vécu dans un rapport de profonde méconnaissance à l'égard de son corps et s'est contenté de quelques formules pour s'exprimer sur ses états [...] on s'en tient fermement, sur son propre compte, à quelques signes extérieurs et accessoires et on ne sent pas à quel point nous sommes profondément inconnus et étrangers à nous-mêmes.
Guidés par le fil conducteur du corps, [...] nous apprenons que notre vie n'est possible que grâce au jeu combiné de nombreuses intelligences de valeur très inégale, donc grâce à un perpétuel échange d'obéissance et de commandement sous des formes innombrables – ou, en termes de morale, grâce à l'exercice ininterrompu de nombreuses vertus. (FP/84-85-v11)
Avec le corps pour fil conducteur, une prodigieuse diversité se révèle ; il est méthodologiquement permis d'utiliser un phénomène plus riche et plus facile à étudier comme fil conducteur pour comprendre un phénomène plus pauvre. (FP/85-87-v12)
… notre corps n'est qu'une collectivité d'âmes nombreuses. (PDBM/86-§19)
Le déguisement inconscient de besoins physiologiques sous le costume de l'objectif, de l'idéel, du purement spirituel atteint un degré terrifiant, — et assez souvent, je me suis demandé si, somme toute, la philosophie jusqu'à aujourd'hui n'a pas été seulement une interprétation du corps et une mécompréhension du corps. Derrière les jugements de valeur suprêmes qui ont jusqu'à présent guidé l'histoire de la pensée se cachent des mécompréhensions relatives à la constitution du corps, que ce soit de la part d'individus, de classes ou de races entières. (LGS/86-pref2)
Mon corps se sent (comme d’ailleurs ma philosophie) assigné au froid comme à l’élément de sa conservation – cela résonne comme un paradoxe déplaisant, c’est pourtant le fait le mieux avéré de mon existence. (DL/87-MVM)
La notion de l' « âme », « esprit » et en fin de compte même de l' « âme immortelle », a été inventée pour mépriser le corps, pour le rendre malade. (EH/88-4§8)
COURAGE
Avez-vous du courage, ô mes frères ? Êtes-vous résolus ? Non pas du courage devant des témoins, mais du courage de solitaires, du courage d'aigles dont aucun dieu n'est plus spectateur ? (APZ/83-85-p4)
CRÉER - CRÉATION
Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche le créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles.
Je veux me joindre aux créateurs, à ceux qui moissonnent et chôment : je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au Surhomme. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude ; et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui alourdirai le cœur de ma félicité. (APZ/83-85-p1)
Créer - c'est la grande délivrance de la douleur, et l'allègement de la vie. Mais afin que naisse le créateur, il faut beaucoup de douleurs et de métamorphoses. (APZ/83-85-p2)
CRIME
CROIRE - CROYANCE
Celui qui attache à ce que l'on croit en lui une importance telle qu'il garantit le ciel en récompense, et cela à tout homme, même au larron en croix, - celui-là doit avoir souffert d'un terrible doute et avoir enduré toutes les sortes de crucifixions : sinon il n'achèterait pas ses croyants si cher. (AUR/81-§67)
Accepter une croyance uniquement parce que c'est la coutume, - cela signifie au fond : être malhonnête, être lâche, être paresseux! - Ainsi la malhonnêteté, la lâcheté et la paresse constitueraient les bases de la moralité? (AUR/81-§101)
La plupart des hommes ne trouvent pas méprisable de croire à telle ou telle chose et de vivre en fonction de cette croyance sans avoir au préalable pris conscience des ultimes et plus sûres raisons relatives au pour ou au contre et sans non plus se donner la peine de chercher ces raisons après coup - les hommes les plus doués et les femmes les plus nobles font encore partie de cette " plupart ". (LGS/82-§2)
Mais qu'est-ce pour moi que la bonté d'âme, la finesse et le génie si l'homme qui possède ces vertus tolère en lui des sentiments relâchés dans ses croyances et ses jugements, s'il ne ressent pas l'exigence de certitude comme son désir le plus intime et son besoin le plus profond, - comme ce qui distingue les hommes supérieurs des hommes inférieurs ! (LGS/82-§2)
Si important qu'il puisse être de connaître les motifs d'après lesquels l'humanité a vraiment agi jusqu'à présent : peut-être la croyance à tel ou tel motif, donc à ce en quoi l'humanité elle-même a voulu voir et a imaginé à tort jusqu'à présent les véritables ressorts de son agir, est-elle une chose encore plus essentielle pour l'homme de connaissance. Les hommes ont en effet reçu en partage leur bonheur et leur misère intérieurs en fonction de leur croyance à tel ou tel motif - et non pas de ce qui était réellement motif ! L'intérêt de ce dernier n'est jamais que de second ordre. (LGS/82-§44)
" Croire " signifie "refuser de savoir " ce qui est vrai. (ANT/88-§52)
CROISSANCE
Mettez à l'épreuve la vie des meilleurs et des plus féconds des hommes et des peuples, et demandez-vous si un arbre qui doit prendre fièrement de la hauteur peut se dispenser du mauvais temps et des tempêtes : si la défaveur et la résistance extérieures, si toutes les espèces de haine, de jalousie, d'obstination, de défiance, de dureté, d'avidité et de violence ne font pas partie des conditions propices sans lesquelles une forte croissance n'est guère possible même dans la vertu? Le poison dont meurt la nature plus faible est pour le fort fortifiant - et il ne le qualifie pas non plus de poison". (LGS/82-§19)
CROIX
La Croix, signe de reconnaissance de la conjuration la plus souterraine qu'il y ait jamais eu - contre la santé, la beauté, la réussite physique, l'audace, l'esprit, la qualité d'âme, contre la vie même… (ANT/88-§62)
CRUAUTÉ
Quelle est la jouissance la plus haute pour des hommes en guerre, dans cette petite communauté constamment menacée où règne la moralité la plus stricte? Donc pour des âmes fortes, vindicatives, haineuses, perfides, soupçonneuses, prêtes au pire et endurcies par les privations et la moralité? La jouissance de cruauté : de même, dans ces circonstances, on compte pour vertu à une telle âme d'être inventive et insatiable dans la cruauté. (AUR/81-§18)
La cruauté est l'une des plus antiques réjouissances de l'humanité. Par suite on s'imagine que les dieux aussi sont récréés et mis en belle humeur lorsqu'on leur offre le spectacle de la cruauté, - ainsi s'insinue dans le monde l'idée que la souffrance volontaire, le martyre librement choisi possède un sens et une valeur élevés. (AUR/81-§18)
CULPABILITÉ
L'arrière-pensée la plus répandue chez les chrétiens du premier siècle ne fut-elle pas vraisemblablement celle-ci : " il vaut mieux se persuader de sa culpabilité que de son innocence, car on ne sait pas très bien quel peut être l'état d'esprit d'un juge si puissant, - mais on doit craindre qu'il souhaite ne trouver que des coupables conscients de leur faute! Ayant une aussi grande puissance, il fera plus facilement grâce à un coupable qu'il n'avouera que quelqu'un est dans son bon droit envers lui. " - Tel était, dans les provinces, le sentiment des pauvres gens devant le préteur romain : " il est trop fier pour que nous ayons le droit d'être innocents ", - comment ce sentiment ne se serait-il pas précisément retrouvé dans la représentation chrétienne du juge suprême! (AUR/81-§74)
CULTURE
Il n'y a d'autre culture que la culture française, ce n'est pas une objection, c'est au contraire la raison pour laquelle il faut aller à l'unique école qui soit - elle est nécessairement la bonne… (DL/88-AS)
CURIOSITÉ
Si la curiosité n'existait pas, il se ferait peu de chose pour le bien du prochain. Mais la curiosité s'insinue sous le nom de devoir ou de pitié dans la maison du malheureux et de l'indigent. - Peut-être même y a-t-il une bonne part de curiosité dans le fameux amour maternel. (HTH/78-§363)
DANGER
On est le plus en danger d'être écrasé lorsqu'on vient d'esquiver une voiture. (HTH/78-§564)
DÉCADENCE
Cette irrévérence de considérer les grands sages comme des types de décadence naquit en moi précisément dans un cas où le préjugé lettré et illettré s'y oppose avec le plus de force : j'ai reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence, des instruments de la décomposition grecque, des pseudo-grecs, des antigrecs (L'Origine de la tragédie. 1872). Ce consensus sapientium - je l'ai toujours mieux compris - ne prouve pas le moins du monde qu'ils eussent raison, là où ils s'accordaient : il prouve plutôt qu'eux-mêmes, ces sages parmi les sages, avaient entre eux quelque accord physiologique, pour prendre à l'égard de la vie cette même attitude négative, - pour être tenus de la prendre.
De la part d'un philosophe, voir un problème dans la valeur de la vie, demeure même une objection contre lui, un point d'interrogation envers sa sagesse, un manque de sagesse. - Comment ? et tous ces grands sages - non seulement ils auraient été des décadents, mais encore ils n'auraient même pas été des sages ? (LCI/88-2§2)
Être forcé de lutter contre les instincts - c'est là la formule de la décadence : tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont identiques. (LCI/88-2§11)
Qu'est-ce qui détruit plus rapidement que de travailler, de penser, de sentir sans nécessité intérieure, sans un choix profondément personnel, sans plaisir, comme un automate mû par le " devoir " ? C'est, tout bonnement, la recette de la décadence. (ANT/88-§11)
C'est la prédominance des sentiments désagréables sur les sentiments agréables qui est la cause de cette morale et de cette religion fictives : mais cette prédominance nous donne aussi la formule de la décadence. (ANT/88-§15)
Partout où, sous une forme ou sous une autre, la volonté de puissance décline, il se produit également une régression physiologique, une décadence. La divinité de la décadence, châtrée de ses vertus et de ses instincts les plus virils, devient alors nécessairement le dieu de ceux qui ont régressé physiologiquement, le dieu des faibles. Ils ne se nomment pas eux-mêmes les faibles, ils se nomment " les bons "...
On comprend, sans qu'il soit besoin d'insister, à quels moments de l'histoire la fiction dualiste d'un Dieu bon et d'un Dieu méchant devient possible. Le même instinct qui amène les hommes soumis à rabaisser leur Dieu au rang de " bien en soi " les conduit à effacer toutes les qualités du Dieu de ceux qui les ont soumis. Ils se vengent de leurs maîtres en diabolisant leur Dieu. Le bon Dieu, tout comme le Diable : deux sous-produits de la décadence. (ANT/88-§17)
Sans compter que je suis un décadent, je suis aussi le contraire d'un décadent. J'en ai fait la preuve, entre autres, en choisissant toujours, instinctivement, le remède approprié au mauvais état de ma santé ; alors que le décadent a toujours recours au remède qui lui est funeste. Dans ma totalité j'ai été bien portant ; dans le détail, en tant que cas spécial, j'ai été décadent. L'énergie que j'ai eue de me condamner à une solitude absolue, de me détacher de toutes les conditions habituelles de la vie, la contrainte que j'ai exercée sur moi-même en ne me laissant plus soigner, dorloter, médicamenter, tout cela démontre que je possédais une certitude instinctive et absolue de ce qui m'était alors nécessaire. Je me suis pris moi-même en traitement, je me suis guéri moi-même. La condition pour réussir une telle cure - tout physiologiste en conviendra - c'est d'être bien portant au fond. (EH/88-1§2)
Quel sens ont ces conceptions mensongères, les conceptions auxiliaires de la morale - " l'âme ", " l'esprit ", " le libre arbitre ", " Dieu ", - si ce n'est de ruiner physiologiquement l'humanité ?... Lorsque l'on détourne le sérieux de la conservation de soi, de l'accroissement de la force corporelle, c'est-à-dire de la vie, lorsque l'on fait de la chlorose un idéal, du mépris du corps le " salut de l'âme ", qu'est-ce autre chose, sinon une recette pour aboutir à la décadence ? (EH/88-3§2)
DÉFAUT
Nos défauts sont les yeux par lesquels nous voyons l'idéal. (OSM/79-§86)
DÉMENT - DÉLIRANT
Pendant tout le moyen âge, on tint pour le signe distinctif et irréfutable de l'humanité supérieure l'aptitude à avoir des visions - c'est-à-dire un profond dérangement mental! Et au fond, les principes de vie médiévaux pour toutes les natures supérieures (les natures religieuses) visent à rendre l'homme capable de visions! Quoi d'étonnant si déferle encore sur notre époque une surévaluation des gens à demi déments, délirants, fanatiques, des soi-disant génies; " ils ont vu des choses que les autres ne voient pas ", - certes! Et cela devrait nous inciter à la prudence envers eux, non à la crédulité. (AUR/81-§66)
DÉSINTÉRESSEMENT
Le " prochain " fait l'éloge du désintéressement parce qu'il en tire profit! Si le prochain pensait lui-même de manière " désintéressée ", il rejetterait cette destruction de force, ce dommage subi à son profit à lui, il travaillerait à empêcher l'émergence de telles inclinations et surtout il témoignerait de son propre désintéressement en ne les qualifiant pas de bonnes! - Voilà qui indique la contradiction fondamentale de la morale qui est justement tenue en grand honneur aujourd'hui : les motivations de cette morale sont en contradiction avec son principe! (LGS/82-§21)
DÉSIR
Hypocrites sensibles et lascifs ! Il vous manque l'innocence dans le désir : et c'est pourquoi vous calomniez le désir ! (APZ/83-85-p2)
Mon sage désir jaillissait de moi avec des cris et des rires ; comme une sagesse sauvage vraiment il est né sur les montagnes ! - mon grand désir aux ailes bruissantes.
DESTIN
Deviens qui tu es ! (APZ/83-85-p4)
DETTE
Le débiteur, pour inspirer confiance en sa promesse de remboursement, pour donner une garantie du sérieux, de la sainteté de sa promesse, pour graver dans sa propre conscience la nécessité du remboursement sous forme de devoir, d’obligation, s’engage, en vertu d’un contrat, auprès du créancier, pour le cas où il ne paierait pas, à l’indemniser par quelque chose d’autre qu’il « possède », qu’il a encore en sa puissance, par exemple son corps, sa femme, sa liberté, voire même sa vie (ou bien, sous l’empire de certaines influences religieuses, son salut éternel, le salut de son âme et jusqu’à son repos dans la tombe : tel en Égypte, où le cadavre du débiteur ne trouvait pas de grâce devant le créancier.
— il est vrai que chez les Égyptiens une idée particulière se rattachait à ce repos. Mais le créancier pouvait notamment dégrader et torturer de toutes les manières le corps du débiteur, par exemple en couper telle partie qui parût en proportion avec l'importance de la dette : — en se basant sur cette manière de voir, il y eut partout et de bonne heure des évaluations précises, parfois atroces dans leur minutie, des évaluations ayant force de droit des divers membres et parties du corps.
[...] Grâce au châtiment infligé au débiteur, le créancier prend part au droit des maîtres : il finit enfin, lui aussi, par goûter le sentiment ennoblissant de pouvoir mépriser et maltraiter un être comme quelque chose qui est « au-dessous de lui » — ou, du moins dans le cas où le vrai pouvoir exécutif et l’application de la peine ont déjà été délégués à l’ « autorité », de voir du moins mépriser et maltraiter cet être. La compensation consiste donc en une assignation et un droit à la cruauté. — (GM/87-dd§5)
C’est dans cette sphère du droit d’obligation que le monde des concepts moraux « faute », « conscience », « devoir », « sainteté du devoir » a son foyer d’origine ; — à ses débuts, comme tout ce qui est grand sur la terre, il a été longuement et abondamment arrosé de sang. Et ne faudrait-il pas ajouter que ce monde n’a jamais perdu tout à fait une certaine odeur de sang et de torture ? (pas même chez le vieux Kant : l’impératif catégorique a un relent de cruauté...) C’est ici aussi que cet étrange enchaînement d’idées, aujourd’hui peut-être inséparable, l’enchaînement entre « la faute et la souffrance » a commencé par se former. Encore une fois : comment la souffrance peut-elle être une compensation pour des « dettes » ? Faire souffrir causait un plaisir infini, en compensation du dommage et de l’ennui du dommage cela procurait aux parties lésées une contre-jouissance extraordinaire : faire souffrir ! — une véritable fête ! d’autant plus goûtée, je le répète, que le rang et la position sociale du créancier étaient en contraste plus frappant avec la position du débiteur. (GM/87-dd§6)
DEVOIR
Tous les hommes qui sentent qu'ils ont besoin des mots et des accents les plus forts, des gestes et des attitudes les plus expressifs, pour simplement produire un effet, les hommes politiques révolutionnaires, les socialistes, les prédicateurs de pénitence avec ou sans christianisme, tous ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des demi-succès : tous ces gens-là parlent de devoirs ", et toujours à vrai dire de devoirs possédant le caractère de l'inconditionné - sans eux, ils n'auraient pas droit à leur grand pathos : et ils le savent parfaitement ! (LGS/82-§5)
DÉVOUEMENT
Supposez que l'instinct de dévouement et de sollicitude envers les autres (" l'affection sympathique ") soit deux fois plus fort qu'il n'est : la situation sur terre deviendrait intenable. Considérez simplement combien chacun commet de sottises par dévouement et sollicitude envers soi-même, tous les jours et à toute heure, et quel insupportable spectacle il offre alors : que serait-ce si nous devenions pour les autres l'objet de ces sottises et de ces importunités qu'ils se réservaient jusqu'ici à eux-mêmes! Ne prendrions-nous pas aveuglément la fuite dès qu'un " prochain " serait dans les parages? Et ne gratifierions-nous pas l'affection sympathique de ces vocables malsonnants dont nous gratifions aujourd'hui l'égoïsme ? (AUR/81-§143)
DIEU
Combien il y a de gens qui raisonnent encore ainsi : " la vie serait insupportable s'il n'y avait pas de Dieu! " (ou, comme on dit dans les cercles idéalistes : " la vie serait insupportable si la signification éthique de son fondement venait à manquer! ") - par conséquent il faut qu'il y ait un Dieu (ou une signification éthique de l'existence)! En vérité, le fait est seulement que celui qui a pris l'habitude de ces représentations ne désire plus vivre sans elles : que pour lui, donc, pour sa survie, ces représentations sont peut-être nécessaires, - mais quelle présomption de décréter que tout ce qui est nécessaire à ma survie doit réellement exister! Comme si ma survie @?tait quelque chose de nécessaire! Et si d'autres ressentaient le contraire! S'ils ne désiraient justement pas vivre dans la dépendance de ces deux articles de foi et trouvaient que dans ces conditions la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue! (AUR/81-§90)
Un Dieu qui laisse subsister pendant des millénaires des doutes et des hésitations innombrables, comme s'ils étaient négligeables pour le salut de l'humanité, et qui donne pourtant constamment à prévoir les plus effroyables conséquences en cas de méprise sur la vérité? Ne serait-ce pas un Dieu cruel, s'il possédait la vérité et supportait toutefois la vue d'une humanité qui se torture misérablement pour l'atteindre? - Ou peut-être est-ce quand même un Dieu de bonté - mais incapable de s'exprimer plus clairement! (AUR/81-§91)
Autrefois on cherchait à prouver qu'il n'y avait pas de dieu, - aujourd'hui on montre comment la croyance en un dieu a pu naître et à quoi cette croyance doit son poids et son importance : du coup une contre-preuve de l'inexistence de Dieu devient superflue. - Autrefois, lorsque l'on avait réfuté les "preuves de l'existence de Dieu " qui étaient avancées, le doute persistait encore : ne pouvait-on pas trouver des preuves meilleures que celles que l'on venait de réfuter : en ce temps-là les athées ne savaient pas faire table rase. (AUR/81-§95)
Dieu nous aime parce qu'il nous a crées ! -
Après que Bouddha fut mort, on montra encore son ombre durant des siècles dans une caverne, - une ombre formidable et terrifiante. Dieu est mort : mais l'espèce humaine est ainsi faite qu'il y aura peut-être encore durant des millénaires des cavernes au fond desquelles on montrera son ombre. - Et nous - il nous faut aussi vaincre son ombre ! (LGS/82-§108)
N'avez-vous pas entendu parler de ce dément qui, dans la clarté de midi alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer : " Je cherche Dieu! Je cherche Dieu! " - Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. S'est-il donc perdu? disait l'un. S'est-il égaré comme un enfant? disait l'autre. Ou bien s'est-il caché? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? - ainsi criaient-ils en riant dans une grande pagaille. Le dément se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. (LGS/82-§125)
N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine? - les dieux aussi se décomposent! Dieu est mort! Dieu demeure mort! Et nous l'avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous, assassins entre les assassins? Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang, - qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles cérémonies expiatoires, quels jeux sacrés nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour apparaître seulement dignes de lui? Jamais il n'y eut acte plus grand, - et quiconque naît après nous appartient du fait de cet acte à une histoire supérieure à ce que fut jusqu'alors toute histoire ! " (LGS/82-§125)
Cet événement formidable (la mort de Dieu) est encore en route et voyage, - il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière des astres a besoin de temps, les actes ont besoin de temps, même après qu'ils ont été accomplis, pour être vus et entendus. Cet acte est encore plus éloigné d'eux que les plus éloignés des astres, - et pourtant ce sont eux qui l'ont accompli. " (LGS/82-§125)
" Dieu lui-même ne peut subsister sans des hommes sages " - a dit Luther, et à juste titre; mais " Dieu peut encore moins subsister sans des hommes sans sagesse " - et cela, le brave Luther ne l'a pas dit! (LGS/82-§129)
Si Dieu voulait devenir objet d'amour, il aurait dû commencer par renoncer au rôle de juge et à la justice : - un juge, même un juge miséricordieux, n'est pas objet d'amour. Le fondateur du christianisme n'a pas fait preuve ici d'une sensibilité assez fine, - en tant que juif. (LGS/82-§140)
Comment? Un Dieu qui aime les hommes à condition qu'ils croient en lui et darde des regards et des menaces terrifiants sur qui ne croit pas à cet amour ! Comment? Un amour négocié comme sentiment d'un Dieu tout-puissant ! Un amour qui n'a même pas su l'emporter sur le sentiment d'honneur et la soif de vengeance ! Que tout ceci est oriental ! Si je t'aime, qu'est-ce que cela peut te faire " est déjà une critique suffisante de tout le christianisme. (LGS/82-§141)
Mais quand Zarathoustra fut seul, il parla ainsi à son cœur : " Serait-ce possible ! Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort ! " (APZ/83-85-p1)
Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser. (APZ/83-85-p1)
Hélas, mes frères, ce dieu que j'ai créé était œuvre faite de main humaine et folie humaine, comme sont tous les dieux.
La fatigue qui d'un seul bond veut aller jusqu'à l'extrême, d'un bond mortel, cette fatigue pauvre et ignorante qui ne veut même plus vouloir : c'est elle qui créa tous les dieux et tous les arrière-mondes.
Qu'y aurait-il donc à créer, s'il y avait des Dieux ? (APZ/83-85-p2)
On a besoin du Dieu méchant tout autant que du Dieu bon : après tout, ce n'est pas à la tolérance, à la philanthropie, que l'on doit l'existence... Que nous importerait un Dieu qui ne connaîtrait pas la colère, la vengeance, l'envie, le sarcasme, la ruse, la violence ? Un Dieu qui pourrait ignorer jusqu'aux voluptueuses " ardeurs " de la victoire et de l'anéantissement ? On ne comprendrait pas un tel Dieu; à quoi bon l'avoir pour Dieu ? (ANT/88-§16)
En vérité, il n'y a pour les Dieux pas d'autre choix : soit ils sont la volonté de puissance - et dans ce cas, ils seront des Dieux nationaux, - soit ils sont l'impuissance de la volonté - et alors ils deviennent nécessairement bons... (ANT/88-§16)
Comment peut-on, maintenant encore, capituler devant la naïveté des théologiens chrétiens au point de décréter avec eux que le passage du " Dieu d'Israël ", du Dieu national, au Dieu chrétien, à l'archétype de tout Bien, constitue un progrès? C'est pourtant ce que fait même un Renan. Comme si Renan pouvait prétendre à la naïveté! Le contraire saute aux yeux. Lorsque les conditions nécessaires à l'éclosion de la vie montante, lorsque tout ce qui est fort, audacieux, dominateur, fier, est éliminé de la notion de Dieu, lorsque, peu à peu, le Dieu est rabaissé au rang d'une symbolique canne pour les éclopés, d'une planche de salut pour tous ceux qui se noient, lorsqu'il devient, par excellence le " Dieu des humbles ", le Dieu des pécheurs, le Dieu des malades, et qu'il ne reste pratiquement comme attribut de la divinité que le prédicat " Messie ", " Sauveur " - que signifie une telle métamorphose? Une telle réduction du divin ? (ANT/88-§17)
La conception chrétienne de Dieu - Dieu conçu en tant que Dieu des malades, Dieu-araignée, Dieu-esprit - c'est là une des conceptions de Dieu les plus corrompues qui aient jamais été formées sur terre : elle constitue peut-être même le plus bas de l'étiage dans l'évolution déclinante des types divins. Dieu dégénéré en antithèse de la vie, au lieu d'être sa transfiguration, son éternel acquiescement! Dieu, défi jeté à la vie, à la Nature, au vouloir-vivre ! Dieu, formule unique pour dénigrer l' " en-deçà " et répandre le mensonge de l' " au-delà "! Avoir, en Dieu, divinisé le Néant, sanctifié l'aspiration au Néant !... (ANT/88-§18)
Que les fortes races de l'Europe septentrionale n'aient pas rejeté le Dieu chrétien, voilà qui ne fait guère honneur à leur sens religieux, sans même parler de leur goût. Elles auraient dû avoir facilement raison de ce monstre cacochyme engendré par la décadence. Mais ce sera leur malédiction de n'avoir su en venir à bout : elles ont absorbé dans tous leurs instincts la maladie, la vieillesse, la contradiction, - et depuis lors, elles n'ont pas créé un seul dieu! Près de deux millénaires, et pas un seul Dieu nouveau! Mais, encore et toujours, comme s'il existait de droit, comme un ultimatum et maximum du pouvoir de créer des Dieux, du creator spiritus dans l'homme, ce pitoyable Dieu du " monotono-théisme " chrétien! Cet hybride produit de la déchéance, fait de vide, d'abstractions et de contradictions, en qui tous les instincts de la décadence, toutes les lâchetés et les lassitudes de l'âme trouvent leur sanction!... (ANT/88-§19)
Dieu a offert son fils en sacrifice pour la rémission des péchés. Et d'un seul coup, c'en était bel et bien fait de l'Évangile ! Le sacrifice expiatoire, et sous sa forme la plus répugnante, la plus barbare, le sacrifice de l'innocent pour les péchés des coupables ! Quel effroyable paganisme ! (ANT/88-§41)
Ce qui nous distingue nous, ce n'est pas de ne retrouver aucun Dieu, ni dans l'histoire, ni dans la nature, ni derrière la nature, - c'est de ressentir ce que l'on a vénéré sous le nom de "Dieu", non comme "divin", mais comme pitoyable, comme absurde, comme nuisible, non seulement comme une erreur, mais comme un crime contre la vie. Nous nions Dieu en tant que Dieu. (ANT/88-§47)
DIONYSOS - DIONYSISME
Sous le charme de Dionysos, non seulement le lien se renoue d'homme à homme, mais même la nature qui nous est devenue étrangère, hostile ou asservie, fête sa réconciliation avec l'homme, son fils prodigue. (LNT/72-§1)
Qu'on transforme en un tableau le triomphal Hymne à la Joie de Beethoven et qu'on tâche d'égaler cette imagination qui voit les millions d'êtres se prosterner dans la poussière : on aura alors une idée approchante du dionysisme. L'esclave devient un homme libre, toutes les barrières rigides et hostiles que la nécessité, l'arbitraire ou " la mode insolente " ont mises entre les hommes cèdent à présent. (LNT/72-§1)
DISTINCTION
L'aspiration à se distinguer est une aspiration à dominer le prochain, ne fût-ce que d'une manière très indirecte et seulement sentimentale ou même imaginaire. Il y a toute une série de degrés dans ce désir secret de domination, et leur nomenclature complète équivaudrait presque à une histoire de la culture, depuis la première barbarie encore grimaçante jusqu'aux grimaces du raffinement excessif et de l'idéalité morbide. L'aspiration à se distinguer entraîne pour le prochain - pour nommer seulement quelques degrés de cette longue échelle - : les tortures, puis les coups, puis l'épouvante, puis l'étonnement angoissé, puis l'émerveillement, puis l'envie, puis l'admiration, puis l'exaltation puis la joie, puis la gaieté, puis le rire, puis la dérision, puis la raillerie, puis les huées, puis la distribution de coups, puis la mise à la torture : - ici, au sommet de l'échelle, se tient l'ascète et le martyr; il ressent la plus haute jouissance à endurer lui-même, par suite de son besoin de se distinguer, ce que son opposé sur le premier barreau de l'échelle, le barbare, inflige à celui devant lequel il veut se distinguer et exceller. (AUR/81-§113)
DOULEUR
On souffre peu de souhaits inexaucés si l'on a exercé son imagination à enlaidir le passé. (HTH/78-§563)
Souffrir moralement, puis s'entendre dire que ce genre de souffrance repose sur une erreur, cela indigne. Car il y a une consolation exceptionnelle à affirmer par sa souffrance un " monde de la vérité plus profond " que tout autre monde, et l'on préfère infiniment souffrir et se sentir par là supérieur à la réalité (par la conscience de s'approcher ainsi de ce " monde plus profond de la vérité ") plutôt que de vivre sans souffrance mais aussi sans ce sentiment de supériorité. Ce sont donc la fierté et la façon habituelle de la satisfaire qui s'opposent à la nouvelle conception de la morale. Quelle force faudra-t-il donc employer pour éliminer cette entrave? Plus de fiert@? ? Une nouvelle fierté ? (AUR/81-§32)
Double douleur est plus facile à porter - Que douleur unique : veux-tu tenter ? (LGS/82-Prél.§20)
… si vous voulez diminuer et amoindrir la souffrance des hommes, en bien ! il vous faudra diminuer et amoindrir aussi la capacité de joie. (LGS/82-§12)
Souffrance méconnue. - Les natures grandioses souffrent autrement que leurs admirateurs ne se l'imaginent : elles souffrent le plus durement par les émotions vulgaires et mesquines de certains mauvais moments, en un mot par les doutes que leur inspire leur propre grandeur, - et non pas par les sacrifices et les martyres que leur tâche exige d'eux. Tant que Prométhée éprouve de la pitié pour les hommes et se sacrifie pour eux, il est heureux et grand par soi-même ; mais lorsqu'il devient jaloux de Zeus et des hommages que les mortels apportent à celui-ci, - c'est alors qu'il souffre ! (LGS/82-§251)
J'ai donné un nom à ma souffrance et je l'appelle " chienne ", - elle est tout aussi fidèle, tout aussi importune et impudente, tout aussi divertissante, tout aussi avisée qu'une autre chienne - et je puis l'apostropher et passer sur elle mes mauvaises humeurs : comme font d'autres gens avec leurs chiens, leurs valets et leurs femmes. (LGS/82-§312)
Nous avons rarement conscience de ce que chaque période de souffrance de notre vie a de pathétique ; tant que nous nous trouvons dans cette période, nous croyons au contraire que c'est là le seul état possible désormais, un ethos et non un pathos - pour parler et pour distinguer avec les Grecs. Quelques notes de musique me rappelèrent aujourd'hui à la mémoire un hiver, une maison et une vie essentiellement solitaire et en même temps le sentiment où je vivais alors : - je croyais pouvoir continuer à vivre éternellement ainsi. Mais maintenant je comprends que c'était là uniquement du pathos et de la passion, quelque chose de comparable à cette musique douloureusement courageuse et consolante, - on ne peut pas avoir de ces sensations durant des années, ou même durant des éternités : on en deviendrait trop " éthéré " pour cette planète. (LGS/82-§317)
Qui donc atteindra quelque chose de grand s'il ne se sent pas la force et la volonté Rajouter de grandes douleurs ? C'est le moindre de savoir souffrir : les femmes faibles et même les esclaves y arrivent à la maîtrise. Mais ne pas périr de misère intérieure et d'incertitude lorsque l'on provoque la grande douleur et que l'on entend le cri de cette douleur - cela est grand - cela fait partie de la grandeur. (LGS/82-§325)
Est-il salutaire pour vous d'être avant tout des hommes compatissants? Est-il salutaire pour ceux qui souffrent que vous compatissiez ? Laissons cependant pour un moment sans réponse ma première question. - Ce qui nous fait souffrir de la façon la plus profonde et la plus personnelle est presque incompréhensible et inaccessible à tous les autres ; c'est en cela que nous demeurons cachés à notre prochain, quand même il mangerait avec nous dans la même assiette. Mais partout où l'on remarque que nous souffrons, notre souffrance est mal interprétée ; c'est le propre de l'affection compatissante de dévêtir la souffrance étrangère de ce qu'elle a de vraiment personnel : - nos " bienfaiteurs ", mieux que nos ennemis, diminuent notre valeur et notre volonté. Dans la plupart des bienfaits que l'on prodigue aux malheureux il y a quelque chose de révoltant, à cause de l'insouciance intellectuelle que le compatissant met à jouer à la destinée : il ne sait rien de toutes les conséquences et de toutes les complications intérieures qui, pour moi, ou bien pour toi s'appellent malheur ! (LGS/82-§338)
Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme des remèdes et des secours au service de la vie en croissance et en lutte : ils supposent toujours des souffrances et des souffrants. Mais il y a deux sortes de souffrants, d'abord ceux qui souffrent de la surabondance de vie, qui veulent un art dionysien et aussi une vision tragique de la vie intérieure et extérieure - et ensuite ceux qui souffrent d'un appauvrissement de la vie, qui demandent à l'art et à la philosophie le calme, le silence, une mer lisse, ou bien encore l'ivresse, les convulsions, l'engourdissement, la folie. (LGS/82-§370)
L'homme cependant est la bête la plus courageuse, c'est ainsi qu'il a vaincu toutes les bêtes. Au son de la fanfare, il a surmonté toutes les douleurs ; mais la douleur humaine est la plus profonde douleur.
...l'homme voit au fond de la souffrance, aussi profondément qu'il voit au fond de la vie. (APZ/83-85-p3)
La culture de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est là l'unique cause des dépassements de l'homme ? Cette tension de l'âme dans le malheur, qui l'aguerrit, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l'endurer, à l'interpréter, à l'exploiter jusqu'au bout, tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d'esprit, de ruse, de grandeur, n'a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance ? La créature et le créateur s'unissent en l'homme. L'homme est matière, fragment, superflu, glaise, fange, non-sens, chaos; mais l'homme est aussi créateur, sculpteur, dur marteau, spectateur divin et repos du septième jour : comprenez-vous cette différence ? Et que votre pitié s'adresse à " la créature dans l'homme ", à ce qui doit être façonné, brisé, forgé, taillé, brûlé, porté à incandescence et purifié, à ce qui souffrira nécessairement et doit souffrir ? Et notre pitié, ne comprenez-vous pas à quoi elle va, notre pitié inverse, qui se tourne contre la vôtre comme contre le pire amollissement, le pire affaiblissement de l'homme ? Pitié contre pitié, donc ! Mais, encore une fois, il est des problèmes plus élevés que ceux du plaisir, de la souffrance et de la pitié, et toute philosophie qui s'arrête là est une naïveté. (PDBM/86-§225)
DOUTE
" Quel mol oreiller que le doute pour une tête bien faite ! " - Ce mot de Montaigne a toujours fait enrager Pascal car personne justement n'avait autant besoin que lui d'un mol oreiller. Que lui manquait-il donc ? (AUR/81-§46)
DROIT
Les juristes disputent si c'est le droit le plus complètement approfondi par la réflexion ou bien le plus aisé à comprendre qui doit triompher chez un peuple. Le premier, dont le modèle éminent est le droit romain, semble incompréhensible au profane, et partant n'être pas l'expression de son sentiment du droit. Les droits populaires, par exemple les droits germaniques, étaient grossièrement superstitieux, illogiques, en partie absurdes, mais ils répondaient à des mœurs et à des sentiments nationaux héréditaires très déterminés. - Mais là où le droit, comme chez nous, n'est plus une tradition, il ne peut être qu'un impératif - qu'une contrainte -; nous n'avons plus, tant que nous sommes, de sentiment du droit traditionnel et par conséquent nous devons nous contenter des droits arbitraires, expressions de cette nécessité, qu'il faut qu'il y ait un droit. Le plus logique est alors en tout cas le plus acceptable, parce qu'il est le plus impartial : même si l'on accorde que dans tous les cas l'unité la plus petite dans le rapport de délit à peine est posée arbitrairement. (HTH/78-§459)
Personne ne parle plus passionnément de son droit que celui qui, au fond de l'âme, a un doute sur son droit. En tirant la passion de son côté, il veut étourdir sa raison et son doute : ainsi il gagne la bonne conscience et avec elle le succès auprès des autres hommes. (HTH/78-§597)
Là où règne le droit, on maintient un certain état et degré de puissance, on s'oppose à son accroissement et à sa diminution. Le droit des autres est une concession faite par notre sentiment de puissance au sentiment de puissance de ces autres. Si notre puissance se montre profondément ébranlée et brisée, nos droits cessent : par contre, si nous sommes devenus beaucoup plus puissants, les droits que nous avions reconnus aux autres jusque-là cessent d'exister pour nous. (AUR/81-§112)
DURETÉ - MOLESSE
" Pourquoi si dur ? - dit un jour au diamant le charbon de cuisine ; ne sommes-nous pas proches parents ? - "
ÉCHEC
L'homme qui échoue en quelque chose aime mieux rapporter cet échec à la mauvaise volonté d'un autre qu'au hasard. Sa surexcitation est allégée par le fait de s'imaginer qu'une personne et non une chose est cause de son échec ; car on peut se venger des personnes, force est bien d'avaler les injures du destin. (HTH/78-§370)
ÉCRIT
A : Je ne suis pas de ceux qui pensent la plume pleine d'encre à la main; encore moins de ceux qui, l'encrier ouvert, s'abandonnent à leurs passions, assis sur leur chaise et l'œil rivé sur le papier. Écrire provoque toujours en moi irritation ou honte; écrire est pour moi un besoin impérieux - il me répugne d'en parler, même de manière imagée. B : Mais alors pourquoi écris-tu? A : Oui, mon cher, tout à fait entre nous, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé d'autre moyen de me débarrasser de mes pensées. B : Et pourquoi veux-tu t'en débarrasser? A : Pourquoi je le veux? Est-ce donc que je le veux? Je le dois. - B : Assez ! Assez! (LGS/82-§93)
De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce que l'on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit. (APZ/83-85-p1)
ÉDUCATION
Si l'éducation réussit, toute vertu individuelle est une utilité publique et un désavantage privé au sens du but ultime de la vie privée, -vraisemblablement une sorte de rabougrissement spirituel et sensible, voire le déclin précoce : que l'on examine l'une après l'autre suivant ce point de vue la vertu d'obéissance, de chasteté, de piété, de justice. L'éloge de l'homme désintéressé, de celui qui se sacrifie, du vertueux - donc de celui qui ne consacre pas la totalité de sa force et de sa raison à sa conservation, à son développement, à son élévation, à son progrès, à l'expansion de sa puissance, mais au contraire mène en ce qui le concerne une vie modeste et insouciante, peut-être même indifférente et ironique, - cet éloge ne provient pas en tout cas de l'esprit de désintéressement ! (LGS/82-§21)
Il faut considérer les divers systèmes philosophiques comme des méthodes d'éducation de l'esprit : ils ont de tout temps cultivé de préférence une faculté particulière de l'esprit ; en exigeant avec partialité de voir les choses précisément de telle façon et non de telle autre. (FP/84-85-v11)
L'éducation : un système de moyens visant à ruiner les exceptions en faveur de la règle. L'instruction : un système de moyens visant à dresser le goût contre l'exception, au profit des médiocres. Vu ainsi, cela semble dur ; mais d'un point de vue économique, parfaitement rationnel. Du moins pour la longue période où une culture se maintient encore avec peine, où toute exception représente un gaspillage de force (quelque chose qui détourne, séduit, rend malade, isole). Une culture de l'exception, de l'expérimentation, du risque, de la nuance - une culture de serre pour les plantes excep-tionnelles n'a droit à l'existence que lorsqu'il y a assez de forces pour que même le gaspillage devienne " économique " . (FP/88-v14)
EGALITÉ
La soif d'égalité peut se manifester en ce qu'on voudrait ou bien se soumettre tous les autres (en les rabaissant, en les étouffant dans le silence, en leur tendant des pièges), ou bien s'élever avec tous (en leur rendant justice, en les aidant, en se réjouissant des succès d'autrui). (HTH/78-§300)
La lutte pour les droits égaux est déjà un symptôme de maladie. (EH/88)
ÉGLISE
L'Église chrétienne est une encyclopédie de cultes et de conceptions primitives des provenances les plus diverses, et par là même apte aux missions : elle pouvait jadis, elle peut encore aujourd'hui arriver n'importe où, elle trouvait, elle trouve encore quelque chose qui lui ressemble, auquel elle peut s'adapter et substituer progressivement ses propres significations. Ce n'est pas son élément proprement chrétien, mais le paganisme universel de ses coutumes qui est à la base de la diffusion de cette religion mondiale; (…) on peut certes admirer cette force capable de fondre ensemble les éléments les plus divers : mais il ne faut surtout pas oublier les côtés méprisables de cette force, -son étonnante grossièreté, son absence d'exigences intellectuelles au moment de la constitution de l'Église, qui lui permirent de se satisfaire ainsi de n'importe quelle nourriture et de digérer les contradictions comme des cailloux. (AUR/81-§70)
Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu ? (LGS/82-§125)
Mais c'est le conseil que je donne aux rois et aux Églises, et à tout ce qui s'est affaibli par l'âge et par la vertu - laissez-vous donc renverser, afin que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne ! -
EGO
La plupart des gens, quoi qu'ils puissent penser et dire de leur " égoïsme ", ne font malgré tout, leur vie durant, rien pour leur ego et tout pour le fantôme d'ego qui s'est formé d'eux dans l'esprit de leur entourage qui le leur a ensuite communiqué ; - en conséquence ils vivent tous dans un brouillard d'opinions impersonnelles ou à demi personnelles et d'appréciations de valeur arbitraires et pour ainsi dire poétiques, toujours l'un dans l'esprit de l'autre qui, à son tour, vit dans d'autres esprits : étrange monde de fantasmes qui sait pourtant se donner une apparence si objective ! (AUR/81-§105)
ÉLÉVATION - HAUTEUR
A bonne hauteur c'est tout un : tout ensemble les pensées du philosophe, les œuvres de l'artiste, et les bonnes actions. (LDP/72-75-ch.1§16)
Ne reste pas au ras du sol !
Tu les dépasses : mais plus tu t'élèves, plus tu parais petit aux yeux des envieux. Mais celui qui plane dans les airs est celui que l'on déteste le plus. (APZ/83-85-p1)
Car ceci est ma doctrine : qui veut apprendre à voler un jour doit d'abord apprendre à se tenir debout, à marcher, à courir, à sauter, à grimper et à danser : on n'apprend pas à voler du premier coup !
D'où viennent les plus hautes montagnes ? C'est que j'ai demandé jadis. Alors, j'ai appris qu'elles viennent de la mer.
Je trace des cercles autour de moi et de saintes frontières ; il y en a toujours moins qui montent avec moi sur des montagnes toujours plus hautes : j'élève une chaîne de montagnes toujours plus saintes.
Celui, pourtant, qui m'est apparenté par la hauteur du vouloir, celui-là sera en proie à de véritables extases dans la compréhension ; car je viens des hauteurs que nul oiseau n'a jamais atteintes, je connais des abîmes où nul pas ne s'est jamais aventuré.
Celui qui sait respirer l'atmosphère qui remplit mon œuvre sait que c'est une atmosphère des hauteurs, que l'air y est vif. Il faut être créé pour cette atmosphère, autrement l'on risque beaucoup de prendre froid. La glace est proche, la solitude est énorme - mais voyez avec quelle tranquillité tout repose dans la lumière ! voyez comme l'on respire librement ! que de choses on sent au-dessous de soi ! (EH/88-pref§3)
ELOQUENCE
Qui posséda jusqu'à aujourd'hui l'éloquence la plus convaincante ? Le roulement du tambour : et aussi longtemps que les rois le tiendront en leur pouvoir, il demeureront toujours les meilleurs orateurs et fomenteurs de soulèvements populaires. (LGS/82-§175)
ENFANT
C'est un envieux, - il ne faut pas lui souhaiter d'enfants; il les envierait parce qu'il ne peut plus être enfant. (LGS/82-§207)
L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation.
La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. (PDBM/86-§94)
ENNEMI
Les gens qu'on ne peut pas souffrir, on cherche à se les rendre suspects. (HTH/78-§557)
Faut-il donc toujours déclarer mauvaise une chose contre quoi il faut lutter, qu'il faut maintenir entre certaines limites ou, à l'occasion, chasser entièrement de sa pensée! N'est-ce pas le propre des âmes vulgaires que de considérer toujours l'ennemi comme mauvais! (AUR/81-§76)
Souvent il y a plus de bravoure à s'abstenir et à passer : afin de se réserver pour un ennemi plus digne !
ENSEIGNEMENT
Mon moi m'a enseigné une nouvelle fierté, je l'enseigne aux hommes : ne plus cacher sa tête dans le sable des choses célestes, mais la porter fièrement, une tête terrestre qui crée le sens de la terre !
ERREUR
L'homme a été éduqué par ses erreurs : il ne se vit jamais, tout d'abord, qu'incomplètement, en second lieu il s'attribua des qualités imaginaires, en troisième lieu il se sentit dans une situation hiérarchique inexacte à l'égard de l'animal et de la nature, en quatrième lieu, il ne cessa d'inventer de nouvelles tables de biens et les considéra pendant un certain temps comme éternelles et inconditionnées de sorte que tantôt telle pulsion et tel état humain, tantôt tels autres occupèrent le premier rang et furent ennoblis par suite de cette appréciation. Si l'on compte pour rien ces quatre erreurs, on aura également compté pour rien l'humanitarisme, l'humanité et la dignité humaine ". (LGS/82-§115)
Maintenant t'apparaît comme une erreur quelque chose que jadis tu as aimée comme une vérité ou du moins comme une probabilité : tu la repousses loin de toi et tu t'imagines que ta raison y a remporté une victoire. Mais peut-être qu'alors, quand tu étais encore un autre - tu es toujours un autre, - cette erreur t'était tout aussi nécessaire que toutes les " vérités " actuelles, en quelque sorte comme une peau qui te cachait et te voilait beaucoup de choses que tu ne devais pas voir encore. C'est ta vie nouvelle et non pas ta raison qui a tué pour toi cette opinion : tu n'en as plus besoin, et maintenant elle s'effondre sur elle-même, et la déraison en sort comme de la vermine. (LGS/82-§307)
Il nous faut aimer et cultiver l'erreur, c'est le sein maternel de la connaissance. (FP/84-85-v11)
ESCLAVE - ESCLAVAGE
Le philosophe grec traversait la vie avec le secret sentiment qu'il y avait bien plus d'esclaves qu'on ne le pensait - à savoir que tout homme qui n'était pas philosophe était un esclave; il exultait de fierté en considérant que même les hommes les plus puissants de la terre faisaient partie de ceux qu'il tenait pour des esclaves. Cette fierté aussi nous est étrangère et est impossible chez nous; même comme image, le mot d'" esclave " n'a pas pour nous la plénitude de sa force. (LGS/82-§18)
Là où s'exerce une domination, il y a des masses; là où il y a des masses, il y a un besoin d'esclavage. Là où il y a esclavage, il n'y a que peu d'individus, et ceux-ci ont contre eux les instincts du troupeau et la conscience. (LGS/82-§149)
ESPRIT
Parfois apparaissent des esprits escarpés, violents et entraînants, mais malgré tout arriérés, qui par enchantement évoquent une fois encore une phase passée de l'humanité; ils servent de preuve que les tendances nouvelles, contre lesquelles ils agissent, ne sont pas encore suffisamment fortes, qu'il leur manque quelque chose : autrement elles tiendraient mieux tête à ces enchanteurs. Ainsi la Réforme de Luther témoigne, par exemple, que, dans son siècle, tous les sentiments naissants de liberté de l'esprit étaient encore peu sûrs, tendres, juvéniles ; (HTH/78-§26)
Que l'esprit humain serait pauvre sans la vanité ! Mais avec elle il ressemble à un magasin bien rempli et sans cesse réapprovisionné, lequel attire des chalands de toute espèce : ils peuvent y trouver presque tout, supposé qu'ils aient sur eux le genre de monnaie qui a cours (l'admiration). (HTH/78-§79)
La foi en des esprits grands, supérieurs, féconds, est, non pas nécessairement, mais très souvent, encore unie à cette superstition entièrement ou à demi religieuse, que ces esprits seraient d'origine surhumaine et posséderaient certaines facultés merveilleuses, au moyen desquelles ils acquerraient leurs connaissances par une tout autre voie que le reste des hommes. On leur attribue volontiers une vue immédiate de l'essence du monde, comme par un trou dans le manteau de l'apparence, et l'on croit que, sans la peine et les efforts de la science, grâce à leur merveilleux regard divinatoire, ils pourraient communiquer quelque chose de définitif et de décisif sur l'homme et le monde. (HTH/78-§164)
Un bon écrivain n'a pas seulement son propre esprit, mais aussi l'esprit de ses amis. (HTH/78-§180)
Les aristocrates-nés de l'esprit ne sont pas trop pressés ; leurs créations paraissent et tombent de l'arbre par un tranquille soir d'automne, sans qu'ils soient hâtivement désirés, sollicités, pressés par la nouveauté. Le désir incessant de créer est vulgaire et témoigne de jalousie, d'envie, d'ambition. Si l'on est quelque chose, on n'a réellement besoin de rien faire - et pourtant l'on agit beaucoup. Il y a au-dessus des hommes " productifs " une espèce encore supérieure. (HTH/78-§210)
L'esprit serf n'occupe pas sa position par des raisons mais par l'habitude; s'il est par exemple chrétien, ce n'est pas qu'il ait eu la vue des diverses religions et le choix entre elles ; s'il est anglais, ce n'est pas qu'il se soit décidé pour l'Angleterre, mais il a trouvé existantes la chrétienté et l'Angleterre et les a admises sans raison, comme un homme qui est né dans un pays de vignes devient buveur de vin. Plus tard, lorsqu'il était chrétien et anglais, il a peut-être aussi trouvé de son fonds quelques raisons en faveur de son habitude ; on a beau renverser ces raisons, on ne le renversera pas par là de toute sa position. Qu'on oblige par exemple un esprit serf à donner ses raisons contre la bigamie, on verra par expérience si son zèle sacré pour la monogamie repose sur des raisons ou sur l'accoutumance. L'accoutumance à des principes intellectuels sans raisons est ce qu'on nomme croyance. (HTH/78-§226)
Tous les États et ordres de la société : les classes, le mariage, l'éducation, le droit, tout cela n'a sa force et sa durée que dans la croyance des esprits serfs, - partant dans l'absence de raisons, au moins dans le fait qu'on écarte les questions touchant leurs raisons. C'est ce que les esprits serfs n'aiment pas à concéder, et ils sentent bien que c'est un pudendum. (HTH/78-§227)
Ce qu'on appelle bon caractère chez un enfant, c'est la preuve qu'il est serf du fait existant ; en se mettant du côté des esprits serfs, l'enfant annonce d'abord son sens commun qui s'éveille ; mais en se fondant sur ce sens commun, il se rendra plus tard utile à son état ou à sa classe. (HTH/78-§228)
Il y a quatre espèces de choses dont les esprits serfs disent qu'elles sont justifiées. Premièrement : toutes les choses qui ont de la durée sont justifiées ; deuxièmement : toutes les choses qui ne nous sont pas fâcheuses sont justifiées ; troisièmement : toutes les choses qui nous portent avan-tage sont justifiées ; quatrièmement : toutes les choses pour lesquelles nous avons fait des sacrifices sont justifiées. Ce dernier point explique, par exemple, pourquoi une guerre qui a été commencée contre la volonté du peuple est continuée avec enthousiasme dès le moment que des sacrifices ont été faits. - Les esprits libres qui plaident leur cause au forum des esprits serfs ont à démontrer qu'il y a toujours eu des esprits libres, partant que la liberté de l'esprit a de la durée, ensuite qu'ils ne veulent pas être importuns, et enfin qu'ils portent dans l'ensemble avantage aux esprits serfs; mais comme ils ne peuvent les convaincre de ce dernier point, il ne leur sert de rien d'avoir démontré le premier et le deuxième. (HTH/78-§229)
Tout comme les glaciers s'accroissent lorsque dans les contrées équatoriales le soleil fait tomber ses feux sur la mer avec plus de chaleur qu'auparavant, de même aussi une liberté de l'esprit très forte, gagnant du terrain tout autour d'elle, peut être un témoignage que la chaleur du sentiment s'est quelque part accrue d'une façon extraordinaire. (HTH/78-§232)
En général, l'axiome que les tyrans sont le plus souvent assassinés et que leur postérité vit peu de temps, s'applique aussi aux tyrans de l'esprit. Leur histoire est courte, violente, leur influence s'interrompt brusquement. De presque tous les grands Hellènes, on peut dire qu'ils semblent être venus trop tard; ainsi d'Eschyle, de Pindare, de Démosthène, de Thucydide ; une génération après eux - et c'en est fait pour toujours. (HTH/78-§261)
Des hommes étrangers à la science, mais bien doués, apprécient tout indice d'esprit, qu'il soit d'ailleurs sur une route vraie ou fausse; ils veulent avant tout que l'homme qui converse avec eux leur donne par son esprit un agréable entretien, les éperonne, les enflamme, les entraîne à la gravité et à la plaisanterie, et en tout cas les garde de l'ennui comme une puissante amulette. Les natures scien-tifiques savent au contraire que le don d'avoir de toutes mains des idées doit être réfréné de la façon la plus sévère par l'esprit de la science; ce n'est pas ce qui a du brillant, de l'apparence, de l'effet, mais c'est la vérité souvent sans apparence qui est le fruit qu'il désire faire tomber de l'arbre de la science. Il a le droit, comme Aristote, de ne pas faire de différence entre " ennuyeux " et " spirituel ", son démon le conduit par les déserts aussi bien que par la végétation tropicale, afin que partout il ne tire sa joie que du réel, de l'assuré, du vrai. - De là vient, chez des érudits sans importance, un mépris et une suspicion de l'homme d'esprit en général, et en revanche des gens d'esprit ont souvent une antipathie contre la science : comme par exemple presque tous les artistes. (HTH/78-§264)
Pour gagner des gens d'esprit à une proposition, il suffit parfois de la présenter sous la forme d'un paradoxe monstrueux. (HTH/78-§307)
Personne ne sait gré à l'homme spirituel de sa courtoisie, quand il se met au niveau d'une société où il n'est pas courtois de montrer de l'esprit. (HTH/78-§324)
L'humanité des célébrités de l'esprit consiste, dans les relations avec des gens non célèbres, à avoir tort de manière obligeante. (HTH/78-§328)
L'esprit supérieur prend plaisir aux manques de tact, aux arrogances, aux hostilités même des jeunes gens ambitieux à son égard ; ce sont les mauvaises manières de chevaux ardents, qui n'ont pas encore porté un cavalier et toutefois seront dans peu de temps si fiers de le porter, lui. (HTH/78-§339)
Après une conversation avec quelqu'un, on est disposé le mieux possible pour l'interlocuteur, si l'on a eu l'occasion de déployer devant lui son esprit, son amabilité, dans tout leur éclat. C'est ce que mettent à profit des hommes malins, qui veulent disposer quelqu'un en leur faveur, en lui procurant dans l'entretien les meilleures occasions de faire un bon mot, et cetera. On pourrait imaginer une conversation amusante entre deux malins, qui veulent réciproquement se mettre en disposition favorable, et dans cette vue jettent çà et là dans la conversation les belles occasions, sans qu'aucun les saisisse : si bien que la conversation se poursuivrait entièrement dénuée d'esprit et d'amabilité, parce que chacun renverrait à l'autre l'occasion de montrer esprit et amabilité. (HTH/78-§369)
Une seule chose est nécessaire à avoir : ou bien un esprit léger de nature ou bien un esprit rendu léger par l'art et la science. (HTH/78-§486)
Aucun cours d'eau n'est par lui-même grand et riche; c'est de recevoir et d'emmener tant d'affluents secondaires qui le rend tel. Il en est de même de toutes les grandeurs de l'esprit. Il s'agit seule-ment qu'un homme donne la direction, qu'ensuite tant d'affluents suivront nécessairement, et pas du tout qu'il soit lui-même dès le commencement pauvre ou riche de dons naturels. (HTH/78-§521)
A l'affranchissement d'esprit sérieusement raisonné d'un homme, ses passions et ses appétits aussi espèrent en secret découvrir leur avantage. (HTH/78-§542)
Celui-là n'a point d'esprit, qui cherche l'esprit. (HTH/78-§547)
Aux grands esprits s'adjoint ce qu'il y a dans leur nature de hideusement trop humain - aveuglements, injustices, manque de mesure - pour que leur influence puissante, facilement trop puissante, soit contrebalancée sans cesse par la méfiance que ces particularités inspirent. Car le système de tout ce dont la nature a besoin pour subsister est si vaste et absorbe des forces si diverses et si nombreuses que, pour chaque avantage accordé d'une part, soit à la science, soit à l'Etat, soit à l'art, soit au commerce, où tendent ces individus, l'humanité est d'autre part obligée de pâtir. (OSM/79-§186)
Le mot d'esprit est l'épigramme que l'on fait sur la mort d'un sentiment. (OSM/79-§202)
Des esprits subtils, de qui rien n'est plus loin qu'une trivialité, en découvrent souvent une après de longs détours à travers des sentiers de montagne, et ils y prennent un vif plaisir, au plus grand étonnement de ceux qui ne sont pas subtils. (OSM/79-§214)
Il y a des esprits extrêmement doués, qui restent toujours stériles, seulement parce que, par faiblesse de tempérament, ils sont trop impatients pour attendre le terme de leur grossesse. (OSM/79-§216)
Le muet embarras d'un esprit distingué est généralement interprété et très redouté de la part de l'esprit moyen, comme de la supériorité qui se tait : tandis qu'apercevoir un certain embarras provoquerait de la bienveillance. (OSM/79-§245)
Lorsque l'on a employé son esprit à se rendre maître de ce que les passions ont de démesuré, on arrive parfois à ce résultat fâcheux d'avoir transporté dans l'esprit le manque de mesure et l'on s'exalte dès lors dans la pensée et la connaissance. (OSM/79-§275)
Ce n'est pas un argument contre la maturité d'un esprit que d'y trouver quelques vers. (OSM/79-§353)
Hiérarchie des esprits. - Tu te classes bien au-dessous de l'autre, car tu cherches à fixer l'exception, mais lui la règle. (OSM/79-§362)
Il y a un ennui des esprits les plus subtils et les plus cultivés pour qui ce que la terre produit de meilleur est devenu sans saveur : habitués comme ils le sont à absorber une nourriture choisie et toujours plus choisie, et à se dégoûter d'une nourriture grossière, ils risquent de mourir de faim, - car les choses parfaites sont en très petit nombre et il leur arrive d'être inaccessibles ou dures comme de la pierre, de sorte que de très bonnes dents ne peuvent plus les mordre. (OSM/79-§369)
Il arrive aussi à l'esprit le plus riche de perdre la clef du grenier où sommeillent ses trésors accumulés, et de ressembler alors au plus pauvre qui est forcé de mendier pour vivre. (OSM/79-§375)
Qui veut montrer son esprit laisse entendre qu'il est aussi richement pourvu du contraire. Ce travers de certains Français spirituels, qui consiste à ajouter à leurs meilleures saillies un trait de dédain, a son origine dans le désir de se faire passer pour plus riches qu'ils ne sont : ils veulent prodiguer avec nonchalance, fatigués en quelque sorte des continuelles offrandes, puisées dans les greniers trop pleins. (LVO/79-§93)
Plus l'esprit devient joyeux et sûr de lui-même, plus l'homme désapprend le rire bruyant; par contre il est pris sans cesse d'un sourire glus intellectuel, signe de son étonnement devant les innombrables charmes cachés de cette bonne existence. (LVO/79-§173)
La médiocrité est le plus heureux des masques que l'esprit supérieur puisse porter, parce que le grand nombre, c'est-à-dire le médiocre, ne songe pas qu'il y a là un travestissement : et pourtant c'est à cause de lui que l'esprit supérieur s'en sert, - pour ne point irriter et, souvent même par pitié et par bonté. (LVO/79-§175)
La fécondité médiocre, le fréquent célibat et, en général, la froideur sexuelle chez les esprits supérieurs et les plus cultivés, ainsi que dans les classes auxquelles ils appartiennent, sont essentiels pour l'économie de l'humanité; la raison reconnaît et utilise ce fait qu'à un point extrême de développement cérébral le danger d'une progéniture nerveuse est très grand : de tels hommes sont les sommets de l'humanité, - ils ne doivent pas se prolonger en monticules. (LVO/79-§197)
Les esprits de tendance classique aussi bien que romantique (les deux espèces existeront toujours) portent en eux une vision de l'avenir; mais la première catégorie fait jaillir cette vision de la force de son temps, la seconde de sa faiblesse. (LVO/79-§217)
Fermer les yeux de l'esprit. - Si l'on est exercé et habitué à réfléchir à ses actions, on sera cependant forcé de fermer l'oeil intérieur pendant l'action (ne fût-ce qu'en écrivant une lettre, en mangeant ou en buvant). Même dans la conversation avec des hommes moyens, il faut s'entendre à penser en fermant les yeux de l'esprit, - car c'est la seule façon d'atteindre et de comprendre la pensée moyenne. Cette action de clore les yeux peut s'accomplir d'une façon sensible et volontaire. (LVO/79-§236)
L'esprit d'observation que nous mettons à reconnaître si les autres s'aperçoivent de nos faiblesses est beaucoup plus subtil que celui que nous mettons à reconnaître les faiblesses des autres : d'où il résulte par conséquent que notre esprit d'observation est plus subtil qu'il n'est nécessaire. (LVO/79-§257)
Notre indifférence et notre froideur passagères à l'égard des hommes, que l'on interprète comme de la dureté et du manque de caractère, ne sont souvent que de la fatigue de l'esprit : lorsque nous sommes dans cet état, les autres, tout comme nous-mêmes, nous sont indifférents ou importuns. (LVO/79-§290)
Avoir beaucoup d'esprit conserve jeune : mais il faut supporter avec cela de passer pour plus vieux qu'on n'est. Car les hommes lisent les traits d'esprit comme si c'étaient des traces d'expérience de la vie, c'est-à-dire des témoignages que l'on a beaucoup vécu et mal vécu, que l'on a souffert, que l'on s'est trompé et que l'on s'est repenti. Donc : on passe auprès d'eux pour plus vieux, tout aussi bien que pour plus mauvais qu'on n'est, lorsque l'on a beaucoup d'esprit et qu'on le montre. (LVO/79-§343)
Les esprits supérieurs ont de la peine à se délivrer d'une illusion : ils se figurent qu'ils éveillent la jalousie des médiocres et qu'ils sont considérés comme des exceptions. Mais en réalité on les considère comme quelque chose de superflu, dont on se passerait si cela n'existait pas. (LVO/79-§345)
Le préjugé de l' " esprit pur ". - Partout où a régné la doctrine de la spiritualité pure, elle a détruit par ses excès la force nerveuse : elle enseignait à mépriser le corps, à le négliger ou à le tourmenter, à tourmenter et à mépriser l'homme lui-même, à cause de tous ses instincts; elle produisait des âmes assombries, raidies et oppressées, - qui en outre, croyaient connaître la cause de leur sentiment de misère et espéraient pouvoir la supprimer! " Il faut qu'elle se trouve dans le corps! il est toujours encore trop florissant! " - ainsi concluaient-ils, tandis qu'en réalité le corps, par ses douleurs, ne cessait de s'élever contre le continuel mépris qu'on lui témoignait. Une extrême nervosité, devenue générale et chronique, finissait par être l'apanage de ces vertueux esprits purs : ils n'apprenaient plus à connaître la joie que sous la forme de l'extase et autres prodromes de la folie - et leur système atteignait son apogée lorsqu'ils considéraient l'extase comme point culminant de la vie et comme étalon pour condamner tout ce qui est terrestre. (AUR/81-§39)
Notre époque, bien qu'elle parle beaucoup d'économie, est gaspilleuse : elle gaspille ce qu'il y a de plus précieux, l'esprit. (AUR/81-§179)
Notre état d'esprit habituel dépend de l'état d'esprit où nous savons maintenir notre entourage. (AUR/81-§283)
Lorsque nous surprenons quelqu'un à cacher son esprit devant nous, nous le traitons de méchant : à plus forte raison, si nous soupçonnons que c'est l'amabilité et la bienveillance qui l'y ont poussé. (AUR/81-§390)
Il existe quelque chose d'excessivement rare et qui vous plonge dans le ravissement : je veux dire l'homme à l'esprit admirablement formé qui possède aussi le caractère, les penchants et fait dans sa vie les expériences personnelles qui y correspondent. (AUR/81-§458)
Esprits plus forts et orgueilleux, on ne vous demande qu'une chose : ne nous imposez pas de charge nouvelle à nous autres, mais prenez sur vous une partie de notre fardeau, vous qui êtes les plus forts ! Mais vous aimez tant à faire l'inverse : car vous voulez prendre votre vol, et c'est pourquoi nous devons ajouter votre fardeau au nôtre : c'est-à-dire que nous devons ramper ! (AUR/81-§514)
On peut observer chez une certaine catégorie de grands esprits un spectacle pénible, parfois épouvantable : leurs moments les plus féconds, leurs vols en haut et dans le lointain ne semblent pas être conformes à l'ensemble de leur constitution, et en outrepasser la force d'une façon ou d'une autre, de sorte qu'il en reste toujours une déficience et qu'il en résulte à la longue une défectuosité de la machine, laquelle, à son tour, se traduit, chez des natures d'une aussi haute intellectualité, par toutes sortes de symptômes moraux et intellectuels, beaucoup plus régulièrement que par des états de détresse physique. Ces côtés incompréhensibles de leur nature, ce qu'ils ont de craintif, de vaniteux, de haineux, d'envieux, de rétréci et de rétrécissant, et qui se manifeste soudain chez eux, ce qu'il y a de trop personnel et de contraint dans des natures comme celles de Rousseau et de Schopenhauer, pourrait très bien être les conséquences d'une maladie de cœur périodique : celle-ci étant cependant la conséquence d'une maladie des nerfs, et celle-ci enfin la conséquence de… Tant que le génie nous habite, nous sommes pleins de hardiesse, nous sommes comme fous et nous nous soucions peu de la santé, de la vie et de l'honneur ; nous traversons le jour de notre vol plus libres qu'un aigle, et dans l'obscurité, nous nous sentons plus en sécurité qu'un hibou. Mais soudain le génie nous abandonne et aussitôt une crainte profonde nous envahit : nous ne nous comprenons plus nous-mêmes, nous souffrons de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous n'avons pas vécu, c'est comme si nous étions au milieu des rochers nus face à la tempête, et nous sommes en même temps comme de pitoyables âmes d'enfant qui s'effrayent d'un bruissement et d'une ombre. - Les trois quarts du mal commis sur la terre arrivent par lâcheté : et cela est avant tout un phénomène physiologique ! (AUR/81-§538)
Si l'on considère tout ce qui a été vénéré jusqu'à présent sous le nom d' " esprit surhumain ", de " génie ", on arrive à la triste conclusion que, dans son ensemble, l'intellectualité humaine a dû être quelque chose de très bas et de très pauvre : tant il fallait peu d'esprit pour se sentir considérablement supérieur à elle ! Qu'est-ce que la gloire facile du " génie " ? Son trône est si vite atteint ! son adoration est devenue un usage ! On adore toujours la force à genoux - selon la vieille habitude des esclaves - et pourtant, lorsqu'il faut déterminer le degré de vénérabilité, le degré de raison dans la force est seul déterminant : il faut évaluer en quelle mesure la force a été surmontée par quelque chose de supérieur, à quoi elle obéit dès lors comme instrument et comme moyen ! Mais pour de pareilles évaluations il y a encore trop peu d'yeux, on va même jusqu'à considérer comme un sacrilège l'évaluation du génie. (AUR/81-§548)
Les grands esprits eux-mêmes n'ont qu'une expérience large de cinq doigts, - immédiatement après cesse la réflexion et leur vide indéfini, leur bêtise commence. (AUR/81-§564)
Le serpent qui ne peut changer de peau périt. De même les esprits que l'on empêche de changer d'opinions ; ils cessent d'être esprit. (AUR/81-§573)
Nous autres aéronautes de l'esprit. - Tous ces hardis oiseaux qui prennent leur essor vers le lointain, le plus extrême lointain, - certes, un moment viendra où ils ne pourront aller plus loin et se percheront sur un mât ou sur un misérable récif - encore reconnaissants d'avoir ce pitoyable refuge ! Mais qui aurait droit d'en conclure que ne s'ouvre plus devant eux une immense voie libre et qu'ils ont volé aussi loin que l'on peut voler ! Tous nos grands maîtres et prédécesseurs ont fini par s'arrêter, et le geste de la fatigue qui s'arrête n'est ni le plus noble, ni le plus gracieux : à moi comme à toi, cela arrivera aussi ! Mais que m'importe, et que t'importe ! D'autres oiseaux voleront plus loin ! Cette idée, cette foi qui est la nôtre vole avec eux à l'envi vers les lointains et les hauteurs, elle monte à tire-d'aile au-dessus de notre tête et de son impuissance, vers le ciel d'où elle regarde au loin et prévoit des vols d'oiseaux bien plus puissants que nous qui s'élanceront dans la direction où nous nous élancions, là où tout est encore mer, mer, mer ! - Et où voulons-nous donc aller? Voulons-nous donc franchir la mer ? Où nous entraîne ce désir puissant qui compte pour nous plus qu'aucune joie ? Pourquoi précisément dans cette direction, là où jusqu'à présent tous les soleils de l'humanité ont disparu ? Peut-être racontera-t-on un jour que nous aussi, tirant vers l'ouest, nous espérâmes atteindre une Inde, - mais que notre destin fut d'échouer devant l'infini ? Ou bien, mes frères ? Ou bien ? (AUR/81-§575)
Les esprits les plus forts et les plus méchants ont jusqu'à présent fait faire les plus grands progrès à l'humanité : ils allumèrent toujours à nouveau les passions qui s'endormaient - toute société organisée endort les passions, - ils éveillèrent toujours à nouveau le sens de la comparaison, de la contradiction, le plaisir de ce qui est neuf, osé, non éprouvé, ils forcèrent l'homme à opposer des opinions aux opinions, un type idéal à un type idéal. Par les armes, par le renversement des bornes frontières, par la violation de la piété, le plus souvent : mais aussi par de nouvelles religions et de nouvelles morales ! (LGS/82-§4)
Je reconnais les esprits qui cherchent le repos aux nombreux objets obscurs qu'ils disposent autour d'eux : qui veut dormir fait l'obscurité dans sa chambre ou rampe au fond d'une caverne. - Avertissement pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent le plus, et aimeraient le savoir ! (LGS/82-§164)
Son esprit a de mauvaises manières, il est précipité et ne fait que bégayer d'impatience : c'est pourquoi on se doute à peine de l'âme qui est la sienne, une âme à longue haleine et à large poitrine. (LGS/82-§212)
Esprit et caractère. - Il y en a qui atteignent leur sommet en tant que caractère, mais c'est précisément leur esprit qui n'est pas à la hauteur de ce sommet - il y en a d'autres chez qui c'est le contraire. (LGS/82-§235)
Nous qui sommes riches et prodigues en esprit, placés comme des puits ouverts au bord de la route, ne voulant interdire à personne de puiser chez nous, nous ne savons malheureusement pas nous garer, lorsque nous désirerions le faire, nous n'avons pas de moyen pour empêcher que l'on nous trouble, que l'on nous obscurcisse, - que l'époque où nous vivons jette au fond de nous-mêmes sa " contemporanéité ", que les oiseaux malpropres de cette époque y jettent leurs immondices, les gamins leurs colifichets, et des voyageurs épuisés qui s'y reposent leurs petites et leurs grandes misères. Mais nous ferons ce que nous avons toujours fait : nous entraînerons ce que l'on nous jette dans notre profondeur - car nous sommes profonds, nous n'oublions pas - et nous redevenons clairs... (LGS/82-§378)
Le soi créateur créa, pour lui-même, l'estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté.
Je suis des voies nouvelles et il me vient un langage nouveau ; pareil à tous les créateurs je fus fatigué des langues anciennes. Mon esprit ne veut plus courir sur des semelles usées.
Ne sens-tu pas déjà l'odeur des abattoirs et des gargotes de l'esprit ? Les vapeurs des esprits abattus ne font-elles pas fumer cette ville ? Ne vois-tu pas les âmes suspendues comme des torchons mous et malpropres ? - et ils se servent de ces torchons pour faire des journaux.
" Je suis le consciencieux de l'esprit, répondit celui qui était interrogé, et, dans les choses de l'esprit, il est difficile que quelqu'un s'y prenne d'une façon plus sévère, plus étroite et plus dure que moi, excepté celui de qui je l'ai appris, Zarathoustra lui-même.
Le pur esprit est pur mensonge. (ANT/88-§8)
Jadis, on voyait dans la conscience de l'homme, dans l' " esprit ", la preuve de sa haute origine, de sa nature divine. Pour parfaire l'homme, on lui conseillait d'imiter la tortue, de rétracter ses sens, d'interrompre tout commerce avec le " monde ", de se défaire de son " enveloppe mortelle " : alors, il ne resterait plus de lui que l'essentiel, le " pur esprit ". Là aussi, nous sommes mieux inspirés - et l'accession à la conscience, à l' " esprit ", nous semble justement être le symptôme d'une certaine imperfection de l'organisme, un essai, un tâtonnement, un coup manqué, une épreuve, qui entraîne une dépense inutile de force nerveuse. Nous nions que l'on puisse faire quoi que ce soit de parfait tant qu'on le fait consciemment. Le " pur esprit " est pure sottise : si, dans nos calculs, nous faisons abstraction du système nerveux et des sens, bref de l' " enveloppe mortelle", eh bien, nous faisons un calcul faux - et un faux calcul - un point, c'est tout !... (ANT/88-§14)
Le degré de vérité que supporte un esprit, la dose de vérité qu'un esprit peut oser, c'est ce qui m'a servi de plus en plus à donner la véritable mesure de la valeur. (EH/88-pref§3)
ESPRIT LIBRE
C'est donc ainsi qu'une fois, lorsque j'en ai eu besoin, j'ai pour mon usage inventé aussi les " esprits libres " à qui est dédié ce livre de découragement et d'encouragement tout ensemble, intitulé Humain, trop humain : des " esprits libres " de ce genre il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, - mais j'avais alors, comme j'ai dit, besoin de leur société, pour rester de bonne humeur parmi des humeurs mauvaises (maladie, isolement, exil, acedia, inactivité) : comme de vaillants compagnons et fantômes, avec lesquels on babille et l'on rit, quand on a l'envie de babiller et de rire, et que l'on envoie au diable, quand ils deviennent ennuyeux, - comme dédommagement des amis manquants. Qu'il pourrait un jour y avoir des esprits libres de ce genre, que notre Europe aura parmi ses fils de demain et d'après-demain de pareils joyeux et hardis compagnons, corporels et palpables et non pas seulement, comme dans mon cas, à titre de schémas et d'ombres jouant pour un anachorète : c'est ce dont je serais le dernier à douter. Je les vois dès à présent venir, lentement, lentement ; et peut-être fais-je quelque chose pour hâter leur venue, quand je décris d'avance sous quels auspices je les vois naître, par quels chemins je les vois arriver ? (HTH/78-pref§2)
On peut s'attendre à ce qu'un esprit dans lequel le type d' " esprit libre " doit un jour devenir mûr et savoureux jusqu'à la perfection ait eu son aventure décisive dans un grand affranchissement, et qu'auparavant il n'en ait été que davantage un esprit serf, qui pour toujours semblait enchaîné à son coin et à son pilier. Quelle est l'attache la plus solide ? Quels liens sont presque impossibles à rompre ? Chez les hommes d'une espèce rare et exquise, ce seront les devoirs : ce respect tel qu'il convient à la jeunesse, la timidité et l'attendrissement devant tout ce qui est anciennement vénéré et digne, la reconnaissance pour le sol qui l'a portée, pour la main qui l'a guidée, pour le sanctuaire où elle apprit la prière, - les instants les plus élevés mêmes seront ce qui la liera le plus solidement, ce qui l'obligera le plus durablement. Le grand affranchissement arrive pour des serfs de cette sorte soudainement, comme un tremblement de terre : la jeune âme est d'un seul coup ébranlée, détachée, arrachée - elle-même ne comprend pas ce qui se passe. C'est une instigation, une impulsion qui s'exerce et se rend maîtresse d'eux comme un ordre; une volonté, un souhait s'éveille, d'aller en avant, n'importe où, à tout prix; une violente et dangereuse curiosité vers un monde non découvert flambe et flamboie dans tous ses sens. " Plutôt mourir que vivre ici " - ainsi parle l'impérieuse voix de la séduction : et cet " ici ", ce " chez nous " est tout ce qu'elle a aimé jusqu'à cette heure ! (HTH/78-pref§3)
De cet isolement maladif, du désert de ces années d'essais, la route est encore longue jusqu'à cette immense sécurité et santé débordante, qui ne peut se passer de la maladie même, comme moyen et hameçon de connaissance, jusqu'à cette liberté mûrie de l'esprit, qui est aussi domination sur soi-même et discipline du cœur, et qui permet l'accès à des façons de penser multiples et opposées, - jusqu'à cet état intérieur, saturé et blasé de l'excès des richesses, qui exclut le danger que l'esprit se perde, pour ainsi dire, lui-même dans ses propres voies, et s'amourache quelque part, et reste assis dans quelque coin à cuver son ivresse; jusqu'à cette surabondance de forces plastiques, médicatrices, éducatrices et reconstituantes, qui est justement le signe de la grande santé, cette surabondance qui donne à l'esprit libre le dangereux privilège de pouvoir vivre à titre d'expérience et s'offrir aux aventures : le privilège de maîtrise de l'esprit libre ! D'ici là il peut y avoir de longues années de convalescence, des années remplies de phases multicolores, mêlées de douleur et d'enchantement, dominées et menées en bride par une tenace volonté d'avoir la santé, qui déjà ose souvent s'habiller et se déguiser en santé. Il y a là un état intermédiaire dont un homme de cette destinée ne peut se souvenir plus tard sans émotion : il a en propre une lumière, une jouissance du soleil pâle et délicate, un sentiment de liberté d'oiseau, de coup d'œil d'oiseau, de pétulance d'oiseau, une combinaison où la convoitise et le mépris tendre se sont réunis. " Esprit libre " - ce mot froid fait du bien dans cet état, il échauffe presque. On vit, n'étant plus dans les liens d'amour et de haine, sans Oui, sans Non, volontairement près, volontairement loin, se plaisant surtout à s'échapper, à s'évader, à prendre son essor, tantôt fuyant, tantôt s'enlevant à tire-d'aile; on est blasé comme tout homme qui a une fois vu au-dessous de lui une immense multiplicité d'objets - et l'on est devenu le contraire de ceux qui se préoccupent de choses qui ne les regardent point. En fait, ce qui regarde l'esprit libre, c'est désormais seulement des choses - et combien de choses! -qui ne le préoccupent plus... (HTH/78-pref§4)
On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui à cause de son origine, de son milieu, de sa situation et de son emploi ou à cause des vues régnantes du temps. Il est l'exception, les esprits serfs sont la règle ; ceux-ci lui reprochent que ses libres principes ou bien ont leur source dans le désir de surprendre, ou bien aboutissent à des actions libres, c'est-à-dire des actions qui ne se concilient pas avec la morale dépendante. De temps à autre, l'on dit aussi que tels ou tels libres principes doivent être dérivés d'un travers ou d'une excitation de l'esprit, mais qui parle ainsi n'est que la malice, qui elle-même ne croit pas à ce qu'elle dit, mais veut s'en servir pour nuire : car le libre esprit a d'ordinaire le témoignage de la bonté et de la pénétration supérieure de son intelligence écrit sur son visage si lisiblement que les esprits dépendants le comprennent assez bien. Mais les deux autres dérivations de sa libre pensée procèdent d'une intention sincère ; le fait est que beaucoup d'esprits libres naissent aussi de l'une ou de l'autre façon. (HTH/78-§225)
Comparé avec celui qui a la tradition de son côté et n'a pas besoin de raisons pour fonder sa conduite, l'esprit libre est toujours faible, notamment dans l'action : car il connaît trop de motifs et de points de vue et par là sa main est peu sûre, mal exercée. Or quel moyen y a-t-il de le rendre pourtant relativement fort, au point de pouvoir au moins se soutenir et de ne pas se perdre sans effet ? Comment naît l'esprit fort (der starke Geist) ? C'est dans un cas particulier le problème de la production du génie. D'où vient l'énergie, la force inflexible, la persistance avec laquelle l'individu, contre la tradition, tâche d'acquérir une connaissance tout individuelle du monde? (HTH/78-§230)
Les hommes d'esprit libre, vivant uniquement pour la connaissance, auront bientôt atteint leur but extérieur, leur situation définitive à l'égard de la société et de l'État, et par exemple se déclareront volontiers satisfaits d'un petit emploi ou d'une fortune qui suffit juste à leur existence, car ils s'arrangeront pour vivre de manière qu'un grand changement dans la fortune publique, et même une révolution de l'ordre politique, ne soit pas en même temps la ruine de leur vie. Ce sont là toutes choses auxquelles ils appliquent aussi peu que possible de leur énergie, pour plonger avec toutes leurs forces rassemblées et, en quelque sorte, avec une respiration longue dans l'élément de la connaissance. Ainsi ils peuvent espérer plonger profondément et peut-être bien voir jusqu'au fond. (HTH/78-§291)
Les esprits libres vivront-ils avec des femmes ? En général, je crois que, pareils aux oiseaux véridiques de l'Antiquité, étant ceux qui pensent et disent la vérité du présent, ils préféreront voler seuls. (HTH/78-§426)
Toute habitude ourdit autour de nous un réseau toujours plus solide de fils d'araignée; et aussitôt nous nous apercevons que les fils sont devenus des lacs et que nous-mêmes restons au milieu, comme une araignée qui s'y est prise et doit vivre de son propre sang. C'est pourquoi l'esprit libre hait toutes les habitudes et les règles, tout le durable et le définitif, c'est pourquoi il recommence toujours, avec douleur, à rompre autour de lui le réseau : quoiqu'il doive souffrir par suite bien des blessures petites et grandes - car c'est de lui-même, de son corps, de son âme, qu'il doit arracher ces fils. Il lui faut apprendre à aimer, là où il haïssait, et réciproquement. (HTH/78-§427)
L'esprit libre respirera toujours, quand il se sera enfin résolu à secouer ces soins et cette vigilance maternels dont les femmes l'entourent. Quel mal peut donc lui faire un air un peu rude, qu'on écartait si anxieusement de lui, que signifie un désavantage réel, une perte, un accident, une maladie, une dette, une séduction de plus ou de moins dans sa vie, comparé au manque de liberté du berceau d'or, du chasse-mouches en plumes de paon et du sentiment pénible de devoir encore être reconnaissant parce qu'il est surveillé et gâté comme un nourrisson ? C'est pourquoi le lait que lui verse la sollicitude maternelle des femmes de son entourage peut si facilement se changer en fiel. (HTH/78-§429)
Des passions naissent les opinions : la paresse d'esprit les fait cristalliser en convictions. - Or qui se sent un esprit libre, infatigable à la vie, peut empêcher cette cristallisation par un changement constant ; et s'il est en tout point une boule de neige pensante, il aura dans la tête en somme, non des opinions, mais seulement des certitudes et des probabilités mesurées avec précision. […] C'est l'esprit qui nous sauve d'être entièrement consumés et réduits en charbons; il nous arrache de temps en temps de l'autel des sacrifices à la Justice ou bien nous cache dans un tissu d'asbeste. Délivrés du feu, nous marchons alors, poussés par l'esprit, d'opinion en opinion, à travers le changement des partis, trahissant noblement toutes les choses qui peuvent en somme être trahies - et cependant sans aucun sentiment de culpabilité. (HTH/78-§637)
L'homme véritablement libre par l'esprit pensera aussi très librement au sujet de l'esprit lui-même et ne se cachera pas ce qu'il peut y avoir d'effrayant dans les sources et la direction de celui-ci. C'est pourquoi les autres le considéreront peut-être comme le pire ennemi de la pensée libre et lui appliqueront ce terme de mépris " pessimiste de l'intellect " qui doit mettre en garde contre lui : habitués comme ils sont à ne point nommer quelqu'un d'après sa force et sa vertu dominante, mais d'après ce qui leur paraît le plus étrange en lui. (OSM/79-§11)
Comment, dans un livre pour esprits libres, ne nommerais-je pas Laurence Sterne, lui que Goethe a honoré comme l'esprit le plus libre de son siècle ! (OSM/79-§113)
Qui d'entre nous oserait s'appeler libre esprit s'il ne voulait pas rendre hommage, à sa façon, aux hommes qui reçurent ce nom pour leur faire injure, en chargeant lui aussi sur ses épaules sa part de ce fardeau de la vindicte et de la honte publiques ? Mais nous avons aussi le droit de nous appeler " francs esprits ", et cela sérieusement (sans aucun défit hautain ou généreux), parce que nous sentons dans l'appel de la liberté l'instinct le plus prononcé de notre esprit et qu'en opposition avec les intelligences liées et enracinées nous voyons presque notre idéal dans une espèce de nomadisme intellectuel, -pour me servir d'une expression modeste et presque dénigrante. (OSM/79-§211)
Les esprits libres prennent des libertés même à l'égard de la science - et provisoirement on leur accorde ces libertés - tant que l'Église subsiste encore ! - En cela ils ont maintenant leur bon temps. (LGS/82-§180)
Mais celui qui est haï par le peuple comme le loup par les chiens : c'est l'esprit libre, l'ennemi des entraves, celui qui n'adore pas et qui hante les forêts. Le chasser de sa cachette - c'est ce que le peuple appela toujours le " sens de la justice " : toujours il excite encore contre l'esprit libre ses chiens les plus féroces.
Ce n'est pas un mince péril que tu cours, esprit libre et voyageur ! Tu as un mauvais jour : prends garde à ce qu'il ne soit pas suivi d'un plus mauvais soir !
Là ou un homme parvient à la conviction fondamentale qu'on doit lui commander, il devient " croyant " ; à l'inverse, on pourrait penser un plaisir et une force de l'autodétermination, une liberté de la volonté par lesquelles un esprit congédie toute croyance, tout désir de certitude, entraîné qu'il est à se tenir sur des cordes et des possibilités légères et même à danser jusque sur le bord des abîmes. Un tel esprit serait l'esprit libre par excellence. (LGS/86-§347)
Pour l'esprit libre, pour celui qui possède la " religion de la connaissance " - la pia fraus (mensonge pieux ; pieuse fraude) est plus contraire à son goût (à sa religiosité) que la impia fraus. De là son incompréhension de l'Église, cette incompréhension qui appartient au type de l' " esprit libre ", - qui est l'assujettissement même du type de l' " esprit libre ". (PDBM/86-§105)
ÉTAT
Un homme d'État ne saurait, afin de pouvoir agir en pleine absence de scrupules, mieux faire que d'accomplir son œuvre non pour lui, mais pour un prince. L'éclat de ce désin-téressement complet aveugle l'œil du spectateur, en sorte qu'il ne voit pas les perfidies et ,les cruautés que comporte l'œuvre de tout homme d'État. (HTH/78-§445)
De même que le peuple suppose tacitement chez l'homme qui s'entend à la pluie et au beau temps et les annonce un peu d'avance, le pouvoir de les faire, de même aussi des gens même cultivés et savants attribuent aux grands hommes d'État, à grand renfort de foi superstitieuse, toutes les révolutions et les conjonctures importantes qui ont eu lieu durant leur gouvernement, comme une œuvre qui leur est propre, pourvu qu'il soit évident qu'ils en ont su quelque chose plus tôt que d'autres et qu'ils ont fondé là-dessus leurs calculs : on les prend donc également pour des dispensateurs de la pluie et du beau temps - et cette croyance n'est pas ce qui sert le moins à leur puissance. (HTH/78-§449)
L'instruction, dans les grands États, sera toujours tout au plus médiocre, par la même raison qui fait que, dans les grandes cuisines, on cuisine tout au plus médiocrement. (HTH/78-§467)
Un État où le malfaiteur se dénonce lui-même est-il impensable, un État où il se dicte lui-même publiquement sa punition dans le sentiment orgueilleux qu'il honore ainsi la loi qu'il a faite lui-même, qu'il exerce sa puissance en se punissant, la puissance du législateur ? Il peut commettre une fois un délit, il s'élève pourtant par sa punition volontaire au-dessus de ce délit ; non seulement il l'efface par sa loyauté, sa grandeur et son calme : il y ajoute encore un bienfait public. - Tel serait le criminel d'un avenir possible qui suppose d'ailleurs, en vérité, une législation de l'avenir, fondée sur la pensée : " Je me plie seulement à la loi que j'ai promulguée moi-même, dans les petites et les grandes choses. " Bien des tentatives doivent encore être faites! Tant d'avenir doit encore voir le jour ! (AUR/81-§187)
Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais ce n'est pas chez nous, mes frères : chez nous il y a des États.
Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un État : ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et cent appétits. (APZ/83-85-p1)
Mais l'État ment dans toutes ses langues du bien et du mal ; et, dans tout ce qu'il dit, il ment - et tout ce qu'il a, il l'a volé.
Beaucoup trop d'hommes viennent au monde : l'État a été inventé pour ceux qui sont superflus !
Oui, c'est l'invention d'une mort pour le grand nombre, une mort qui se vante d'être la vie, une servitude selon le cœur de tous les prédicateurs de la mort !
Là où finit l'État, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu : là commence le chant de la nécessité, la mélodie unique, la nulle autre pareille.
ÉTERNEL RETOUR
Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait : " Cette vie, telle que tu la vis et l'a vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innom-brables fois ; et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement - et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussi@?res ! " - Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais : " Tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin! " Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et, peut-être, t'écraserait ; la question, posée à propos de tout et de chaque chose, " veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois ? " ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd ! Ou combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et apposer ce sceau ultime et éternel ? (LGS/82-§341)
" Mais si tout est nécessaire, en quoi puis-je décider de mes actes ? " La pensée de l'éternel retour et la croyance à ce retour forment une pesanteur qui parmi d'autres pesanteurs t'oppresse et pèse sur toi davantage que celles-ci. Tu dis que la nourriture, le lieu, l'air, la société te changent et te déterminent ? Or, tes opinions font bien plus encore, car celles-ci te déterminent à choisir telle nourriture, tel lieu, tel air, telle société. - Si tu t'incorpores la pensée des pensées, elle te métamorphosera. La question que tu te poses pour tout ce que tu veux faire : " Le voudrais-je de telle sorte que je le veuille faire d'innombrables fois ? " constitue la pesanteur la plus importante.
Je reviendrai avec ce soleil, avec cette terre, avec cet aigle, avec ce serpent - non pas pour une vie nouvelle, ni pour une vie meilleure ou semblable : je reviendrai éternellement pour cette même vie, identiquement pareille, en grand et aussi en petit, afin d'enseigner de nouveau l'éternel retour de toutes choses, -
Imprimer au devenir le caractère de l'être - c'est la suprême volonté de puissance. […] Que tout revienne, c'est le plus extrême rapprochement d'un monde du devenir avec celui de l'être : sommet de la contemplation. (FP/85-87-v12)
ÉVANGILES
Les Evangiles sont un témoignage inestimable sur la corruption déjà irrésistible à l'intérieur de la première communauté chrétienne. Ce que, plus tard, Paul a mené à terme avec la cynique logique d'un rabbin, n'était pourtant que le processus de dégradation qui avait commencé dès la mort du Rédempteur. (ANT/88-§44)
ÉVÉNEMENT
Les plus grands événements - ce ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. (APZ/83-85-p2)
ÉVOLUTION
Il n'est pas vrai que le but inconscient de l'évolution de tout être conscient (animal, homme, humanité, etc.) soit son "bonheur suprême " : il s'agit bien plutôt, à toutes les étapes de l'évolution, de parvenir à un bonheur particulier et incomparable, ni supérieur, ni inférieur, mais personnel. L'évolution ne veut pas le bonheur, mais l'évolution, et rien d'autre. (AUR/81)
EXISTENCE
On ne peut démontrer ni le sens métaphysique ni le sens éthique, ni le sens esthétique de l'existence. (LDP/72-75-ch.1§83)
EXPÉRIENCE
Qu'est-ce donc que nos expériences vécues? Bien plus ce que nous y mettons que ce qui s'y trouve! Ou devrait-on même dire : en soi, il ne s'y trouve rien? Expérimenter, c'est imaginer ? (AUR/81-§119)
EXPLICATION
Nous appelons cela " explication " : mais c'est une " description ", ce qui nous distingue des stades plus anciens de la connaissance et de la science Nous décrivons mieux, - nous expliquons tout aussi peu que tous nos prédécesseurs. (LGS/82-§112)
Nous opérons exclusivement avec des choses qui n'existent pas, avec des lignes, des surfaces, des corps, des atomes, des temps divisibles, des espaces divisibles -, comment pourrait-il seulement y avoir explication quand nous commençons par tout transformer en image, en notre image ! (LGS/82-§112)
FAMILLE
Si l'on n'a pas un bon père, on doit s'en faire un. (HTH/78-§381)
Les pères ont beaucoup à faire pour compenser ce fait qu'ils ont des fils. (HTH/78-§382)
Les mères sont facilement jalouses des amis de leurs fils, quand ils ont une influence marquée. Habituellement, ce qu'une mère aime dans son fils, c'est plus elle-même que son fils. (HTH/78-§385)
Dans la maturité de la vie et de l'intelligence, il vient à l'homme le sentiment que son père a eu tort de l'engendrer. (HTH/78-§386)
Pères et fils se ménagent mutuellement bien plus que mères et filles. (LGS/82-§221)
FANATIQUE
La limitation pathologique de son optique fait de l'homme convaincu un fanatique - Savonarole, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon - l'antithèse de l'esprit vigoureux et affranchi. Mais l'imposante gesticulation de ces esprits malades, de ces épileptiques de l'entendement agit sur la grande masse - les fanatiques sont pittoresques, l'humanité aime mieux voir des gestes qu'écouter les arguments… (ANT/88-§54)
FATIGUE - PARESSE
Ô mes frères, il y a des tables créées par la fatigue et des tables créées par la paresse, la paresse pourrie : quoiqu'elles parlent de la même façon, elles veulent être écoutées de façons différentes. -
FEMME(S)
Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme; mais pour la maintenir - il y faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique. (HTH/78-§390)
L'intelligence des femmes se montre comme une maîtrise complète, présence d'esprit, utilisation de tous les avantages. Elles la transmettent en héritage comme leur qualité fondamentale à leurs enfants, et le père y ajoute le fond plus obscur de la volonté. (HTH/78-§411)
La femme est notre ennemie " - par la voix de celui qui, en tant qu'homme, parle ainsi à des hommes, s'exprime l'instinct indompté, qui non seulement se hait lui-même, mais hait aussi ses moyens. (AUR/81-§346)
Il existe des femmes nobles affectées d'une certaine pauvreté d'esprit qui pour exprimer leur don de soi le plus profond, ne savent pas s'y prendre autrement qu'en offrant leur vertu et leur pudeur : c'est là ce qu'elles possèdent de plus précieux. Et ce présent est souvent accepté sans que le bénéficiaire se sente aussi profondément engagé que le supposaient les donatrices, - une bien triste histoire ! (LGS/82-§65)
Les femmes sont expertes à exagérer leurs faiblesses, elles sont même inventives en faiblesses dans le but de se faire passer tout entières pour des ornements fragiles que blesse un simple grain de poussière : leur existence doit faire sentir à l'homme sa grossièreté et la faire peser sur sa conscience. C'est ainsi qu'elles se défendent contre les forts et tout " droit du plus fort ". (LGS/82-§66)
Les pauvres femmes qui en présence de celui qu'elles aiment perdent leur calme et leur assurance, et parlent trop, n'ont jamais de succès : car c'est toujours une certaine douceur secrète et flegmatique qui sera le plus sûr moyen de séduire les hommes. (LGS/82-§74)
Chez la femme tout est une énigme : mais il y a un mot à cet énigme : ce mot est grossesse.
L'homme est pour la femme un moyen : le but est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme ?
[…] Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme.
" Donne-moi, femme, ta petite vérité ! " dis-je. Et voici ce que me dit la vieille femme :
" Tu vas chez les femmes ? N'oublie pas le fouet ! " -(APZ/83-85-p1)
La femme apprend à haïr dans la mesure où elle désapprend de charmer. (PDBM/86-§84)
Même les femmes, au fond de leur vanité personnelle, ont toujours un mépris impersonnel - pour " la femme ". (PDBM/86-§86)
L'ancien Dieu, tout " esprit ", tout grand prêtre, toute perfection, déambule dans son jardin ; seulement, il s'ennuie. Contre l'ennui, même les dieux sont désarmés. Que fait-il alors ? Il invente l'homme - l'homme est divertissant... Mais ne voilà-t-il pas que l'homme s'ennuie aussi ? Dieu compatit sans réserve à cette misère, la seule qui affecte tous les Paradis : il créa aussitôt d'autres animaux. Première bévue de Dieu : l'homme ne trouva pas les animaux divertissants - il régna sur eux, il ne voulut même pas être un " animal " parmi d'autres. - En conséquence, Dieu créa la femme. Et, effectivement, c'en était fait de l'ennui - mais de bien autre chose aussi ! La femme constitue la deuxième bévue de Dieu.
" La femme est par nature serpent Heva " - tout prêtre sait cela. " C'est de la femme que vient tout le mal sur la terre " - cela aussi, tout prêtre le sait. " Par conséquent, c'est d'elle aussi que vient la science " ... Ce n'est que par la femme que l'homme apprit à goûter à l'arbre de la connaissance. Que s'était-il passé ? Une peur infernale s'empara de l'ancien Dieu. L'homme même était devenu sa plus grave bévue, il s'était créé un rival, car la science rend l'égal de Dieu, -c'en est fait des prêtres et des dieux, si l'homme s'adonne à la science ! (ANT/88-§48)
La femme parfaite commet de la littérature, de même qu'elle commet un petit péché : pour essayer, en passant, et en tournant la tête pour voir si quelqu'un s'en aperçoit, et afin que quelqu'un s'en aperçoive... (LCI/88-1§20)
On dit que la femme est profonde - pourquoi ? Puisque chez elle on n'arrive jamais jusqu'au fond. La femme n'est pas même encore plate. (LCI/88-1§27)
Quand la femme a des vertus masculines, c'est à ne plus y tenir ; quand elle n'a point de vertus masculines, c'est elle qui n'y tient pas, elle qui se sauve. (LCI/88-1§28)
Tous les médecins le savent. La femme, plus elle est femme, se défend des pieds et des mains contre toute espèce de droit : l'état primitif, la guerre perpétuelle entre les sexes, lui assigne de beaucoup le premier rang. A-t-on prêté l'oreille à ma définition de l'amour ? Elle est la seule qui soit digne d'un philosophe. L'amour, son moyen, c'est la guerre et il cache au fond la haine mortelle des sexes. A-t-on entendu ma réponse à la question comment on guérit une femme, comment on fait son " salut " ? On lui fait un enfant. La femme a besoin d'avoir des enfants, l'homme n'est toujours qu'un moyen vers ce but - ainsi parlait Zarathoustra.
" Émancipation de la femme ", c'est le nom que prend la haine instinctive de la femme manquée, c'est-à-dire incapable d'enfantement, contre la femme d'une bonne venue. La lutte contre l' " homme " n'est jamais qu'un moyen, un prétexte, une tactique. En s'élevant elles-mêmes, sous le nom de " femme en soi ", de " femme supérieure ", de " femme idéaliste ", ces femmes tendent à abaisser le niveau général de la femme ; il n'y a pas de plus sûr moyen pour cela que l'éducation des lycées, les culottes et les droits politiques de la bête électorale. Au fond, les femmes émancipées sont les anarchistes dans le monde de " l'éternel féminin ". (EH/88-3§5)
FIDÉLITÉ
Les personnes qui, dans nos relations avec elles, veulent étourdir notre prudence par leurs flatteries, usent d'un moyen dangereux, pareil au narcotique qui, s'il n'endort pas, ne fait que tenir plus éveillé. (HTH/78-§318)
On ne reste parfois fidèle à une cause que parce que ses adversaires ne cessent pas d'être ineptes. (HTH/78-§536)
FLATTEUR
Il ne faut plus chercher maintenant les bas flatteurs dans l'entourage des princes - ces derniers ont tous le goût militaire que le flatteur choque. Mais c'est une fleur qui pousse aujourd'hui encore dans l'entourage des banquiers et des artistes. (AUR/81-§158)
FOI
Les docteurs protestants continuent de propager cette erreur fondamentale : seule la foi compte, et de la foi découlent nécessairement les œuvres. Cette idée est absolument fausse, mais elle exerce une telle séduction qu'elle a déjà fasciné bien d'autres intelligences que celle de Luther (je pense à celles de Socrate et de Platon) : bien que toutes les expériences de tous les jours prouvent évidemment le contraire. La connaissance ou la foi la plus assurée est incapable de donner la force et l'habileté nécessaires à l'action , elle est incapable de remplacer l'exercice préalable de ce mécanisme subtil et complexe, exercice indispensable pour qu'un élément quelconque d'une représentation puisse se transformer en action. D'abord et avant tout les œuvres! C'est-à-dire l'exercice, l'exercice, l'exercice! La " foi " adéquate s'ajoutera d'elle-même, - soyez-en sûrs. (AUR/81-§22)
Vous ne vous étiez pas encore cherchés : alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants ; c'est pourquoi la foi est si peu de chose. (APZ/83-85-p1)
Si c'est de foi qu'il est avant tout besoin, il faut jeter le discrédit sur la raison, la connaissance, la recherche de la vérité : la voie de la vérité devient une voie interdite. (ANT/88-§23)
La " foi " n'a été, de tous temps, par exemple chez Luther, qu'un manteau, un voile pudique, un écran derrière lequel les instincts menaient leur jeu; un prudent aveuglement quant à la domination de certains instincts !... La " foi ", je l'ai déjà appelée la véritable ruse chrétienne - On a toujours parlé de foi, mais toujours agi d'instinct... (ANT/88-§39)
Paul a compris que le mensonge (que la " foi " …) était une nécessité ; plus tard, l'Église, à son tour, a compris Paul. (ANT/88-§47)
La foi sauve, donc elle ment. (ANT/88-§50)
FOLIE
Ce ne sont pas la vérité et la certitude qui constituent l'opposé du monde du fou, mais l'universalité et le caractère absolument contraignant d'une croyance, bref l'absence de caprice dans le jugement. Et le plus grand travail qu'aient accompli les hommes jusqu'à présent consista à se mettre d'accord sur un très grand nombre de choses et à s'imposer une loi d'accord - sans se préoccuper de savoir si ces choses sont vraies ou fausses. Voilà la discipline de l'esprit qui a conservé l'humanité ; - mais les pulsions inverses sont encore si puissantes que l'on ne peut parler de l'avenir de l'humanité avec tant soit peu de confiance. (LGS/82-§76)
L'heure où vous dites : " Qu'importe mon bonheur ! Il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même ! "
Il y a toujours un peu de folie dans l'amour. Mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. (APZ/83-85-p1)
Plutôt être un fou pour son propre compte qu'un sage dans l'opinion des autres ! (APZ/83-85)
FORCE
C'est une force en nous qui nous fait percevoir avec plus d'intensité les grands traits de l'image du miroir et c'est de nouveau une force qui met l'accent sur le même rythme par-delà l'imprécision réelle. Ce doit être une force d'art : car elle crée. (LDP/72-75-ch.1§55)
On n'attaque pas seulement pour faire du mal à quelqu'un, pour le vaincre, mais peut-être aussi pour le seul plaisir de prendre conscience de sa force. (HTH/78-§317)
Nous disons les choses les plus fortes avec simplicité, à supposer que nous soyons entourés d'hommes qui croient à notre force : - un tel entourage éduque à la " simplicité de style ". Les méfiants parlent avec emphase; les méfiants rendent plein d'emphase. (LGS/82-§226)
La hiérarchie s'est établie par la victoire du plus fort et l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible comme pour le plus faible du plus fort - c'est là que prennent naissance des fonc-tions séparées : car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. " (FP/84-v10)
L'homme est une pluralité de forces qui se situent dans une hiérarchie, de telle sorte qu'il y en a qui commandent, mais que celles qui commandent doivent aussi fournir à celles qui obéissent tout ce qui sert à leur subsistance, si bien qu'elles-mêmes sont conditionnées par l'existence de ces dernières. Tous ces êtres vivants doivent être d'espèces apparentées, sans quoi ils ne sauraient ainsi servir et obéir les uns aux autres. Les maîtres doivent en quelque façon être à leur tour subordonnés et dans des cas plus subtils, il leur faut temporairement échanger leurs rôles et celui qui commande d'ordinaire doit, pour une fois, obéir. Le concept " d'Individu " est faux. (FP/84-85-v11)
Un excédent de force ne fait que prouver la force. (LCI/88-pref)
Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. (LCI/88-1§8)
FORÊT
J'aime la forêt. Il est difficile de vivre dans les villes : ceux qui sont en rut y sont trop nombreux. (APZ/83-85-p1)
Le prétendu instinct de connaissance peut se ramener à un instinct d'appropriation et de domination : c'est en suivant cet instinct que se sont développés les sens, la mémoire, les instincts, etc. (FP/88-v14)
C'est ainsi que l'expansion du bouddhisme (non pas son émergence) est liée pour une large part à la place prépondérante et presque exclusive du riz dans l'alimentation des Indiens et à l'amollissement général qu'elle entraîne.(LGS/82-§134)
Vous contraignez toutes choses à s’approcher et à entrer en vous, afin qu’elles rejaillissent de votre source, comme les dons de votre amour.
En vérité, il faut qu’un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs ; mais j’appelle sain et sacré cet égoïsme.
Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là, et toujours affamé, un égoïsme qui veut toujours voler, c’est l’égoïsme des malades, l’égoïsme malade.
Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille, avec l’avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger, et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne.
Une telle envie est la voix de la maladie, la voix d’une invisible dégénérescence ; dans cet égoïsme l’envie de voler témoigne d’un corps malade. (APZ/83-85-p1)
J’aime celui dont l’âme déborde au point qu’il s’oublie lui-même, et que toutes choses soient en lui : ainsi toutes choses deviendront son déclin. (APZ/83-85-prol/4)
Oh ! Cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée : et pour elle la cruauté était une volupté !
Mais, vous aussi, mes frères, dites-moi : votre corps, qu’annonce-t-il de votre âme ? Votre âme n’est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même ?
Il fait nuit : c'est maintenant que s'éveillent tous les chants des amoureux. Et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. (APZ/83-85-p2)
Qu’une amitié faites de pièces recollées ! (LGS/82-Prél.§14)
La femme n’est pas encore capable d’amitié. Mais, dites-moi, vous autres hommes, lequel d’entre vous est donc capable d’amitié ? (APZ/83-85-p1)
Seuls les oiseaux sont encore au-dessus de lui. Et si l’homme apprenait aussi à voler, malheur à lui ! à quelle hauteur – sa rapacité volerait-elle ! (APZ/83-85-p3)
A : Je ne suis pas de ceux qui pensent la plume pleine d'encre à la main; encore moins de ceux qui, l'encrier ouvert, s'abandonnent à leurs passions, assis sur leur chaise et l'œil rivé sur le papier. Écrire provoque toujours en moi irritation ou honte; écrire est pour moi un besoin impérieux — il me répugne d'en parler, même de manière imagée.
B : Mais alors pourquoi écris-tu ?
A : Oui, mon cher, tout à fait entre nous, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé d'autre moyen de me débarrasser de mes pensées.
B : Et pourquoi veux-tu t'en débarrasser?
A : Pourquoi je le veux? Est-ce donc que je le veux? Je le dois. B : Assez ! Assez ! (LGS/82-§93)
Eh bien ! Ceux-là seuls sont mes lecteurs, mes vrais lecteurs, mes lecteurs prédestinés : qu'importe le reste ? Le reste n'est que l'humanité. — Il faut être supérieur à l'humanité, par sa force, par sa hauteur d'âme, par son mépris... (ANT/88-pref)
Pour nous représenter plus précisément ces deux instincts, imaginons-les d'abord comme les deux régions esthétiques séparées du rêve et de l'ivresse, dont les manifestations physiologiques offrent le même contraste que l'apollinisme et le dionysisme. […] Cette nécessité heureuse du rêve, les Grecs l'ont en quelque sorte personnifiée dans leur Apollon. Apollon, dieu de toutes les forces plastiques, est en même temps le dieu des prophéties. Lui qui est d'après la racine de son nom le « Brillant », le dieu de lumière, gouverne aussi la lueur belle du monde intérieur, de l'imagination. La vérité supérieure, la perfection de ces états de rêve comparés à la réalité diurne qui n'est intelligible que par fragments, le sens profond que nous avons de l'action salutaire et secourable de la nature dans le sommeil et dans le rêve, sont l'analogue et le symbole de la faculté prophétique et, en général, de tous les arts qui font la vie possible et digne d'être vécue.
Dans ce sens j'ai le droit de me considérer moi-même comme le premier philosophe tragique, c'est-à-dire comme l'antithèse extrême et l'antipode d'un philosophe pessimiste. Avant moi, cette transposition du dionysien en une émotion philosophique n'a pas existé. La sagesse tragique faisait défaut. […] L'affirmation de l'anéantissement et de la destruction, ce qu'il y a de décisif dans une philosophie dionysienne, l'approbation de la contradiction et de la guerre, le devenir avec la négation radicale de la conception même de l'« être », dans tout cela il faut que je reconnaisse, en tout cas, ce qui ressemble le plus à mes idées au milieu de tout ce qui fut jamais pensé. (EH/88-3OT§3)
[…] Est-ce que je vous conseille l’amour du prochain ? Plutôt encore je vous conseillerais la fuite du prochain et l’amour du lointain !
Plus haut que l’amour du prochain se trouve l’amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus haut encore que l’amour de l’homme, je place l’amour des choses et des fantômes. (APZ/83-85-p1)
Ainsi l’exige mon grand amour pour les plus éloignés : ne ménage point ton prochain ! L’homme est quelque chose qui doit être surmonté.
On peut arriver à se surmonter par des chemins et des moyens nombreux : c’est à toi à y parvenir ! Mais le bouffon seul pense : « On peut aussi sauter par-dessus l’homme. »
Surmonte-toi toi-même, même dans ton prochain : il ne faut pas te laisser donner un droit que tu es capable de conquérir !
Ce que tu fais, personne ne peut te le faire à son tour. Voici, il n’y a pas de récompense.
Celui qui ne peut pas se commander à soi-même doit obéir. Et il y en a qui savent se commander, mais il s’en faut encore de beaucoup qu’ils sachent aussi s’obéir ! (APZ/83-85-p3)
Un grand despote pourrait venir, un démon malin qui forcerait tout le passé par sa grâce et par sa disgrâce : jusqu’à ce que le passé devienne pour lui un pont, un signal, un héros et un cri de coq.
Mais ceci est l’autre danger et mon autre pitié : – les pensées de celui qui fait partie de la populace ne remontent que jusqu’à son grand-père, – mais avec le grand-père finit le temps.
Ainsi tout le passé est abandonné : car il pourrait arriver un jour que la populace devînt maître et qu’elle noyât dans des eaux basses l’époque tout entière.
C’est pourquoi, mes frères, il faut une nouvelle noblesse, adversaire de tout ce qui est populace et despote, une noblesse qui écrirait de nouveau le mot « noble » sur des tables nouvelles.
Car il faut beaucoup de nobles pour qu’il y ait de la noblesse ! Ou bien, comme j’ai dit jadis en parabole : « Ceci précisément est de la divinité, qu’il y ait beaucoup de dieux, mais pas de Dieu ! » (APZ/83-85-p3)
Mais la voix de la beauté parle bas : elle ne s’insinue que dans les âmes les plus éveillées.
Aujourd’hui mon bouclier s’est mis à vibrer doucement et à rire, c’était le frisson et le rire sacré de la beauté !
Je n’exige la beauté de personne autant que de toi, de toi qui es puissant : que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même.
Oui, homme sublime, un jour tu seras beau et tu présenteras le miroir à ta propre beauté.
Avec vos valeurs et vos paroles du bien et du mal, vous exercez la force, vous, les appréciateurs de valeur : ceci est votre amour caché, l’éclat, l’émotion et le débordement de votre âme.
Mais une puissance plus forte grandit dans vos valeurs, une nouvelle victoire sur soi-même qui brise les œufs et les coquilles d’œufs.
Et celui qui doit être créateur dans le bien et dans le mal : en vérité, celui-là commencera par détruire et par briser les valeurs. (APZ/83-85-p2)
Toute discussion sur la vertu leur semblait une chose vieille et fatiguée, et celui qui voulait bien dormir parlait encore du « bien » et du « mal » avant d’aller se coucher.
J’ai secoué la torpeur de ce sommeil lorsque j’ai enseigné : Personne ne sait encore ce qui est bien et mal : – si ce n’est le créateur !
Mais c’est le créateur qui crée le but des hommes et qui donne sons sens et son avenir à la terre : c’est lui seulement qui crée le bien et le mal de toutes choses.
Et je leur ai ordonné de renverser leurs vieilles chaires, et, partout où se trouvait cette vieille présomption, je leur ai ordonné de rire de leurs grands maîtres de la vertu, de leurs saints, de leurs poètes et de leurs sauveurs du monde.
Je leur ai ordonné de rire de leurs sages austères et je les mettais en garde contre les noirs épouvantails plantés sur l’arbre de la vie.
Au contraire, les imbéciles eux-mêmes le contredisent. « Comment ! s’écrient-ils, tout coule ? Les planches et les balustrades sont pourtant au-dessus du fleuve ! »
« Au-dessus du fleuve tout est solide, toutes les valeurs des choses, les ponts, les notions, tout ce qui est « bien » et « mal » : tout cela est solide ! »
Et quand vient l’hiver, qui est le dompteur des fleuves, les plus malicieux apprennent à se méfier ; et, en vérité, ce ne sont pas seulement les imbéciles qui disent alors : « Tout ne serait-il pas – immobile ? »
« Au fond tout est immobile », – c’est là un véritable enseignement d’hiver, une bonne chose pour les temps stériles, une bonne consolation pour le sommeil hivernal et les sédentaires.
« Au fond tout est immobile » – : mais le vent du dégel élève sa protestation contre cette parole !
Le vent du dégel, un taureau qui ne laboure point, – un taureau furieux et destructeur qui brise la glace avec des cornes en colère ! La glace cependant – brise les passerelles !
Ô mes frères ! tout ne coule-t-il pas maintenant ? Toutes les balustrades et toutes les passerelles ne sont-elles pas tombées à l’eau ? Qui se tiendrait encore au « bien » et au « mal » ?
Jadis on croyait aux devins et aux astrologues ; et c’est pourquoi l’on croyait que tout était fatalité : « Tu dois, car il le faut ! »
Puis on se méfia de tous les devins et de tous les astrologues et c’est pourquoi l’on crut que tout était liberté : « Tu peux, car tu veux ! »
Ô mes frères ! sur les étoiles et sur l’avenir on n’a fait jusqu’à présent que des suppositions sans jamais savoir : et c’est pourquoi sur le bien et le mal on n’a fait que des suppositions sans jamais savoir ! (APZ/83-85-p3)
Même quand tu es bienveillant à leur égard, ils se sentent méprisés par toi ; et ils te rendent ton bienfait par des méfaits cachés. (APZ/83-85-p1)
Je suis bienheureux de voir les miracles que fait éclore l’ardent soleil : ce sont des tigres, des palmiers et des serpents à sonnettes.
Parmi les hommes aussi il y a de belles couvées d’ardent soleil et chez les méchants bien des choses merveilleuses.
Il est vrai que, de même que les plus sages parmi vous ne me paraissaient pas tout à fait sages : ainsi j’ai trouvé la méchanceté des hommes au-dessous de sa réputation.
Et souvent je me suis demandé en secouant la tête : pourquoi sonnez-vous encore, serpents à sonnettes ?
En vérité, il y a un avenir, même pour le mal, et le midi le plus ardent n’est pas encore découvert pour l’homme.
Combien y a-t-il de choses que l’on nomme aujourd’hui déjà les pires des méchancetés et qui pourtant ne sont que larges de douze pieds et longues de trois mois ! Mais un jour viendront au monde de plus grands dragons. (APZ/83-85-p2)
« Hélas ! Pourquoi sa pire méchanceté est-elle si petite ! Hélas ! pourquoi sa meilleure bonté est-elle si petite ! »
Ils cèdent, ces bons, ils se rendent, leur cœur répète et leur raison obéit : mais celui qui obéit ne s’entend pas lui-même !
Tout ce qui pour les bons est mal doit se réunir pour faire naître une vérité : ô mes frères, êtes-vous assez méchants pour cette vérité ?
– chez ceux qui parlent et qui sentent dans leur cœur : « Nous savons déjà ce qui est bon et juste, nous le possédons aussi ; malheur à ceux qui veulent encore chercher sur ce domaine ! »
Et quel que soit le mal que puissent faire les méchants : le mal que font les bons est le plus nuisible des maux !
Et quel que soit le mal que puissent faire les calomniateurs du monde ; le mal que font les bons est le plus nuisible des maux !
Ô mes frères, un jour quelqu’un a regardé dans le cœur des bons et des justes et il a dit : « Ce sont les pharisiens. » Mais on ne le comprit point.
Les bons et les justes eux-mêmes ne devaient pas le comprendre : leur esprit est prisonnier de leur bonne conscience. La bêtise des bons est une sagesse insondable.
Mais ceci est la vérité : il faut que les bons soient des pharisiens, – ils n’ont pas de choix !
Il faut que les bons crucifient celui qui s’invente sa propre vertu ! Ceci est la vérité !
Un autre cependant qui découvrit leur pays, – le pays, le cœur et le terrain des bons et des justes : ce fut celui qui demanda : « Qui haïssent-ils le plus ? »
C’est le créateur qu’ils haïssent le plus : celui qui brise des tables et de vieilles valeurs, le briseur, – c’est lui qu’ils appellent criminel.
Car les bons ne peuvent pas créer : ils sont toujours le commencement de la fin : –
– ils crucifient celui qui écrit des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles, ils sacrifient l’avenir pour eux-mêmes, ils crucifient tout l’avenir des hommes !
Les bons – furent toujours le commencement de la fin. –
Chez qui y a-t-il les plus grands dangers pour l’avenir des hommes ? N’est-ce pas chez les bons et les justes ?
Brisez, brisez-moi les bons et les justes ! Ô mes frères, avez-vous aussi compris cette parole ?
Vous fuyez devant moi ? Vous êtes effrayés ? Vous tremblez devant cette parole ?
Ô mes frères, ce n’est que lorsque vous ai dit de briser les bons et les tables des bons, que j’ai embarqué l’homme sur la pleine mer.
Et c’est maintenant seulement que lui vient la grande terreur, le grand regard circulaire, la grande maladie, le grand dégoût, le grand mal de mer.
Les bons vous ont montré des côtes trompeuses et de fausses sécurités ; vous étiez nés dans les mensonges des bons et vous vous y êtes abrités. Les bons ont faussé et dénaturé toutes choses jusqu’à la racine.
Mais celui qui découvrit le pays « homme », découvrit en même temps le pays « l’avenir des hommes ». Maintenant vous devez être pour moi des matelots braves et patients !
Marchez droit, à temps, ô mes frères, apprenez à marcher droit ! La mer est houleuse : il y en a beaucoup qui ont besoin de vous pour se redresser.
La mer est houleuse : tout est dans la mer. Eh bien ! allez, vieux cœurs de matelots !
Qu’importe la patrie ! Nous voulons faire voile vers là-bas, vers le pays de nos enfants ! au large. Là-bas, plus fougueux que la mer, bouillonne notre grand désir. (APZ/83-85-p3)
Ils veulent tous s’approcher du trône : c’est leur folie, – comme si le bonheur était sur le trône ! Souvent la boue est sur le trône – et souvent aussi le trône est dans la boue. (APZ/83-85-p1)
Maintenant son sol est encore assez riche. Mais ce sol un jour sera pauvre et stérile et aucun grand arbre ne pourra plus y croître.
Malheur ! Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer !
Je vous le dis : il faut encore porter en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis : vous portez encore un chaos en vous. (APZ/83-85-p1)
Mais celui qui est de mon espèce n’échappe pas à une pareille heure, l’heure qui lui dit : « C’est maintenant seulement que tu suis ton chemin de la grandeur ! Le sommet et l’abîme se sont maintenant confondus !
Tu suis ton chemin de la grandeur : maintenant ce qui jusqu’à présent était ton dernier danger est devenu ton dernier asile !
Tu suis ton chemin de la grandeur : il faut maintenant que ce soit ton meilleur courage de n’avoir plus de chemin derrière toi !
Tu suis ton chemin de la grandeur : ici personne ne se glissera à ta suite ! Tes pas eux-mêmes ont effacé ton chemin derrière toi, et au-dessus de ton chemin il est écrit : Impossibilité.
Et si dorénavant toutes les échelles te manquent, il faudra que tu saches grimper sur ta propre tête : comment voudrais-tu faire autrement pour monter plus haut ? (APZ/83-85-p3)
Évaluer c’est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C’est leur évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. (APZ/83-85-p1)
Et lorsque j’ai regardé autour de moi, voici, le temps était mon seul contemporain.
Alors je suis retourné, fuyant en arrière – et j’allais toujours plus vite : c’est ainsi que je suis venu auprès de vous, vous les hommes actuels, je suis venu dans le pays de la civilisation. (APZ/83-85-p2)
Il faut contenir son cœur ; car si on le laisse aller, combien vite on perd la tête ! (APZ/83-85-p2)
Le comédien a de l'esprit, mais peu de conscience de l'esprit. Il croit toujours à ce qui lui fait obtenir ses meilleurs effets, - à ce qui pousse les gens à croire en lui-même !
Demain il aura une foi nouvelle et après-demain une foi plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt comme le peuple, et prompt au changement.
Renverser, - c'est ce qu'il appelle démonter. Rendre fou, - c'est ce qu'il appelle convaincre. Et le sang est pour lui le meilleur de tous les arguments. (APZ/83-85-p1)
J'ai appris à trouver.
Depuis qu'un vent m'a tenu tête,
Je fais voile avec tous les vents. (LGS/82-Prél.§2)
Mais vaudrait mieux dire : « Celui qui cherche la connaissance passe au milieu des hommes, comme on passe parmi les bêtes. »
Celui qui cherche la connaissance appelle l’homme : la bête aux joues rouges.
Pourquoi lui a-t-il donné ce nom ? N’est-ce pas parce l’homme a eu honte trop souvent ?
Mes amis ! Ainsi parle celui qui cherche la connaissance : honte, honte, honte – c’est là l’histoire de l’homme !
Et c’est ainsi que font tous les hommes faibles : ils se perdent sur leurs chemins. Et leur lassitude finit par demander : « Pourquoi avons-nous jamais suivi ce chemin ? Tout est égal ! »
C’est à eux qu’il est agréable d’entendre prêcher : « Rien ne vaut la peine ! Vous ne devez pas vouloir ! » Ceci cependant est un appel à la servilité.
Ô mes frères ! Zarathoustra arrive comme un coup de vent frais pour tous ceux qui sont fatigués de leur chemin ; bien des nez éternueront à cause de lui !
Mon haleine souffle aussi à travers les murs dans les prisons et dans les esprits prisonniers ! (APZ/83-85-p3)
« Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement est une faute » : ainsi parle le troupeau. Et longtemps tu as fait partie du troupeau.
En toi aussi la voix du troupeau résonnera encore. Et lorsque tu diras : « Ma conscience n’est plus la même que le vôtre, » ce sera plainte et douleur. (APZ/83-85-p1)
Mais comment donc cette « chose ténébreuse », la conscience de la faute, comment tout cet appareil qu’on appelle la « mauvaise conscience » est-il venu au monde ? — Par là nous revenons à nos généalogistes de la morale. Je le répète — ou ne l’ai-je peut-être pas encore dit ? — ils ne font pas de bonne besogne. Une expérience personnelle, à peine longue de cinq aunes et « moderne » rien que moderne ; aucune connaissance du passé, aucun désir de le connaître ; encore moins l’instinct historique, ce qui constituerait une « seconde vue » indispensable ici — et pourtant ils veulent s’attaquer à l’histoire de la morale : forcément, ils aboutiront à des résultats qui n’ont avec la vérité que des rapports excessivement lointains. Ces généalogistes de la morale se sont-ils seulement douté, même en rêve, que, par exemple, le concept moral essentiel « faute » tire son origine de l’idée toute matérielle de « dette » ? ou bien que le châtiment, en tant que représaille, s’est développé indépendamment de toute hypothèse au sujet du libre arbitre ou de la contrainte ? — au point qu’il faut toujours d’abord un haut degré d’humanisation pour que l’animal « homme » commence à établir la distinction entre les notions beaucoup plus primitives, telles que « à dessein », « par négligence », « par hasard », « capable de discernement », et leurs contraires, pour les mettre en rapport avec la sévérité du châtiment. Cette idée, aujourd’hui si générale et en apparence si naturelle, si inévitable, cette idée qu’on a dû mettre en avant pour expliquer comment le sentiment de justice s’est formé sur terre, je veux dire l’idée que « le criminel mérite le châtiment parce qu’il aurait pu agir autrement », est en réalité une forme très tardive et même raffinée du jugement et de l’induction chez l’homme ; celui qui la place au début se méprend grossièrement sur la psychologie de l’humanité primitive. (GM/87-dd§4)
Ce n’est vraiment pas à des arrière-mondes et aux gouttes du sang rédempteur : mais eux aussi croient davantage au corps et c’est leur propre corps qu’ils considèrent comme la chose en soi.
Mais le corps est pour eux une chose maladive : et volontiers ils sortiraient de leur peau. C’est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort et ils prêchent eux-mêmes les arrière-mondes.
Il apprend à parler toujours plus loyalement, ce moi : et plus il apprend, plus il trouve de mots pour exalter le corps et la terre.
Ils voulaient se sauver de leur misère et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer : Hélas ! Que n’y a-t-il des voies célestes pour que nous puissions nous glisser dans un autre Être, et dans un autre bonheur ! » – Alors ils inventèrent leurs artifices et leurs petites boissons sanglantes !
Ils se crurent ravis loin de leur corps et de cette terre, ces ingrats. Mais à qui devaient-ils le spasme et la joie de leur ravissement ? À leur corps et à cette terre.
Le corps sain parle avec plus de loyauté et plus de pureté, le corps complet, carré de la tête à la base : il parle du sens de la terre.
« Je suis corps et âme » – ainsi parle l’enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants ?
Mais celui qui est éveillé et conscient dit : Je suis corps tout entier et rien autre chose ; l’âme n’est qu’un mot pour une parcelle du corps.
Instrument de ton corps, telle est aussi ta petite raison que tu appelles esprit, mon frère, petit instrument et petit jouet de ta grande raison.
Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, des moissonneurs qui moissonnent avec lui : car chez lui tout est mûr pour la moisson. Mais il lui manque les cent faucilles : aussi, plein de colère, arrache-t-il les épis.
Des compagnons, voilà ce que cherche le créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs faucilles. On les appellera destructeurs et contempteurs du bien et du mal. Mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fête.
Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche Zarathoustra, de ceux qui moissonnent et chôment avec lui : qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres ! (APZ/83-85-p1)
A partir du moment où les conséquences naturelles d'un acte ne sont plus " naturelles ", mais qu'on les croit produites par les idées-fantômes de la superstition, par " Dieu ", par les " esprits ", par les " âmes ", comme des conséquences purement " morales ", des récompenses et des châtiments, des avertissements, des moyens éducatifs, on a du même coup ruiné les conditions de la connaissance, on a donc commis le plus grand crime contre l'humanité. (ANT/88-§49)
Et souvent il m'a emporté bien loin, au delà des monts, vers les hauteurs, au milieu du rire : alors il m'arrivait de voler en frémissant comme une flèche, à travers des extases ivres de soleil : - au delà, dans les lointains avenir que nul rêve n'a vus, dans les midis plus chauds que jamais imagier n'en rêva : là-bas où les dieux dansants ont honte de tous les vêtements : - afin que je parle en paraboles, que je balbutie et que je boite comme les poètes ; et, en vérité, j'ai honte d'être obligé d'être encore poète ! -
Où tout devenir me semblait danses et malices divines, où le monde déchaîné et effréné se réfugiait vers lui-même : -
- comme une éternelle fuite de soi et une éternelle recherche de soi chez des dieux nombreux, comme une bienheureuse contradiction de soi, une répétition et un retour vers soi-même des dieux nombreux : - où tout temps me semblait une bienheureuse moquerie des instants, où le nécessité était la liberté même qui se jouait avec bonheur de l'aiguillon de la liberté :
Où j'ai retrouvé aussi mon vieux démon et mon ennemi né, l'esprit de lourdeur et tout ce qu'il il a créé : la contrainte, la loi, la nécessité, la conséquence, le but, la volonté, le bien et le mal : -
Car ne faut-il pas qu'il y ait des choses sur lesquelles on puisse danser et passer ? Ne faut-il pas qu'il y ait - à cause de ceux qui sont légers et les plus légers - des taupes et de lourds nains ? (APZ/83-85-p3)
" L'homme a créé Dieu " - rétorquez-vous, vous les subtils.
N'aimerait-il pas ce qu'il a crée ? (LGS/82-Prél.§38)
Il n'était qu'homme, pauvre fragment d'un homme et d'un " moi " : il sortit de mes propres cendres et de mon propre brasier, ce fantôme, et vraiment, il ne me vint pas de l'au-delà !
(…) Maintenant, croire à de pareils fantômes ce serait là pour moi une souffrance et une humiliation. C'est ainsi que je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. (APZ/83-85-p1)
Croyez-m'en, mes frères ! Ce fut le corps qui désespéra du corps, - il tâtonna des doigts de l'esprit égaré, il tâtonna le long des derniers murs.
Croyez-m'en, mes frères ! Ce fut le corps qui désespéra de la terre, - il entendit parler le ventre de l'Être.
Alors il voulut passer la tête à travers les derniers murs, et non seulement la tête, - il voulut passer dans " l'autre monde ". (APZ/83-85-p1)
Pourquoi si mous ? Ô mes frères, je vous le demande : n'êtes-vous donc pas - mes frères ?
Pourquoi si mous, si fléchissants, si mollissants ? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d'abnégation dans votre cœur ? Si peu de destinée dans votre regard ?
Et si vous ne voulez pas être des destinées, des inexorables : comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi ?
Et si votre dureté ne veut pas étinceler, et trancher, et inciser : comment pourriez-vous un jour créer avec moi ?
Car les créateurs sont durs. Et cela doit vous sembler béatitude d'empreindre votre main en des siècles, comme en de la cire molle, - béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires, comme sur de l'airain, - plus dur que de l'airain, plus noble que l'airain. Le plus dur seul est le plus noble.
Ô mes frères, je place au-dessus de vous cette table nouvelle : DEVENEZ DURS ! (APZ/83-85-p3)
C'est ainsi que j'ai parlé devant le chien de feu : alors il m'interrompit en grommelant et me demanda : " Église ? Qu'est-ce donc cela ? "
" Église ? Répondis-je, c'est une espèce d'État, et l'espèce la plus mensongère. Mais, tais-toi, chien de feu, tu connais ton espèce mieux que personne ! (APZ/83-85-p2)
Ne t'élève pas trop haut !
C'est à mi-hauteur
Que le monde apparaît le plus beau.
(LGS/82-Prél.§6)
Ce témoignage est écrit dans leurs rochers et dans les pics de leurs sommets. C'est du plus bas que le plus haut doit atteindre son sommet.
Mais où que vous vouliez monter avec moi, mes frères : veillez à ce qu'il n'y ait pas de parasites qui montent avec vous !
Un parasite : c'est un ver rampant et insinuant, qui veut s'engraisser de tous vos recoins malades et blessés.
Et ceci est son art de deviner où les âmes qui montent sont fatiguées : c'est dans votre affliction et dans votre mécontentement, dans votre fragile pudeur, qu'il construit son nid répugnant.
Là où le fort est faible, là où le noble est trop indulgent, - c'est là qu'il construit son nid répugnant : le parasite habite où le grand a de petits recoins malades.
Quelle est la plus haute espèce chez l'être et quelle est l'espèce la plus basse ? Le parasite est la plus basse espèce, mais celui qui est la plus haute espèce nourrit le plus de parasites. (APZ/83-85-p3)
J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur.
Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te demande : es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant ?
Es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus ? C'est ce que je te demande.
Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence ? Ou la peur de la solitude ? Ou la discorde avec toi-même ?
Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance. (APZ/83-85-p1)
Vous ne devez avoir que des ennemis dignes de haine, mais point d'ennemis dignes de mépris : il faut que vous soyez fiers de votre ennemi : c'est ce que j'ai enseigné une fois déjà.
Il faut vous réserver pour un ennemi plus digne, ô mes amis : c'est pourquoi il y en a beaucoup devant lesquels il faut passer, -
- surtout devant la canaille nombreuse qui vous fait du tapage à l'oreille en vous parlant du peuple et des nations.
Gardez vos yeux de leur " pour " et de leur " contre " ! Il y a là beaucoup de justice et d'injustice : celui qui est spectateur se fâche.
Être spectateur et frapper dans la masse - c'est l'œuvre d'un instant : c'est pourquoi allez-vous-en dans les forêts et laissez reposer votre épée !
Suivez vos chemins ! Et laissez les peuples et les nations suivre les leurs ! - des chemins obscurs, en vérité, où nul espoir ne scintille plus !
Que l'épicier règne, là où tout ce qui brille - n'est plus qu'or d'épicier ! Ce n'est plus le temps des rois : ce qui aujourd'hui s'appelle peuple ne mérite pas de roi. (APZ/83-85-p3)
J'enseigne aux hommes une volonté nouvelle : suivre volontairement le chemin qu'aveuglément les hommes ont suivi, approuver ce chemin et ne plus se glisser à l'écart comme les malades et les décrépits ! (APZ/83-85-p1)
Jadis l'esprit était Dieu, puis il devint homme, maintenant il s'est fait populace.
Et lorsque je vis mon démon, je le trouvai sérieux, grave, profond et solennel : c'était l'esprit de lourdeur, - c'est par lui que tombent toutes choses.
Pour celui qui a délivré son esprit il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contrainte et de bourbe : il faut que son œil se purifie.
" L'esprit aussi est une volupté " - ainsi disaient-ils. Alors leur esprit s'est brisé les ailes : maintenant il ne fait plus que ramper et il souille tout ce qu'il dévore.
Et l'esprit - qu'est-il pour le corps ? Il est le héraut des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho.
L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de mille façons différentes. Hélas ! dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise : elles sont devenues corps et volonté !
L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas ! Combien d'ignorances et d'erreurs se sont incorporées en nous ! (APZ/83-85-p1)
Péniblement et avec prudence mon esprit a monté des degrés ; les aumônes de la joie furent sa consolation ; la vie de l'aveugle s'écoulait, appuyée sur un bâton.
On a persuadé à votre esprit de mépriser tout ce qui est terrestre, mais on n'a pas persuadé vos entrailles : pourtant elles sont ce qu'il y a de plus fort en vous !
Et maintenant votre esprit a honte d'obéir à vos entrailles et il suit des chemins dérobés et trompeurs pour échapper à sa propre honte.
" Ce serait pour moi la chose la plus haute - ainsi se parle à lui-même votre esprit mensonger - de regarder la vie sans convoitise et non comme les chiens avec la langue pendante.
Ils sont adroits et leurs doigts sont agiles : que veut ma simplicité auprès de leur complexité ! Leurs doigts s'entendent à tout ce qui est filage et nouage et tissage : ainsi ils tricotent les bas de l'esprit !
Ce sont de bonnes pendules : pourvu que l'on ait soin de les bien remonter ! Alors elles indiquent l'heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste tic-tac.
En vérité leur esprit lui-même est le paon le plus vain entre tous les paons et une mer de vanité !
L'esprit du poète veut des spectateurs : ne fût-ce que des buffles ! (APZ/83-85-p2)
N'entends-tu pas ici l'esprit devenir jeu de mots ? il se fait jeu en de repoussants calembours ! - et c'est avec ces rinçures qu'ils font des journaux ! Ils se provoquent et ne savent pas à quoi. Ils s'échauffent et ne savent pas pourquoi. Ils font tinter leur fer-blanc et sonner leur or.
Ils sont froids et ils cherchent la chaleur dans l'eau-de-vie ; ils sont échauffés et cherchent la fraîcheur chez les esprits frigides ; l'opinion publique leur donne la fièvre et les rend tous ardents.
Et c'est surtout parce que je suis l'ennemi de l'esprit de lourdeur, que je suis comme un oiseau : ennemi à mort en vérité, ennemi juré, ennemi né ! Où donc mon inimitié ne s'est-elle pas déjà envolée et égarée ?
[…] La terre et la vie lui semblent lourdes, et c'est ce que veut l'esprit de lourdeur ! Celui cependant qui veut devenir léger comme un oiseau doit s'aimer soi-même : c'est ainsi que j'enseigne, moi.
" La sagesse fatigue, rien ne vaut la peine ; tu ne dois pas convoiter ! " - j'ai trouvé suspendue cette nouvelle table, même sur les places publiques.
Brisez, ô mes frères, brisez même cette nouvelle table ! Les gens fatigués du monde l'ont suspendue, les prêtres de la mort et les estafiers : car voici, c'est aussi un appel à la servilité ! -
Ils ont mal appris et ils n'ont pas appris les meilleures choses, tout trop tôt en tout trop vite : ils ont mal mangé, c'est ainsi qu'ils se sont gâté l'estomac, -
Car leur esprit est un estomac gâté : c'est lui qui conseille la mort ! Car, en vérité, mes frères, l'esprit est un estomac !
Avec la tempête qui s'appelle " esprit ", j'ai soufflé sur ta mer houleuse ; j'en ai chassé tous les nuages et j'ai même étranglé l'égorgeur qui s'appelle " péché ". (APZ/83-85-p3)
Ma conscience de l'esprit exige de moi que je sache une chose et que j'ignore tout le reste : je suis dégoûté de toutes les demi-mesures de l'esprit, de tous ceux qui ont l'esprit nuageux, flottant et exalté.
Que tu aies dit un jour, ô Zarathoustra : " L'esprit, c'est la vie qui incise elle-même la vie, " c'est ce qui m'a conduit et éconduit à ta doctrine. Et, en vérité, avec mon propre sang, j'ai augmenté ma propre science. "
Celui qui a dit : " Dieu est esprit " - a fait jusqu'à présent sur la terre le plus grand pas et le plus grand bond vers l'incrédulité : ce ne sont pas là des paroles faciles à réparer sur la terre ! (APZ/83-85-p4)
" Car la vérité est là : puisque le peuple est là ! Malheur ! malheur à celui qui cherche ! " - C'est ce que l'on a répété de tout temps.
C'est dans le désert qu'ont toujours vécu les véridiques, les esprits libres, maîtres du désert ; mais dans les villes habitent les sages illustres et bien nourris, - les bêtes de trait.
Car ils tirent toujours comme des ânes - le chariot du peuple !
Je ne leur en veux pas, non point : mais ils restent des serviteurs et des êtres attelés, même si leur attelage reluit d'or.
Et souvent ils ont été de bons serviteurs, dignes de louanges. Car ainsi parle la vertu : " S'il faut que tu sois serviteur, cherche celui à qui tes services seront le plus utiles !
L'esprit, c'est la vie qui incise elle-même la vie : c'est par sa propre souffrance que la vie augmente son propre savoir, - le saviez-vous déjà ?
Et ceci est le bonheur de l'esprit : être oint par les larmes, être sacré victime de l'holocauste, - le saviez-vous déjà ?
Et la cécité de l'aveugle, ses hésitations et ses tâtonnements rendront témoignage de la puissance du soleil qu'il a regardé, - le saviez-vous déjà ?
Il faut que ceux qui cherchent la connaissance apprennent à construire avec des montagnes ! c'est peu de chose quand l'esprit déplace des montagnes, - le saviez-vous déjà ?
Vous ne voyez que les étincelles de l'esprit : mais vous ignorez quelle enclume est l'esprit et vous ne connaissez pas la cruauté de son marteau !
En vérité, vous ne connaissez pas la fierté de l'esprit ! Mais vous supporteriez encore moins la modestie de l'esprit, si la modestie de l'esprit voulait parler !
Et jamais encore vous n'avez pu jeter votre esprit dans des gouffres de neige : vous n'êtes pas assez chauds pour cela ! Vous ignorez donc aussi les ravissements de sa fraîcheur.
Mais en toutes choses vous m'avez l'air de prendre trop de familiarité avec l'esprit ; et souvent vous avez fait de la sagesse un hospice et un refuge pour de mauvais poètes.
Vous n'êtes point des aigles : c'est pourquoi vous n'avez pas appris le bonheur dans l'épouvante de l'esprit. Celui qui n'est pas un oiseau ne doit pas planer sur les abîmes. (APZ/83-85-p2)
Celui qui donne des ailes aux ânes et qui trait les lionnes, qu'il soit loué, cet esprit bon et indomptable qui vient comme un ouragan, pour tout ce qui est aujourd'hui et pour toute la populace, - celui qui est l'ennemi de toutes les têtes de chardons, de toutes les têtes fêlées, et de toutes les feuilles fanées et de toute ivraie : loué soit cet esprit de tempête, cet esprit sauvage, bon et libre, qui danse sur les marécages et les tristesses comme sur des prairies !
Celui qui hait les chiens étiolés de la populace et toute cette engeance manquée et sombre : béni soit cet esprit de tous les esprits libres, la tempête riante qui souffle la poussière dans les yeux de tous ceux qui voient noir et qui sont ulcérés ! (APZ/83-85-p4)
État ? Qu'est-ce, cela ? Allons ! Ouvrez les oreilles, je vais vous parler de la mort des peuples.
L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids : il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : " Moi, l'État, je suis le Peuple. " (APZ/83-85-p1)
Tout en lui est faux ; il mord avec des dents volées, le hargneux. Même ses entrailles sont falsifiées. (APZ/83-85-p1)
Voyez donc comme il les attire, les superflus ! Comme il les enlace, comme il les mâche et les remâche.
" Il n'y a rien de plus grand que moi sur la terre : je suis le doigt ordonnateur de Dieu " - ainsi hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent à genoux ! (APZ/83-85-p1)
L'État est partout où tous absorbent des poisons, les bons et les mauvais : l'État, où tous se perdent eux-mêmes, les bons et les mauvais : l'État, où le lent suicide de tous s'appelle - " la vie ". (APZ/83-85-p1)
Là où finit l'État, - regardez donc, mes frères ! Ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont du Surhomme ? (APZ/83-85-p1)
Notre univers tout entier n'est que la cendre d'innombrables êtres vivants : et si minime que soit le vivant comparé à la totalité : il reste que tout fut déjà une fois converti en vie, et ainsi de suite. Admettons une durée éternelle, par conséquent un éternel métabolisme. (FP/81-82-v5)
afin de proclamer à nouveau la parole du grand Midi de la terre et des hommes, afin d'enseigner de nouveau aux hommes le venue du Surhomme.
Toute chose qui sait courir ne doit-elle pas avoir parcouru cette rue ? Toute chose qui peut arriver ne doit-elle pas être déjà arrivée, accomplie, passée ?
Et si tout ce qui est a déjà été : que penses-tu, nain, de cet instant ? Ce portique lui aussi ne doit-il pas déjà - avoir été ?
Et toutes choses ne sont-elles pas enchevêtrées de telle sorte que cet instant tire après lui toutes les choses de l'avenir ? Donc - aussi lui-même ?
Car toute chose qui sait courir ne doit-elle pas suivre une seconde fois cette longue route qui monte ! -
Et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce clair de lune lui-même, et moi et toi, réunis sous ce portique, chuchotant des choses éternelles, ne faut-il pas que nous ayons tous déjà été ici ?
Ne devons-nous pas revenir et courir de nouveau dans cette autre rue qui monte devant nous, dans cette longue rue lugubre - ne faut-il pas qu'éternellement nous revenions ?
Tout va, tout revient, la roue de l'existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit, le cycle de l'existence se poursuit éternellement.
Tout se brise, tout s'assemble à nouveau ; éternellement se bâtit le même édifice de l'existence. Tout se sépare, tout se salue de nouveau ; l'anneau de l'existence se reste éternellement fidèle à lui-même. (APZ/83-85-p3)
Voyez cet homme langoureux ! Il n'est plus éloigné de son but que d'un empan, mais, à cause de sa fatigue, il s'est couché, boudeur, dans le sable : ce brave !
Il bâille de fatigue, fatigué de son chemin, de la terre, de son but et de lui-même : il ne veut pas faire un pas de plus, - ce brave !
Maintenant le soleil darde ses rayons sur lui, et les chiens voudraient lécher sa sueur : mais il est couché là dans son entêtement et préfère se consumer : -
- se consumer à un empan de son but ! En vérité, il faudra que vous le tiriez par les cheveux vers son ciel, - ce héros !
En vérité, il vaut mieux que vous le laissiez là où il s'est couché, pour que le sommeil lui vienne, le sommeil consolateur, avec un bruissement de pluie rafraîchissante :
Laissez-le coucher jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même, - jusqu'à ce qu'il réfute de lui-même toute fatigue et tout ce qui en lui enseigne la fatigue !
Mais chassez loin de lui, mes frères, les chiens, les paresseux sournois, et toute cette vermine grouillante : -
- toute la vermine grouillante des gens " cultivés " qui se nourrit de la sueur des héros ! (APZ/83-85-p3)
L'heure où vous dites : " Qu'importe ma vertu ! Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal ! Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. "
L'heure où vous dites : " Qu'importe ma justice ! Je ne vois pas que je sois charbon ardent. Mais le juste est charbon ardent ! "
L'heure où vous dites : " Qu'importe ma pitié ! La pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes ? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. "
Avez-vous déjà parlé ainsi ? Avez-vous déjà crié ainsi ? Hélas, que ne vous ai-je déjà entendus crier ainsi !
Ce ne sont pas vos péchés - c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel !
Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue ? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer ? (APZ/83-85-p1)