LA NÉCROPOLE NEOLITHIQUE DU "RUDEMONT"
(3000 avant J.-Ch.)
PREHISTOIRE DE LORRAINE (par ANDRE BELLARD / Société préhistorique Française 1935)
Au confluent de la Moselle et du Rupt-de-Mad, sur la rive gauche de ces deux cours d'eau, se trouve une hauteur d'un relief considérable (301 mètres). C'est le Rud-Mont, sorte de promontoire aux flancs escarpés, séparé par un col assez étroit des collines boisées, formant le côté gauche de la vallée du Rupt-de-Mad Je l'ai exploré avec soin et à plusieurs reprises depuis 1899, et ai reconnu à son Sommet un gisement néolithique, l'un des plus riches du département (1). Il peut servir de station typique pour les établissements humains de cette époque, situés en aval du confluent de la Moselle et de la Meurthe. On s'explique aisément que cette hauteur, surmontée d'un plateau au Sol bien uni, ait été l'objet d'une prédilection particulière, quand on examine sa belle situation au point de jonction de plusieurs vallées, celle de la Moselle au Nord-Est à l'Est et au sud-Est celle du Rupt-de-Mad au Sud, au Sud-Ouest et à l'Ouest, enfin celle de Gorze au Nord.
Les débris abondent sur tout le plateau, long d'environ 900 mètres, large de 400, dans sa partie La plus étendue; mais on les trouve surtout dans le voisinage et un peu en arrière des crètes, principalement sur quatre points, qu'il y a lieu d'inscrire sur la carte au 1/80.000 de la façon suivante:
- 1° Vis-à-vis de la vallée de la Moselle (amont), au-dessus de la lettre A du mot Arnaville;
- 2° A l'Ouest, face à la vallée du Rupt-de-Mad depuis le sommet du chiffre 3 de la cote 301, en remontant au Nord vers la frontière;
- 3° Vis-à-vis la vallée de Gorze, autour de la lettre R du mot Rud ;
- 4° En face de la vallée de la Moselle (aval), autour de la lettre M du mot Mont.
Ces deux derniers emplacements sont situés en Alsace-Lorraine: la recherche y est difficile, le terrain n'ayant pas été cultivé depuis plusieurs années. Ils semblent être très riches, surtout celui qui regarde la vallée de Gorze. C'est de là que provient la hachette en silex complète reproduite sur la planche II. La surface n'étant plus remaniée, le gisement est momentanément presque épuisé. Il n'en est pas de même de la partie demeurée française, presque entièrement cultivée. Mes recherches ont éveillé l'attention de nos collègues de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine de Metz. Un article paru dans la Gazette et reproduit par plusieurs journaux de cette ville, notamment par le Courrier (2)., annonçait que des recherches allaient être faites pour le compte de la Société.
Le rudemont à la même époque.
Exécutées quelque temps après ma dernière exploration, sous la direction de M. le docteur Wolfram, directeur des Archives, et de M. Keune, directeur du Musée de Metz, elles ont donné, des silex taillés, tels que pointes de flèches, grattoirs, etc., mais surtout une remarquable flèche en bronze, à soie et barbelée. L'ouverture d'un des nombreux pierriers qui se trouvent dans la partie Est du plateau n'a donné aucun résultat. Sans parler des éclats informes, les objets trouvés par moi, pendant ces dernières années, sont au nombre de près d'une centaine (voir les planches I et II). La proportion entre les bonnes pièces et les éclats indéterminables est d'environ 1 sur 5, proportion remarquable qui, Jointe à l'absence de percuteurs, exclut d'une façon absolue l'hypothèse d'un atelier de taille proprement dit. Nous n'en avons d'ailleurs encore rencontré aucun en Meurthe-et-Moselle, ce qui tendrait à prouver que le silex arrivait le plus souvent tout façonné, les éclats rencontrés sur nos plateaux provenant d'instruments brisés ou de retouches faites sur ceux-ci, pour les rendre utilisables dans un pays où le silex est rare. C'est ainsi que, pour une seule hachette complète en silex, se trouvent quatorze fragments plus ou moins volumineux ayant appartenu à des haches polies, et utilisés ensuite comme pointes de flèche, ràcloirs, etc. Un seul talon n'a pas été remis en oeuvre mais cela tient sans doute à la mauvaise qualité de la roche qui le constitue; il en est de même d'un grand fragment provenant d'une grande hache de forme allongée, dans le genre de celles découvertes à Longeville en 1900 et déposées au Musée de Metz (3) . Comme dans celles-ci, les bithinelles sont très apparentes, de même que les carats; c'est du silex d'eau douce, du silex tertiaire lacustre de la Champagne. A l'encontre de ce qui se produit pour les stations situées en amont de Pont-à-Mousson, le silex du pays et celui du Coralien font défaut, il en est de même des quartzites taillées. Ces dernières ne sont employées ici que comme broyons, dans la proportion de 5 sur 7 (4) . On rencontre sur le plateau quelques fragments de grés vosgien fin, polis sur une de leurs faces, ne dépassant pas la grosseur du poing ayant fait partie d'instruments brisés, meules ou polissoirs. Leurs dimensions sont, le plus souvent, trop restreintes pour qu'on puisse se prononcer. Parmi ceux que nous avons recueillis, l'un présente une surface usée en creux: c'est un débris de polissoir; un autre, usé en dessous et en dessus, présente une partie plate et une partie légèrement convexe avec bord arrondi: c'est un fragment de meule (5). L'agriculture parait avoir été bien peu de chose ici, comme dans toutes nos stations lorraines les plus anciennes. Elle devait se borner à quelques essais, exécutés sur des emplacements très restreints. Étant donné la mauvaise qualité du sol du plateau, de nature rocailleuse, elle devait être bien peu rémunératrice, comparée aux efforts de travail nécessaires pour mettre le terrain. en oeuvre. Sur le Rud-Mont. tous les types classiques d'instruments se trouvent mélangés, depuis le Chelléen jusqu'au Robenhausien Y a-t-il eu superposition, ou les instruments ont-ils été fabriqués sensiblement à la même époque, suivant des types transmis à travers les àges? La question parait devoir être résolue de cette dernière manière, car le silex est de même nature pour tous les objets, la patine est identique. Le tout serait contemporain; peut être même la flèche de bronze; car, en Lorraine, l'usage des instruments de pierre parait s'être perpétué pendant toute la durée de l'âge dit du Bronze, et même après l'apparition du fer. Quoi qu'il en soit, la question de la flèche de bronze mise à part, le gisement ne me parait pas antérieur aux derniers temps de la Pierre polie. Cet enchevêtrement des types, attribués à des époques totalement différentes et successives, se retrouve partout dans notre région, et cette constatation, faite également en Alsace par le Docteur Bleicher, tend à se généraliser comme on peut le voir par les travaux de M. Bosteaux-Pàris en Champagne, de M. Cazalis de Fondouce dans l'Hérault, etc. C'est la réaction contre la tendance à tout vieillir, la balance qui s'établit.
J. BEAUPRÉ
(Société d'archéologie Lorraine, 1901 - 12, 2° série, 50° vol.)
|
(1) : (retour) |
M. Fr. Barthélemy signalait, dans un répertoire faisant partie de son ouvrage La Lorraine avant l'histoire, de nombreux éclats de silex sur le Rud-Mont. C'est tout ce que l'on savait de ce gisement. |
| (2)
: (retour) |
Numéro du samedi 20 avril 1901. |
| (3)
: (retour) |
Dans la collection de Saulcy figurait une hache polie trouvée, dit-on, sur le Rud-Mont. |
| (4)
: (retour) |
Deux sont en granulite. |
| (5)
: (retour) |
Sur la planche II, les broyons sont placés en bas, sur la même ligne. En haut se voient les haches et les fragments de haches avec traces de polissage. Sur la gauche se trouve un petit broyon côte à côte avec un débris de polissoir sous lequel se trouve un morceau de meule. |
Après avoir considéré
plus particulièrement l'industrie des quartz du Mont Jouy, qui
nous semble constituer un faciès spécial, occasionnel,
de l'industrie néolithique, il nous faut reporter notre attention
sur les quartzites de la station du Rudemont.
Nous n'avions guère envisagé ceux-ci, dans notre précédent
travail (17), que dans leur
condition de broyons ou égrugeoirs, ou encore de pierres de fronde.
Les quartzites vosgiens, gris ou rosés, utilisés par les
Néolithiques au Rudemont méritent étude plus détaillée.
Tous ceux qui sont recueillis sur la station se trouvent bénéficier
en effet de la même présomption que ses éclats de
silex, fussent-ils les moins typiques: pas plus que les silex, en effet,
les galets de quartzite ne se trouvent originellement in situ sur le
plateau du Rudemont. On peut donc poser a priori qu'ils y ont été
apportés par l'homme, et dans un but bien défini.
L'examen attentif de chacun d'eux est, en effet, convaincant, car la
station du Rudemont ne nous a livré qu'extrêmement peu
- un dixième à peine - de galets de quartzite ne portant
pas de traces manifestes d'utilisation ou n'imposant pas l'idée
d'une sélection.
Les quartzites utilisés peuvent se répartir en plusieurs
catégories: 1° ceux précisément dont la grosseur
et le poids sensiblement uniformes témoignent de cette sélection,
et qui, comme nous l'avons déjà fait observer en 1926,
ont été choisis dans les alluvions de la plaine et apportés
sur la station pour y servir au jet, soit direct, soit par l'intermédiaire
d'une fronde - on observera d'ailleurs que, outre ces quartzites de
taille moyenne, la station du Rudemont nous a livré quelques
galets de même taille en granité et en quartz, alors qu'il
n'en est jamais, en ces matières, récolté de plus
gros - ce qui confirme la destination de projectiles des galets bruts
de petites dimensions; 2° ceux que des plans d'usure nettement affirmés
qualifient pour avoir tenu l'emploi de broyons ou égrugeoirs
- avec celle des meules, on sait que leur présence nous a fourni
le témoignage formel " du caractère sédentaire
et des connaissances agricoles des populations lorraines de la préhistoire"
(18); enfin, 3° les quartzites
rencontrés en fragments de qui la morphologie, jointe à
la présence de caractéristiques de la taille intentionnelle
permet le classement dans une catégorie d'instruments néo-lithiques
connus. Certains d'entre ceux que le Rudemont nous a livrés portent,
sur ce qui subsiste de la surface corti-cale du galet, des traces d'usure
montrant qu'ils ont été tirés de galets précédemment
utilisés comme broyons.
Dans cette 3e catégorie nous faisons entrer les nucléus,
souvent caractérisés aussi nettement que les nucléus
de silex, ainsi qu'en témoigne ci-contre (ci-dessous)
la fig. 1.
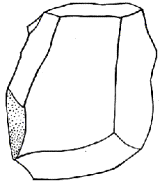 3/4
3/4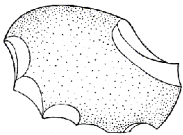
FiG. 1. - Nucleus caractéristiques en quartzite, du Rudemont ; l'un traité par épannelage à l'instar du silex; l'autre dont une face naturellement plane à été choisie comme plan de frappe pour l'obtention de lames courtes et coupantes. (Le pointillé montre ce qui subsiste de la surface corticale du galet brut.)
Nous ne reviendrons pas sur les pierres de fronde ni sur les broyons, que nous avons décrits et figurés (19) précédemment, mais sur l'outillage en quartzites taillés.
Nous n'avons jusqu'à
présent rencontré sur le Rudemont - Beaupré a étendu
cette constatation à toutes les stations lorraines - aucun instrument
tel que fusaïole se référant à une industrie
néolithique du tissage d'une plante textile ou de la laine. Mais
aussi bien, des fusaïoles en os ou en bois n'auraient laissé
subsister jusqu 'à nous aucun vestige. On sait cependant - nous
l'avons fait observer dans la note 2 de nos pp. 39 = 45 (op. cit.) - que
les stations suisses (Robenhausen) ont livré des filets en lin
avec flotteurs en écorce de pin, et nous avons marqué, pp.
38 = 44, que " les tribus néolithiques qui fondèrent
les cités lacustres " étaient "contemporaines
très certainement des habitants primitifs du Rudemont". Or,
les tisserands néolithiques des cités lacustres n'utilisaient
point le lin cultivé de nos jours (Linum usitatis-simum, Linné)
mais une espèce à feuilles étroites: comment pour-rions
nous ne point retenir comme un argument éventuel ce fait que l'on
trouve de nos jours encore, sur le Rudemont, Linum tenuifolium, Linné,
dont Siélain, dans son Album des plantes des champs, des prairies
et des bois (T. IV, p. 30. Lhomme, Paris, 1911) écrit: "Le
lin à feuilles menues aurait sans doute quelques-unes des qualités
du lin cultivé, mais il n'est pas employé".
C 'est en tous cas une espèce fort rustique qui recherche précisé-ment
les coteaux calcaires ensoleillés et peut fort bien avoir retenu
l'attention des primitifs qui y avaient leur résidence. Tout bien
pesé, étant admise la parenté de civilisation de
nos " Mosellans d'avant l'histoire " avec les Lacustres et le
caractère observateur des primitifs, nous serions tenté
de poser en fait qu'il est impossible que ce lin indigène leur
ait échappé et qu 'ils n 'en aient point tiré parti.
Peut-être même le botaniste d'aujourd'hui ne fait-il que récolter
une " relique " des cultures primitives...
Nous avons dit incidemment
plus haut qu'au contraire des quartz, les quartzites ont, pour des causes
imposées par leur structure intime, fourni surtout des instruments
tranchants, obtenus à larges éclats francs. Tous en effet,
ou à peu près tous, peuvent être rangés dans
la catégorie des racloirs et grattoirs. Nous en figurons (pl.
VI et VII) trois exemplaires particulièrement typiques et dont
l'examen laisse bien découvrir par quelle technique ils ont été
obtenus. On peut observer sur eux comme sur maint autre quartzite ouvré
du Rudemont les caractéristiques fort nettes de la taille intentionnelle,
notamment le bulbe de percussion et l'étoilure du point de frappe
qui, en tout état de cause, témoignent de la vigueur calculée
du coup porté, et - par leur emplacement visiblement choisi - d'une
discrimination intelligente, ce qui, joint à la multiplicité
des exemples, à la constance avec laquelle un galet non préalablement
maintenu se dérobe aux heurts occasionnels, élimine radicalement
ici l'hypothèse de fracture par chocs fortuits survenus dans le
cours des âges. Nous avons d'ailleurs recueilli au Rudemont un nucleus
de quartzite récemment venu au jour et dont de fortes incrustations
calcaires, garantes de l'ancienneté du travail, tapissent les plans
de taille laissés par le départ de deux grattoirs.
Si l'on admet que racloirs et grattoirs étaient destinés
à servir, par exemple, au décharnage des peaux, au rabotage
du bois, etc., on conviendra que les propriétés des quartzites
taillés suffisaient amplement à l'emploi. Ils offraient
même l'avantage de procurer à bon compte les larges surfaces
planes et les tranchants étendus que nos primitifs hésitaient
à demander au silex, matière précieuse qu'il leur
fallait importer de loin. Enfin, le " dos " lisse qu'offraient
sans travail spécial les grattoirs de quartzite, devait être
apprécié, si l'on considère avec quel soin le dos
des grattoirs de silex était retouché et débarrassé
de ses aspérités principales.
Les galets dont le grain et la dureté s'étaient, à
l'expérience, révélés comme particulièrement
propices à la taille, étaient mis à profit avec une
application toute particulière. Il en est résulté
des nucléus très caractéristiques, tel celui que
nous figurons ci-contre, dont il n'a pas été tiré
moins de cinq instruments et qui se présente aussi scrupuleusement
équarri que le pourrait être un rognon de silex de choix:
observons là encore que ce nucléus a été abandonné
lorsque son utilisation l'eût littéralement "décortiqué":
il paraît certain que la surface corticale du galet de quartzite,
délibérément conservée sur les outils, était
non seulement acceptée mais encore recherchée, et il ne
semble pas impossible que, pour des emplois déterminés,
l'outillage en quartzite eût constitué un progrès
ou plus exactement consacré un avantage sur l'outillage en silex.
Au contraire de ce que nous avons observé sur la station du Mont
Jouy, dont les occupants se sont efforcés d'établir un outillage,
complet en sa diversité, aux dépens des galets de quartz
récoltés sur place, les quartzites taillés du Rude-mont,
préalablement sélectionnés dans le lit de la Moselle,
ne constituent pas un faciès industriel spécial. On l'a
vu, ils n'ont fourni qu'un assortiment très restreint d'outils:
ceux-là seuls que la texture des quartzites permettait d'obtenir
par une technique de taille directement héritée des pratiques
de la taille du silex, et susceptibles de suppléer les outils de
silex dans des cas limités, sauf rares exceptions, aux grattoirs,
racloirs et lames courtes.
Parmi les exceptions, nous rangerons le singulier outil qui, probablement
après fracture du galet originel suivant son plus grand diamètre,
a été finement poli sur tout le plan ainsi créé
(voir pl. IIb ).
Nous observerons en passant que la taille des quartzites, manifestement
opérée sur place - nos récoltes de nucléus
et d'outils à différents stades de la confection ne laissent
aucun doute à ce sujet - apporte un nouvel élément
de preuve à l'affirmation que nous élevions dès 1926
à l'encontre du comte Beaupré (20),
de la pratique de la taille sur nos stations proprement dites de Lorraine,
après importation à l'état brut des matériaux
appropriés. Plus évidente encore, la taille sur place des
quartz du Mont Jouy appuie notre affirmation avec une force particulière.
Ci-dessous, la figure 2 représente en grandeur naturelle le plus
caractéristique des nucléus que nous ait livré le
Rude-mont : ce nucléus, en silex de choix, de section pentagonale,
n'a été rejeté qu'après qu'il en eût
été tiré parti jusqu'à l'extrême limite.
La figure 3 représente un curieux nucléus en basalte que
nous avons pareillement recueilli sur le Rudemont.
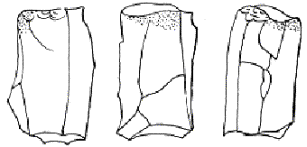
FlG. 2. - Nucleus
en silex abandonné après complet épuisement
(le pointillé représente une zone sous-corticale).
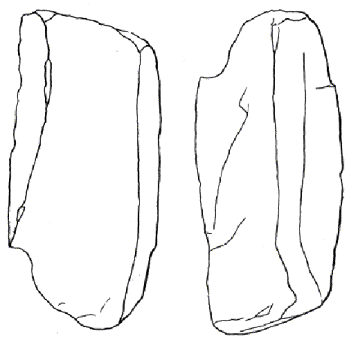
L'examen réfléchi
des documents procurés par une station aussi homogène que
le Rudemont permet d'affirmer que les outils de silex et les outils en
quartzite y ont été absolument contemporains, dans leur
fabrication comme dans leur emploi (21).
La morphologie comparée des instruments de quartz et des instruments
de silex de la station du Mont Jouy imposait d'ailleurs une conclusion
pareille en ce qui la concerne. Dans l'un comme dans l'autre cas, la mise
à profit de roches dures locales autres que le silex s'explique
par une opération bien naturelle de l'intelligence de l'homme,
sans qu'il soit besoin de recourir à l'hypothèse, tout à
fait gratuite dans le cas qui nous occupe, de l'irruption d'un "
courant de civilisation ".
Cette utilisation de roches dures locales peut, et doit sans doute, croyons-nous,
s'expliquer, pour partie, comme une conséquence normale et une
preuve de l'accession de tribus à la vie sédentaire. On
peut admettre que les temps néolithiques ont été
marqués par une recrudescence de migrations humaines, par une certaine
distribution des peuplades issues de rameaux communs - une " mise
en place " comme le dit M. Boule des grandes races paléolithiques
- puis par la fixation de ces peuplades. C'est de ce dernier stade que
nous entendons parler en invoquant leur accession à la sédentarité.
Sédentaires, d'ailleurs, il est bien certain que les hôtes
des grottes décorées du Paléolithique l"étaient
déjà autant qu'hommes au monde.
De même, la présence sur la station du Rudemont d'instruments
en roches dures étrangères, non apportées par charriage
dans le lit de la Moselle proche, peut, et selon nous, doit s'expliquer
sans conteste par le double effet des progrès du peuplement et
l'affermissement des relations d'échange entre tribus.
Nous reproduisons à ce sujet (pl. IIc) trois
extrémités brisées d'instruments robustes attribuables
à des pointes de lance et recueillis sur la station du Rudemont.
L'allure " paléolithique " qu'ils manifestent peut s'expliquer
très suffisamment par la structure intime des matières employées,
car par ailleurs ils se réfèrent à un type d'arme
courant au Néolithique et ne peuvent donc pas bénéficier
des arguments que peuvent suggérer les " coups de poing "
de quartz de la Grande Côte de Novéant. Car le " coup
de poing ", lui, est un instrument spécifiquement paléolithique.
Et deux au moins des instruments de la Grande Côte sont bien des
" coups de poing ".
Progrès du peuplement, accession à la sédentarité,
affermissement des relations d'échange, ce sont là trois
conditions qui nous semblent suggérer avec une force renouvelée
cette idée que nos Néolithiques vivent les derniers temps
des âges de la Pierre. Toutes les conditions semblent s'établir,
qui serviront de préface à la découverte des métaux.
Et plutôt qu'une procession générale et méthodique
du fer succédant au cuivre, nous serions porté à
admettre avec l'origine orientale des industries du cuivre et du bronze
charriées jusqu'à la Lorraine par migrations restreintes
ou relations d'échanges industriels, une origine toute régionale
en quelque sorte des industries du fer primitives dont les vestiges sont
découverts en Lorraine, à quelque six cents kilomètres
à vol d'oiseau de la nécropole éponyme de Hallstatt
(22).
|
(17) : (retour) |
Op. cit., pp. 31-33, 35-36 = 37-39, 41-42. |
| Op. cit., pp. 32-33 = 38-39. | |
| (19)
: (retour) |
Op. cit., pl. IV-V. |
| (20)
: (retour) |
" Je ne crois pas aux
ateliers de taille en Lorraine, sauf sur certains points très
peu nombreux où des couches de silex af fleurent, comme
dans la Meuse aux environs de Saint-Mihiel...Il me paraît
plus rationnel de croire que les instruments étaient ex-portés
tout préparés... De telle sorte qu'on aurait pratiqué
en Lorraine la retouche plutôt que la taille elle-même
". J. BEAUPRE. Les Etudes préhistoriques en Lorraine
de 1889 à 1902 (Nancy, Crépin-Leblond, 1902), p.
14; cf. BELLARD, Op. cit., pp. 22-24 = 28-30. On verra plus loin que nos
trouvailles personnelles - 461 bonnes pièces sur un total
de 1.644 documents en silex du Rudemont - n'atteignent même
pas à cette proportion. Cela ne nous trouble aucunement.
Les petits élèves de M. Léger conservaient
souvent par devers eux, à pleines boîtes d'allumettes,
les menus éclats amorphes refusés par le maître,
et nous ne parcourons jamais le Rudemont sans récolter
une dizaine d'éclats. Avant eux, au cours des âges,
les chercheurs de "pierre à feu" avaient récolté
quantité de fragments plus considérables. Enfin
et surtout, les nucléus mis en oeuvre sur la station ont
engendré quantité d'outils unifaces (grattoirs,
racloirs, pointes de lances ou dards, lames, perçoirs,
etc..) |
| (21)
: (retour) |
C. Millot, cité par Beaupré, observait déjà en 1900: " Prises isolément, les quartzites n'attireraient peut-être pas toujours l'attention, mais en les comparant aux objets en silex de même provenance, on est frappé de leur analogie et l'on est porté à croire que l'emploi des roches autres que le silex était, non pas une exception, mais un usage constant. >> BEAUPRE. De l'emploi des roches cristallines aux temps préhistoriques, in Journal 1900 de la Société d'archéologie lorraine, pp. 5-8. |
| (22)
: (retour) |
J. BEAUPRE, abordant l'âge du bronze (Et. préh., p. 27,} marque expressément : " Cette division des temps préhistoriques semble jusqu'ici praticablement inapplicable dans notre région. Les peuples paraissent y être passés, presque sans transition, de l'époque de la Pierre Polie à la période intermédiaire entre le bronze et le fer, connue sous le nom de Période de Hallstatt. " |
Les enseignements
que nous avons et reçu et tiré du Rudemont (23)
nous pressent de consacrer une nouvelle étude à l'outillage
en silex de la station. Les pièces recueillies, par leur abondance,
leur perfection, leur variété et tout à la fois l'homogénéité
de leurs ensembles, qualifient jusqu'à présent, sans contestation
possible, la station du Rudemont, nous y insistons, comme la plus remarquable
station néolithique de tout l'Est français avec le camp
de Chassey.
Quelques heureuses circonstances, hélas passagères, de remise
en culture nous y ont rouvert carrière au cours des neuf dernières
années et ont amélioré le rendement de prospections
que nous n'avons jamais complètement cessé. Dans les planches
nos VIII et IX, nous avons tenu
à reproduire une sélection des pointes de flèches,
de javelots et de lances, de perçoirs, de poignards, une scie que
nous avons trouvé sur le Rudemont. Bien entendu, la plupart de
ces pièces de choix proviennent de nos recherches antérieures
à 1926 et ont été reproduites dans notre précédent
ouvrage. Nous avons tenu cependant à les redonner en compagnie
des pièces nouvelles dignes de leur voisinage, et surtout à
les re-produire cette fois en grandeur naturelle, pour remédier
aux inconvénients de la réduction au quart adoptée
par nous en 1926 (explicitement indiquée sur les planches mais
dont plusieurs lecteurs prenaient texte pour chercher la grandeur réelle
dans une multiplication par quatre de toutes les dimensions).
Par ailleurs, on trouvera ci-dessous le tableau détaillé
des documents livrés par le Rudemont jusqu'à ce jour, à
notre connaissance, en conformant la conception analytique de cette statistique
aux données du tableau comparatif des principales stations néolithiques
lorraines dressé par Beaupré (24):
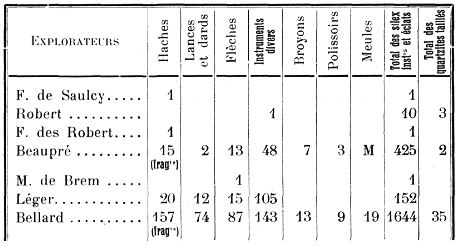
Trois catégories de documents nous paraissent mériter une étude plus particulière: les pointes de flèches et les haches polies, les lances et dards.
Les pointes de flèches. -
A l'exception de
l'admirable pointe en quartz que nous reproduisons à nouveau et
de la pointe en nacre d'unio précédemment publiée,
qui nous semble plutôt une amulette, toutes les pointes de flèches
du Rudemont sont en silex.
Les 87 pointes de flèches que nous avons personnellement recueillies
(25) se décomposent
en 63 pointes spécialement ouvrées à destination
de pointes de flèche et en 24 pointes fortuitement obtenues d'éclats
de débitage ou d'écailles de haches polies et dûment
adaptées à leur rôle d'armature - détail important,
dans lequel il faut retrouver le souci de tirer un avare parti de la rare
matière de choix qu'était le silex.
Les 63 pointes spécialement ouvrées à destination
de pointes de flèches se répartissent entre les grandes
catégories morphologiques retenues par Déchelette, de la
façon suivante:
- - 42 pointes sans pédoncule ni barbelures;
- - 6 pointes à pédoncules sans barbelures;
- - 11 pointes à pédoncule et barbelures.
Quatre pointes de flèches spécialement ouvrées ont échappé à cette classification en raison de leur état de fragmentation; à ce sujet, nous devons déclarer que d'assez nombreuses pointes de flèches - qui auraient pu, pour la plupart, entrer en compte dès notre précédent travail - ne sont re-présentées que par leur partie antérieure ou postérieure; mais, au contraire de ce qui a lieu pour les haches polies, nous n'avons aucun scrupule à compter ici la partie pour le tout; n'ayant jamais rencontré de fragments multiples d'une même pointe de flèche, tandis que de toute évidence plu-sieurs des nombreux éclats de haches polies recueillis devaient appartenir à un seul et même instrument.
L'examen de la série
de pointes de flèches que nous avons constituée fait ressortir
que la forme amygdaloïde (sans pédoncule ni barbelures) l'emporte
de beaucoup sur toutes autres ; que sur les 42 spécimens amygdaloïdes
recueillis, deux seulement contre quarante sont unifaces, que trois seulement
portent une base légèrement concave contre trente-neuf à
base nettement convexe, et qu'aucun ne présente cette base nettement
rectiligne que l'on observe, au con-traire, sur de nombreuses pièces
de la collection Merciol, re-cueillies sur les stations de la Seille,
aux environs de Mor-ville-lès-Vic.
Parmi les formes à pédoncule, barbelées ou non, aucune
n'est uniface: toutes sont soigneusement taillées sur les deux
faces; d'autre part, une seule des pointes barbelées présente
des barbelures récurrentes.
Lances et dards. -
L'abondance de pointes
robustes susceptibles de rentrer dans la catégorie des " lances
et dards " retenue par Beaupré est, sur la station du Rudemont,
particulièrement remarquable: dans les trouvailles de M. Léger
comme dans les nôtres, leur quantité serre de près
celle des pointes de flèches. Peut-être faudra-t-il tirer
argument de cette prépondérance des armes d'hast sur la
station en faveur de son occupation par des éléments de
tribu investis d'un rôle guerrier - ceci, en tout cas, est à
rapprocher de l'abondance des pierres de fronde et de l'existence du retranchement
que nous avons découvert en 1920.
Le Rudemont nous a livré 74 pointes de " lances et dards ".
Faisons observer toutefois que, lorsque ces documents sont fragmentés,
ce qui est la règle à peu près constante, il est
difficile de faire le départ entre les armatures de lances, de
dards, de couteaux ou de poignards. Nous inclinons à croire que
les pointes larges, d'épaisseur relativement faible et de retouche
marginale très soignée, appartiennent à des poignards,
et à ce sujet nous renvoyons (voir pl. X) à
la convaincante comparaison que permet le poignard de silex trouvé
emmanché dans la station lacustre de Saint-Blaise et figuré
par Munro (26).
Il est à remarquer qu'au contraire des pointes de flèches,
les grandes pointes de lances, dards, poignards, etc... en silex, recueillies
sur le Rudemont sont, sans exception, uni-faces.
Les haches polies. -
L'énumération utile des haches polies récoltées sur la station du Rudemont présente des difficultés insurmontables résultant de ce fait que la presque totalité des documents recueillis ne consistent qu'en fragments sou-vent peu volumineux parmi lesquels les vestiges caractéristiques du tranchant ou du talon ne sont qu'en faible pro-portion, ainsi qu'il est normal. Dans l'impossibilité où l'on se trouve d'affirmer qu'aucune hache ne nous a livré plu-sieurs de ses propres fragments - et selon toute vraisemblance, nombre de fragments recueillis, encore qu'inadaptables entre eux, doivent provenir d'une quantité de haches relativement restreinte - tout essai d'énumération est voué à l'arbitraire. Nous nous refusons, en tout cas, à suivre la méthode adoptée par Beaupré et par Barthélemy, et qui leur fit tenir compte, pour autant de haches différentes, des divers fragments qu'ils ont inventoriés.
Ce n'est jamais en
vain, pourtant, que l'on interroge les documents recueillis, si mutilés
qu'ils nous soient parvenus Nous avons récolté sur la station
du Rudemont 155 fragments de haches polies en silex, contre seulement
deux instruments polis d'autre matière que le silex. L'un de ces
derniers est le fragment de lourde hache figuré sur la planche
V de notre précédent travail (27).
Enfin, nous avons eu la bonne fortune de récolter en 1930 une hache
entière que nous tenons à reproduire en sa grandeur naturelle.
Elle est en phtanite, comme ce précédent fragment, et mesure
74 mm. de longueur, 40 mm. de largeur au tranchant, et 26 mm. d'épaisseur
maximum (dimension prise au tiers antérieur).
Les reliefs mis en évidence par la photographie démontrent
que le talon de la hache, jusqu'à mi-longueur de l'outil, a subi
un piquetage, un " bouchardage " destiné à favoriser
la fixation dans une gaine d'emmanchement, particularité souvent
observée sur les haches polies en roches dures, de petites dimensions
surtout, recueillies dans l'Ouest et le Midi français (28).
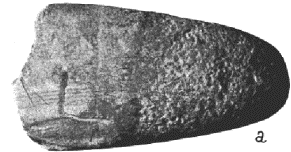
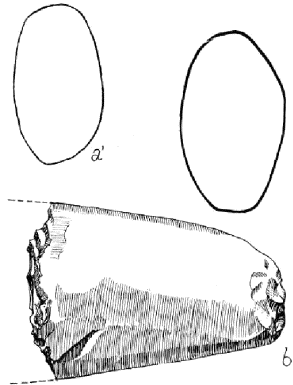
FIG. 4. - Haches
à profil pisciforme et section ovale
(a: phtanite ; b : silex).
Cette hache polie est la seule
hache entière, en provenance du Rudemont, que nous eussions pu
considérer, avec la hachette en silex recueillie par J. Beaupré
et reproduite par lui sur la seconde planche, consacrée à
ses trouvailles sur le Rudemont (29) -
la hachette que nous avons précédemment figurée
(pl. V) n'avait reçu encore aucune trace de polissage.
Mais M. Léger, directeur de l'école publique de Novéant,
en retraite, nous déclarait n'avoir pas recueilli moins de vingt
haches polies entières ou en fragments importants, chiffre qui
ne nous surprendra pas si l'on considère qu'aidé par les
enfants de l'école il a été le premier prospecteur
méthodique du Rudemont (30),
et que les documents en question sont les premiers que l'on découvre
sur une station de surface à peu près inexplorée.
Plusieurs des fragments de haches polies que nous avons pu recueillir
sont toutefois assez importants pour permettre une étude fructueuse
de la morphologie des haches du Rude-mont.
Toutes réserves faites sur l'importance, à notre avis
considérablement exagérée, que certains auteurs
ont donnée à la morphologie des haches - trop étroitement
entendue, dans le but d'en dégager des possibilités de
chronologie relative ou d'attribution de provenance - nous avons tenu
à les faire figurer à toutes fins utiles.
Les dessins ont été confiés à une plume
particulièrement experte (31),
ils ont été exécutés à la grandeur
réelle et toute fantaisie en a été rigoureusement
bannie:( taille non garantie sur Internet, l'unité
étant le pixel et non le centimetre ! ) les pointillés
destinés à préciser des courbes et à suppléer
des dimensions absentes n'ont été esquissés qu'autant
qu'ils étaient permis à
un homme de l'art, par une évidence toute mathématique,
après étude minutieuse des données fournies par
le fragment. Nous ferons observer toutefois que les coupes d'instruments
que nous publions ci-contre sont, bien entendu, obtenues à vue
d'œil et données en coupe supposée; l'œil du
dessinateur ayant totalisé les divers plans de polissage perçus
par lui, la coupe comporte un effet de raccourci responsable des dissymétries
apparentes de celle-ci; chacune des coupes réelles opérées
à des diamètres différents des instruments corroborerait
au contraire l'impression de perfection que dégage l'aspect général
des haches polies.
Mais on pourra, d'ailleurs, pour cinq des haches en silex, se reporter
aux réductions photographiques non retouchées de ces mêmes
documents, sur la planche V de notre précédent ouvrage.
Les huit haches polies dont l'état a permis l'étude détaillée
répondent respectivement aux diagnoses suivantes:
Les huit haches polies dont l'état a permis l'étude détaillée répondent respectivement aux diagnoses suivantes:
- a) Hache à profils pisciformes et à section ovale, à talon piqueté pour permettre l'emmanchement engaîné (Matière: phtanite);
- b) Hache à profil pisciforme et à section ovale (Talon; matière: silex);
- c) Hache à profil ovoïde et à section ovale amincie (Partie médio-postérieure; matière: silex);
- d) Hache à section ovale irrégulière, à extrémité fruste ayant conservé le cortex originel (Partie postérieure ; matière: silex).
- e) Hache à profil rectangulaire très allongé, tranchant très large et section ovale équarrie (Partie médio-antérieure; matière: silex);
- f) Hache à profil rectangulaire très allongé; section ovale équarrie (Partie antéro-supérieure; matière: silex);
- g) Hache à profil rectangulaire très allongé, à tranchant étroit et section ovale équarrie (Partie antéro-supérieure; matière: silex);
- h) Hache à
profil rectangulaire très allongé, à section
mince quasi-rectangulaire (Partie antéro-supérieure;
matière: silex).
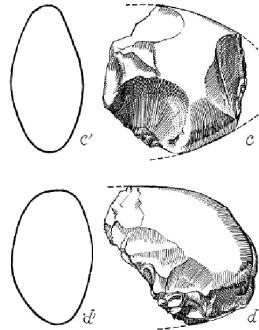
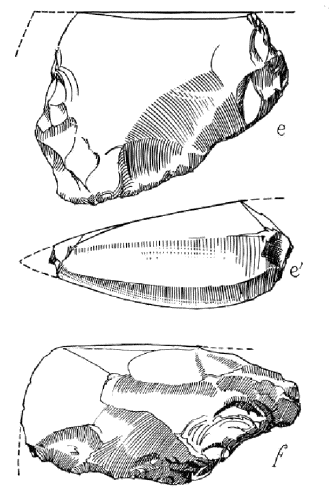
Comparaisons. -
Des comparaisons morphologiques utiles avec des haches entières
peuvent, en prenant référence au Musée Préhistorique
de Mortillet (32), être
faites entre notre modèle a et, en ce qui concerne la pratique
du " piquetage ", les n° 565 (hache en roche dure trouvée
dans le département de l'Aude) et 566 (hache en roche dure trouvée
dans la station lacustre de Locras, sur le lac de Bienne) [originaux
au musée de Saint-Germain];
entre notre modèle b et le n° 555 (hache en roche dure trouvée,
encore emmanchée, dans la même station lacustre; original
au Musée de Berne); les écaillures de l'extrémité
du talon de notre hache sont un peu trop accusées par le dessin,
le contour général du talon après polissage n'est
pas complètement disparu en réalité;
entre nos modèles e, f et g et le n° 569 (hache en silex
provenant du Danemark; original au Musée de Saint-Germain);
entre notre modèle h et le n° 563 (hache en jadéite,
de coupe à peu près rectangulaire, aux bords latéraux
parfaitement équarris, provenant de l'Ardèche; original
au Musée de Saint-Germain) ; G. et A. de Mortillet font d'ailleurs
observer que " d'autres roches, même des plus communes, comme
le silex, étaient aussi parfois équarries ".
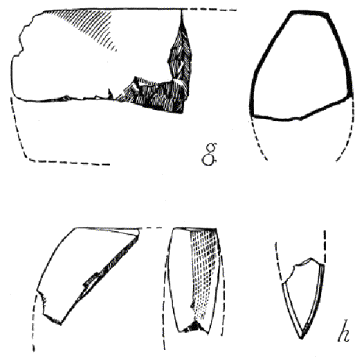
L'étude systématique des haches polies du Rudemont permise par l'état dans lequel un certain nombre d'entre elles nous sont parvenues, accuse une proportion singulièrement élevée, non encore observée jusqu'à ce jour en Lorraine, de haches à section équarrie tendant à une coupe rectangulaire. C'est, à nos yeux, une simple conséquence du caractère très appuyé des recherches que nous avons consacrées à la station; il est probable que l'étude comparative des formes re-cueillies sur d'autres stations patiemment prospectées ferait apparaître le même résultat. Au reste, si les auteurs ont admis jusqu'à présent que " les haches de coupe rectangulaire sont particulièrement communes en Scandinavie" (33), nous en tirerons d'autant moins argument qu'ils donnent, d'autre part, de nombreux exemples de telles haches provenant de diverses régions françaises, et notamment de Bretagne.
Signalons au passage que les diverses ébauches de haches préparées
en vue du polissage qu'il nous a été donné d'observer
nous donnent à croire que, pour les haches fabriquées en
France, c'est au seul travail du polissage que l'artisan a demandé
l'équarrissage des plans étroits de l'instrument, tandis
que les ébauches trouvées au Danemark montrent que les incomparables
tailleurs de silex de la presqu'île danoise donnaient une section
quadrangulaire à leurs haches dès la taille préalable
à petits éclats: celles-ci avaient une coupe rectangulaire
avant que d'être polies (34).
Quant à préjuger d'une influence nordique pour expliquer
les haches équarries de nos régions - ou vice-versa - nous
ne nous y risquerons point, ne fût-ce que parce que le défaut
de prospections suffisamment persévérantes sur les stations
néolithiques de France, l'insuffisance des jalons solidement plantés
dans la connaissance des temps les plus récents de la pierre, et
pour tout dire l'insuffisance de la documentation sur le Néolithique
ne permet pas de formuler présentement à ce sujet un jugement
qui vaille.
Dès maintenant, le Rudemont verse contribution positive à
la réponse qu'il appartiendra aux chercheurs de l'avenir, mieux
informés, de dégager d'observations monographiques qu'il
reste à généraliser: sur cette station mosellane
on re-cueille des haches fort différentes entre elles par leur
profil et leur coupe mais que rien ne permet d'attribuer pour au-tant
à des échelons différents de la chronologie.
La constatation n'est pas nouvelle pour nous: elle rejoint exactement
celle que nous ont permis nos recherches sur la station de Vaux-sur-Somme,
où toutefois nous n'avons jamais recueilli de haches de coupe rectangulaire,
alors qu'au contraire nous avons pu y récolter des haches accusant
une tendance marquée à une coupe circulaire.
Considérations sur le polissage. - Nous croyons pouvoir proposer
l'explication suivante de la prépondérance des formes à
section rectangulaire dans les haches de la station du Rudemont. Traitant
précédemment de ces haches et de l'outillage en pierre polie
(35), nous imprimions les considérations
suivantes: "Aucun de ces "polissoirs fixes" nécessaires
à leur fabrication en grand ne nous est connu dans la région,
et les polissoirs portatifs dont nous avons trouvé des fragments
ne semblent guère avoir permis que des opérations de ravaudage.
Mais il est fort probable que les polissoirs ont existé, qui ont
disparu dans la suite des temps ".
Il ne nous a pas été donné, depuis, de repérer
l'un de ces polissoirs fixes, et pas plus qu'en 1926 nous ne sommes autorisé
à décider que la pierre aux " genoux de Saint Clément
", dont l'original aura disparu à la fin du XVIII° siècle,
était un de ces polissoirs. Par contre, s'ajoutant aux nombreux
fragments de polissoirs portatifs en grès vosgien, etc., que nous
signalions alors avoir recueillis sur le Rudemont, il s'en est ajouté
un dont la surface striée est particulièrement caractéristique
et qui paraît avoir appartenu à une dalle d'assez belles
dimensions. Si les traces de polissage qu'il porte (celles-ci étaient
nécessairement communes au polissoir et à l'objet soumis
au polissage) sont manifestes, toutefois ce fragment, pas plus que les
précédents, ne porte trace d'une vraie "cuvette".
Ce détail nous amène à penser - étant donné
que la forme des " cuvettes " observées sur les polissoirs
fixes conditionnait pour bonne part la forme définitive des haches
qui y recevaient leur dernière façon - que les haches à
coupe rectangulaire pourraient fort (bien avoir été polies
sur des dalles planes n'ayant reçu préalablement aucune
taille en cuvette, et auxquelles l'opération du polis-sage à
plat n'aurait guère pu communiquer qu'une dépression atténuée,
ample et de très grand rayon, telle que celle dont témoigne
l'examen en profil du fragment bien caractérisé que nous
signalons ci-dessus. Précisons que ce der-nier est en quartzite
à grain fin qui n'est point sans analogie avec les quartzites de
Sierck.
Que la pratique du polissage et non seulement l'importation de pièces
polies eût été pratiquée sur le Rudemont, cela
ne fait pour nous aucun doute. Cette conviction est basée sur la
trouvaille de nombreux fragments de polissoirs et sur l'interprétation
que nous pensons pouvoir tirer de l'abondance des formes plates parmi
les haches recueillies, enfin sur la découverte de la hache préparée
pour le polissage et que nous avons précédemment publiée
(36).
Enfin, nous tenons, avant de conclure ces considérations sur le
polissage, à nous élever contre la théorie qui vient
de se faire jour et suivant laquelle " les Campigniens sont les importateurs
de la hache taillée en silex... ce sont les Campigniens qui ont
donné l'idée aux Néolithiques autochtones d'employer
le silex comme matière première des haches... les Campigniens
d'ailleurs, s'ils enseignaient aux Néolithiques moyens à
se servir du silex pour la fabrication des haches, leur empruntaient la
pratique du polissage " (37).
Les industries lithiques de Picardie, par exemple, qui offrent la succession
complète des époques depuis le Paléolithique le plus
ancien, n'ont mis en œuvre que le silex, roche locale par excellence
et d'ailleurs matière première d'élection de tous
nos primitifs; on ne voit vraiment pas en quoi les Néolithiques
autochtones auraient dû attendre qu'une influence externe leur vînt
suggérer " l'idée d'employer le silex comme matière
première des haches ".
Eussent-ils eu besoin de recevoir " l'idée ", ces Picards
avant la lettre l'eussent héritée sur place de leurs devanciers,
en recueillant sur quelque plateau, limé par l'érosion,
quelque limande acheuléenne, comme il nous est donné parfois
de le faire aujourd'hui.
Compte tenu de la préférence marquée avec laquelle,
aux divers stades de la préhistoire, les primitifs de France ont
demandé au silex la matière première de leurs instruments,
il nous semble au contraire que les roches dures locales n'ont été
utilisées qu'à titre de succédané du silex,
lorsque l'éloignement des gîtes silicifères, la facilité
relative de la récolte sur place de roches dures susceptibles d'utilisation,
les progrès du peuplement avec différenciation peut-être
hostile des tribus, l'acquisition d'une notion de la valeur du temps due
aux exigences de l'agriculture naissante, eussent déterminé
les autochtones à demander au terroir même où avait
pris forme leur tendance à la vie sédentaire, les ressources
nécessaires à leur existence. Il nous semble que telle est
la conclusion qui se dégage de la préhistoire de Lorraine.
Cliché Prillot
Grandeur naturelle.
FiG. 8. - A gauche: retouchoir du
Rudemont, dont l'extrémité s'est trouvée presque
entièrement polie à l'usage (collection Bellard) ; à
droite : perçoir néolithique du Rudemont, dont on remarquera
le style paléolithique (collection de la ville de Metz, don Léger).
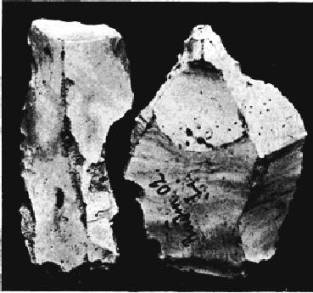
Avant de mettre en
ligne un autre argument tiré de cette dernière, nous exprimerons
notre conviction que c'est le retouchoir qui a inventé le polissage
du silex et que le silex a été la première en date
des roches soumises au polissage; il faut de toute évidence chercher
la naissance du polissage sur les stations et chez les Néolithiques
adonnés à la taille à très petits éclats;
le polissage est né de cette taille et de la minutie des retouches
successives suivant le processus même par lequel la circonférence
naît de la ligne droite.
Nous avons signalé (38) outre la présence sur le Rude-mont
de retouchoirs - alors que précédemment Barthélémy
notait qu' " aucun de ces derniers éléments d'outillage
n'est signalé par nos chercheurs " - le polissage partiel
dont leur extrémité portait témoignage (voir fig.
8). On saisit fort bien que le retouchoir devait se polir à l'usage:
mais elles-mêmes, les pièces retouchées devaient finir,
en raison même de la finesse des retouches, par postuler la mise
en œuvre de ce stade nouveau de la technique: le polissage, réalisable
par une friction au cours de laquelle chaque grain de sable interposé
joue le rôle du retouchoir.
Les scies. -
Pour terminer cette présentation de divers documents particulièrement intéressants de l'outillage en silex du Rudemont, nous avons cette fois la satisfaction de pouvoir reproduire (voir pl. X) un remarquable fragment de scie que nous a fourni la station du Rudemont. C'est de beaucoup, nous semble-t-il, le mieux caractérisé des instruments de ce genre qui ait été recueilli en Lorraine. Nous re-produisons en parallèle un instrument analogue provenant d'une station lacustre, en insistant sur ce fait que le dessin, exécuté d'après une médiocre photogravure, exagère forte-ment, du fait de cette médiocrité, la régularité de la taille, qui en réalité se rapproche nettement de celle de notre outil.
Armatures de faucilles. -
Nous croyons pouvoir attribuer à un élément d'armature de faucille le fragment de lame représenté ci-contre en grandeur naturelle. Cette lame, d'un travail fort habile, a subi une minutieuse préparation préalable sur le nucleus, mais ne porte aucune retouche marginale intentionnelle : elle a été profilée dans la double recherche d'un dos propice à l'enchâssement et d'un tranchant très incisif, à l'instar des armatures livrées par les palafittes.
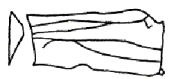
Fig. 9. - Armature de faucille en silex, du Rudemont
Il nous faut encore
attirer l'attention sur un énigmatique instrument reproduit sur
notre pl. IX (le troisième en haut à
compter de la gauche), et dont la pointe, retouchée sur les deux
faces avec une extraordinaire perfection, a subi un gauchissement intentionnel
(non perceptible sur la photo-gravure) qui en recourbe l'extrémité
de 4 mm. 1/2 par rap-port au plan sur lequel repose l'outil.
Le néolithique de Picardie nous a livré un instrument de
facture analogue : il s'agit donc bien là d'outils nettement spécialisés,
dont la destination reste à établir.
Indications fournies par la nature minéralogique des roches utilisées.
- Nous avions, au cours de la rédaction du présent travail,
expressément appelé de nos vœux " le minéralogiste
patient et expérimenté qui voudrait affronter le travail,
si important pour notre préhistoire, de la détermination
méthodique de toutes les roches employées à la confection
de l'outillage préhistorique en Lorraine, et parallèle-ment
du repérage des gîtes originels desdites roches ", quand
nous avons eu la bonne fortune de distinguer, dans l'important ensemble
bibliographique que nous avons constitué, un travail du docteur
Bleicher. modestement intitulé Contribution à l'étude:
1° de la céramique préromaine; 2° des matières
premières utilisées par les populations anciennes de l'Alsace,
de la Lorraine, du Nord de l'Afrique, imprimé à Colmar chez
Vve Decker, en 1888, sous les auspices de la Société d'histoire
naturelle de Colmar (Bulletin 1886-1888). Ce très important ouvrage
fait suite expressément à la 4e publication des Matériaux
pour une étude préhistorique de l'Alsace (qui ont paru dans
les mêmes conditions de 1877 à 1885) et il est inconcevable
qu'au contraire de ces derniers il ait échappé au comte
Beaupré lorsqu'il rédigea la Biblio-graphie préhistorique
de M. Bleicher, à la fin de la nécrologie de ce dernier
(in: Bulletin mensuel [juin 1901] de la Société d'archéologie
lorraine, de Nancy; pages 139-144). Il a pareillement échappé
aux répertoires bibliographiques de préhistoire lorraine
de Barthélémy (1889) et de Beaupré (1902), accompagnant
leurs importants ouvrages souvent cités au cours de notre travail.
Félix culpa! puisqu'elle nous permet de rendre, nous aussi, hommage
à notre illustre devancier en restituant ci-dessous à la
préhistoire lorraine le fruit méconnu de recherches d'une
capitale importance:
" Le silex du muschelkalk de nos régions est souvent de couleur
foncée grise noirâtre, quelquefois noire. il peut, grâce
à la matière organique qu'il contient toujours, prendre
diverses teintes, la violette par exemple, mais il devient rare-ment blanc.
Cette couleur se manifeste quelquefois par des taches sur un fond plus
sombre (Weyer) [pages 52-53];
" Le bathonien inférieur des environs de Tout, le corallien,
partout où il affleure, peut-être même l'astartien,
fournis-sent des silex propres à la taille. Le silex du bathonien
inférieur pris en place à la Rochotte, près de Pierre-la-Treiche,
est gris passant à la couleur café au lait; exposé
à l'air il peut devenir noirâtre, mais il a une patine assez
caractéristique ferrugineuse rouge et finement grenue. Sa cassure
présente souvent des traces de fossiles marins reconnaissables
à la loupe. Comme les précédents, il convient peu
à la taille des pièces fines [page 53];
" Les silex corallo-astartiens jouent un rôle plus considérable
que les précédents en raison de leur abondance plus grande
d'une part, et de leur cassure moins sèche et plus favorable par
conséquent à la taille. S'ils sont souvent gris noirâtres
en place, leur tendance à la couleur blanche, avec zones, rubans
ou taches grises qui se manifestent par l'exposition à l'air, les
fait facilement distinguer. C'est à l'aide de ces caractères
extérieurs que nous avons reconnu leur présence en Alsace,
loin des gisements classiques des environs de Bâlle ou du Jura du
Sundgau. C'est... surtout à l'aide des caractères extérieurs
déjà connus et utilisés depuis long-temps, qu'il
est possible de reconnaître cette roche si sou-vent employée
en Lorraine pour les instruments de silex de forme variée [page
54];
" Quoique la distance kilométrique soit assez grande entre
le pied des Vosges et les premiers affleurements de la craie blanche,
et plus considérable encore pour les premiers affleurements des
silex meulières qui couronnent les collines tertiaires du bassin
de Paris, les deux sortes de silex nous sont arrivés en quantité
notable jusque vers le parallèle de Nancy, et peut-être plus
à l'Est jusque vers les premiers contreforts de la chaîne.
Fait remarquable et digne d'attirer l'attention des préhistoriciens:
ce ne sont pas, à beaucoup près, les silex crétacés
qui sont les plus communs. De l'avis de tous ceux qui se sont occupés
de ces questions, les silex blancs ou à patine blanche fortement
cacholonnée sont les plus répandus, et leur étude
superficielle aidée de la loupe permet souvent de préciser
leur origine à l'aide de caractères positifs. Un grand nombre
des éclats, couteaux, ou même pointes de flèches de
petite taille habilement retouchées portent sur leurs faces des
sections ou empreintes de sporanges de chara... Aussi n'hésitons-nous
pas à attribuer ces silex qui se rencontrent abondamment sur le
sommet des collines des environs de Nancy à la meulière
du bassin de Paris, seule formation géologique qui puisse les fournir...
Ces caractères facilement saisissables sont meilleurs que ceux
que l'on peut tirer de l'observation microscopique, qui ne donne ici aucun
résultat, le magma calcédonieux n'ayant rien qui permette
de le reconnaître. On peut ainsi distinguer ces silex de ceux du
corallien avec lesquels ils ont une certaine analogie par leur patine
blanche, et de ceux de la craie qui ne présentent jamais de ces
fossiles végétaux; mais qui n'ont que rarement une patine
blanche uniformément répandue sur toute la pièce,
et n'ont guère non plus les zones alternativement claires et foncées
que l'on distingue souvent sur les silex coralliens.
C'est donc surtout
par élimination des autres silex que l'on peut arriver à
déterminer les silex de la craie au moins pour les pièces
de couleur claire grise ou blanchâtre. Pour celles qui ont une couleur
de miel jaunâtre ou brun jaunâtre, tout porte à croire
qu'elles sont bien attribuables à la craie blanche, sans qu'il
nous ait paru nécessaire d'en faire une étude microscopique.
En résumé on peut affirmer pour la Lorraine: que le silex
du bassin de Paris n'a pas franchi le versant lorrain des Vosges sous
la forme d'objets taillés par la main de l'homme; que les populations
primitives de l'âge de la pierre pris en bloc, ont générale-ment
préféré le silex des meulières du bassin de
Paris à toute autre roche, même au silex de la craie; qu'elles
ne se sont que très peu servi des ressources propres de nos régions
en silex. En Alsace, c'est surtout au silex local du muschelkalk qu'elles
se sont adressées, tout en se servant relativement souvent des
silex coralliens du jurassique supérieur des environs de Bâle
ou de Ferrette, des régions du midi par conséquent [pages
54-56]." Pour tirer plein parti de la si importante étude
de ce maître incontestable de la préhistoire lorraine, nous
lui emprunterons encore, à toutes fins utiles, les deux considérations
que voici:
" Le silex du grès rouge permien, plus répandu sur
le versant lorrain que sur le versant alsacien des Vosges, a été
certainement utilisé pour la fabrication de certains instruments,
mais on peut affirmer que ceux-ci sont extrêmement rares. Les affleurements
des environs de Saint-Dié ont dû être abordables de
tout temps, et d'ailleurs les alluvions anciennes des Vosges en ont disséminé
de nombreux rognons sous la forme de cailloux roulés au loin, puisque
nous les retrouvons jusque vers le parallèle de Commercy. Ce silex
se taille facilement, et sa structure cireuse à la cassure, sa
couleur souvent rougeâtre, peuvent servir à le faire reconnaître
[page 52]; il existe dans les carrières du calcaire à Melania
Laurae des environs de Mulhouse, et particulière-ment à
Riedisheim, des bancs avec lentilles de silex noir... quoique ce silex
soit en définitive peu abondant, et qu'il ait été
selon toute probabilité peu abordable aux populations primitives,
il doit être signalé comme ayant pu être utilisé
par elles. C'est une roche noire ou noire brunâtre, à cassure
ingrate au point de vue de la taille, et jusqu'ici aucun silex taillé
n'a pu être rapporté avec certitude à cette sorte
de gisement [page 56] ".
Voici, de la même source, quelques indications concernant les haches
polies de Lorraine:
" L'étude pétrographique de sept échantillons
de hachettes de pierre polie d'origine lorraine... prouve que la serpentine
sous toutes ses formes et avec toutes ses variétés a été
largement employée pour ces sortes d'instruments. Sur ces sept
échantillons, six appartiennent à cette roche, facile à
reconnaître en coupe microscopique; l'un d'eux... nous avait été
donné comme jadéite; c'est de la serpentine pure... deux
échantillons sont riches en grenats microscopiques, deux autres
sont de la serpentine avec bastite. Peut-on en conclure que ces différentes
hachettes provenaient de localités différentes? Nous l'ignorons,
mais le fait est à signaler. Enfin une des coupes appartient évidemment
à la roche appelée fibrolite, d'origine non vosgienne par
conséquent " [page 60]
Etudiant par ailleurs la nature minéralogique des haches en silex
du Rudemont, Beaupré nous a livré cette intéressante
observation: " les bithinelles sont très apparentes, de même
que les carats [lisez: charas]; c'est du silex d'eau douce, du silex tertiaire
lacustre de la Champagne ". BEAU-PRE, Note sur le Rud-Mont, in Bulletin
1901 de la Société d'Archéologie lorraine, p. 125.
De son côté, F. Barthélémy établissait
ainsi les " espèces minéralogiques des matières
premières employées (pierre taillée), par ordre de
préférence": 1° silex de la meulière de
la Brie; 2° silex de la craie de Champagne; 3° silex du Corallien
(Meuse); 4° silex du Bajocien (origine locale); silex du Muschelkalk
(origine locale).
D'autre part, " d'après un chiffre de plus de trois cents
haches lorraines ", il concluait que " par ordre de fréquence,
les haches polies lorraines sont: 1° le plus grand nombre en trapp
et grauwacke des Vosges, dont il existe un gisement étendu aux
environs de Raon-1'Etape; 2° en silex: I°, du Corallien de la
Meuse; II°, du tertiaire parisien; III°, du crétacé
de Champagne; IV0 du Bajocien; 3° en serpentine des Vosges; 4°
en serpentine verte ou noirâtre, probablement des Alpes; 5°
en schiste silicifié passant à la lydienne (Vosges); 6°
en roches dioritiques, probablement des Vosges; 7" en euphotide (Alpes);
une seule en jadéite " (39) .
Les deux documents se référant aux haches polies et d'autre
matière que le silex, qu'il nous a été donné
de recueillir sur le Rudemont, sont donc à ranger dans la 5e catégorie
établie par Barthélémy. Nous devons à M. L.
Guillaume, agrégé de la Faculté de Strasbourg, attaché
au service de la Carte géologique, la détermination de ces
phtanites, ainsi que celle des autres roches dures utilisées sur
la station concurremment avec le silex et les quartzites.
La céramique ; l'os. - En dépit de tous nos soins, nous
n'avons pu découvrir sur le Rudemont qu'un fragment de poterie
susceptible d'être attribué à la préhistoire
; il s'agit d'un tesson triangulaire d'un peu plus de 3 cm. de côté,
de 5 mm. d'épaisseur environ, de couleur gris clair et portant
de nombreuses mouchetures blanches dues vraisemblable-ment à ces
particules de nacre que recèle la terre des berges de rivière,
et déjà observées sur les fragments de poterie recueillis
par nous parmi le maigre mobilier qui accompagnait les restes de l'homme
néolithique de Novéant.
Il nous faut préciser ici que les prospections les plus attentives
n'ont jamais jusqu'à ce jour permis de découvrir au Rudemont
la moindre sépulture. On sait que la trouvaille d'assez nombreux
instruments calcinés de silex nous incite à croire à
des pratiques rituelles d'incinération : outre de nombreux morceaux
amorphes, nous avons recueilli sur le Rudemont les fragments calcinés
de six grattoirs, quatre pointes de flèches, trois haches polies,
deux pointes de javelots, deux pointes de lances, un couteau et un perçoir.
Il n'a rien été découvert, d'autre part, qui puisse
être tenu pour un vestige incontestable d'habitation. Toutefois,
fouillé dans l'automne 1935 jusqu'au sol non remanié, un
pierrier régulier de deux mètres de diamètre sur
quelque 70 centimètres de hauteur moyenne a livré à
René Thiriot, sur un grossier dallage de pierres brutes, deux éclats
de silex et douze fragments d'une poterie grossière, noire à
l'intérieur, rougeâtre extérieurement, et pailletée
de particules nacrées.
Nous avons également recueilli sur la station une courte (35 mm.)
et robuste esquille d'os long de bovidé, en biseau, dont l'aspect
général et l'état de pré-fossilisation semblent
permettre l'attribution aux temps préhistoriques. On sait d'ailleurs
combien mal se trouvent remplies, au Rudemont, les conditions de conservation
des documents osseux.
|
(23) : (retour) |
Divers auteurs ont cru devoir
conserver l'orthographe Rud-Mont que rien ne justifie, et que
les travaux de la topographie française postérieurs
à 1918 ont eux-mêmes abandonnée. Quoi qu 'il
en pût être d'une étymologie toujours sujette
à discussion, indiquons ici que la forme la plus ancienne
que nous eussions rencontrée au cours de nos recherches
sur le village de Novéant, berceau de notre lignée
maternelle, est " Ruttemont ", conformément à
la prononciation lorraine. |
|
BEAUPRE. Et. préh., pp. 24-25. - Nous faisons observer que les chiffres relativement restreints atteints par les trouvailles de M. Léger s'expliquent par le fait qu'il s'agit d'une véritable sélection où ne sont entrés en ligne de compte, à l'exclusion de tous éclats de taille, fragments amorphes et peut-être outils atypiques ou indéterminés, que des instruments parfaitement entiers ou en fragments très importants (haches). |
|
| (25)
: (retour) |
Bien que nos trouvailles
personnelles ne forment pas la totalité de ce que le Rudemont
a livré en pointes de flèches, elles constituent
de beaucoup la plus importante collecte qui en ait été
faite. Selon toutes probabilités, la proportion réelle
des types morphologiques utilisés se trouvera donc fidèlement
exprimée par les chiffres que nous publions. |
| (26)
: (retour) |
Robert MUNRO, Les stations lacustres d'Europe (Paris. Schleicher, 1908; traduct. du Dr Paul Rodet) ; cf. fig. 4, n° 28. Dans le même ouvrage, voir à la fig. 15bis, les nos 5 et 6, recueillis dans le lac d'Annecy, sur la station de Port, dont les prospections méthodiques "démontrèrent qu'elle datait de l'âge de la Pierre, mais qu'elle avait subsisté pendant l'âge du Bronze". |
| (27)
: (retour) |
J. Beaupré,
après avoir fait observer que " les haches en silex
sont plutôt rares dans nos collections locales ", avait
cru devoir écrire que " la moyenne, prise sur l'ensemble
des haches figurant aux Musées de Nancy et de Metz, semble
être de 10 % environ" (BEAUPRE, De l'emploi des roches
cristallines aux temps préhistoriques, in Journal de la
Société d'archéologie lorraine, 1900. pp.
5-8). |
| (28)
: (retour) |
Il nous faut
prendre à 26 kilomètres à l'aval du Rudemont
un exemple mosellan de travail du bois de cerf par la pierre taillée,
puisque aussi bien l'exposition de la station, la nature calcaire
du sol, les conditions de vie " en surface " des occupants,
propices à la consomption des matières osseuses ou
cornées, n'en ont laissé aucun vestige subsister jusqu'à
nous. C'est à Hauconcourt qu'en 1930, au cours de travaux
tangents au cours actuel de la Moselle et intéressant les
dépôts fluviaux, à une profondeur que nous n'avons
pu déterminer, fut mis à jour un bois de Cervus elaphus
entré en notre possession. Selon toute apparence, le sciage
grossier qu'il a subi, à l'aide d'un instrument de pierre,
avait pour but de détacher du " merrain ", sous
les andouillers terminaux, un " manchon " propre à
l'enchâssement d'une hachette du type de celle que le Rudemont
nous a livrée. |
| (29)
: (retour) |
BEAUPRE, Et. préh., pl. Ibis. |
| (30)
: (retour) |
Plusieurs lots d'instruments offerts au Musée de Metz en 1903, par M. Léger, y ont été retrouvés naguère dans un tiroir ; malheureusement ce ne sont que grattoirs, racloirs et surtout très nombreux éclats amorphes - mais il s'y trouvait aussi le remarquable perçoir que nous avons tenu à reproduire (voir fig. 8). |
| (31)
: (retour) |
Celle de M. Jean Thiriot, architecte du Bureau d'études municipal de Metz, secrétaire du Groupement des artistes mosellans - que nous remercions ici en lui exprimant notre vive reconnaissance. |
| (32)
: (retour) |
G. et A. DE MORTILLET, Musée Préhistorique (Paris, Schleicher, 2e édit., 1903). |
| (33)
: (retour) |
Cf.
DECHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, t.
I, p. 515. |
| (34)
: (retour |
Voir de Mortillet, op. cit., fig. 568 (original au Musée de Saint-Germain). |
| (35)
: (retour |
Op. cit., pp. 33 = 39. |
| (36)
: (retour |
Op. cit., pp. 34 = 40. |
| (37)
: (retour |
L'Homme des Cités lacustres, précis d'archéologie préhistorique, par Georges GOURY (Paris, Picard, 1932), p. 264. |
| (38)
: (retour |
Op. cit., pp. 26-27 = 32-33, |
| (39)
: (retour |
BARTHÉLÉMY, op. cit., pp. 69, 83-84. |
Dans l'avant-propos qui soumettait au public nos recherches de 1904-1926, nous avions cru devoir formuler " une indication de portée pratique et d'une importance primordiale " qui nous semble avoir conservé et même accru son caractère d'opportunité.
" Le système de division de la France - écrivions-nous
- en bassins fluviaux, imaginé en 1752 par le géographe
Buache... nous semble offrir des avantages tout particuliers, appliqué
aux travaux de la préhistoire.
" Quoi qu'il en soit de l'avis des géographes - qui se meuvent
du reste sur un plan différent du nôtre et pour-suivent d'autres
objectifs - il est certain que cette conception du bassin appliquée
à la préhistoire, au moins dans nos régions de l'Est
français, serait grosse de résultats positifs, fût-elle
arbitraire par ailleurs.
" Pratiquement, les trouvailles préhistoriques semblent chez
nous ne devoir guère concerner que l'époque néolithique,
dont les vestiges se retrouvent surtout dans les stations de surface.
- Or - quoi qu'il en puisse être des variations connues du cours
de la Moselle - les grandes lignes de l'hydrographie de nos contrées
n'ont pas varié depuis cette époque; en nul temps autant
qu'en ces temps lointains les cours d'eau n'ont mérité leur
appellation de " chemins qui marchent"; c'est surtout à
leur faveur que la pénétration des peuplades préhistoriques
s'est effectuée en notre région: qu'elles aient pratiqué
couramment une batellerie rudimentaire ou qu'elles se soient bornées
à demander aux eaux vives d'abondantes ressources alimentaires
et un guide sûr au sein de contrées inconnues.
" Le bassin offre donc aux chercheurs le double avantage de concentrer
leur attention vers ces abords des cours d'eau où les recherches
préhistoriques sont si fréquemment fructueuses, et surtout
de tracer à ces recherches un cadre conventionnel sans doute, mais
riche pourtant d'avantages pratiques de toute nature.
" Un groupement
de chercheurs et amateurs de préhistoire se constituant en Lorraine
sur la base Moselle, affluents et plateaux annexes, en liaison avec les
chercheurs de Champagne et de Bourgogne, et ceux du bassin meusien de
France et de Belgique - sans omettre le contact avec les très actifs
chercheurs alsaciens, quelque spécial que soit leur domaine d'outre-Vosges
-- un tel groupement ne manquerait pas de provoquer de très rapides
progrès dans la connaissance préhistorique ".
Peut-être eût-il fallu ne se point borner à formuler
des vœux en faveur de l'éclosion d'un semblable groupement:
aussi bien est-ce surtout en préhistoire qu'il convient de ne point
faire fonds sur la génération spontanée...
Quoi qu'il en soit, nul ne s'est soucié de la révision et
de la consolidation, par investigations nouvelles et surtout publications
appropriées, des jalons si remarquablement posés par nos
grands devanciers, les Barthélemy, les Robert, les Beaupré,
dans le cadre si accueillant et si souple que nous rappelions ci-dessus:
à Vaudémont, à Tonnoy, à Autre-ville, à
Pont-à-Mousson, à Jezainville, à Villers-sous-Prény,
etc.. Et pourtant, combien se sont trouvé vérifiées
ces autres lignes de notre avant-propos: "à notre avis, entre
les admirables ouvrages plus haut cités de Barthélemy et
de Beau-pré... et la Somme de l'archéologie préhistorique
lorraine qu'entrevoyait Barthélemy et que ne pourra réaliser
qu'un savant de l'avenir, il ne saurait plus y avoir raisonnablement place,
de nos jours, que pour des monographies... Il faut que ces monographies
se multiplient. C'est seulement une suffisante floraison de semblables
travaux qui permettra de dresser un jour la probe et passionnante Histoire
de la Lorraine avant l'histoire, pierre de choix dans le monument qui
pourra être élevé à la France préhistorique,
puis à l'Europe ".
Si complexe se révèle, quand on la serre de près,
la période néolithique dans l'Est français "
véritable point de confluence de races primitives ", qu'il
apparaît présentement impossible de demander à la
Lorraine un type industriel nettement différencié, à
plus forte raison capable de recevoir application générale,
fût-ce seulement dans un cadre limité à l'Ouest européen.
Si nous maintenons à la station du Rudemont la qualité que
nous lui avons attribuée dans nos précédents travaux,
de " station-type de l'époque
néolithique ", c'est en raison de l'incontestable homogénéité
économique - pourrait-on dire - des vestiges industriels qu'il
nous a livré au cours de recherches qui s'inscrivent maintenant
entre les dates extrêmes de 1904 et 1935, vestiges qui nous sont
témoins et garants de ce que nous pourrions aussi bien dénommer
l' " homogénéité " dans le cadre considéré,
d'un stade de civilisation donné. Mais nous réservons expressément
aux travailleurs de l'avenir toute décision de portée générale.
Le Rudemont, pour nous, est une station-type - et, en vérité,
l'on ne voit pas bien comment on pourrait lui marchander cette étiquette!
- mais ce n'est point la station-type, à prétentions à
l'éponymie d'une époque industrielle (40).
Dès aujourd'hui, en effet, nous avons lieu de croire qu'il faudrait
au moins provisoirement, envisager l'existence d'un stade mosellan du
Néolithique, comportant divers facies industriels contemporains,
dont les diversités mêmes s'expliquent par la diversité
des matériaux offerts à l'industrie des hommes, à
une époque où semble s'opérer une stabilisation des
peuplades.
Cette stabilisation opérée ou en voie de réalisation,
rien n'a dû plus vite évoluer vers des différenciations
locales qu'une industrie où l'habileté et le génie
individuels d'une part, les ressources du milieu d'autre part ont un retentissement
si direct sur les produits ouvrés.
La station du Schirmerter de Kirchnaumen. - Dans le cours de 1928, il
nous était donné d'apprendre par notre jeune disciple et
collaborateur René Thiriot quelle importante quantité de
haches polies était en possession de l'ancien instituteur de Kirchnaumen,
M. Mouth. Déjà une visite à ce dernier et au lieu
éventuel des prospections était mise au point, lorsque la
publication des haches de M. Mouth (41) nous
signifia que l'heure était passée de porter nos investigations
dans ces parages. Mais cette publication même nous apprenait qu'il
ne s'agissait pas d'une trouvaille comparable, on plus important, à
celle de Longeville-lès-Metz: les vingt-quatre haches de Kirchnaumen
étaient le produit de l' " écrémage " d'une
station. Celle-ci, située au lieudit " Schirmerter ",
se trouvant placée dans l'arrondissement de Thionville, nous nous
en entretînmes dès la plus prochaine séance de la
Société d'histoire naturelle de la Moselle avec notre distingué
collègue M. H. Guyot, inspecteur des Eaux et Forêts, chef
du groupe forestier de Thionville et qui, comme tel, a l'administration
de la région intéressée. Déplorant la récolte
exclusive, par des amateurs insuffisamment informés, d'instruments
particulièrement caractérisés - ici haches polies,
là pointes de flèches - nous montrions comment cette sélection
offrait l'inconvénient d'engendrer le déséquilibre
des proportions numériques et relations d'emploi dos diverses pièces
de l'outillage d'une station donnée, et de vouer à l'oubli
des documents non moins caractéristiques aux yeux du préhistorien,
mais qui n'avaient pas l'heur d'être des haches polies.
Observateur avisé autant que bienveillant collègue, M. Guyot
nous faisait part quelques semaines plus tard des précisions qu'il
avait pu recueillir. La station du Schirmerter se trouve à quelque
50 km. N.-N.-E. du Rudemont, à moins de 6 km. à vol d'oiseau
du cours de la Moselle, sur remplacement d'une forêt défrichée
vers 1840, entre la commune de Ritzing et les hameaux d'Obernaumen et
d'Ewendorf, qui dépendent de la commune de Kirchnaumen. La plupart
des haches en possession de M. Mouth avaient été recueillies
et remises à ce dernier par le berger d'Ewendorf.
Par leurs occupations et surtout leurs loisirs forcés, qu'engendrent
colles-ci, les bergers peuvent être, en préhistoire, de remarquables
collaborateurs; il était toutefois un peu tard pour entreprendre
l'initiation de celui d'Ewendorf. M. Guyot eut la complaisance de déterminer
personnellement l'emplacement de la station proprement dite; il eut celle
plus grande encore de styler les gardes forestiers dont, de longue date,
il a su faire de précieux auxiliaires des sciences naturelles:
deux mois ne s'étaient pas écoulés que M. Guyot nous
remettait un lot intéressant de documents recueillis sur ses indications
et comportant: trois broyons et deux nucleus en quartzite; deux fragments
de meules ou polissoirs en grès et quartzite; un petit grattoir
en silex, très caractérisé, et deux fragments atypiques
de silex; une hachette polie à talon " bouchardé "
destinée à l'emmanchement, le talon d'une hache brisée
et la partie antérieure, avec tranchant intact, de trois haches
brisées, dont l'une en roche éruptive.
Ultérieurement, M. Guyot nous présentait un important "
couteau " en silex, mais dont le garde qui l'avait trouvé
se réservait la propriété.
Deux choses nous ont frappé, à l'examen de ces documents:
d'une part la parenté manifestée entre l'outillage du Rudemont
et celui du Schirmerter par les broyons et nucléus de quartzite,
par les fragments de meules ou de polissoirs, par la hachette " piquetée
" et par le grattoir en silex - d'autre part l'inversion que cette
collecte forcément hâtive accuse pourtant, dès l'abord,
entre les proportions respectives des instruments en roches dures et en
silex, selon qu'ils proviennent du Rudcmont ou du Schirmerter. Ici prépondérance
du silex mais emploi concomitant, quoique rare, de roches dures; là
prépondérance des roches dures mais emploi concomitant,
quoique rare, du silex; dans les deux cas, emploi sensiblement aussi considérable,
à proportion, des quartzites et des grès de provenance régionale.
Nous avons eu, depuis, la possibilité d'accroître notre documentation
sur la station du Schirmerter de Kirchnaumen (42).
Malheureusement, l'excessive réduction de l'échelle des
documents figurés et l'imperfection des photographies effectuées
font que ce nouvel élément d'information n'est que d'un
faible secours pour une totale comparaison morphologique, et l'auteur,
prématurément hanté du désir de voir clair
parmi les influences des " cinq groupes ethniques " qu'il lui
plaît discerner en Lorraine, afflige l'évocation où
nous cherchons à le suivre d'une terminologie en Bandkeramiker,
Stichkeramiker et autres Glockenbecherstufe qui hérisse le problème
sans le simplifier pour autant (43).
Retenons pourtant - et accueillons comme une confirmation de nos vues
personnelles - la description et la figure d'un intéressant fragment
d'un polissoir en grès portant un long segment d'une indéniable
cuvette de polissage, assez étroite et de médiocre profondeur;
la reproduction de haches polies " presque à facettes ",
" avec facette sur chaque bord " ou à " facettes
des 2 côtés ", qui sont ce que nous appelons plus haut
des haches à section ovale équarrie; l'énumération
de onze " éclats de silex " dont l'un " ressemble
à une pointe de flèche " amygdaloïde fracturée
dont la base seule subsisterait.
En espérant une monographie du Schirmerter de Kirchnaumen, dotée
de toutes les précisions désirables et, avant tout, nourrie
des prospections inlassablement répétées à
quoi rien ne saurait suppléer, nous noterons dès aujourd'hui
que tout semble se passer comme si une complète identité
d'industrie et une simultanéité indéniable avaient
existé entra les trois stations néolithiques mosellanes
- nous voulons dire : appartenant au bassin de la Moselle - les plus connues
à ce jour et qui sont, avec le Rudemont, la station de Vaudémont,
étudiée par Beaupré, et celle du Schirmerter, présentée
par Linckenheld (44).
La station de Vaudémont. - La station de Vaudémont
- qui tire son nom du village dont elle occupe les confins - occupe, à
quelque 70 kilomètres au sud du Rudemont, l'extrémité
méridionale d'un plateau escarpé dont l'extrémité
septentrionale porte le village et la station de Sion. Le plateau de Sion-Vaudémont
a depuis longtemps retenu l'attention des archéologues, puisque
dès 1756 le célèbre dom Calmot (45)
remarquait, déjà à l'article intitulé Vaudémont
et Sion: " On montre chez les Pères Tiercelins des bouts de
lances et de javelots, des haches et des moules de ces haches, le tout
en bronze ", et cette notice concerne de toute probabilité
des trouvailles faites sur le plateau. F. Barthélemy
(46) notait en 1889: " Sur le plateau
(altitude 549 mètres) qui relie Sion à Vaudémont,
M. R. Guérin a fait une ample récolte de pointes de flèches
et autres silex taillés et polis, dont une hache polie en trapp
(collection R. Guérin). D'autres chercheurs ont recueilli différents
objets de l'âge de la pierre sur le même point. "
Toutefois, la station de Vaudémont n'a jamais suscité ni
les recherches persévérantes et méthodiques, ni surtout
les publications détaillées sur lesquelles il eût
été possible de fonder "pré historiquement"
cette fois la notoriété en laquelle sont tenus ces lieux:
il s'agit en effet de la Colline inspirée de Maurice Barrès.
La station est désavantagée, d'ailleurs, par son éloignement
des cours d'eau: les deux affluents de la rive gauche de la Moselle qui
l'encadrent topographiquement en coulent, à vol d'oiseau, le Brenon
à 3 kilomètres à l'Ouest, le Madon à 8 kilomètres
et demi à l'Est. Il est vrai cependant que d'insignifiants sous-affluents
de ces deux cours d'eau prennent naissance à quelque 1.300-2.000
mètres de la station.
La station de Vaudémont n'a inspiré en tout cas, à
propre-ment parler, aucune monographie. La plus importante étude
en laquelle elle se trouve individualisée a pour effet surtout
de montrer la variété, l'intensité et l'étendue
de la vie qui eut pour théâtre à diverses époques
l'ensemble topographique auquel elle appartient (47).
En définitive, Beaupré ne s'est pas particulièrement
montré enthousiasmé par la station de Vaudémont:
le Rudemont "lui en imposait manifestement davantage, en raison des
trouvailles qu'il y avait faites: " Ces trouvailles - écrivions-nous
en 1926 (48) - avaient donné
la station en si haute estime au savant préhistorien nancéien,
qu'il consacra deux planches hors texte de son ouvrage à reproduire
la collection d'outils en silex qu'il y avait formée "; dans
le même ouvrage, (Etudes préhistoriques en Lorraine de 1889
à 1902) Beaupré accordait une planche unique à la
station de Vaudémont. Par ailleurs, voici les trois lignes qu'il
y consacre à ses trouvailles de Vaudémont, après
avoir décrit le vallum qu'il y a découvert: " Entre
ce remblai et le village, les silex abondent, surtout vers le vallum;
nous y avons recueilli des flèches en silex, des fragments de haches
polies, etc.." (49). Préhistorien
averti, Beaupré prit soin d'individualiser, on l'a vu, la station
de Vaudémont, qu'il a circonscrite à la portion du plateau
qui s'étend entre le village et le retranchement préhistorique
identifié par lui. Ceci posé,, voici - à des fins
qui apparaîtront ultérieurement - la reproduction de deux
des articles du tableau qui, dans ses Etudes préhistoriques, précède
immédiatement les planches phototypiques I et Ibis (Rudemont) et
II (Vaudémont). Ce tableau, dit Beaupré, " a été
dressé d'après les observations de quelques-uns de mes confrères
et collaborateurs, et les miennes ", et c'est lui seul qui révèle
le détail des trouvailles de l'auteur:
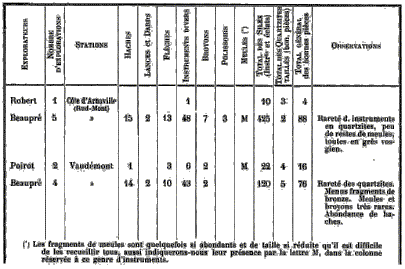
Il est digne de remarque
que, les explorations prises en considération par Beaupré
s'équilibrant par ailleurs (6 et 6), l'analyse des documents recueillis
fait ressortir un égal équilibre: quinze haches au Rudemont,
autant à Vaudémont; deux lances ou dards au Rudemont, autant
à Vaudémont ; treize flèches au Rudemont, autant
à Vaudémont; quarante-neuf instruments divers au Rudemont,
autant à Vaudémont, enfin, au total général
des bonnes pièces, quatre-vingt douze au Rudemont et autant à
Vaudémont.
Toutefois, le Rudemont l'emporte par sept broyons contre quatre à
Vaudémont, par quatre cent trente-cinq instruments et éclats
de silex contre cent quarante-quatre à Vaudémont - tandis
que Vaudémont l'emporte, en quartzites taillés, dans la
statistique de Beaupré, par neuf contre cinq au Rudemont.
Il importe enfin de faire ressortir que Beaupré a découvert
et signalé, sur la station même de Vaudémont, et non
plus seulement sur une station voisine, de menus fragments de bronze,
qui mettent l'accent sur l'importance exceptionnelle en Lorraine de cette
région du Saintois, à l'âge dit du bronze.
Il nous faut retenir que les témoignages à peu près
exclusivement sporadiques du passage en Lorraine d'un courant de la civilisation
du bronze se sont laissé toutefois découvrir avec une sorte
de constance sur les stations néolithiques, notamment du Schirmerter
et 'de Vaudémont (50).
De toutes, celle du Rudemont s'est montrée la moins catégorique,
puis-qu'elle n'a livré que la pointe de flèche en bronze,
à soie, longue de 58 mm, figurée par Beaupré
(51) et visible au musée de Metz, tandis
que Vaudémont, outre les trouvailles insuffisamment " situées
" par dom Calmet et les découvertes connexes de Gugney-sous-Vaudémont,
a donné, avec les " menus fragments de bronze " de Beaupré,
des présomptions d'occupation autrement recevables que la pointe
esseulée d'un engin de chasse ou de combat essentiellement susceptible
d'être perdu en cours d'action; tandis que le Schirmerter de Kirchnaumen
a livré - outre un lingot de bronze (ou bavure de coulée?)
à nous remis par M. Guyot, les documents suivants signalés
par E. Linckenheld (52): un
"moule pour couler des haches à ailerons " en "
terre cuite rouge-brun " et " le fragment d'une meule de la
forme dite chapeau de Napoléon ...en lave basaltique probablement
de Niedermen-dingen (Eifel) ".
En conclusion de la présentation que nous venons d'assurer de la
station de Vaudémont, nous ne saurions mieux faire que de reprendre
les données de la conclusion que nous avons formulée à
la présentation du Schirmerter de Kirchnaumen: tout bien considéré,
tant au Rudemont qu'au Schirmerter et à Vaudémont, tout
se passe comme si nous étions en présence des vestiges d'un
seul et même stade mosellan du Néolithique à faciès
industriels divers, mais dont la diversité doit s'expliquer par
la diversité même des matériaux offerts à l'industrie
des hommes et par des différenciations de genres d'existence conditionnées
par les ressources du milieu. Hé quoi: les constructeurs des cités
lacustres d'époque néolithique, contemporains de nos stations
terrestres, ne nous en ont-ils pas fait voir bien d'autres ?
Il est de toute évidence que les Néolithiques du Rudemont,
sur leur station directement enserrée par trois cours d'eau poissonneux
- la Moselle, le Rupt-de-Mad et la Gorzie - n'ont pas manqué de
se spécialiser dans des pratiques de capture, d'alimentation certainement,
de transport et d'habillement sans doute - et d'ornement, comme semblent
en témoigner les nombreux fragments de nacre d'unio recueillis
sur la station - fort différentes de celles à quoi étaient
contraints des contemporains isolés sur un plateau éloigné
des rivières comme l'est la Colline inspirée.
Nous n'en pensons pas moins que la nature des matériaux offerts
à l'activité de tels contemporains a joué le rôle
pré-pondérant dans la différenciation de leurs industries
respectives. Ce n'est pas sans satisfaction que nous observons que Vaudémont
rejoint le Schirmerter de Kirchnaumen dans l'inversion - par rapport au
Rudemont - de la proportion des outils en roches dures par rapport au
silex.
Nous croyons pouvoir expliquer - sans recours à l'intervention
non démontrée de " courants de civilisation "
- la prépondérance d'une industrie du silex au Rudemont
par la facilité relative des communications avec les régions
silicifères de la Meuse et de Champagne (53).
Au lieu que la Moselle, par sa vallée méridionale - ceci
concerne Vaudémont - établit des communications directes
avec la chaîne des Vosges et que sa vallée septentrionale
ouvre, en dessous de Trèves, à la région do Kirchaumen
l'accès de l'Eifel et du Hunsriïck. Ce sont trois gîtes
originels de nombre de roches dures utilisées par les Néolithiques
de Vaudémont et du Schirmerter - trois gîtes originels des
phtanites, andésites, basaltes, etc., dont les Néolithiques
du Rudemont, aussi bien, ont tiré la demi-douzaine d'instruments
ou nucléus recueillis et figurés par nous.
| (40)
: (retour) |
Beaupré, dans sa Note sur le Rud-Mont, disait du Rude-mont : " Il peut servir de station typique pour les établissements humains de cette époque situés en aval du confluent de la Moselle et de la Meurthe " (p. 123). |
| (41)
: (retour) |
Cf. E. LINCKENHELD, Vingt-quatre haches néolithiques de Kirchnaumen, in " Bulletin de la Société préhistorique française ", janvier 1929, pp. 90-96. |
| (42)
: (retour) |
Cf. E. LINCKENHELD, La station néolithique du "Schirmer-ter " près de Kirchnaumen, in " Bulletin do la Société préhistorique française ", novembre 1932, pp. 502-517. |
| (43)
: (retour) |
C 'est toutefois avec un vif intérêt que nous apprenons que cette " Glockenbecherstufe >> de K. Schumacher, désigne " une civilisation et un peuple qui, venu d'Espagne et de l'Ouest de la France, s'est propagé jusqu'en Hongrie". Op. cit., p. 503. |
| (44)
: (retour |
M. Paul Dubuisson, dans la séance du 23 juin 1902 de la Société préhistorique française, a signalé avoir trouvé " de beaux quartzites taillés, en contact avec de beaux silex taillés et retouchés... dans la nappe alluviale de la ferme Saint-Jacques, située sur le plateau de Haye (près de Nancy) ". L'étude approfondie de cette station ne manquera pas de contribuer à la connaissance de l'industrie mixte du silex et des quartzites, que nous croyons caractériser un faciès du néolithique " mosellan ", sans qu'il fût besoin d'invoquer une intervention des " Campigniens en Lorraine ". |
| (45)
: (retour |
Notice de la Lorraine, Nancy, Beaurain, 1756, t. II, p. 732. |
| (46)
: (retour |
BARTHÉLÉMY, Op. cit., p. 299. |
| (47)
: (retour |
J. BEAUPRE, Les stations de l'époque
de la pierre sur la côte de Sion-Vaudémont, in Journal
1897 de la Société <1 'archéologie lorraine,
Nancy; pp. 187-189. On verra qu'une certaine hardiesse est nécessaire
pour dégager un " type " industriel et une époque
tranchée du "complexe" humain que révèle
ce site: La côte de Sion est un des points les plus riches de la Lorraine en vestiges de l'Epoque de la Pierre. La principale station se trouve à l'extrémité septentrionale du, plateau (A. 495 m.) sur l'emplacement de la Semita gallo-romaine, occupé actuellement par l'église de Notre-Dame de Sion et ses dépendances. Cet endroit a été habité de tout temps; aussi, les conditions de conservation des objets y sont des plus défavorables, et il a fallu que ce gisement fût bien riche pour que de nos jours on y ramasse encore des haches polies et des instruments de silex, associés à des débris de tous les âges... ...une petite station, qui nous a donné deux pointes de flèches et quelques éclats de silex, à 150 mètres au Nord du point coté (A. 493) au bord de l'escarpement dominant le village de Praye... ...une autre plus importante, si l'on en juge par le nombre des éclats, était située au-dessus du village de Sion... à droite du chemin de Sion à Vaudémont, entre le chiffre 4 de la cote 493 et le sommet de la lettre S du mot Saxon... ...Le point 545, exploré par B. Guérin, lui a donné jadis des haches polies et des pointes de flèches: il est actuellement recouvert de gazon et de mousse, les recherches y sont devenues impossibles, mais l'emplacement d'une petite station assez riche (pointes de flèches et éclats) se trouve le long du chemin, à gauche en regardant vers Vaudémont... ...En continuant vers Vaudémont, on aperçoit un remblai, élevé de 2 à 3 mètres; il coupe en ligne droite le plateau, suivant une direction Nord-Sud, et se trouve à 300 mètres environ à l'Ouest du point 545. C'est sans doute un ancien retranchement, au delà duquel les éclats de silex abondent principalement sur la crête, depuis le bord de l'escarpement, au-dessus de They, jusqu'au milieu du plateau, c'est-à-dire sur toute sa partie méridionale. Nous y avons recueilli deux haches polies brisées, des pointes de flèches et un grand nombre d'éclats de silex taillés... ...La partie septentrionale du plateau nous a paru moins riche; néanmoins, notre confrère M. Marts y a ramassé une belle hache en pierre polie, à gauche du chemin de Sion à Vaudémont, avant d'arriver au village... Par la suite, Beaupré revint brièvement sur la station de Vaudémont au cours de ses Etudes préhistoriques - et cette dernière référence est appelée, comme on le verra, à jouer un rôle important. Enfin, la région continua de retenir son attention et. en 1909, Beaupré publiait Une enceinte de l'âge du bronze: Gugney-sous-Vaudémont (in Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, Nancy, pp. 427-446). Gugney n'est sis qu'à 2.400 m. S.-O. de Vaudémont. |
| (48)
: (retour |
Op. cit., p. 14 = 20. |
| (49)
: (retour |
BEAUPRE. Op. cit., p. 78, pl. II |
| (50)
: (retour |
Au reste, il en a été de même au camp de Chassey, avec lequel nous avons mis le Rudemont en parallèle (Op. cit., pp. 28 = 34). Déchelette a noté : " Comme la plupart des bourgades néolithiques occupant une forte position défensive, le camp de Chassey ne fut pas abandonné lors de l'apparition du métal. Le début de l'âge du bronze y est encore représenté par quelques objets (DECHELETTE, Op. cit., p. 353). |
| (51)
: (retour |
BEAUPRE, Et. préh., pl. IX, fig. 5. |
| (52)
: (retour |
E. LINCKENHELD, Station néolithique du Schirmerter, in " Bulletin de la Société préhistorique française ", novembre 1932, p. 510. |
| (53)
: (retour |
En direction d'où s'oriente précisément la vallée du Rupt-de-Mad. Dans cette dernière vallée, Robert découvrit à Rembercourt une importante station à industrie du silex, qui lui livra notamment six haches et quatre flèches, au total 28 bonnes pièces dont trois en quartzite (Cf. le tableau de Beaupré). |
Dans la même plublication;
- Les quartz taillés du Mont JOUY
- Du Paléolitique en Moselle
- Le mythe VADEMONTIEN
Arnaville votre village 1981 -1984 par la Direction des Antiquités Préhistoriques de Lorraine
CAMPAGNE DE FOUILLES 1980
Ce site a été découvert en 1860 par F. de Saulcy et plus récemment de nombreuses prospections de surface , notamment celles de A. Bellard ont livré un matériel lithique abondant: pointes de flèches , poignards , haches et outillage divers en silex , meules et broyons , rares tessons de poterie etc. ... Cette colline a été en effet occupée dès le Néolithique moyen ( - 3500 ) mais aucune structure (cabane , trou de poteau, fosse à détritus etc...) n'a été découverte au cours des fouilles de la Direction des Antiquités Préhistoriques de Lorraine en 1978; la dalle calcaire se trouvant à - 0,20 m Des sondages sur le rebord de la falaise dominant la vallée de la Moselle ont mis cependant au jour la nécropole de ces premiers agriculteurs.
Etablie dans une faille étroite formée par un pan de rocher détaché de la falaise , elle offre un plan en baïonnette sur 24 m de longueur et 0,60 m de largeur moyenne. Trois niveaux de sépultures ont été dégagés à ce jour jusqu'à - 6 m. Ces tombes sont toutes des coffres en pierres plus ou moins bien structurés avec des dalles de chant et les parois rocheuses comme limites.
- Sépulture I (fouilles 1978) : inhumation en coffre d'un adulte accompagnée d'un vase et de poinçons en os .
- Sépulture II ( fouilles 1979) : inhumation en coffre d'un adulte accompagnée de crânes de chiens , de cervidé et d'un petit rongeur, de deux vases et de deux pointes de flèches en silex.
- Sépulture III (fouilles 1980) : inhumations multiples et incomplètes en coffre d'adultes accompagnées de deux cornes de bovidés , d'un chien, d'une mandibule de cervidé , d'un vase très fragmenté , de gaines de hache en bois de cerf , d'une pointe de flèche en silex et d'un fragment de hache polie en silex .
- Sépulture IV ( fouilles 1980) : inhumation en coffre d'un enfant de 2 à 4 ans accompagnée d'un dépôt vôtif de membres de cerf , disposés à la tête du défunt et d'un vase
- Sépulture V (fouilles 1980): incinération sur dalles d'un adulte accompagné d'ossement d'animal également calciné.
- Sépulture VI ( fouilles 1980) : inhumation d'un adulte , non fouillée
- Sépulture VII (fouilles 1980) : inhumation en coffre d'un enfant de 2 à 4 ans accompagnée de quelques silex taillés et de fragments d'un vase Le deuxième niveau de sépultures ( tombes II - III - IV et VI) était recouvert d"une couche d'éboulis contenant 5 à 6 chiens mis intentionnellement dans un but votif.
Ce rituel funéraire est assez complexe et varié Cependant il y a quelques points communs la structure en coffre et le dépôt votif d'animaux, chiens prédominants bovidés et cervidés. Le mobilier funéraire vases silex taillés objets en bois de cerf etc... est très pauvre. Il n'y a pas de parure (perles , collier bracelet etc...) Ce groupe humain en - 3000 avant J.Ch. ne connaissait pas le métal et il enterrait ces morte avec des objets quotidiens simples . Cette nécropole ne renferme donc pas de "trésor" mais elle apporte de précieux renseignements sur la vie quotidienne de ces premiers agriculteurs de notre région. Ce sont des agriculteurs (ils sont enterraient avec meules et broyons), des éleveurs (restes de bovidés et de chiens) mais également des chasseurs (cervidés et sangliers) qui se sont établis le long de la vallée de la Moselle.
La datation de cet ensemble a pu être faite à partir de la poterie de la sépulture II qui est typique d'un groupe appelé "Michelsberg". Ce dernier provenait d'Allemagne. Il se disperse au Néolithique moyen (vers -3500) en Europe moyenne en remontant la vallée du Rhin puis celle de la Moselle. Il évoluera localement pour devenir un faciès régional vers - 2500 dit "groupe mosellan" dont les nécropoles sont la grotte des Rochers de la Frasse à Novéant-sur-Moselle , et le Trou-des-Fées à Bayonville-sur-Mad.
La nécropole ou grotte-sépulcrale du "Rudemont" est un site très important pour le Nord-Est de la France car elle apporte des éléments nouveaux sur la connaissance du peuplement néolithique de notre région. En effet entre le début de la néolithisation ( agriculture, élevage et poterie) de la Lorraine par le groupe Danubien (vers -4000 ) et le groupe mosellan (vers -2500) il n'y avait aucun site connu en Lorraine à ce Jour. Cette lacune est donc comblée par le Rudemont.
Nous comptons exposer au 1° trimestre 1981 à Arnaville les résultats de ces trois années de fouilles afin que chacun puisse voir comment vivaient nos lointains ancêtres Nous profitons de cet article pour inviter toute personne intéressée par ces recherches sur le passé, a venir nous voir au cours des fouilles au mois de Septembre 1981
CAMPAGNE DE FOUILLES 1981
Par sa situation au confluent de deux cours d'eau importants et par sa topographie, le Rudemont est un éperon très propice a un habitat de hauteur au Néolithique. Si aucune structure d'habitat n'y a été découverte jusqu'à présent, la grotte sépulcrale de ce rebord de falaise reflète bien une forte densité de population.
La campagne de fouilles
de Septembre 1981 a Porté sur le dégagement des sépultures
commencées en 1980 et de nouvelles structures. Un tel gisement
pose des problèmes de méthodes de fouilles. D'une part,
très étroit, il faut poser des vérins pour aménager
un plancher afin de ne pas marcher sur les vestiges osseux ; d'autre part,
riche en restes humains, il faut relever sur des feuilles plastiques tous
les squelettes afin de bien les repérer en plan et en coupe. C'est
une fouille longue et minutieuse, mais passionnante.
Quatre niveaux de sépultures ont été reconnus sur
une hauteur de 8 mètres (voir Bulletin Municipal 1981, D. 19).
Cette année, seul le niveau 4 a été fouillé,
mais partiellement devant le nombre des sépultures imbriquées
les unes dans les autres. Les structures funéraires sont toujours
identiques : coffres faits de dalles calcaires disposées en travers
de la diaclase, plus ou moins bien structurés et sépultures
de sujets très jeunes souvent à même l'éboulis
ou en coffre.
La sépulture V commencée en 1980 est une crémation incomplète d'un adolescent. Déposé le long de la paroi, il a été partiellement carbonisé par un feu important, comme le montre les pierres et la paroi rougies.
La sépulture
VI se trouve dans une zone à forte concentration de squelettes.
A un coffre d'un adolescent et de plusieurs nouveaux-nés et enfants
de 6 mois, s'imbrique un deuxième coffre d'un nouveau-ne accompagne
d'un chien. Puis, sous cette structure, il y a un adolescent avec un nouveau-né,
un adulte bouleversé par les remaniements postérieurs et
un autre adulte de forte constitution dont les os ont été
rassemblés en tas près du crâne. D'autres restes humains
apparaissent mais n'ont pas été encore fouillés.
Cet ensemble assez complexe possède peu d'offrandes funéraires
: quatre vases dispersés à tous les niveaux, deux cornes
de bovidés, un bois de cerf, un lissoir en os, un chien et un silex
brûlé. Les offrandes animales sont plus importantes que le
mobilier lithique ou l'industrie osseuse, et nous apportent de précieux
renseignements sur le mode de vie de ces agriculteurs-éleveurs
d'il y a 5 000 ans.
La sépulture IX a livré un nouveau-né déposé
à même l'éboulis sous un surplomb sans aucune offrande
funéraire, même animale. Il faut dire que dans cette grotte
sépulcrale, la proportion de restes de nouveaux-nés et d'enfants
de moins de 6 mois est assez impressionnante et inexpliquée pour
l'instant. Il s'agit peut-être d'une forte proportion dans les niveaux
supérieurs et il faut attendre la fouille de l'ensemble pour pouvoir
en trouver la raison.
Une première analyse très succincte de la faune faite par Monsieur Philippe MOREL, étudiant à Bâle en Suisse, montre 1'importance du chien dans le rituel de cette grotte sépulcrale. Il est en effet associé à presque toutes les sépultures et principalement à celles des nouveaux-nés et des enfants de moins de six mois comme dans le deuxième niveau de sépulture fouillé en 1980. Les autres espèces animales représentées sont principalement le bœuf domestique et moins fréquemment le porc et le mouton. La faune sauvage est moins abondante, il n'y a que quelques individus : cerf, auroch, castor, lièvre et poisson.
Ces nouvelles découvertes 1981, notamment la poterie, confirment l'appartenance de cette grotte sépulcrale au groupe Michelsberg du Néolithique Moyen. Cette période est caractérisée par l'implantation des groupes humains néolithiques depuis un millénaire. Ils se sédentarisent de plus en plus et s'adaptent à leur région, en en modifiant petit à petit le paysage par l'élevage et la culture.
CAMPAGNE DE FOUILLES SEPTENBRE 1982
Un temps exceptionnellement beau a permis un bon déroulement des travaux tout au long du mois de septembre et début octobre. La suite de la sépulture 10, deux sépultures en coffres de nouveaux-nés et une sépulture d'adolescent établie à même l'éboulis ont été dégagées cette année. Il semblerait qu'un bloc barre la diaclase en deux, et que l'ensemble du niveau archéologique s'enfonce sous la voûte du gros bloc, côté vallée.
Il y a peu de mobilier funéraire, comme toujours, excepté quelques fragments de vases en cours de restauration; deux lissoirs sur côtes de bovidés et quelques silex, simples éclats bruts de taille. Tout cela est dans la continuité des trouvailles des années précédentes.
Cependant, il y a une découverte fort intéressante, faite dans la dernière semaine: un cerf de 14 corps a été enseveli, les ligaments coupés, pour passer dans ce puits étroit. Il a été mis volontairement, couché sur le dos et la tête déposée sur une dalle, sa ramure bloquant la largeur de la faille. A ses côtes, une cruche, un vase à provision à fond rond et une pelle fabriquée dans une omoplate de bovidé.
Les fouilles de l'année prochaine nous diront si ce cerf recouvre une sépulture humaine ou s'il s'agit d'une sépulture de cerf uniquement. Le rituel funéraire de ce groupe Michelsberg ( - 3 200 avant J. C. ) est en effet bien particulier : chiens, bovidés et cerf, fond partie du cortège de l'au-delà de ces populations d'agriculteurs mais surtout éleveurs.
Arrivée à
- 8 m cette année, cette diaclase étroite pose bien des
problèmes quant aux méthodes de fouilles. Le plan en baïonnette
et le profil en S oblique ne permettent pas, en effet, de poser un carroyage
ou même une simple ligne verticale ou horizontale de référence.
Nous avons donc planté arbitrairement des lignes de clous tous
les mètres, en plan et en hauteur, sur les deux parois de la diaclase
appelées paroi X ( vers le plateau ) et paroi Y ( vers la vallée
).
Chacun des objet est ainsi repéré par triangulation dans
chacun des carrés, sa profondeur est donné(- par rapport
à chaque ligne de clous soit : Z 1, Z 2, Z 3 etc... A chaque Z,
le plan de la diaclase est relevé avec en annotation les clous
du Z précédent pour permettre une superposition des divers
plans successifs et de leurs structures funéraires. Les sépultures
sont toutes relevées sur plastique transparent en grandeur nature.
Les os sont dessinés avec des symboles précisant Les diverses
positions vue antérieure, vue médiale ; extrémité
distale etc...
Le tout est reproduit sur calque et microfilmé pour obtenir le format voulu. Les pierres, les gros blocs et les vestiges hors des structures funéraires ou entre deux plans importants sont relevés sur papier millimétré au 1/5 0. Les déblais sont évacués à la surface et tamisés à l'eau, charbon de bois, escargots, esquilles d'os, tessons etc... sont séparés par carré et par Z.
Il faut un minimum de 5 personnes et un maximum de 8 personnes pour fouiller dans les meilleurs conditions. Une découverte photographique avec torches photo alimentées par un groupe électrogène est prise des divers plans et structures. Devant l'importance de ce gisement et avec toutes les récentes découvertes néolithiques de Lorraine, un colloque interrégional sur le néolithique du Nord-Est de la France aura lieu à la fin septembre 1983 à Metz..
CAMPAGNE DE FOUILLES 1983
Afin de pénétrer dans le réseau-souterrain à la prochaine campagne de fouilles en Septembre 1984 l'éboulis a été mis à niveau sur toute la longueur de la faille. Une zone stérile retenue par une murette composée de deux dalles superposées plonge d'une part à l'Ouest vers l'intérieur de la grotte et d'autre part à l'Est vers la petite salle. Cinq sépultures s'articulent autour d'elle.
Le fond de la sépulture du cerf, fosse établie dans l'éboulis et limitée par des dalles de chant a livré une pointe de flèche dans la cage thoracique de l'animal. Vu sa disposition ce doit être l'arme qui a tué le cerf.
Une nouvelle sépulture en coffre avec couvercle a été mise au jour à -9,50 m de profondeur dans un secteur où la faille se rétrécit en escaliers naturels pour ne faire plus que 0,50 m. Il s'agit d'une inhumation d'un jeune sujet, fouillée incomplètement en 1983
Pendant la campagne de fouilles de Septembre 1983, des prises de vues ont été effectuées dans la grotte pour un montage audiovisuel du Musée Lorrain de Nancy. Une cassette a été déposée à la Direction des Antiquités de Lorraine 6 place de Chambre à Metz. Elle est disponible pour toute personne intéressée.
1 - poinçon en os / 2 - lissoir en os / 3 - armature de flèche / 4 - triangle à encoche / 5 - lamelle à dos abattu / 6 à 8 - éclats / 9 - grattoir / 10 - fragment de hache en roche dure / 11 - polissoir en grès.
|
Association
Le Pont Rouge
178
rue du Pallon
54530
Arnaville
|