 Depuis
ma première sortie en janvier 2009 dans les barthes de Villefranque,
j'ai effectué une dizaine de randonnées ou voyages naturalistes
en groupe guidé par
Dimitri
Marguerat.
Ornithologue,
celui-ci se passionne pour tout ce qui compose la nature sauvage
au sujet de laquelle il a beaucoup lu, citant ses auteurs préférés à
chaque
fois
que l'occasion se présente. Parmi eux reviennent fréquemment
les noms de
Stéphan Carbonnaux
et de Robert Hainard, le premier ayant rédigé la biographie
du second. Ce
n'est
donc
pas un
hasard
si
je participe aujourd'hui à cette randonnée d'un
caractère
un peu
particulier,
à la fois
littéraire,
naturaliste et historique, pour laquelle je me suis rendue tout spécialement
à Lescun en vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Au préalable,
j'avais commandé le livre
de Stéphan, "Robert
Hainard, Chasseur au crayon", et
j'en ai déjà lu le premier tiers d'un jet, comme un roman,
lorsque j'arrive sur le lieu de rendez-vous. A mon retour à la
maison, je m'empresse de m'y replonger jusqu'à la fin et depuis,
je
ne cesse d'y penser tant il m'a marquée. -
Photo : Gypaète barbu.
-
Depuis
ma première sortie en janvier 2009 dans les barthes de Villefranque,
j'ai effectué une dizaine de randonnées ou voyages naturalistes
en groupe guidé par
Dimitri
Marguerat.
Ornithologue,
celui-ci se passionne pour tout ce qui compose la nature sauvage
au sujet de laquelle il a beaucoup lu, citant ses auteurs préférés à
chaque
fois
que l'occasion se présente. Parmi eux reviennent fréquemment
les noms de
Stéphan Carbonnaux
et de Robert Hainard, le premier ayant rédigé la biographie
du second. Ce
n'est
donc
pas un
hasard
si
je participe aujourd'hui à cette randonnée d'un
caractère
un peu
particulier,
à la fois
littéraire,
naturaliste et historique, pour laquelle je me suis rendue tout spécialement
à Lescun en vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Au préalable,
j'avais commandé le livre
de Stéphan, "Robert
Hainard, Chasseur au crayon", et
j'en ai déjà lu le premier tiers d'un jet, comme un roman,
lorsque j'arrive sur le lieu de rendez-vous. A mon retour à la
maison, je m'empresse de m'y replonger jusqu'à la fin et depuis,
je
ne cesse d'y penser tant il m'a marquée. -
Photo : Gypaète barbu.
-
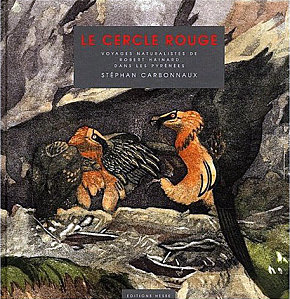 Le
Genevois Robert
Hainard (1906-1999) est en effet un personnage
hors du commun. Voici quelques phrases extraites du site de Stéphan
pour en donner une petite idée. "Sculpteur, graveur sur bois, naturaliste
et philosophe,
il a eu une vie foisonnante
et
exceptionnelle
aux côtés
de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue. Visionnaire,
il a été le premier à prôner, au-delà de
toute idéologie,
une société sans croissance économique et à plaider
pour une réconciliation de l’homme avec la nature. De
tous les élèves des écoles d'art, Robert
Hainard est le seul à mener pareille double vie : dessiner,
peindre, sculpter et simultanément rechercher l’animal
dans la nature, jusqu’à rappeler de plus en plus un chasseur
des âges farouches, aussi habile à la sagaie qu’avec
un crayon de sanguine ou un fusain. Quelle parenté saisissante
entre un ours dessiné de profil à l’ocre rouge
dans la grotte ardéchoise du Pont-d’Arc, découverte
artistique majeure de la fin du siècle, et les premiers croquis
d’ours de Robert Hainard en Bulgarie ! Par-delà une trentaine
de millénaires, un chasseur aurignacien tend la main au chasseur
moderne et signifie que rien n’est rompu." -
Photo : Couverture du livre de Stéphan Carbonnaux, Le Cercle
rouge. -
Le
Genevois Robert
Hainard (1906-1999) est en effet un personnage
hors du commun. Voici quelques phrases extraites du site de Stéphan
pour en donner une petite idée. "Sculpteur, graveur sur bois, naturaliste
et philosophe,
il a eu une vie foisonnante
et
exceptionnelle
aux côtés
de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue. Visionnaire,
il a été le premier à prôner, au-delà de
toute idéologie,
une société sans croissance économique et à plaider
pour une réconciliation de l’homme avec la nature. De
tous les élèves des écoles d'art, Robert
Hainard est le seul à mener pareille double vie : dessiner,
peindre, sculpter et simultanément rechercher l’animal
dans la nature, jusqu’à rappeler de plus en plus un chasseur
des âges farouches, aussi habile à la sagaie qu’avec
un crayon de sanguine ou un fusain. Quelle parenté saisissante
entre un ours dessiné de profil à l’ocre rouge
dans la grotte ardéchoise du Pont-d’Arc, découverte
artistique majeure de la fin du siècle, et les premiers croquis
d’ours de Robert Hainard en Bulgarie ! Par-delà une trentaine
de millénaires, un chasseur aurignacien tend la main au chasseur
moderne et signifie que rien n’est rompu." -
Photo : Couverture du livre de Stéphan Carbonnaux, Le Cercle
rouge. -
Stéphan
Carbonnaux nous attend devant l'hôtel
Le Pic d'Anie qui hébergea
Robert Hainard lorsqu'il séjourna dans le cirque de
Lescun avec son ami Jacques Burnier pour tenter de voir le gypaète
barbu,
un rapace qui vivait
autrefois dans presque toutes les montagnes du sud de l'Europe et dans
les Alpes mais en avait été éradiqué. En effet,
comme de nombreuses fables
et légendes le
présentaient sous la forme d'une bête
féroce n'hésitant pas à enlever les enfants, la promesse
de primes de capture et de destruction avait conduit à la
persécution
de ces oiseaux. Ils étaient victimes d'appâts
empoisonnés, de tirs à la demande de collections zoologiques
et, dans certaines régions, de la disparition de ressources alimentaires.
Pourtant, son surnom de "casseur d'os" indique bien son régime
alimentaire : c'est un vautour qui se nourrit de charogne et passe après
tous les "consommateurs", car il a une prédilection pour
les os dont il laisse tomber les plus gros (de préférence
les os longs)
d'une hauteur de 50 à 100 mètres sur les flancs de falaise
ou sur les pierriers pour en manger les débris
et les ligaments. Avant de se lancer dans la biographie, Stéphan
a d'abord écrit un petit livre centré sur
cette quête
du rapace à partir des années
1950,
"Le
Cercle rouge, Voyages naturalistes de Robert Hainard dans les Pyrénées".
- Pour information, le gypaète a un oeil jaune entouré
d'un cercle rouge formé d'un
fin réseau de
vaisseaux sanguins superficiels apparents
sous la peau très fine, alors que notre oeil
les cache sur la
face intérieure de nos paupières. -
Photo
:
Stéphan
Carbonnaux explique la vie et la pensée de Robert Hainard.
-
Entre
1949 et 1964, Robert Hainard, qui est suisse,
va ainsi faire huit voyages sur les traces du grand rapace casseur d’os,
de Benasque au Néouvielle, de l’Ossau aux Especières,
tout en guettant l’isard, le vautour fauve, le pic à dos
blanc ou le merle de roche. Le
18 avril 1956, il quitte l'hôtel du Pic d'Anie skis sur le
dos et part en exploration dan
le cirque de Lescun alors dépourvu des routes qui le sillonnent maintenant
de toutes parts. Il est avec son ami Jacques Burnier, médecin de profession,
qui, depuis
l'âge de dix ans, prend des notes qui sont de véritables
récits. Il relate
ainsi la présence de traces et de crottes d'ours à l'endroit
même où nous
passons à notre tour, quelque 50 ans plus tard. Il rencontre une poule
de grand tétras, un renard,
un pic
à dos blanc, endémique des
Pyrénées. Cet oiseau vivait primitivement en plaine, mais dans
de
vieilles
forêts qui ont disparu et le pic avec elles : il n'a pu survivre que
dans des lieux moins exploités par l'homme. Quant
au grand tétras,
il est malheureusement absent aujourd'hui des Pyrénées en raison
de la modification de son habitat, de la chasse illégale et des dérangements
pendant la période de reproduction dus à la création des
pistes de ski et aux travaux forestiers. -
Photo : Pavot jaune
(Méconopsis). - Trace dans la boue du sentier : Si on place une baguette à la
base des deux griffes de devant et qu'elle ne coupe pas les pelotes, cela laisse
supposer qu'il s'agit
de traces de renard plutôt que de chien. -
Ce
ne sera qu'à
son huitième voyage, en juin 1964, qu'il aura
la
chance,
exceptionnelle,
d'observer
le gypaète
sur son
aire depuis une distance de 20 mètres seulement, grâce à Yves
Boudoint et Michel Terrasse qui ont repéré au
printemps le déplacement
de l'oiseau en cet endroit de la vallée d'Ossau et ont
construit une cache à flanc de falaise à cet effet.
Le "grand-père" réussira à l'atteindre
sans même se servir de la corde
prévue pour l'assurer. Rédacteurs
de la préface du livre de Stéphan, Jean-François
et Michel Terrasse évoquent
la mémoire
immédiate,
la presque collusion, qui porte et guide le trait de Robert Hainard quelques
secondes après qu’il ait observé une scène.
"C’est
la mouvance brute, la fulgurance de la fuite d’un
isard débusqué, l’ellipse silencieuse d’un
vautour en plein ciel.
" Une
photo du Cercle rouge le montre, bâton
en main, jumelles pendant sur la poitrine, auréolé des
cheveux blancs d’un alerte septuagénaire (en 1981, lors
d'un neuvième séjour pyrénéen), en compagnie
de l’un
des frères
Terrasse. Petit
détail, Robert Hainard a dû subir la pose d'une prothèse à la
hanche droite en mars 1978...
- Photos : La Latrée clandestine, sans chlorophylle, parasite grâce à des suçoirs les racines de nombreux arbres ou arbustes : aulnes, peupliers, saules... Elle est aussi carnivore : elle développe des tiges souterraines ramifiées portant des bractées écailleuses dont le centre présente une cavité débouchant à l'extérieur par une fente et garnie de glandes. Les insectes de la microfaune du sol y sont piégés et constituent pour la plante une source de matières premières pour la fabrication de ses protéines. Le fruit produit après la floraison est une capsule aplatie qui, à maturité, projette les graines à une distance impressionnante. - Couleuvre à collier à l'âge d'un an : elle goûte l'air en tirant la langue. -
Au
hasard de ses marches et de ses affûts, Robert Hainard a pu voir "son
seul ours pyrénéen" 30 secondes à 300 mètres,
trop peu de temps et trop loin pour pouvoir le dessiner. Devant l'emprise
croissante de l'homme sur la nature en Europe de l'Ouest, l'artiste,
qui s'est donné pour objectif de dessiner tous les grands animaux
sauvages européens encore vivants, est obligé d'aller
observer l'ours dans les forêts préservées de Croatie et de Slovénie,
ainsi qu'en Bulgarie.
Il demande sa réimplantation dans le Vercors,
mais elle est combattue par Jean Dorst, directeur du Museum d'histoire
naturelle
de Paris, qui ne connaît rien au comportement du fauve et craint
pour la sécurité des populations humaines.
Nos accompagnateurs commentent qu'il y a 20 ans, il en restait encore trois à Lescun. Il y a un an, la présence d'un ours à Saint Engrâce a été attestée par l'ONCFS : il a éventré une brebis et, le 10 juin, des gens l'ont vu passer, ainsi que les 20 et 25 juin. Stéphan est incollable sur la situation de l'ours dans nos montagnes. Au sein de la SEPANSO, il s'est engagé dans la défense de la vallée d’Aspe et de ses animaux sauvages contre la construction du tunnel du Somport, les destructions occasionnées par les carrières, les barrages et les aménagements divers. Il a collaboré à l'ouvrage "Plainte contre la France, pour défaut de protection de l'ours dans les Pyrénées" et écrit "Le Cantique de l'ours, Petit plaidoyer pour le frère sauvage de l'homme".
-
Photos : Fleur de Raiponce, dont le nom me rappelle à chaque
fois le conte des
frères Grimm qui évoquait le sort d'une
princesse ainsi dénommée (Rapunzel en allemand). Lorsque
j'étais jeune, j'avais été frappée que
la sorcière puisse escalader
la tour où elle l'avait enfermée, simplement en s'agrippant
aux tresses que la jeune fille faisait pendre de sa fenêtre
haut perchée.
A la relecture, je remarque que les conteurs illustrent
de façon
originale les envies irrépressibles qui s'emparent des femmes
enceintes (celle d'une salade de raiponces en l'occurence), et le
manque cruel
qui étreint les femmes qui ne peuvent avoir d'enfant, au point
de souhaiter
prendre celui des autres (ici, celle dénommée "la
sorcière"). - Dimitri et Stéphan repèrent
au son les oiseaux et cherchent à les attirer près
de nous avec leurs appeaux. -
La controverse entre l'occupation humaine
de la montagne et la préservation des animaux sauvages se focalise également
sur le sort des vautours.
Leur situation en France est devenue très difficile au cours du XXe siècle avec la disparition de la quasi-totalité des populations de Vautour fauve, Gypaète barbu et Vautour percnoptère. Le Vautour moine, quant à lui était en forte régression dans toute l’Europe et avait disparu de France depuis le XIXe siècle. L’origine de ces régressions est multiple et liée à des persécutions, empoisonnement et tirs, mais aussi aux changements importants qu’a subis l’agriculture et en particulier le pastoralisme, ainsi qu’à la réglementation vétérinaire qui réduisait drastiquement les disponibilités alimentaires en obligeant à l’équarrissage des bêtes mortes. Afin de rétablir des populations viables de ces espèces emblématiques, plusieurs programmes de réintroduction ont été entrepris. Le premier d’entre eux initié dans les années 1970 s’est déroulé en France et a concerné le Vautour fauve dans les Grands Causses du Massif Central (où les frères Terrasse ont été très impliqués). Il a été suivi en 1992 par la réintroduction du Vautour moine.
Ils
font davantage gagner que perdre de l'argent, le bilan économique
est positif, disent Dimitri et Stéphan. Le problème
des vaches
"attaquées
vivantes" provient de l'introduction de la Blonde d'Aquitaine,
espèce
nouvelle dans les Pyrénées,
qui est laissée seule en estives alors qu'elle est connue
pour avoir des
mises
bas difficiles. Issue de sélections
successives pour produire de la viande de boucherie, les éleveurs
ont privilégié
la prise rapide de poids en négligeant les conséquences
sur la gestation. Le vautour a toujours
mangé le placenta après les vêlages, sans causer
de problèmes
aux troupeaux. Il ne peut absolument pas s'attaquer
à une vache qui est debout, elle est bien trop haute par rapport à lui
lorsqu'il se
tient
à côté et il glisserait s'il était perché sur
son dos, car ses serres sont dépourvues de force de préhension.
S'il a pu "aider à mourir" une vache, c'est qu'elle était
déjà en difficulté, en position couchée.
Le vautour n'a fait qu'aggraver la situation délicate qui
s'était
enclenchée
sans qu'il n'y soit pour rien.
Les
porcheries industrielles navarraises ont trouvé pratique de
se débarrasser
de leurs déchets en les donnant à manger aux vautours.
Résultat,
ces derniers ont été nourris eux aussi de façon "industrielle" par
ricochet, leur démographie a explosé,
et du jour où le scandale de la vache folle est survenu
et que le dépôt
de cadavres et de déchets animaux sur la montagne a été interdit,
les vautours sont devenus affamés. Sur la durée, la population
se régule
automatiquement, ils se reproduisent moins et les effectifs se réduisent
en fonction de la nourriture disponible. Cependant, il y a un certain
temps de latence où les effectifs sont trop importants par rapport
à la nourriture disponible. Ceci dit, les vautours ont beaucoup
profité (y
compris le gypaète)
des pratiques humaines, et notamment de l'élevage. -
Photo : Nid de guêpe poliste déserté. -
Robert
Hainard voit au cours de sa vie disparaître un à un de grands
mammifères
comme l'ours, le loup (encore
présent dans le Leon et dans les Asturies en Espagne), le lynx,
ainsi que les aigles, les vautours et bien d'autres animaux encore. Il
en souffre comme s'il s'agissait d'amputations sur son propre corps.
Stéphan Carbonnaux le décrit fort bien dans son livre.
Depuis sa prime jeunesse, Robert Hainard parcourait toutes les régions
encore sauvages et préservées de
la Suisse,
et il
affectionnait tout particulièrement se rendre au bord du Rhône,
encore un torrent dans
le Jura, où il se baignait et canotait en famille et avec les
amis et dont il dessinait, de concert avec sa femme, les habitants, "le
petit gravelot sur ses oeufs, le martin-pêcheur, les
limicoles pressés en halte migratoire". Il
y guettait surtout l'insaisissable bête aquatique, la loutre. Il
désespère
lorsqu'un barrage hydro-électrique
fait taire en 1951 la cascade de Pissevache qu'il
a gravée au mois de
mars
1947
d'après un croquis vieux de deux ans. Tout ouvrage qui entrave
les cours d'eau, tout comblement de marais, toute disparition de biotope
le navrent
et lui percent le coeur. - Photo : Orchis
blanc investi par des fourmis qui semblent élever une colonie
de pucerons dont elles sucent un jus nutritif et énergétique.
Ceux-ci se nourrissant de sève, nous voyons que la tige ralentit
sa croissance et dépérit avant que la fleur n'ait éclos.-
| SOMMAIRE | Page 1/2 |