Nous ne formons qu'un avec l'univers. C'était une intuition évidente autrefois, et si nous en avons douté quelque temps, les preuves s'accumulent désormais grâce à notre science toute neuve. Gaïa, notre Terre, plus douée encore que l'Hydre de Lerne dont les têtes coupées repoussaient à l'identique, engendre sans cesse de nouvelles formes de vie en dépit des calamités qui l'accablent parfois. Les malheurs qui surgissent par surprise proviennent souvent des profondeurs de la planète, mais certains phénomènes qui reviennent avec une régularité troublante de métronome sont d'une autre nature : ils émanent du ciel. En effet, le sort de la Terre est intimement lié aux aléas du système planétaire au sein duquel elle gravite et à la quantité d'énergie que lui dispense le Soleil, son étoile. - Photo : Zumaia, depuis la casa rural Santa Klara. -
Jean-Louis
et moi avons la chance de servir de "bouche-trou" lors
d'une sortie organisée par
l'association paloise Géolval. Nous avons pour
guide Thierry
Juteau, l'un des premiers découvreurs de la
faune abyssale vivant à l'orifice des fumeurs noirs de la
dorsale du Pacifique à la fin des années 70 et spécialiste
des fonds marins. Il nous emmène
à
Zumaia, un village dont les falaises côtières ont eu l'honneur
d'être
élues en 2010 "Référence mondiale" par
la Commission de Stratigraphie de l'IUGS (International Union of
Geological Sciences)
pour
deux "limites" ou transitions particulières,
devenues ainsi des "stratotypes" marqués
d'un Clou d'or : la limite
Danien (65,5-61,1 Ma - Millions d'années) / Sélandien
(61,1-58,7 Ma) (D/S) et la limite Sélandien / Thanétien
(58,7-55,8 Ma) (S/T). Le Danien est la période qui a suivi
le cataclysme qui engendra (notamment) la disparition des dinosaures
et la fin du Thanétien coïncide avec l'un des plus
forts réchauffements
planétaires, ce qui lui vaut toute l'attention des scientifiques
qui aimeraient bien prévoir ce qui nous attend dans un avenir
plus ou moins proche. La limite la plus ancienne (D/S) est localisée
dans la transition de roches dures et de roches plus tendres, juste
au-dessous de l’ermitage de San Telmo. Elle est liée
à une grande baisse du niveau marin. La plus récente
(S/T), située sur la plage d’Itzurun à Zumaia,
est définie
par l’inversion des pôles magnétiques, un phénomène
très habituel dans l’histoire de notre planète.
Ces deux marques du temps ne sont que deux repères parmi
d'autres puisque les strates basculées pour former ces falaises
ne couvrent pas moins de 50 millions d'années entre 50 et
100 Ma, recouvrant la totalité du Paléocène.
-
Photo : Thierry Juteau montre un des deux Clous d'or de la
plage de Zumaia. -
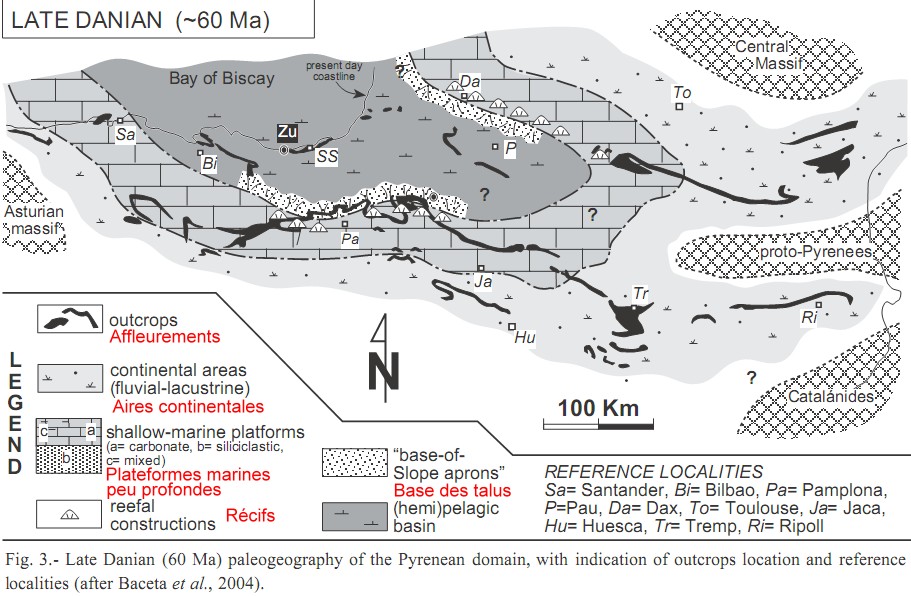
Nous
voyons sur la carte que tout le futur Pays basque (de Santander à l'Ouest à Dax à l'Est,
et jusqu'à
Pampelune au Sud) est alors occupé par un bassin semi-pélagique
d'environ 1000 mètres de profondeur ouvert
sur
l'océan
atlantique au Nord. Les contours
de cette baie sont composés de récifs coralliens
qui protègent
une lagune peu profonde en arc de cercle, bordée de zones émergées
"fluviales-lacustres" et, plus à l'intérieur
des terres, de massifs montagneux.
Il fait plutôt
chaud et sur le fond marin de cette immense
baie, trois sortes de sédiments
se déposent
pendant les millions d'années qui précèdent le
soulèvement
de la région
qui accompagnera celui des Pyrénées. Tout d'abord, l'érosion
continentale, dont l'intensité dépend des conditions climatiques
et des précipitations,
entraîne vers le large de fines particules qui descendent lentement
saupoudrer le fond marin :
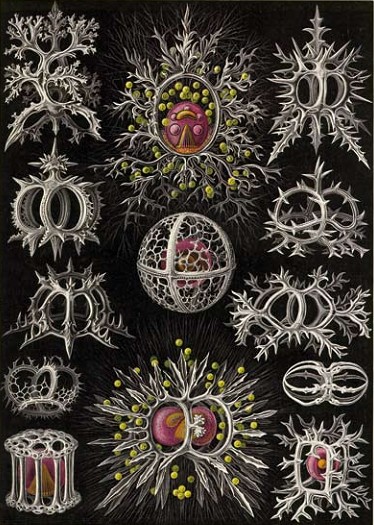 à la
fin du Thanétien à 55
Ma, la strate de plusieurs mètres d'épaisseur n'est composée que de
roches rougeâtres, de l'argile sans plancton, en raison
du très fort réchauffement climatique qui perturba l'existence
du vivant. En second lieu, des soubresauts déstabilisent
parfois les talus continentaux dont des pans entiers se détachent
en avalanches sous-marines ponctuelles appelées turbidites
: leur fréquence est liée à la plus ou moins grande
pression exercée
lors de l'affrontement des blocs européen et ibérique.
Au Danien, par exemple, il n'y en a aucune, alors que l'Eocène,
qui succède au Thanétien après le Paléocène, en subit de plus en plus
au cours du temps. -
Photo : Falaise à Zumaia -
à la
fin du Thanétien à 55
Ma, la strate de plusieurs mètres d'épaisseur n'est composée que de
roches rougeâtres, de l'argile sans plancton, en raison
du très fort réchauffement climatique qui perturba l'existence
du vivant. En second lieu, des soubresauts déstabilisent
parfois les talus continentaux dont des pans entiers se détachent
en avalanches sous-marines ponctuelles appelées turbidites
: leur fréquence est liée à la plus ou moins grande
pression exercée
lors de l'affrontement des blocs européen et ibérique.
Au Danien, par exemple, il n'y en a aucune, alors que l'Eocène,
qui succède au Thanétien après le Paléocène, en subit de plus en plus
au cours du temps. -
Photo : Falaise à Zumaia -
Enfin, cette enclave marine abritée héberge une vie foisonnante, composée d'espèces de toutes tailles, mais surtout, du point de vue géologique, de plancton, cet ensemble d'organismes minuscules mais innombrables, qui contiennent en leur sein un test calcaire ou siliceux. Lorsque ces êtres meurent, une infime fraction échappe aux "consommateurs" et un pourcentage encore moindre de leur test (squelette) ne se dissout pas pendant la chute dans la colonne d'eau de 1000 mètres. Parvenus sur le fond, ces composés minéraux organiques s'accumulent durant des millions d'années et se transforment lentement en roches. - Schéma : Radiolaires (à test siliceux). -
Sachant
cela, les géologues s'étonnent, en contemplant
les affleurements de strates
basculées à la
verticale par l'orogenèse
pyrénéenne pour former ces falaises vertigineuses, car
ils présentent
une magnifique alternance de roches dures et tendres,
le
Flysch.
Mieux que cela, il est possible de déceler, sous la chapelle San
Telmo, une succession rythmée
de quatre couples dur/tendre suivis de deux grosses strates dures dont
la couche tendre intercalaire est si fine qu'elle en devient presque
imperceptible. Quelle baguette mystérieuse a mis de l'ordre dans
cette combinaison de phénomènes qui aurait dû donner
un ensemble rocheux à l'aspect
bien plus confus ? - Photo : Thierry Juteau
au pied des strates basculées à la verticale sur la plage
d'Itzurun à Zumaia. -
L'idée
qui est venue au Serbe Milutin
Milankovic au début du XXe siècle, dix
ans après ses études à Vienne, c'est qu'il existerait
une corrélation
entre les mouvements astronomiques et les variations climatiques terrestres.
Il mit en évidence l'existence de cycles (notamment
glaciaires) pour
les derniers millions d'années (Se reporter
au site en lien pour consulter les schémas).
Publiés
durant la période troublée de la seconde guerre mondiale, ses
travaux ne rencontreront l'assentiment
de la communauté scientifique que trente ans plus tard, dans les années
70, à l'examen
des sédiments marins extraits dans les fonds océaniques profonds.
En effet, un indicateur couramment utilisé pour
l'estimation du volume global des glaces continentales est le rapport isotopique
entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16 contenu dans
les squelettes carbonatés des foraminifères benthiques : la variation
de celui-ci viendra confirmer cette théorie des cycles de Milankovic. Ensuite,
l'amélioration
de la détermination
des mouvements à long terme de la Terre et de la résolution des
enregistrements climatiques permettra d'affiner continûment ce lien. Ainsi,
depuis 2005, l'Échelle de Temps Géologique des 25 derniers millions
d'années (le Néogène) est officiellement basée
sur ces calculs affinés des variations à long terme de l'orbite
et de la rotation terrestre. - Photo : Falaise près
du Clou d'or de la limite S/T. -
De quoi s'agit-il ? Si la Terre était le seul satellite du Soleil, son orbite (c'est à dire la trajectoire de sa course annuelle autour du Soleil) resterait stable. Mais la présence de la Lune et des autres planètes engendre des perturbations de trois ordres qui, sur le Néogène, se combinent selon des rythmes désormais bien connus. - Photo : Annie, la présidente de Géolval, pèse l'importance des variations du niveau marin sur la physionomie des strates. -
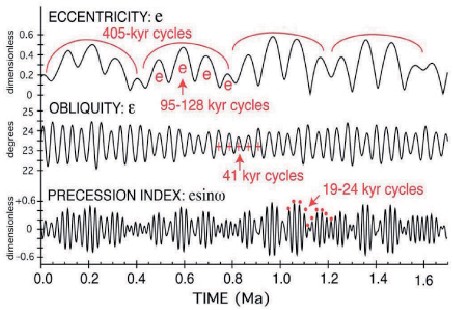 La
première variation de l'orbite terrestre est celle de son excentricité,
c'est à dire
le degré d'aplatissement
de l'ellipse parcourue par la Terre en un an autour du Soleil, par
rapport à un
cercle. Cette excentricité est actuellement très
faible, de l'ordre de 0,017 et les perturbations engendrées
par la présence des autres planètes du système
solaire entraînent
des variations lentes de celle-ci entre 0 (cercle) et 0,06 (ellipse
légèrement aplatie), selon
une périodicité
d'environ 100 000 et 400 000 ans. Comme l'a démontré le
mathématicien, astronome et physicien français Pierre-Simon de Laplace
en 1772, le grand axe de l'ellipse ne change pas, c'est l'ellipse qui
se déplace,
de fortes excentricités
engendrant conjointement une diminution de la distance la plus faible entre
la Terre et le Soleil (périhélie) et une augmentation de
la distance maximale entre les deux astres (aphélie). -
Graphique : Cycles de Milankovitch. -
La
première variation de l'orbite terrestre est celle de son excentricité,
c'est à dire
le degré d'aplatissement
de l'ellipse parcourue par la Terre en un an autour du Soleil, par
rapport à un
cercle. Cette excentricité est actuellement très
faible, de l'ordre de 0,017 et les perturbations engendrées
par la présence des autres planètes du système
solaire entraînent
des variations lentes de celle-ci entre 0 (cercle) et 0,06 (ellipse
légèrement aplatie), selon
une périodicité
d'environ 100 000 et 400 000 ans. Comme l'a démontré le
mathématicien, astronome et physicien français Pierre-Simon de Laplace
en 1772, le grand axe de l'ellipse ne change pas, c'est l'ellipse qui
se déplace,
de fortes excentricités
engendrant conjointement une diminution de la distance la plus faible entre
la Terre et le Soleil (périhélie) et une augmentation de
la distance maximale entre les deux astres (aphélie). -
Graphique : Cycles de Milankovitch. -
La
deuxième variation de l'orbite terrestre concerne son obliquité. À cause
des perturbations planétaires, l'inclinaison du plan orbital de
la Terre évolue et oscille, ce qui fait varier l'angle entre l'axe
de rotation de la Terre et la perpendiculaire à son plan orbital
moyen (ou plan de l'écliptique). En outre, la Terre n'étant
pas sphérique
mais légèrement aplatie sur les pôles, les forces gravitationnelles
exercées par le Soleil et la Lune tendent à faire tourner et
précesser l'axe de rotation de la Terre (comme une toupie !) autour
de cette perpendiculaire à l'écliptique. Le cône décrit
alors par l'axe de rotation fait un tour en environ 26 000 ans. La combinaison
de ces deux effets engendre, au premier ordre, une oscillation de l'obliquité terrestre
qui reste actuellement très limitée, environ 1,3° autour
d'une valeur moyenne proche de 23,5°. La période principale de ces
oscillations est d'environ 41 000 ans. - Photo : Fossiles
et traces de terriers d'organismes marins dans les roches. -
L'obliquité est à l'origine
du phénomène des saisons car elle module la quantité d'ensoleillement
reçue
aux différentes latitudes au cours de l'année. Si l'obliquité était
nulle (si l'axe de rotation de la Terre sur elle-même était
perpendiculaire au plan orbital), il n'y aurait plus de saisons à la
surface de la Terre. Le climat des hautes latitudes est très sensible
aux variations d'obliquité, à l'inverse des régions équatoriales.
L'insolation
annuelle moyenne en un point de latitude donnée ne dépend
quasiment que de l'obliquité. Pour une obliquité donnée,
l'insolation diminue avec la latitude (il fait plus froid aux pôles
!) mais, pour un point de latitude donné, l'écart d'insolation
entre l'été et
l'hiver augmente lorsque l'obliquité s'accroît. -
Photo : La Lune à son premier quartier cet après-midi à Zumaia.
-
L'effet de "précession''
(toupie) de l'axe de rotation de la Terre entraîne un décalage
régulier
de la position des solstices et des équinoxes. - Au solstice d'été,
les rayons solaires sont perpendiculaires à la Terre au niveau du
Tropique du Cancer, dans l'hémisphère Nord, au solstice d'hiver,
ils sont perpendiculaires au tropique du Capricorne, dans l'hémisphère
Sud, aux équinoxes de printemps
et d'automne,
les rayons solaires sont perpendiculaires à l'Equateur terrestre -. Si
on y ajoute le fait que l'orbite elliptique terrestre "tourne" aussi
progressivement autour du Soleil, la position de la Terre sur l'ellipse à un
moment précis de l'année, à l'équinoxe
de printemps par exemple, évolue dans le temps. Ce phénomène
s'effectue avec des périodes proches de 19 000 et 23 000 ans. Plus
concrètement, actuellement le solstice d'été a lieu à proximité de
l'aphélie (le point de l'ellipse le plus éloigné du Soleil),
ce qui permet de tempérer les étés dans
l'hémisphère Nord, et de créer, à l'inverse,
des hivers moins rigoureux, puisque, six mois plus tard, la Terre se trouve
au périhélie, au plus proche du Soleil. L'hémisphère
Sud est dans la situation opposée.
Il y a environ 11 500 ans, la situation était inversée, plaçant
le solstice d'été au périhélie de l'orbite et
engendrant ainsi des étés très chauds et des hivers
très froids dans l’hémisphère Nord. Toutefois, en
terme d'insolation, il faut tenir compte aussi des variations de l'excentricité qui
modulent la distance Terre-Soleil. - Photo : Alternance
de roches dures et tendres. -
| SOMMAIRE | Page 1/3 |