Les
scientifiques postulent donc que les
variations périodiques d'insolation
de notre golfe "basque" dues à tous ces effets astronomiques
combinés influent sur la vie marine. C'est ce que l'on appelle
le "forçage orbital". Lorsque l'énergie
dispensée par
le
Soleil
s'accroît, la production biologique augmente corrélativement,
et les tests de plancton, coquilles et squelettes s'accumulent en plus
grand nombre, pour former à terme des roches à dominante
calcaire, dures. On découvre en effet dans les strates de Zumaia
une grande variété de
fossiles de pleine mer, y compris des foraminifères planctoniques
et des nanofossiles calcaires (que nous n'avons bien sûr pas pu observer,
en raison de leur taille minuscule). Inversement, si l'énergie
reçue
se réduit,
la proportion de particules issues de l'érosion
continentale augmentera corrélativement, et il se formera des
couches de marnes ou d'argile plus tendres. Jaume
Dinarès-Turell, de l'Institut
National de Géophysique italien, a contribué à mettre
en évidence l'expression
de ces cycles climatiques et astronomiques à Zumaia. Il explique
que chaque
couple de strates composé d'une alternance
roche dure/roche tendre (calcaire/marne) correspond à une séquence
de 21 000 ans, notamment dans la portion remontant au Danien, non perturbée
par des turbidites. Celle-ci correspondrait au phénomène
de précession
des équinoxes. Un cycle plus long de 100 000 ans semble aussi
perceptible (5 alternances de
21 000 ans) en raison de la combinaison avec le paramètre de la
variation d'excentricité de l'orbite. -
Photo : Un rythme décelable à la lecture des strates. - Photo (ci-dessous)
: Images de foraminifères planctoniques
obtenues au microscope électronique à balayage. -
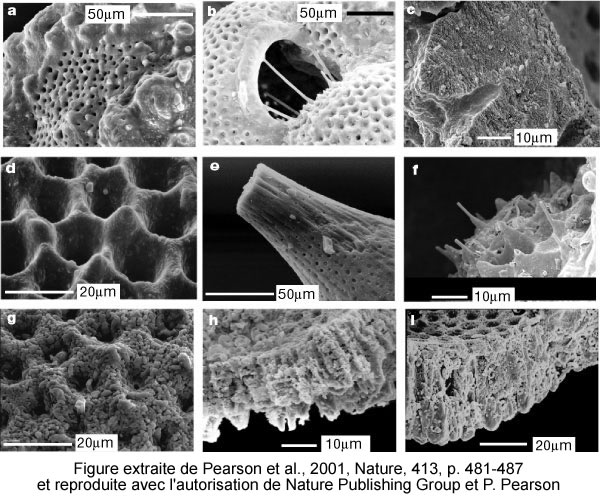
Remonter le temps et comprendre la succession des événements géologiques, climatiques et biologiques n'est pas chose aisée. Les scientifiques ne disposent que de très peu d'éléments et font preuve d'une grande imagination pour découvrir de nouveaux critères qui soient parlants. Cette problématique est abordée dans un film documentaire "Flysch, haitzen hitza" (Flysch, le murmure des roches) tourné à Zumaia en 2008, avec la contribution de Thierry Juteau parmi de nombreux scientifiques, experts en géologie, astronomie, biologie, climatologie, anthropologie et économie. Son objectif est de partager avec le public les résultats des recherches en montrant l'importance de connaître le passé pour prévoir l'avenir et nous adapter - autant que possible - aux changements. - Photo ci-dessous : Falaises à Zumaia. -
Les 60 millions d'années qui s'étendent devant nous sur ces quelques kilomètres que nous parcourons en bateau en longeant la côte depuis le petit port de Zumaia en direction de Deba et Mutriku offrent bien des sujets de réflexion. Le niveau de la mer, par exemple, a varié souvent de façon très sensible dans le passé. Je savais déjà que les alignements mégalithiques bretons se prolongent dans l'océan, indices d'un trait de côte plus lointain - et d'un niveau marin plus bas - à l'époque de leur élaboration. A Zumaia, c'est la roche elle-même qui en a gardé la mémoire, à la limite D/S sous l'ermitage de San Telmo qui enregistre une grande baisse du niveau marin.
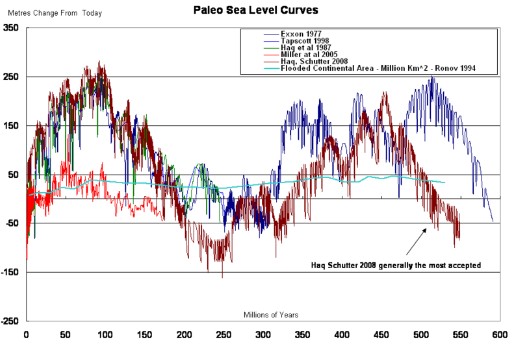 Les fluctuations du
niveau des océans de grande amplitude sur le très long
terme pourraient être la conséquence de la tectonique
des plaques. Les continents, dont le volume s'accroît en permanence
par subduction, se maintiennent à la surface du globe grâce à
leur faible densité. Ils réduisent
ainsi progressivement l'espace dévolu aux océans dont
le niveau s'élève
depuis le début de l'histoire
de la
Terre.
Lorsque deux plaques entrent en collision, il
se
produit
une compression
et un soulèvement des roches qui occupent moins de surface.
L'espace libéré
est envahi par les océans dont le niveau global s'abaisse corrélativement.
A l'inverse, lorsque l'orogenèse se termine, l'érosion
des reliefs vient combler les fonds marins et le niveau des océans
remonte. D'autres facteurs
peuvent contribuer à la hausse du niveau marin : une forte activité
des dorsales océaniques qui hausse le plancher océanique,
la fonte des
glaciers, un réchauffement planétaire qui accroît
le volume océanique...
Inversement, les glaciations, le regroupement des continents font baisser le
niveau marin. Il y a 100 Ma, le niveau marin était à 265
mètres au-dessus du niveau actuel, puisque la dissociation Europe-Amérique
au cours du Crétacé induisait l'ouverture de l'Atlantique.
Par contre, durant la dernière glaciation, il était 120
mètres au-dessous. - Schéma :
Diverses sources d'évaluation du niveau marin, celle de Haq
Schutter 2008 étant la plus
reconnue. -
Les fluctuations du
niveau des océans de grande amplitude sur le très long
terme pourraient être la conséquence de la tectonique
des plaques. Les continents, dont le volume s'accroît en permanence
par subduction, se maintiennent à la surface du globe grâce à
leur faible densité. Ils réduisent
ainsi progressivement l'espace dévolu aux océans dont
le niveau s'élève
depuis le début de l'histoire
de la
Terre.
Lorsque deux plaques entrent en collision, il
se
produit
une compression
et un soulèvement des roches qui occupent moins de surface.
L'espace libéré
est envahi par les océans dont le niveau global s'abaisse corrélativement.
A l'inverse, lorsque l'orogenèse se termine, l'érosion
des reliefs vient combler les fonds marins et le niveau des océans
remonte. D'autres facteurs
peuvent contribuer à la hausse du niveau marin : une forte activité
des dorsales océaniques qui hausse le plancher océanique,
la fonte des
glaciers, un réchauffement planétaire qui accroît
le volume océanique...
Inversement, les glaciations, le regroupement des continents font baisser le
niveau marin. Il y a 100 Ma, le niveau marin était à 265
mètres au-dessus du niveau actuel, puisque la dissociation Europe-Amérique
au cours du Crétacé induisait l'ouverture de l'Atlantique.
Par contre, durant la dernière glaciation, il était 120
mètres au-dessous. - Schéma :
Diverses sources d'évaluation du niveau marin, celle de Haq
Schutter 2008 étant la plus
reconnue. -
Curieusement, durant cette période de 65 à 55 Ma, de fortes variations du niveau marin, de 50 à 150 mètres, semblent s'être produites sur tout le globe (variations eustatiques) et demeurent inexpliquées. Après une chute à la limite KT (65 Ma), il y a eu progradation, jusqu'à un très haut niveau, puis à 60 Ma, une nouvelle chute de quelque -20 m, s'est produite, pratiquement identique à la précédente. Ensuite, jusqu'à la limite avec l'Eocène, le niveau est remonté progressivement jusqu'à +15 m. Cette évolution est celle de l'ensemble du globe et correspond à un stade de haut niveau marin. En Europe, la plupart des terres sont immergées. Pourtant, on constate dans ces roches du Paléocène des indices de températures élevées. Un climat sub-tropical règne sur l'ensemble de la Terre, avec (sans doute) des saisons peu marquées. Une flore tropicale s'étend jusqu'à 50° de latitude (celle de Bruxelles aujourd'hui) de part et d'autre de l'équateur. - Photo : Chapelle San Telmo à Zumaia. -
 Les
roches
du
Paléocène ont également
enregistré plusieurs
pics (6) de réchauffement planétaire
d'une durée de 20 000 à 200 000 ans dont le
maximum a été atteint
il y a 55 Ma (les roches rouges de la limite Paléocène/Eocène
P/E, qui sont visibles en descendant vers la plage d'Itzurun à Zumaia).
Ces pics ont été
mis en évidence grâce
aux
modifications
de la faune benthique (petits organismes invertébrés
comme les foraminifères),
de la chute relative de l'isotope de carbone d13C et d'autres facteurs
comme l'isotope d'oxygène d18O. L'origine
de cette crise climatique appelée PETM (Paleocene-Eocene Thermal
Maximum) est
encore débattue. Elle proviendrait d'un brutal effet de serre, mais
les sources possibles
d'émissions de carbone sont multiples
: – libération d’hydrates
de méthane (*) dans
les océans par augmentation de température ou chute
de pression ;
Les
roches
du
Paléocène ont également
enregistré plusieurs
pics (6) de réchauffement planétaire
d'une durée de 20 000 à 200 000 ans dont le
maximum a été atteint
il y a 55 Ma (les roches rouges de la limite Paléocène/Eocène
P/E, qui sont visibles en descendant vers la plage d'Itzurun à Zumaia).
Ces pics ont été
mis en évidence grâce
aux
modifications
de la faune benthique (petits organismes invertébrés
comme les foraminifères),
de la chute relative de l'isotope de carbone d13C et d'autres facteurs
comme l'isotope d'oxygène d18O. L'origine
de cette crise climatique appelée PETM (Paleocene-Eocene Thermal
Maximum) est
encore débattue. Elle proviendrait d'un brutal effet de serre, mais
les sources possibles
d'émissions de carbone sont multiples
: – libération d’hydrates
de méthane (*) dans
les océans par augmentation de température ou chute
de pression ; – éruptions
volcaniques massives en liaison avec les phases finales de l’ouverture
océanique de l’Atlantique nord, – recrudescence
de l’hydrothermalisme des
dorsales ; – intrusion de sills
volcaniques dans des bassins très riches en matière
organique en mer de Norvège, production de méthane
par métamorphisme de contact et éruption sur le fond
marin ; – émersion de mers épicontinentales par
chute du niveau marin (provoquée par le soulèvement
lié au rifting de l’Atlantique nord ou la fermeture
de la Néo-Téthys par collision entre Inde et Eurasie),
puis dessiccation et altération du carbone organique sédimentaire
par l’activité bactérienne... - Photo :
Foraminifères, au corps protégé par une coquille,
d'une taille du millimètre, mais pouvant atteindre quelques
centimètres chez les nummulites (visibles au Rocher de la
Vierge à Biarritz). - Phare du port de Zumaia. -
(*) Le méthane provient de la décomposition des matières organiques enfouies dans les sédiments des fonds marins. En se dégageant, il migre doucement vers la surface et, en présence d’eau et à des températures et pressions convenables, il est piégé sous forme d’hydrates de méthane, une forme solide qui reste stable tant que la température et la pression ne varient pas. Ils sont constitués de molécules de méthane entourées par un réseau de molécules d’eau disposées en cage, d’où le nom de clathrate, du latin clatatrus, encapsulé, aussi donné aux hydrates. La quantité de méthane emprisonnée est considérable puisque un volume d’hydrate peut contenir jusqu’à 160 fois son volume de méthane (volume de gaz à 0°C et à une pression de 160 mm de Hg). A la température ordinaire, la cage de molécules d’eau se dissocie, l’eau s’écoule et le méthane est libéré. - Photo : Le bateau du Geoparkea. -
Toutefois,
les
isotopes du carbone contenu dans les carbonates marins et les organismes
terrestres montrent dans la strate du PETM
une abondance anormale de l'isotope de carbone 12C par rapport au 13C.
Cette excursion négative du d13C dont l’importance est de
plus de 2,5‰ ne pourrait être expliquée que par la
libération de grandes quantités de carbone organique qui
se trouvaient stockées dans des hydrates (Dickens, 2003), induisant
ainsi un changement climatique global et rapide
(1 000 à 10
000 ans pour apparaître). Mais il lui faudra 200 000 ans pour
se résorber. - Photo : Eglise de Zumaia.
-
 Outre
le réchauffement planétaire et l'acidification des
océans, le PETM a été accompagné de perturbations
majeures de l’environnement : modification des circulations océaniques,
modifications régionales du régime des précipitations
et de l’hydrologie des bassins versants, alternances saisonnières
renforcées entre aridité et humidité, crues catastrophiques
renforçant ruissellement et apports terrigènes et en nutriments
aux océans. Il a bouleversé la répartition des
milieux de vie et niches écologiques, les régimes trophiques
et chaînes
alimentaires. Ces changements ont eu des conséquences non négligeables
sur les populations végétales et animales, et sur la biodiversité,
qui s’en est trouvée modifiée. - Photo : Algues dans
les creux de rochers près de la limite K/T. -
Outre
le réchauffement planétaire et l'acidification des
océans, le PETM a été accompagné de perturbations
majeures de l’environnement : modification des circulations océaniques,
modifications régionales du régime des précipitations
et de l’hydrologie des bassins versants, alternances saisonnières
renforcées entre aridité et humidité, crues catastrophiques
renforçant ruissellement et apports terrigènes et en nutriments
aux océans. Il a bouleversé la répartition des
milieux de vie et niches écologiques, les régimes trophiques
et chaînes
alimentaires. Ces changements ont eu des conséquences non négligeables
sur les populations végétales et animales, et sur la biodiversité,
qui s’en est trouvée modifiée. - Photo : Algues dans
les creux de rochers près de la limite K/T. -
En
milieu marin, la baisse de la saturation en carbonate et l'acidification (*) de
l'océan, le déclin de sa ventilation, de son oxygénation,
et une réduction globale des ressources alimentaires, tous ces éléments étant
liés à l'injection massive de gaz carbonique, ont provoqué
une extinction notable des foraminifères benthiques. Les faunes
d’ostracodes et de foraminifères agglutinés
se sont renouvelées dans les mers profondes, on a constaté la
présence
transitoire de faunes spécifiques
de foraminifères planctoniques et de nannoplancton calcaire,
une acmé et un pic de diversité des espèces de
dinoflagellés
Apectodinium. En milieu continental, renouvellements, disparitions
et chute de la diversité taxonomique affectent les flores. Parmi
les animaux, différents groupes archaïques disparaissent,
et des groupes modernes apparaissent. C’est le cas pour les tortues,
certains lézards, grenouilles et surtout les mammifères. -
Photo : Fossile. -
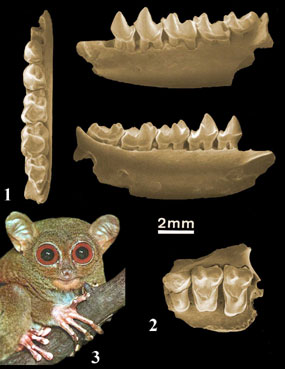 (*)
L'acidification océanique
est une menace particulièrement
pour les espèces dépendantes du carbonate de calcium
(un composé chimique qui diminue au fur et à mesure que
les océans s’acidifient) telles que les récifs
coralliens, les mollusques marins et même certains planctons,
leur disparition induisant celle des milliers d'autres espèces
qui en dépendent. Lors du PETM, le pH des océans
a chuté d'approximativement 0,45 unité sur une durée
de 20 000 ans. - A titre de comparaison, celui-ci a chuté de
0,1 unité, rien qu'au cours du XXe siècle -.
(*)
L'acidification océanique
est une menace particulièrement
pour les espèces dépendantes du carbonate de calcium
(un composé chimique qui diminue au fur et à mesure que
les océans s’acidifient) telles que les récifs
coralliens, les mollusques marins et même certains planctons,
leur disparition induisant celle des milliers d'autres espèces
qui en dépendent. Lors du PETM, le pH des océans
a chuté d'approximativement 0,45 unité sur une durée
de 20 000 ans. - A titre de comparaison, celui-ci a chuté de
0,1 unité, rien qu'au cours du XXe siècle -.
Les périssodactyles, artiodactyles et primates apparaissent, se diversifient et se répandent très rapidement dans l’hémisphère Nord. La migration du plus ancien primate Teilhardina (56-47 Ma) s’est ainsi réalisée en moins de 25 000 ans de l’Asie vers l’Amérique, en passant par l’Europe. Les vertébrés terrestres ont pu emprunter certains passages émergés à de hautes latitudes via le détroit de Béring, le Groënland et à la faveur des reliefs liés au rift de l’Atlantique nord naissant. À l’époque, ces zones étaient des havres subtropicaux, à la végétation luxuriante. - Photo : Mandibule (1) et mâchoire supérieure (2) de Teilhardina, un des premiers primates, qui vivait dans l'Éocène inférieur ; le tarsier (3), le parent récent le plus proche de Teilhardina. -
Un autre effet un peu curieux du PETM apparaît chez les mammifères. Les chevaux de cette époque, qui étaient de la taille d'un petit chien, se réduisirent à celle d'un chat siamois, pour reprendre ensuite leurs dimensions normales après restauration du climat, selon une analyse basée sur des fossiles des badlands du Wyoming. La chaleur associée à l'excès de dioxyde de carbone aurait profité aux plantes dont la croissance aurait réduit la proportion de protéines, les rendant moins nutritives pour les herbivores. - Photo : Sortie du port de Zumaia en bateau. -
| Page précédente | Page 2/3
|