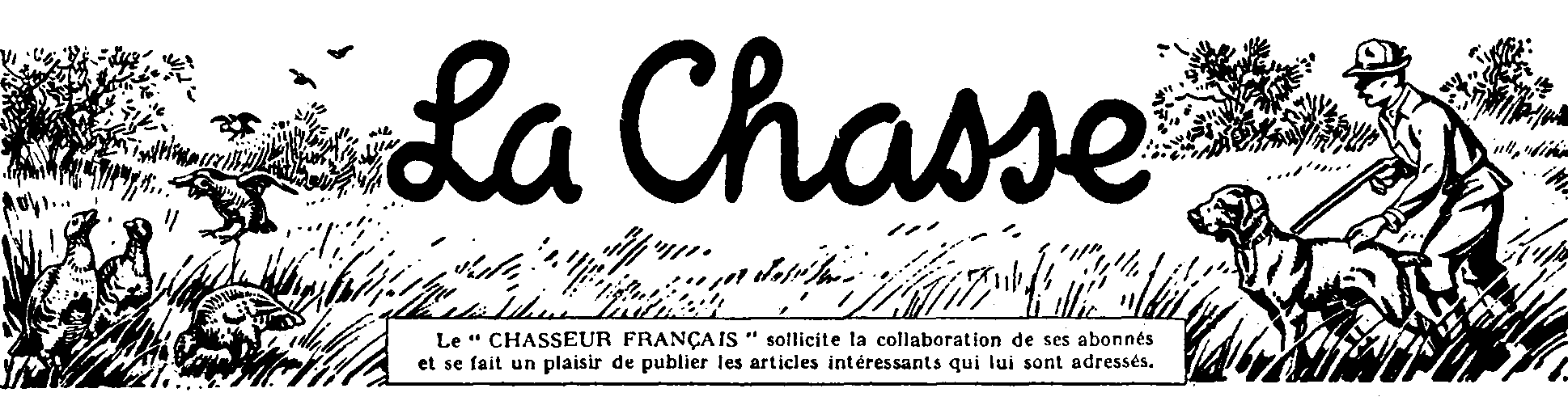| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°596 Février 1940 > Page 71 | Tous droits réservés |

|
Diane, chienne de Brière |

|
|
Le jour était encore incertain. Vers l’Est, une épaisse bordure noire. Un deuil du soleil ? Non, un soleil paresseux simplement. La fenêtre de sa chambre est fermée, tout à l’heure il ouvrira un œil, puis l’autre, tout apparaîtra mauve et rosé. Il sort de sa couche, un quart de mauvais teint, puis une grosse moitié sans rayons. Enfin, comme à regret, le voici. Il imite timidement une lune morte, la brume reprend le dessus et le noie petit à petit, jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement. Le ciel se couvre, le vent tourne à l’Ouest ; au mois de novembre, ces levers du soleil n’annoncent rien de bon pour le reste de la journée. Le marais est vide de canards ; c’est ainsi que, sans enthousiasme, mais avec cette magnifique « confiance malgré tout » du chasseur de sauvagine, j’ai quitté la Brière en ce jour de fin novembre vers neuf heures du matin pour tenter quelques approches en Loire. Très rapidement nous y arrivons, le punt est armé, nous embarquons mes deux douze, mon grand huit, les cartouches, l’extincteur, l’épuisette, et quelques victuailles indispensables. La chienne d’Albert Troffigué, Diane, une bonne bretonne, a bondi la première dans le bateau. Comme un inspecteur de bord, elle s’intéresse à tout, elle renifle avec passion aussi bien le panier aux provisions que l’épuisette qui sent le canard à plein nez. Un bon point au moteur que Frédéric a sagement graissé et nourri : il bondit au quart de tour, comme s’il voulait prendre sa part des plaisirs de la journée ... En avant ! À plein gaz, nous suivons le petit canal qui doit nous emmener jusqu’à la Loire. Le ciel est bas, un ciel de novembre dans toute sa tristesse, envoûtant ces paysages qui ont été fixés pour lui et les imprégnant d’un charme émouvant. Le chasseur de sauvagine aime ces grisailles fondues qui rendent encore plus mystérieuses les surprises de l’attente ou les angoisses de l’approche. En nous frôlant de ses ailes, une mouette nous suit bêtement, elle paraît quémander quelque pitance. Un chevalier se lève de la bordure des roseaux, je le perds dans la brume, j’entends son cri d’adieu, dramatique comme une plainte de désespéré. On pourrait croire que le chant de certains oiseaux leur a été donné pour créer l’ambiance. Nous voici en pleine Loire, les vagues s’amusent de nous. Le bateau danse, danse dans le courant; il serait impossible d’approcher une bande de gibier dans ces conditions, mais la passe rude est vite franchie. Les sarcelles sont là, à la pointe du banc de la Garenne, sur les dernières de ces vases qui tout à l’heure seront baignées par la marée. Vingt sarcelles au repos. L’approche. Le moteur au ralenti. Nous sommes tous les trois couchés au fond du punt en position d’attaque. Une avance de quelques centimètres à la minute. En observant du coin de l’œil. Je les vois, les petites sarcelles ; elles sont encore imprécises dans le brouillard. Chacune d’entre elles me paraît un gros flocon gris sur un fond de même couleur, et cependant elles sont bien lointaines encore. Une tonalité de Copenhague luisante et glauque. Lentement nous approchons. Pourquoi les vagues viennent-elles se briser si bruyamment sur l’avant de notre punt ? ... Nous approchons : les unes me semblent endormies, la tête sous l’aile; d’autres voltigent, se reposent doucement. Si le moteur pouvait s’arrêter, si le bateau pouvait s’en aller, sans bruit, vers les petites sarcelles, comme un bateau de rêve. Ce sont là mes pensées du moment. Je me cramponne à mon huit, nous sommes presque à portée, à cent mètres peut-être, je les vois maintenant distinctement. Elles paraissent s’agiter, battent des ailes comme pour s’entraîner au départ ; un malard se tourne vers nous et lève la tête. Je n’aime pas ça ... Encore quarante mètres et l’approche est réussie, ma respiration est courte, ma tension est folle, le vol s’enlève ... Tout est perdu ! Non ! elles reviennent se poser sur la même pointe de vase. Pendant cet intermède, le punt a gagné vingt mètres. Tout s’envole à nouveau. Mes deux coups partent très vite, j’ai tiré trop bas; une seule sarcelle vient de tomber raide en bordure des roseaux, à cent mètres. Impossible d’aller la chercher, le pain de suif de ces vasières de Loire est trop mou, leur profondeur atteint trois mètres ; comment s’y aventurer sans palettes ! ... Mais, sans que nous puissions la retenir, Diane, qui a vu tomber la sarcelle, s’est élancée vers les roseaux, à la nage d’abord, puis à pattes dans la vase. Elle enfonce jusqu’au poitrail, essaye de se dégager. Nous la rappelons, mais le vent ne porte pas, elle enfonce encore, la pauvre bête, disparaît dans les roseaux, nous la perdons de vue, nous l’entendons de loin lutter contre l’enlisement, elle pleure, elle ressort, non ! ses plaintes semblent s’éloigner, l’émotion est grande pour nous qui vivons le drame, nous continuons à appeler la chienne. Puis nous n’entendons plus rien. Nous souffrons d’être dans l’incapacité de porter secours à notre cher compagnon de chasse. Nous essayons de gagner la rive des roseaux de l’autre côté, plus près de l’endroit où nous avons vu notre chienne disparaître, la mer baisse et nous éloigne d’elle. Nous appelons encore. Soudain, les gémissements reprennent, ils semblent plus faibles et cependant peut-être plus confiants. Quel bonheur ! La voici qui apparaît à la sortie des roseaux, à cent mètres de nous. Pauvre Diane ! elle n’a plus forme canine, elle est entièrement recouverte de boue. Longtemps encore elle lutte sous nos yeux pour combler la distance qui la sépare du bateau, alternatives d’espoir et de désespoir ! Elle n’était plus qu’à trente mètres de nous, lorsqu’elle s’enfonça dans un coulisseau où l’eau, quoique très crémeuse, lui permettait de nager. Une minute après, elle était prise à bras le corps et déposée dans le punt, sur le flanc. Sauvée !!! Quel soulagement ! Elle grelottait de froid et geignait de fatigue. Un petit tas de boue pendait lamentablement de sa bouche ! la petite sarcelle qu’elle n’avait pas voulu abandonner ... Je vous le dis sans fausse honte, j’ai eu bien des émotions dans ma vie. Mais ce jour-là, en regardant Diane lutter fidèlement pour accomplir son devoir, j’ai eu beaucoup de peine à retenir mes larmes. J. de WITT. |
|
|
Le Chasseur Français N°596 Février 1940 Page 71 |
|