| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°598 Avril 1940 > Page 203 | Tous droits réservés |
Veillées de chasseurs

|
Souvenirs du bord de l’eau |

|
|
Je crois avoir rapporté ici même comment, en 1935, je crois, mon ami Marcel Charbonnier, le grand tireur international et chasseur bourbonnais, spécialiste des descentes de l’Allier en canoé, l’hiver, à la surprise des canards, avait fait naufrage par cinq mètres de fond. Ayant regagné le bord à la nage et ôté ses bottes, il n’avait pas hésité à repiquer une tête dans le bain glacé, volontairement cette fois, afin de repêcher les deux brownings engloutis qui ne furent d’ailleurs jamais retrouvés. Il m’est arrivé un jour de sombrer également, non en bateau, mais de la terre ferme. L’affaire eût pu, tout comme dans le cas de Marcel Charbonnier, se terminer tragiquement car je n’avais pas pied, et, mon éducation sportive ayant été, du côté natatoire, complètement négligée, je ne vivrais plus que dans le souvenir de quelques personnes, si, cette fois, mon fusil ne m’avait sauvé. Il y a quinze, douze et dix ans, nous chassions chaque hiver, mon frère et moi, dans les Landes, sur les bords de l’étang de Parentis-en-Born, coin sauvage et retiré, habité par des gens aimables, où l’on circulait librement et mangeait à merveille. La chasse y est toujours autorisée, sans doute ; mais la région n’a plus tout à fait le même caractère, vu l’accroissement de population dans cette région et le bouleversement de mœurs que cela comporte. Enfin, on a balisé l’étang, ce qui le défigure et lui retire ce cachet de nature vierge d’une si plaisante mélancolie dans son immobile majesté. Enfin ... En ces temps très anciens, on ne faisait pas les 7 ou 8 kilomètres d’un des côtés de la vaste étendue d’eau, sans rapporter une ou deux demi-douzaines de bécassines, suivant le moment et l’intensité du passage. Il ne se passait point non plus de matinée sans qu’on ne levât quelque biganou égaré le long des cent et un ruisselets qui serpentent dans la forêt landaise, ou une bécasse dans les taillis de chênes. L’Arcadie du chasseur ... C’est cette Arcadie qui faillit devenir le tombeau liquide du chasseur soussigné, si on lui pardonne cette image audacieuse. Je cherchais un après-midi, et seul, une bécassine dans la queue ouest de l’étang, ou plutôt sur le terrain ferme en bordure de la dite queue. Ce terrain renfermait de petites mares hospitalières aux oiseaux. Sans m’en rendre compte, et trompé par l’uniformité des joncs, je franchis la démarcation entre la terre et l’eau, la rive étant à pic à cet endroit et le fond de plus 2m,50. Je me sentis descendre, perpendiculairement, comme un pieu vigoureusement enfoncé dans la vase molle. L’espace d’un éclair, j’avais compris, me rappelant les recommandations faites au sujet des dangers de l’endroit. Inconsciemment, mais inspiré par l’instinct de défense et de conservation, j’avais, en glissant dans le gouffre, donné un coup de reins désespéré, me retournant vers la berge distante d’un bon demi-mètre et réussissant à y plaquer le fusil que je tenais des deux mains, et qui me servit de point d’appui pour remonter péniblement après avoir repris ma respiration et mes esprits commotionnés. Sorti de cette prodigieuse baignoire et sommairement ébroué, je rentrai, je dois le dire, en droiture au logis et ne chassai pas plus avant ce jour-là. Je n’ai jamais oublié l’intensité de ces quelques secondes et, dans la suite immédiate, je rayai la queue d’étang de mes explorations quotidiennes. Le Born est vraisemblablement propice aux aventures, car il m’en advint une autre, presque au même endroit, et quelques jours plus tard, toujours en l’absence de mon frère et compagnon de chasse. Je l’ai contée déjà ailleurs et m’excuse auprès de ceux qui en auraient eu connaissance. Chacun sait que l’on appelle « tonne », dans les Landes, l’installation d’affût, sommaire ou perfectionnée, où l’on guette les passages de gibier, sur les bords de mer ou de lacs. Il y a beaucoup de « tonnes » le long de ce chapelet d’étangs qui borde la côte de la Pointe de Grave à l’Adour ; mais la plus réputée pour son confort est incontestablement celle de M. Lipostey sur l’étang de Parentis-en-Born. Elle est célèbre dans tout le département et comprend cave, bibliothèque, cabinet de toilette, cuisine, etc. Ce n’est même plus une tonne, mais un endroit de villégiature. On y passerait six mois. L’ambition de tous les chasseurs du Born est d’être invité par M. Lipostey. C’est une consécration. L’histoire que l’on raconte ensuite en prend un éclat particulier : « Une nuit que nous étions à la tonne de M. Lipostey ... » et les canards qu’on y tue paraissent deux fois plus gros qu’ailleurs. Nouveau venu à Parentis, je n’avais pas tardé à subir l’envoûtement, ou plutôt l’entonnement commun. En poursuivant la bécassine sur les deux rives de l’étang, je ne pouvais m’empêcher de jeter de temps en temps un regard de convoitise à la silhouette large et trapue de la tonne renommée, à l’air glorieux et inaccessible au milieu de l’étang, ainsi que Malte en Méditerranée. Mais je poussais un soupir et chassais bien vite le mirage, car, ne connaissant M. Lipostey ni d’Ève ni d’Adam, il n’y avait aucune raison vraiment qu’il se souciât de moi un jour. Et pourtant, j’y fus plus tôt que je le pensais, à la tonne de M. Lipostey ... Un soir, à la queue de l’étang, à l’endroit où s’y jette un des bras de la Leyre, j’abattis une bécassine qui tomba dans la rivière et, emportée par le courant, descendit vers le large. Une longue barque plate s’allongeait, du bord dans l’eau. L’oiseau allait passer près de l’extrémité. En me penchant, je pourrais le saisir par le bout de l’aile. Vivement, je posai mon fusil sur la berge et, d’un bond, sautai dans la barque légère, qui, sous mon impulsion, quitta la rive où ne la retenait nulle amarre et s’abandonna, avec sa cargaison ahurie, au courant qui la drossait vers le milieu de l’étang, droit sur la tonne de M. Lipostey ... Les rames étaient restées sur la rive avec le fusil. Du fond de lectures anciennes me revint le souvenir de forçats évadés qui pagayaient avec leurs mains. Je tentai vainement, par ce moyen précaire, de regagner le bord. Après vingt minutes d’une navigation sans histoire, le bateau tournoyant m’offrant tour à tour les quatre points cardinaux du décor sur quoi la lune commençait de sourire, j’abordai à la terre promise. À vrai dire, dans ces conditions particulières, ça ne me paraissait plus du tout la terre promise ... Que faire ? Appeler ? Je me trouvais a quatre kilomètres de toute habitation et les abords du lac, le soir, ne sont fréquentés que par les chouettes ou les renards. Par les canards aussi. La passée fut magnifique ... J’y assistai platoniquement, recroquevillé contre la porte verrouillée de la tonne, le ventre creux et dans un perpétuel courant d’air, « Ah ! fichtre, oui, on peut en parler du confort de la tonne de M. Lipostey, grommelais-je tout bas ... Il est bien surfait... » Le lendemain matin, je fus recueilli par la pinasse de l’adjudicataire de pêche, qui avait heureusement, dans le gaillard d’arrière, un boujaron de vieux rhum. L’histoire, bien entendu, fit le tour du pays et vint aux oreilles ravies de M. Lipostey. Et, depuis, j’ai passé plus d’une nuit à sa tonne ... Mais à l’intérieur, et avec un fusil ... Jean LURKIN. |
|
|
Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 203 |
|
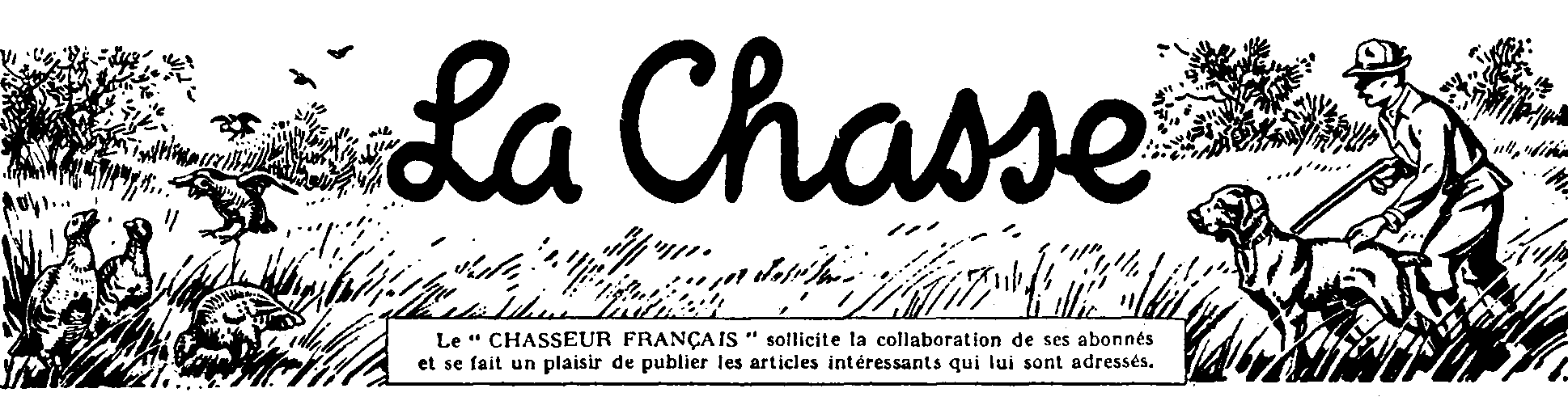
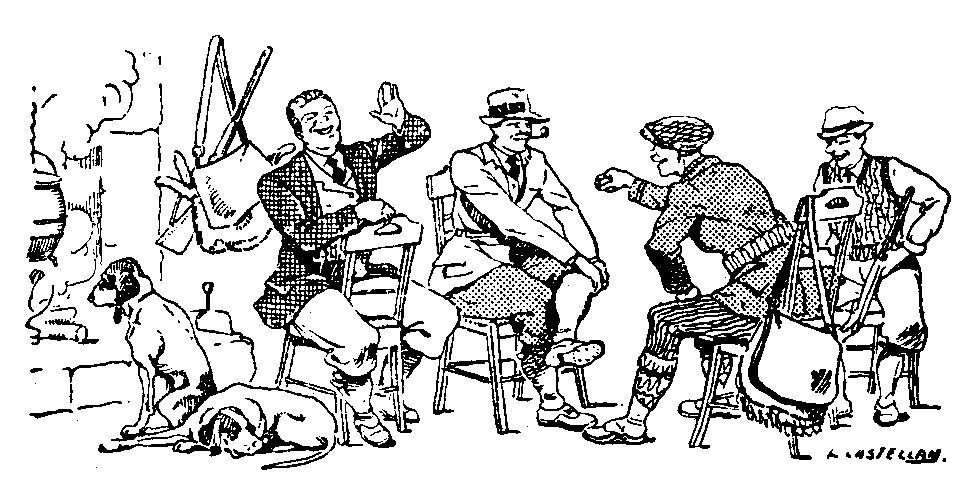 De toutes les chasses à tir, celle du gibier d’eau
est sans contredit la plus fertile en émotions et péripéties diverses, passant
par toutes les gammes du comique au tragique. La chute à l’eau constitue
évidemment le fond le plus fréquent de cette sorte d’aventures. Lorsqu’on en
sort, on peut généralement cataloguer l’épisode dans le genre amusant, à moins
que les conséquences en aillent jusqu’à la fluxion de poitrine. Mais on peut
n’en pas sortir. La chronique cynégétique en a rapporté de nombreux exemples,
et les faits-divers de l’espèce, barques chavirées, noyades, affûteurs surpris
par la marée, s’y retrouvent régulièrement.
De toutes les chasses à tir, celle du gibier d’eau
est sans contredit la plus fertile en émotions et péripéties diverses, passant
par toutes les gammes du comique au tragique. La chute à l’eau constitue
évidemment le fond le plus fréquent de cette sorte d’aventures. Lorsqu’on en
sort, on peut généralement cataloguer l’épisode dans le genre amusant, à moins
que les conséquences en aillent jusqu’à la fluxion de poitrine. Mais on peut
n’en pas sortir. La chronique cynégétique en a rapporté de nombreux exemples,
et les faits-divers de l’espèce, barques chavirées, noyades, affûteurs surpris
par la marée, s’y retrouvent régulièrement.