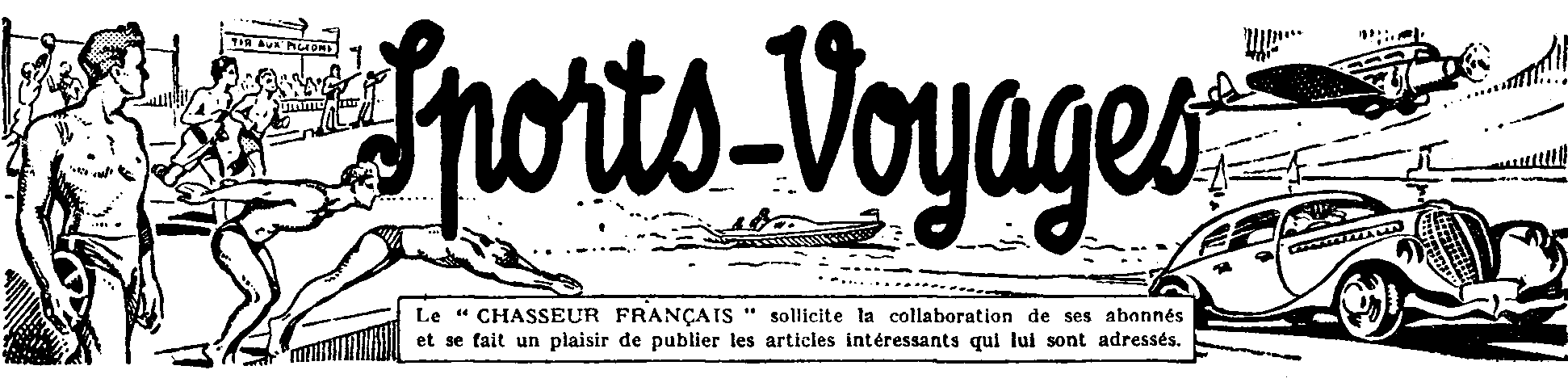| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°598 Avril 1940 > Page 218 | Tous droits réservés |

|
Le tourisme intellectuel |

|
|
« Il faudrait, a dit quelque part André Maurois, qu’ayant relu un beau livre, ceux qui ont à la fois le culte des lettres et le goût du voyage aillent voir le pays où ce livre fut conçu ; qu’ils se plaisent à retrouver dans les paysages naturels les premières esquisses ou les prétextes des tableaux que créa l’artiste qu’ils aiment ; qu’ils suivent, à travers une province, de maison en maison, de village en village, les pas et la vie d’un grand homme. Je crois qu’ils trouveront à de telles promenades un charme inimitable, car la beauté de la nature se trouvera animée et rehaussée par le souvenir de l’émotion qu’elle engendra, et telle page, objet, depuis longtemps, de leur prédilection, prendra pour eux plus de prix, parce qu’ils l’auront relue, dans le décor où elle fut écrite ... » Quel charme ne goûte-t-on pas, en effet, à suivre Balzac, ce guide incomparable, à travers les paysages où se meuvent les personnages de son épopée aux cent actes divers, les rues étroites de Poitiers ou celles escarpées de Châteauroux, les landes des Chouans ou cette merveilleuse Touraine et les bords ombragés de l’Indre où se déroule la douloureuse idylle du Lys dans la Vallée. Qui n’aurait voulu parcourir l’Italie et l’Espagne avec, en mains Dumas et Gautier ! On cherche Stendhal dans le Dauphiné, Berlioz à la Côte Saint-André ; on évoque Jean-Jacques à Annecy et aux Charmettes et Taine au Roc de Chère. Ainsi nos écrivains, par la vie qu’ils ont donnée à nos paysages, constituent-ils pour ceux-ci la meilleure des propagandes. Croit-on que le lac du Bourget serait aussi universellement célèbre-sans Lamartine ? Alors que ce grand poète est quasi oublié en France, il n’est pas une Université en Europe ou dans le Nouveau Continent ou des centaines de jeunes gens et de jeunes filles n’aient lu et appris Le Lac et savent s’en souvenir. Il serait bon que l’on établît ainsi, pour le jour où la paix sera revenue, des guides touristes-littéraires, comme cet « Itinéraire des sites lamartiniens de Savoie », que fit paraître, il y a déjà quelques années. Mme Michaud-Lapeyre, avec une préface du Président d’honneur du Touring-Club, Léon Auscher. Avec l’auteur, on parcourt les sites devant lesquels Lamartine s’est laissé aller à des émotions qui nous ont valu ses plus beaux poèmes. On fait des haltes autour du lac, on visite les châteaux de la campagne savoyarde, la Sainte-Chapelle de Chambéry. Le sentiment que nous avons éprouvé, à la lecture de ces vers, nous le comprenons mieux en entrant dans la maison où les souvenirs de l’auteur sont encore vivants, en posant nos pieds sur ce gazon où la page préférée aura été écrite. Nos voisins l’avaient bien compris, qui savaient réunir leurs fidèles autour de Wagner à Bayreuth, ou de Mozart à Salzbourg. Les Anglais, eux-mêmes, n’appellent-ils pas à Stratford-sur-Avon les amis de Shakespeare. Il faudra cependant faire un choix dans ses auteurs. Ce n’est pas, par exemple, dans le Voyage au Mont Blanc de Chateaubriand, qu’il faudrait chercher un encouragement à visiter les Alpes. Le grand romantique, en effet, revint de ce voyage, qu’il effectua cependant à deux reprises, en 1803 et en 1805, avec une véritable aversion pour la montagne, aussi bien savoyarde que suisse. Quelques critiques malicieux alléguèrent que, s’il avait rapporté de ces deux déplacements des visions aussi maussades, c’est qu’il avait fait le voyage …, avec sa femme ! Peut-être aussi, le génial écrivain s’est-il plu à prendre le contre-pied des sophismes de Rousseau qu’il n’aimait guère. « Où sont, disait-il, les fameux chalets tant vantés par Jean-Jacques ? Je n’ai trouvé que des méchantes cabanes remplies du fumier des troupeaux, de l’odeur des fromages et du lait fermenté. » Leurs habitants, « de véritables campagnards qui se regardent comme en exil et aspirent à descendre en plaine, c’est-à-dire en bon pays ». « Comment, se demande-t-il plus loin, peut-on s’extasier sur les vallées de la Suisse ? Leur verdure consiste-en quelques saules chétifs ; en quelques sillons d’orge et d’avoine qui croissent péniblement et mûrissent tard, en quelques arbres sauvageons qui portent des fruits âpres et amers. » Ce grand peintre de la nature a éprouvé devant la montagne une déception qui va en s’accentuant. « Dans l’intérieur des monts, écrit-il, il n’y a pas de lieux agréables à habiter. Les yeux et le cœur peuvent-ils être satisfaits, là où on manque d’air et d’espace ? Ces lourdes masses ne sont point en harmonie avec les facultés de l’homme et la faiblesse de ses organes. » Le Mont Blanc, lui-même, n’évoque en lui rien de sublime. Il ne semble élevé que du bas de la vallée où notre vicomte a la sensation d’être « dans un entonnoir. Cette grandeur des montagnes, dont on fait tant de bruit, n’est réelle que par la fatigue qu’elle vous donne ... Tout, ensemble et détails, se rapetissent dans le défilé des Alpes. Alors, il n’y a plus de rapport entre le tout et la partie ». Cette horreur de la montagne ne fut pas, chez Chateaubriand, une impression fugitive. Son antipathie persista, puisque, vingt-cinq ans après, l’auteur d’Atala écrivait : « J’ai beau me battre les flancs, pour arriver à l’exaltation des écrivains de montagne, j’y perds ma peine. » Chateaubriand fit l’ascension du Montenvers — qu’il écrit « Montanvert » — à dos de mulet. Inscrivit-il son nom sur le registre de l’auberge ? C’est douteux, en supposant, ce qui n’est pas certain, que le registre existât déjà au commencement du XIXe siècle. Le noble vicomte évita ainsi la mésaventure qui arriva une dizaine d’années plus tard à un autre gentilhomme, illustre poète lui aussi, lord Byron. C’était en 1816: Byron vivait à Genève en compagnie de son ami Shelley. Les deux poètes prétendaient les médisants, ne s’y ennuyaient pas. Byron, un jour, fit, avec quelques compatriotes, l’excursion du Montenvers. Prié de mettre sa signature sur le registre de l’auberge, il aperçut le nom de Shelley. Celui-ci, qui avait devancé son ami de quelques jours, avait, par suite de quelque forfanterie, ajouté à son nom le mot « athée », et un voyageur, survenu peu après, y avait ajouté cet autre mot « sot ». Par amitié, Byron raya les deux épithètes, pas assez nettement cependant, pour qu’un troisième voyageur, un autre poète anglais, Southey, mais qui était, celui-là, à l’opposé de l’école romantique, ne pût déchiffrer l’inscription et se rendre compte du nom de celui qui l’avait effacée. Il s’en suivit une guerre de plumes entre les deux écrivains, qui passionna l’Angleterre pendant six ans, d’autant que l’illustre lord parlait toujours d’aller pourfendre, sur son terrain, le poète lauréat. Les registres du siècle dernier ont-ils été conservés ? c’est peu probable. C’est regrettable, car, outre qu’ils auraient constitué, pour le musée de Chamonix de M. Henri Vallot, une attraction de premier choix, ils eussent apporté à la petite histoire littéraire une documentation pleine d’intérêt. On n’y trouverait pas, et pour cause, la fameuse réflexion de M. Perrichon sur la mèr ... e de glace, mais on y pourrait lire celle non moins humoristique, que l’on dit avoir été inspirée à Labiche lui-même par l’hôtelière d’alors. Celle-ci était, parait-il, jeune, jolie, aimable : quand elle lui présenta l’album, avec un sourire engageant, l’auteur de la Cagnotte, inscrivit galamment « La mer de glace ... a des filles de feu ». L’hôtelière, rapporte-t-on, redoubla d’amabilité. Mais, au moment où l’auteur allait quitter l’hôtel. — Permettez-moi, monsieur, dit le mari, de vous poser une question, sans que vous y voyiez de mal. — De quoi s’agit-il ? — J’ai lu la phrase que vous avez écrite sur le registre de l’hôtel. — Oh ! plaisanterie sans importance, pas plus. — Puis-je vous demander si c’est à propos de ma femme que vous avez écrit cela ? Labiche protesta avec indignation. Mais l’hôtelier continua : — Je le regrette, monsieur, parce que, dans ce cas, vous seriez revenu ! L’écrivain, qui était du reste en compagnie de son fils, et qui menait la vie bourgeoise la plus exemplaire, rit bien de l’aventure. Et c’est peut-être de là qu’est né l’immortel Voyage de M. Perrichon. Marcel VIOLLETTE. |
|
|
Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 218 |
|