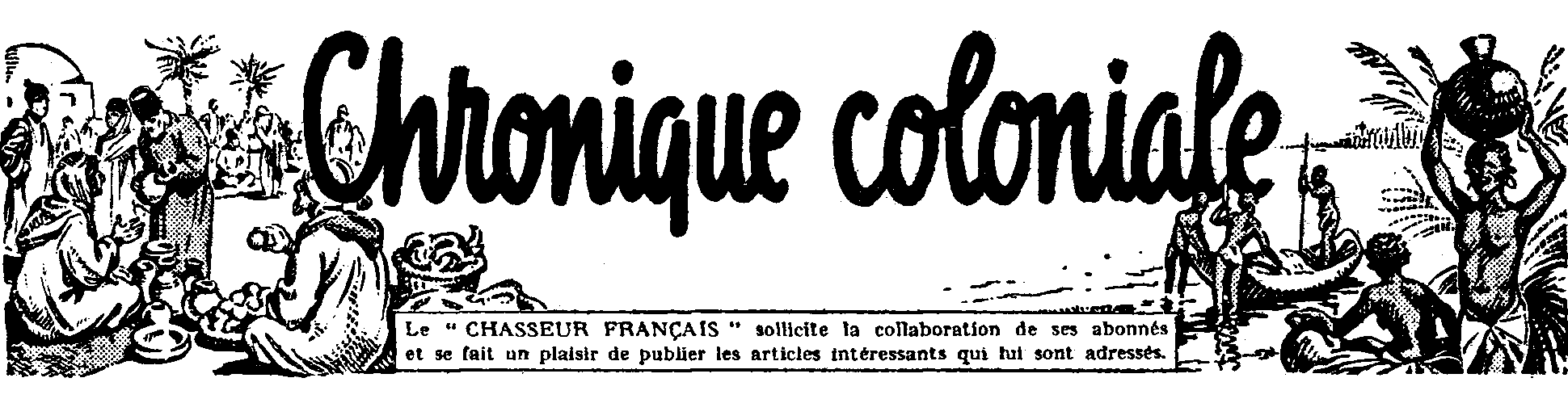| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°598 Avril 1940 > Page 248 | Tous droits réservés |

|
Les caïmans de Madagascar |

|
|
À l’époque, six ans avant la conquête, où je traversais Madagascar de bout en bout avec mes braves porteurs betsileos, les caïmans pullulaient sur la côte Ouest, dans le moindre marigot. Ils étaient vénérés comme dans l’ancienne Égypte, au temps des Pharaons. Le folklore sakalave, race guerrière et indisciplinée, est d’une grande richesse ; le caïman terrible joue toujours le premier rôle. Quand nous voguions sur le Betsibouc, dans une grande pirogue, manœuvrée par une douzaine de robustes pagayeurs, sous les ordres du chef-barreur, j’ai souvent pris ces gigantesques et affreux sauriens, couverts d’algues et de lichens, immobiles comme des blocs de granit, pour de gros troncs d’arbres de 6 à 8 mètres de longueur. Ces monstres fantastiques, comparables à ceux qui hantent nos cauchemars, sont de plus grands mangeurs d’hommes que les lions et les tigres. Ils pénètrent la nuit dans les cases des indigènes, saisissent leur proie et se perdent avec elle dans l’obscurité. De tous les spécimens de la faune malgache, il n’en est pas de plus impressionnants que les caïmans. Leur chasse, très attrayante, mais périlleuse, offre toutes les péripéties que peut souhaiter le chasseur le plus fougueux et le plus blasé. Leur peau épaisse, véritable carapace, ne saurait les rendre invulnérables. Le facteur décisif en l’espèce est l’homme derrière la carabine, il ne doit tirer qu’à coup sûr et dans les parties vitales. Les pêcheurs sakalaves attaquent sans crainte la pieuvre et même le requin ; rien ne saurait les décider à se mettre à l’eau pour ramener sur la rive le cadavre d’un caïman. À Morotsangana, poste que je venais de créer sur la côte de Mozambique, ils abondaient dans le plus petit ruisselet. J’en ai pris un long de 2 mètres, dans un trou de vase qui n’avait pas 50 centimètres de profondeur. Un vaste étang, entouré de palétuviers très élevés (le palétuvier est le rendez-vous préféré des moustiques), recelait toutes les espèces de gibier d’eau, depuis la poule sultane bleue aux pattes rouges jusqu’au royal aigle pêcheur dont la queue est d’une éclatante blancheur ; c’était aussi l’habitat d’un monstrueux caïman. Il avait tout l’air de ce qu’il était réellement, un survivant de la préhistoire. On peut tenir pour certain que les caïmans vivent normalement deux cents années ; ce spécimen unique avait, peut-être, vu s’écouler près de trois siècles. Il était légendaire dans toute la région du Nord-Ouest. Les indigènes, qui en tremblaient, le faisaient souvent suprême arbitre de leurs jugements. Il vivait là, honoré et tranquille, rôdant la nuit ; pour rien au monde, je n’aurais voulu être obligé de tuer ce monstre formidable qui à lui seul aurait fait la gloire et la fortune d’un zoo. Dans la journée, il quittait volontiers son séjour aquatique et dormait des heures entières couché sur le sable, sous un soleil torride et un ciel d’émail bleu qu’aucun nuage ne craque. Ici, le temps n’existait pas ; si loin du reste des hommes, sous le charme inexprimable de la nature vierge, de l’irrésistible magie du silence, au milieu de cette forêt où couve la mort, je m’occupais — distraction passionnante — à observer attentivement, ma carabine sur les genoux, ce « tabou » qu’une véritable amitié liait à un couple de grands buphages. Ces beaux oiseaux avaient le courage de s’intéresser au monstre. Ils besognaient activement sur son dos ou ailleurs, pour le débarrasser des sangsues, tiques, capricornes et autres parasites qui le rongeaient ; aucune partie du corps n’était négligée. L’affreux saurien ouvrait même son immense mâchoire, véritable herse, et les buphages pénétraient vivement dans le gouffre pour lui nettoyer les dents. Les soins assidus de ces jolies bestioles resteront, certes, un de mes plus pittoresques souvenirs malgaches. Il n’est pas un chasseur vivant qui ne serait heureux de tuer un caïman. Eh bien ! une ligne aérienne régulière met l’Ile-Rouge à six jours de la Métropole ; les caïmans y pullulent toujours, terreur des riverains. Paul CAZARD. |
|
|
Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 248 |
|