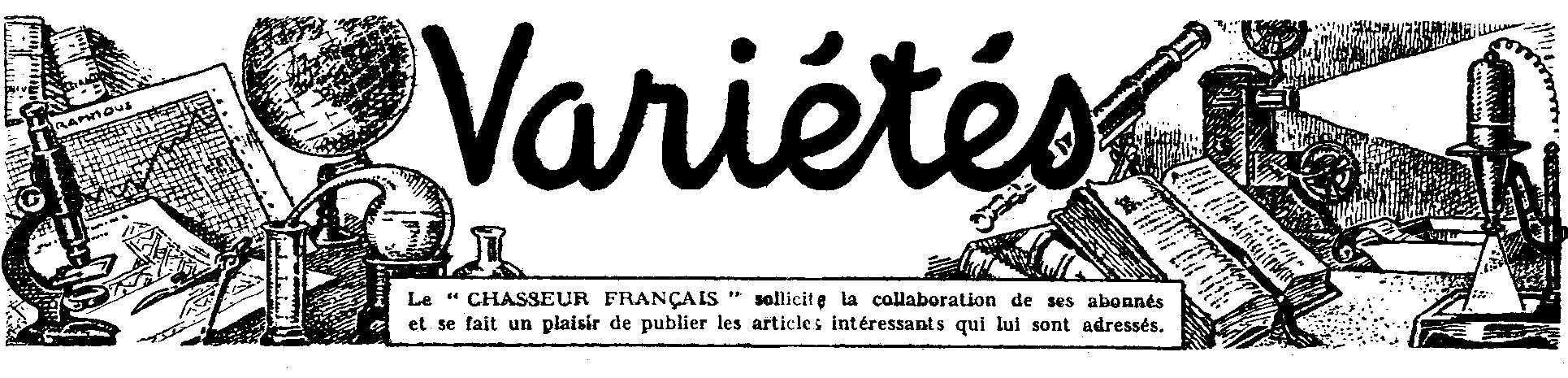| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°603 Novembre 1941 > Page 573 | Tous droits réservés |

|
Le rata des grognards de la grande armée |

|
|
La grande histoire, l’histoire-bataille, que l’on apprend dans les manuels, nous montre le soldat impérial sous un jour fort brillant. Il est beau, bien portant, vêtu d’un uniforme somptueux ; il a l’air de vaincre en se jouant de tout. Le beau grenadier de la Garde coiffé de son ourson qui pouvait contenir plusieurs bouteilles de vin, le hussard tout chamarré ont l’air, sur les estampes, d’être bien habillés et bien nourris. Si nous consultons les documents du temps, nous sommes, hélas ! obligés de constater qu’il n’en était rien. Les souliers du beau grenadier étaient percés, l’uniforme du bouillant hussard était en loques et l’estomac des deux pauvres diables criait bien souvent famine. Dans son bel ouvrage sur le soldat de la Grande Armée, le général Monval a, documents à l’appui, montré toutes les misères qui se cachaient sous des dehors fastueux. La lecture de certains souvenirs de vieux de la vieille nous permet de nous faire une idée de ce qu’était la cuisine de ces braves. Tout d’abord ces briscards étaient obligés de faire leur rata eux-mêmes ; ils n’avaient point de cuistots. Le futur capitaine Robinaux conte dans son amusant journal de route que, dès son arrivée au corps, il dut préparer la soupe. « Il fallut, écrit-il, ce qu’on appelle en terme militaire : graisser la marmite ... Ce fut un achat de lard et de mouton que je fis au profit de l’ordinaire (vingt hommes). Pour une première épreuve, la soupe fut bonne et les portions passablement dodues ; les vieux gastronomes, — il s’agit de ses anciens, — ne disaient rien et mangeaient de façon à faire croire qu’ils étaient satisfaits. » La plupart du temps, nos troupiers n’avaient point d’ustensiles pour préparer leurs plats. Le sabre servait alors de broche et le combustible était pris n’importe où. Le plus souvent, nos soldats, fort débrouillards et gourmets, savaient se tirer fort élégamment d’affaire. C’est ainsi que Vaxelaire, perdu en pleine Égypte au moment de la fameuse campagne, réussit à offrir à ses camarades un bon repas. Écoutons-le raconter son aventure culinaire. Il était sans « poêle, ni gril, ni casserole, ni marmite », il réfléchit, puis il s’écria : — Eh bien ! je dis, nous ferons comme l’on faisait dans la Vendée ! ... Quand le feu fut allumé, nous plantâmes quelques-unes des plus grosses et grandes branches de nos buissons au milieu, et puis l’on attacha les gigots avec de la ficelle que les dragons avaient après leurs portemanteaux ; sans cette ficelle nous ne serions pas encore venus à bout de notre entreprise. Alors, quand ils furent attachés, on les faisait tourner et retourner, en y donnant, de temps en temps quelques coups de doigts. » C’était en somme le fameux gigot à la ficelle, bien connu des gastronomes. Un musicien de la grande armée d’origine suisse, J.-L. Sabon, raconte, dans ses mémoires fort vivants, qu’il apprêta un jour une oie de cette façon. Feuilletons les campagnes de Girault, lui aussi musicien d’état-major, mais français, Son carnet fourmille de notes précieuses. Il réfute, sans le savoir évidemment, Thiers qui prétendait que nos troupes cantonnées à l’île Lobau avaient été fort bien ravitaillées. Or il nous apprend qu’il fut obligé de faire cuire dans un arrosoir, faute d’ustensile, un morceau du cheval d’un cuirassier ; la viande était à moitié cuite et sans sel. « N’ayant plus de sel, écrit-il, un de nos camarades eut l’idée de le remplacer par deux ou trois cartouches, le salpêtre et la poudre devant tenir lieu de sel. Je ne goûtais point ce nouveau genre d’assaisonnement. Le bouillon était comme du cirage, et j’eus beau frotter la viande pour enlever la couche de suie, il me fut impossible de l’avaler. » Souvent, le soldat était, en effet, obligé de remplacer le sel par de la poudre. Fleuret, dans ses si pittoresques « Passages », conte que, durant la campagne d’Espagne, il dut maintes fois mettre de la « poudre à tirer » dans la marmite. Pour suivre cet usage, les Saint-Cyriens, lors de la visite de l’Empereur à leur école, le 5 août 1810, réunirent leurs portions de viande et les découpèrent en petits morceaux, ils les saupoudrèrent de poudre à cartouche. Reprenons notre récit de Girault. Les débuts de sa vie militaire furent pénibles. Après la victoire de Valmy, il note qu’il resta cinq jours sans vivres ; n’ayant que des assignats, il ne put se procurer, et encore avec beaucoup de peine, que deux ou trois pommes de terre dont il se nourrit pendant cinq jours ! En 1794, il avoue qu’il ne peut digérer le pain d’avoine qui leur est distribué. Faisant campagne sur les bords du Rhin, en compagnie du général Marceau, il note que, « durant trois jours, il n’a pas eu le temps de faire bouillir marmite ». « Nous ne pûmes recueillir que quelques pommes de terre, un morceau de suif et un petit oignon. » Maigre pitance pour des hommes qui marchaient sans cesse en se battant. Les distributions de viande et de pain se faisaient de plus en plus rares. Un jour, cependant, il eut la bonne fortune de « chiper » à un dragon une marmite contenant quatre poules, une oie et du lard. Qu’on juge de sa joie. Suivant la Grande Armée, il n’a à manger en Poméranie que du pain plein de vers. Le roi Jérôme envoya alors une voiture pleine de pains de munition. « Le tout était si mauvais, écrit Girault, que les soldats n’en voulurent pas, et, si le commis chargé de la distribution ne s’était sauvé sur son cheval au galop, on lui eût fait un mauvais parti. » Entrant en France, notre musicien passa par Arbois ; il y but, plus que de raison, le vin si délicieux du pays, et arriva, ainsi que ses compagnons, fort gai à l’étape. Tout près d’Essling, notre héros se trouva, une fois de plus, en fâcheuse posture. Mais, grâce à son ingéniosité habituelle, il s’en tira fort bien. « Je trouvai, écrit-il, un bidon de graisse ; puis, comme dans le village il y avait beaucoup d’oies, qui avaient été plumées et vidées par les premiers arrivants, je ramassai, parmi les débris, des foies et des cœurs qu’on avait dédaignés et qui furent pour moi les éléments d’un bon fricot où la graisse ne manquait pas ; un de mes confrères avait trouvé de la farine, nous en fîmes une galette que nous fîmes cuire dans la cendre. » Pressé par la faim, Girault avoue qu’il ne put attendre la fin de la cuisson et qu’il dévora sa galette à moitié cuite ! ... Les souvenirs gastronomiques du sergent Fricasse, — un nom prédestiné cependant, — ne sont guère meilleurs. Au camp de la Chartreuse, près Coblentz, il manqua de tout. « Mais le printemps, écrit-il, nous produisit des plantes pour un peu nous soutenir, qui étaient des feuilles de pois sortant de terre, des coquelicots ou feu d’enfer, du sarrasin, des pissenlits. Avec tous ces herbages, nous nous faisions une farce que nous mangions en guise de pain ; et, lorsque le seigle est venu en grain, on allait lui couper la tête et on le faisait griller sur le feu ... C’était vraiment une grande misère. Le matin, on battait la breloque pour le pain, la viande, mais on revenait souvent sans viande. Le soir, à l’entrée de la nuit, pas tous les jours, on revenait avec un pain pour quatre hommes. Tout le monde sortait de ses baraques et la gaîté renaissait pour un moment dans le camp. » Les témoignages concordent pour affirmer que la Grands Armée dut, souventes fois, avoir faim. Le futur commandant Coudrieux, écrit qu’en 1807, à Guttalt, il ne but que de l’eau et ne mangea que du mauvais pain de pommes de terre, des carottes et de la choucroute. Vaxelaire, à l’armée de Mayence, fut tout heureux, un jour, d’acheter un morceau de viande de cheval pour trois sous ; il aurait pu le mettre dans son gousset, nous dit-il ... . Lorsque, par hasard, ces briscards pouvaient trouver quelques victuailles, ils se jetaient littéralement dessus et les accommodaient à leur façon. Le capitaine Parquin, dans ses Mémoires, — Mémoires absolument véridiques, à l’encontre de ceux, plus célèbres, du fameux Coignet, — raconte qu’un jour ses chasseurs purent avoir quelques feuillettes de vin de Bordeaux, du sucre et des citrons ; ils mélangèrent le tout et en firent, paraît-il, une boisson exquise. Cet empressement à savourer des mets depuis longtemps oubliés nous fait penser que le Genevois et musicien J.-L. Sabon a volontairement exagéré lorsqu’il a écrit dans ses Mémoires qu’il avait vu des soldats français tuer un bœuf pour en avoir la fressure et la cervelle qu’ils préparaient à la poêle avec des oignons. Ce fait paraît bien invraisemblable. Si nos grenadiers nous donnent sur leurs coutumes culinaires de bien précieuses indications, ils nous renseignent parfois aussi sur les mœurs épulaires de certains peuples avec lesquels ils se trouvaient en contact. C’est ainsi que Noël, un officier d’artillerie, nous conte qu’en Hongrie il mangea une cuisine épicée, sucrée, les sauces étaient longues et les habitants du pays les mangeaient avec leurs couteaux au bout arrondi ; les poulets étaient farcis d’herbes, les pigeons accommodés au miel, les rôtis aux confitures, et avec cela un morceau de pain gros comme un biscaïen. Ces journaux de route de vieux braves, on peut s’en rendre compte par ces quelques citations, sont des plus curieux pour qui veut connaître les coulisses de la grande épopée napoléonienne ; ne croirait-on pas, en les relisant, revivre les veillées de Wagram ou d’Eylau et manger devant le feu du bivouac traditionnel une maigre pitance arrosée d’eau vinaigrée ? Roger VAULTIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 573 |
|