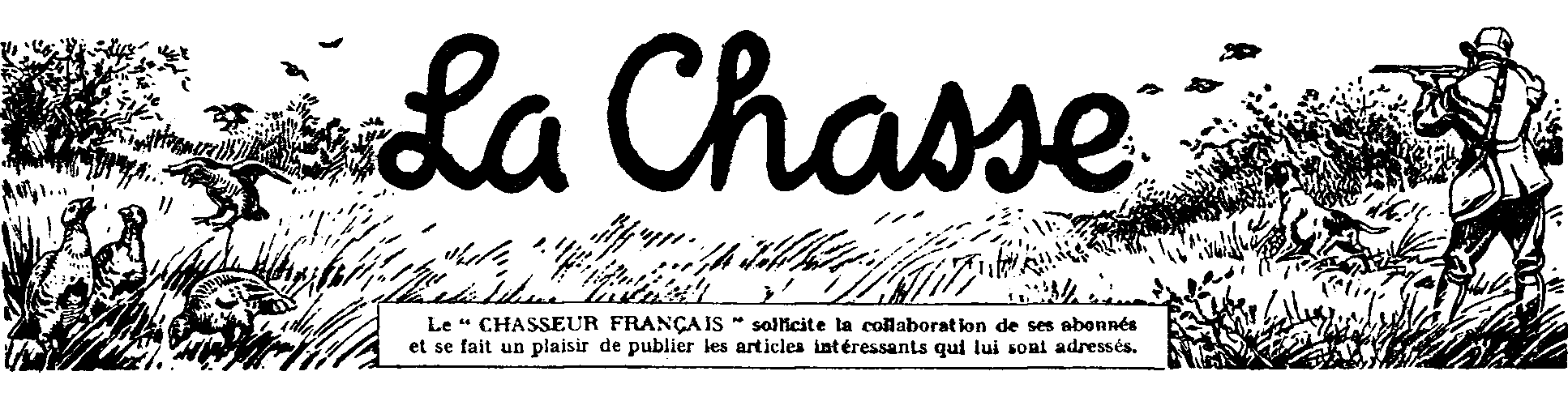| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°605 Janvier 1942 > Page 4 | Tous droits réservés |
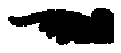
|
En forêt |
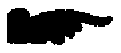
|
Dispersion du gibier.
|
Les périodes difficiles pendant lesquelles l’élevage, l’affouragement ou l’agrainage du gibier subissent une éclipse entraînent en général la dispersion des animaux peuplant la forêt ; du moins de ceux d’entre eux qui exigent des soins particuliers pour être maintenus en place et pour se propager. L’exemple du faisan est typique ; à part de rares cantons privilégiés comme sol, climat et consistance des taillis, bien gardés au surplus, piégés avec méthode, parsemés de cultures propices, les bois à faisans se dépeuplent vite lorsque cessent les tournées du garde, les soins attentifs de l’éleveur. Les faisans se dispersent, profitant des brouillards de l’automne ; ils gagnent d’autres bois, d’autres lisières, se cantonnent parfois en des boqueteaux où leur présence est insolite et le plus souvent sans lendemain. D’autres espèces ont, plus encore que le faisan, la manie d’errer à l’aventure, le goût de la dispersion. Je ne parle pas du sanglier, dont le nomadisme bien connu ne s’explique pas toujours très aisément ... D’aucuns attribuent ses randonnées, ses pérégrinations à la simple recherche d’une nourriture manquant ici, abondante ailleurs : glands, faînes, tubercules, racines sauvages. D’autres mettent en cause le fait de l’homme : chasses à courre répétées, grandes battues, rassemblements, mouvements de troupes, guerres, batailles ... Ces diverses explications possèdent toutes, je le crois, une part de vérité. Mais il est un problème plus subtil à résoudre, celui des motifs de l’essaimage régulier, presque fatidique d’un de nos oiseaux de chasse les plus rebelles à l’acclimatation, à la fixation dans les bois et sous les climats favorables à son habitat, je veux parler de la gelinotte. Les lecteurs du Chasseur Français m’excuseront si je reviens sur cet exquis gibier de la vieille France, sur cette pièce royale, peu connue sauf des initiés, peu répandue au demeurant, inconstante, capricieuse en son attachement à nos forêts qui sont celles des régions de montagne et de collines, avec des creux d’eau, des combes, des lignes de coupes ou des pistes bien tracées, des arbres feuillus et des résineux, des alisiers, des fruits sylvestres, des baies, des myrtilles. Forêts fraîches où les rayons de soleil percent par trouée l’ombre dense du massif, où des vallonnements, des clairières rompent l’épaisseur du sous-bois, où de grands arbres offrent à l’oiseau, pour se brancher, ce qui est sa ruse favorite, le refuge de leur ramure. Nous avons dans nos régions de l’Est des milliers d’hectares de tels bois. La gelinotte les fréquente sans pourtant s’y propager avec l’intensité que lui vaudrait une protection sérieuse par endroits. J’admets en maintes forêts un défaut de piégeage : trop de renards, trop de petits fauves, trop de chats sauvages ou de chats-harets, des martres, des putois ; trop de chiens aussi qui divaguent en temps de fermeture. Je crains qu’en bien des points le braconnage sévisse : colletage, affût, usage de l’appeau. Je ne crois pas à l’exagération des tableaux de chasse ; partout où j’ai rencontré la gelinotte, elle ne s’inscrivait qu’en petit nombre sur les relevés des meilleurs fusils, des chasseurs les plus tenaces en sa recherche. Mais, partout aussi où j’ai pu observer ses mœurs, j’ai constaté, ce qui exige le minimum d’attention, sa dispersion à l’automne. Pariade si vous voulez, ou mieux fiançailles, le couple ne s’unissant qu’après l’hiver en la station boisée qui est le terme de son évasion. Gibier de passage, vous diront les chasseurs ruraux, même ceux des contrées où la gelinotte est bien connue, et je puis citer le Barrois, la Franche-Comté, le Revermont, le Dauphiné, le Vercors. J’y ajouterai des provinces où l’apparition des gelinottes, parfois contestée, constitue pour moi une certitude : le Massif Central, y compris ses confins, puis les Pyrénées. Dans les Alpes, tirons un trait au sud de la région dauphinoise ; trop sèches en été, trop méridionales sont les forêts de la zone méditerranéenne, même en montagne. Le Vercors, au contraire, avec ses vastes étendues de hêtres, d’épicéas, de pins, entrecoupées de pâturages, à des altitudes variant de 1.000 à 2.000 mètres, touchant à l’est au Dauphiné, s’abaissant à l’ouest vers la vallée du Rhône, le Vercors, plateau solitaire, peu accessible, aimé des gelinottes qui s’y rencontrent surtout auprès des points d’eau, serait bien pour elles le tremplin d’essaimage vers l’Auvergne, si ce n’est vers les Pyrénées, au travers des Cévennes relativement proches. Toussenel, dans son Monde des Oiseaux, semble avoir vu juste en disant qu’il est possible que quelques gelinottes émigrent de nos montagnes de l’Est vers les forêts du Cantal et des Pyrénées. Dans le Cantal, j’ai plusieurs observations certaines : un de mes anciens et regrettés collaborateurs avait levé, en mai 1912, dans une futaie de hêtres couvrant les flancs nord du puy Mary, à 1.200 mètres d’altitude, une gelinotte qui couvait une douzaine d’œufs au pieds d’un fayard. L’oiseau ne s’était envolé qu’au moment où le garde allait marquer la perche. Autre observation près de Murat, dans la sapinière mélangée d’épicéas, de hêtres et de quelques essences feuillues : des gelinottes y ont été levées en 1935 et à diverses reprises sur le versant oriental du Plomb du Cantal, sans que l’on ait trouvé de nids pas plus que de petits ; oiseau de passage, affirment mes correspondants. Remontons au nord de l’Auvergne, en Combrailles, aux confins du Puy-de-Dôme et de l’Allier : des gelinottes ont été tuées récemment dans le massif boisé de Bellenaves et des Colettes, couvrant plus de 2.000 hectares peuplés de hêtres, de chênes, charmes et bois blancs, en futaies et taillis, et culminant à 700 mètres ; une gelinotte fut tuée également non loin de là, dans les bois qui bordent les gorges de la Sioule. Provenaient-elles du Revermont ou du Bugey, à 200 kilomètres à l’est à vol d’oiseau, avec escales successives ? S’agissait-il d’échappées d’anciennes tentatives d’acclimatation, comme l’on croit qu’il s’en est fait jadis en Auvergne pour la gelinotte et pour le grand coq ? Je penche pour la première hypothèse, ayant vu personnellement en Bresse, de 1904 à 1908, plusieurs apparitions soudaines de couples et de couvées de gelinottes dans des bois de plaine où jamais cet oiseau ne s’était reproduit, où jamais on ne l’avait signalé ; ainsi à Montcony, dans le Louhannais, à Piurlans, près de Pierre-de-Bresse. Ces gelinottes venaient à coup sûr, les premières du Jura, où elles se rencontrent normalement, les secondes de la Côte-d’Or, où elles fréquentent les taillis sous futaie des environs d’Auxonne. Dans l’un et l’autre cas, la dispersion, l’essaimage étaient constatés pour ainsi dire à la première halte. Je pourrais indiquer de semblables observations en Haute-Marne, en Haute-Saône, et jusqu’aux rives du lac de Genève en Haute-Savoie. On m’objectera que c’est la zone même de l’habitat de la vagabonde ; j’en conviens, quoiqu’en Haute-Marne la gelinotte soit aussi étiquetée comme passagère, soit entre Chaumont et Joinville, soit au sud de Langres. Et je change de secteur pour aborder les Pyrénées, où la présence de notre poule des bois a fait l’objet de vives discussions, les uns soutenant qu’elle ne s’y rencontre jamais, les autres qu’elle s’y reproduit parfaitement. Faisons encore la part de l’hypothèse nullement chimérique d’essais d’acclimatation ; il y a eu, il y a certainement dans la zone pyrénéenne soit des mécènes enclins à propager des espèces rares, soit des chercheurs s’attachant au problème passionnant de la rénovation de la faune. Il se peut que l’introduction de la gelinotte au centre du massif ait été tentée. Je crois plutôt, de même qu’en Auvergne, à la théorie de Toussenel, au résultat de la dispersion des couples. Je sais qu’il subsistait des gelinottes vers 1910 en Ariège, dans les hêtraies et les sapinières entre Foix et Tarascon-sur-Ariège, qu’on en a levé près de Saint-Girons, dans le Couserans, enfin qu’une compagnie fut observée en juillet 1933, vers 1.500 mètres d’altitude, dans la forêt de Varousse, en Hautes-Pyrénées, touchant la Haute-Garonne. Les gelinottes sont-elles autochtones dans la chaîne pyrénéenne ? Y furent-elles introduites ? S’y propagent-elles de loin en loin, au gré de l’essaimage singulier de cette espèce à la fois indigène et migratrice ! Autant de questions qui méritent de retenir l’attention des amis de la nature, à qui les mœurs des oiseaux offrent un champ d’étude permettant d’oublier bien des discordes. Et, quand il s’agit d’oiseaux de chasse aussi précieux, le naturaliste, doublé d’un disciple de Diane, consacre tous ses efforts à la solution d’une énigme qui peut-être lui livrera le secret de rencontres inespérées. Pierre SALVAT. |
|
|
Le Chasseur Français N°605 Janvier 1942 Page 4 |
|