| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°608 Juin 1946 > Page 196 | Tous droits réservés |
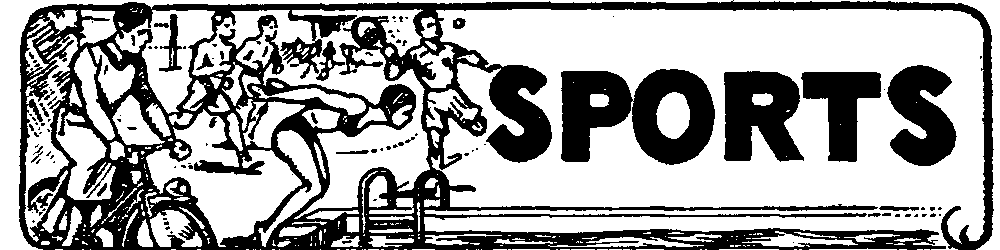
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Sprinters en casaque (1880) |

|
|
Je n’ai pas connu cette époque héroïque, antérieure à ma naissance. Mais voici comment des gravures et des documents de l’époque représentent nos premiers champions officiels. je sais bien que, lorsque je relis l’histoire dans les manuels qu’on offre en pâture aux pauvres potaches, ou bien lorsque je lis les récits conformistes de batailles auxquelles j’ai personnellement participé, il y a vingt ans, j’en éprouve une certaine méfiance envers les historiens. À plus forte raison sur ce que l’on admet comme vérité historique concernant les siècles passés, où l’on se demande où finit « l’histoire » et où commencent « les histoires ». Il n’en reste pas moins qu’en matière de sport, comme ailleurs, il existe, depuis le dessin et la photographie, des documents incontestables et des témoins encore vivants et sincères de la génération qui nous a précédés. Il est certain que, de tous les sports, le plus ancien est celui que nous appelons aujourd’hui l’« athlétisme », puisque le fait de courir, de lancer, de grimper, de sauter, de se battre à main nue, est l’une des activités naturelles de l’homme de tous les temps. Les hommes n’ont pas attendu M. de Coubertin, ni M. Hébert pour se mesurer entre eux dans ce genre de compétition ; ni les règles élégantes de la boxe anglaise ou française pour s’entre-casser la figure. Entre le pancrace de Sparte et le soldat de Marathon (qui n’avait pas subi le contrôle médical, car le ministre n’était pas encore chargé de le rendre obligatoire, et qui en est mort) et Jean Bouin, s’échelonnent à coup sûr de grandes performances que l’histoire n’a pas retenues. Elles avaient même l’audace de se dispenser d’une autorisation fédérale. Mais, pour ce qui concerne notre pays et que nous pouvons appeler notre « ère » sportive nationale, régie par les témoins impartiaux que sont le chronomètre et le système métrique, on s’accorde à en fixer le début vers 1880. C’est vraisemblablement à l’exemple des Anglais, qui, depuis le roi Henri VIII, lui-même coureur à pied de bonne classe, et le duc de Monmouth, qualifié par ses compatriotes, bien avant notre Basque national, de « bondissant », que nous obéîmes à la manie (heureuse pour une fois) de nous extasier sur tout ce qui vient de l’étranger et de créer les premières sociétés sportives et les premières épreuves officielles distribuant des titres de champions. Les premières rencontres consistèrent d’ailleurs dans des rencontres avec des coureurs anglais, émules de Foster Powell, qui fixèrent le premier record de l’heure en course à pied officiellement contrôlé, avec 16 kilomètres dans l’heure, en 1764. Les premiers adeptes en France (1880) furent les scolaires. Il a fallu le désastre de 1940 pour que l’Université, d’où le sport français est parti, y revienne véritablement avec la foi dont elle n’aurait jamais dû se départir. Les élèves du lycée Condorcet, trouvant rapidement insuffisante la piste qu’ils avaient improvisée dans le grand hall de la gare Saint-Lazare, créent, le 20 avril 1882, le Racing-Club de France (qui s’honore à juste titre du beau nom de « Club doyen »), dont la première circulaire, signée « Twhight, Saint-Arnaud et F. de Hainaut », indiquait que « les écuries se distinguent, par des écharpes et des toques ». Les premières courses se disputèrent au Bois de Boulogne : courses plates sur la route de Madrid, courses d’obstacles sur la piste cavalière autour de la grille du Tir aux Pigeons (1882). Les dessins d’alors nous représentent les coureurs toque enfoncée sur les yeux et les oreilles, casaque, culotte bouffante serrée aux genoux, bas de soie noirs (sans « bons » et sans « points »). Exactement des jockeys débottés. Sans oublier la cravache, destinée sans doute à donner de l’ardeur au coéquipier, ou à écarter le concurrent dangereux de l’écurie adverse. Les compétiteurs ne s’appelaient pas, comme ces dessins pourraient le laisser croire, de Saint-Clair, Fernand Meiers, Blanchet ou Durand ou Dupont, comme vous et moi. Ils s’appelaient : Bruce, Dandin, Saint-James, Acacia, Villars, Verduron, général Williams, etc. …, noms de chevaux réputés de l’époque. Le tout complété, ne vous en déplaise, de propriétaires d’écuries, de bookmakers et de prix payés en argent variant entre deux et cinquante francs, selon l’importance présumée du pari mutuel. On n’a jamais entendu dire que les coureurs aient été pour cela disqualifiés, ni traités d’amateurs marrons, d’autant plus que ces grosses recettes étaient utilisées à « arroser » la gloire des vainqueurs à titre de consolation pour les lanternes rouges. On ne les obligeait pas, toutefois, à manger de l’avoine. Mais, si l’on en juge par leur prestance, qu’est-ce qu’ils devaient toucher comme tickets de viande ! Ne souriez pas, jeunes espoirs d’aujourd’hui. Ils n’avaient pas, comme vous, la chance de posséder des pistes en cendrée, des entraîneurs compétents, des souliers à pointes, ni même de ministre des Sports. Mais c’est grâce à ces glorieux apôtres et à ces bons ouvriers de la première heure que vous avez aujourd’hui tout cela et que le sport français est devenu ce qu’il est. Robert JEUDON. |
|
|
Le Chasseur Français N°608 Juin 1946 Page 196 |
|