| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°609 Août 1946 > Page 234 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Veillées des chasseurs

|
Le « trypanocorax frugilegus » |

|
|
Modeste contribution à l’histoire du marché noir.
— C’est singulier ... — Quel plomb tires-tu ? — Essaie donc ceci, du 3 en douilles de 70. — J’ai l’impression que tu fais bas, tu devrais couvrir un peu plus l’oiseau ... Le matin, on réussissait généralement à garder son sérieux jusqu’au quinzième coup. Après midi, l’hilarité, chez l’un ou l’autre des conjurés, éclatait beaucoup plus tôt, sous les menaces de congestion produites par les efforts de retenue. C’était là essentiellement une chasse d’équipe. Il y avait l’équipe de Gustave, l’équipe du cousin Marcel, sa famille admirative tendrement groupée autour de lui, celle d’Henri Flach, Marcel Lafite et René Vislaire, ce dernier maintenant sans conteste la plus forte moyenne de cartouches tirées — son chauffeur devait brouetter la réserve, — et celle de Max et Charles, lesquels, par ces premières chaleurs accablantes, ne voyaient qu’une ombre au tableau : le manque total de bistrots sous les ombrages condruziens. Il existe à Vervoz, au lieu dit « Derrière chez Adèle », sans que cette dénomination implique la plus légère équivoque, une rangée de hêtres trois fois séculaires, majestueux, tous semblables dans leur force et leur puissance, qui dominent le terrain en contrebas et formeraient la rampe du plus étonnant théâtre de verdure. Je surpris Charles un jour en méditation devant cet émouvant décor naturel. Je le supposai en proie aux mêmes inspirations que les miennes. — Hein ! lui dis-je, Cyrano là-dedans, ou Le Tour du Monde en 80 jours ... Quel merveilleux théâtre ! ... — ... Sans doute, consentit Charles, mais surtout quelle terrasse ! Trois fois comme celle du Métropole (il est bruxellois). On y mettrait mille personnes au frais et à l’aise, sans que les garçons soient gênés pour circuler ... L’opinion de pareil technicien me donna à penser. L’année suivante, je disposai sous la mousse, à des endroits déterminés que ne pouvaient atteindre les rayons du soleil, quelques dépôts de rafraîchissements : ici un bock, là une fillette de muscadet ou de pouilly fumé. Ainsi, avant l’aviation, les explorateurs polaires installaient des cairns de pemmican et de poisson séché. Je cherchai ensuite, à l’approche d’une de ces caches, et ce ne fut pas difficile, à provoquer les lamentations de Charles sur la sécheresse ambiante. Puis, tel Moïse frappant le rocher de sa verge, j’écartai la mousse du canon de mon fusil et découvris, aux yeux extasiés de Charles, des flacons couverts d’une buée glacée. Par après, il ne déambulait plus, comme les autres corbeautiers, tête levée jusqu’au torticolis pour découvrir l’innocent gibier. Sa position faisait plutôt croire à un chercheur de morilles. Il y avait encore Jean et José, Arthur et Gaby et, enfin, exception à cette règle d’équipe, Georges de Tudert, qui venait tout seul, d’un trait d’auto, de Tours, annonçant son arrivée à un quart d’heure près. La fin de la guerre et les difficultés économiques, le louable souci de ravitailler les populations urbaines en proie à la famine firent envisager sous un angle plus pratique l’exploitation de la corbeautière, devenue, en la circonstance, une manne providentielle. Au début de la campagne corbicide, le conseil d’administration d’un grand magasin d’alimentation bruxellois, séduit par un exposé de mon frère et porte-parole, se déclarait prêt à absorber toute notre production à condition que la volaille arrivât quotidiennement, par convoyeur, et dans un état de fraîcheur impeccable. Des femmes en tabliers blancs plumeraient publiquement sans arrêt. Les oiseaux, galamment parés et troussés, seraient exposés en vente à 10 francs, dont les trois quarts reviendraient au producteur que j’étais. Mais ces séduisantes perspectives restèrent du domaine de la chimère. Il fallait, pour être en règle avec les ordonnances, obtenir une approbation du prix de la denrée des ministères des Affaires économiques et de l’Agriculture ... Mon frère, diligemment, y fit plusieurs démarches, sans réussir à arracher leur consentement aux messieurs Soupe intéressés qui, n’arrivant pas à retrouver dans les mercuriales le prix des corbeaux en mai 1940, et pour cause, s’épouvantèrent devant les responsabilités et s’obstinèrent, malgré les raisons d’intérêt général évidentes, à laisser indéfiniment « pendre » l’affaire ... La grande épicerie refusant dès lors de se compromettre, je dus trouver des débouchés dans le trafic extra-officiel — c’est sans doute de ce négoce de corbeaux que vient l’expression « marché noir », — avec la conscience de rendre d’éminents services à la communauté en corsant son ravitaillement étique d’une viande saine, appétissante et savoureuse. Si la moule est l’huître du pauvre, le corbeau, en pareille circonstance, figurait le perdreau du citadin dépourvu, ou, à tout le moins, le pigeonneau. Je sus, en effet, par des observateurs embusqués sur la place de Bruxelles, que les restaurants servirent quotidiennement du pigeon pendant une période qui coïncidait étrangement avec mes envois massifs. Cette métamorphose, au sujet de laquelle je récuse toute responsabilité, car je livrais des corbeaux, de loyaux et ventrus jeunes corbeaux, à visage découvert, procédait d’ailleurs d’une psychologie altruiste et charitable. Vendus comme tels, peut-être que personne n’en aurait voulu. Transformés en colombins, ils passaient ainsi que communiqués de la B. B. C. Au surplus, têtes et pattes prudemment tranchées, convenablement accommodés en même temps que d’authentiques pigeons et servis dans le même plat, je défie neuf consommateurs sur dix de faire la distinction entre les deux espèces. La chair est de même grain, couleur et goût, avec au moins autant de vitamines, de calories et pouvoir nutritif. Pour les jeunes, bien entendu. Le vieux corbeau est redoutable à mastiquer, mais fait un excellent pot-au-feu, connu, dans le Perche, sous l’appellation gamine de « soupe à la poule nouère ». En pâté, les jeunes — toujours — seraient plutôt supérieurs aux pigeons, le fumet de gibier étant légèrement plus accentué. Est-il quelque chose de plus propret, de plus sain, de plus dodu que ces jeunes oisons qui n’ont jamais posé patte à terre et dont les premières semaines se sont poétiquement écoulées dans les ramures bruissantes, sous les tièdes baisers du soleil de mai ? En vérité, quand on y songe, c’est autrement appétissant qu’un jeune poulet compromis depuis sa naissance par l’ignoble promiscuité du fumier. La gastronomie n’a pas fait au jeune freux la place qu’il mérite. Cette injustice vient probablement de ce que les ignorants, c’est-à-dire légion, le confondent avec le corbeau légendaire du champ de bataille, le mangeur de cadavres. Il n’en est rien. J’eus soin d’y insister auprès d’un coquetier de Seraing qui vint en enlever un paquet pour faire un essai de vente à son magasin. Mais ici, point de mise en scène, de fioritures, d’accortes plumeuses en rubans et bavolets, la marchandise telle quelle, habillée, avec têtes et pattes, ce qui, je ne sais pourquoi, jette toujours un léger froid. Je lui avais confectionné une énorme pancarte à placarder au-dessus des volatiles afin d’apaiser les répugnances et de rectifier les préjugés d’une clientèle mal Informée :
L’astucieux coquetier fit même imprimer en polycopie un petit livre de recettes ad hoc qui n’eut, il faut bien l’avouer, pas beaucoup plus de succès que sa camelote. L’expérience prouva aux divers grossistes qu’il était préférable de parer le trypanocorax, tout frugilegus qu’il fût authentiquement, des plumes innocentes de son compère le columba livis ou palumbus, au choix de l’amateur. La question du transport souleva maint problème. Le chemin de fer, d’abord, se chargea de plusieurs expéditions qui ne furent pas toutes heureuses. Les corbeaux, empilés comme sardines, pour peu qu’il y eût quelque délai dans le voyage, ou que la température fût trop aimablement printanière, se faisandaient au delà des pronostics les plus pessimistes, et les bulletins de réception accusaient une proportion catastrophique de « sujets verts » ou « confisqués par les services d’hygiène ». Il fallut se résigner à établir un va-et-vient, de porteurs. Les valises, énormes et pesantes, dont ils étaient chargés, ne manquaient pas, dans les trains et sur les quais des gares, d’alerter le flair des contrôleurs du ravitaillement aux aguets du lard, du beurre ou de la farine illicitement ambulatoires. C’était la revanche et le divertissement de cette fastidieuse mission de coltinage. Le porteur feignait mille craintes et ruses pour attirer l’attention des intègres fonctionnaires, bouillant de dépister la fraude, et goûtait une joie sans mélange, quoique non exprimée, à les voir plonger avidement les mains à travers les couches de corbeaux jusqu’au tréfonds des valises, dans l’espoir toujours déçu d’y découvrir une denrée prohibée. Leur déconvenue se corsait bientôt de démangeaisons, légères sans doute, mais insistantes et tenaces, car les diablesses de bestioles sont difficiles à capturer, causées par les bataillons d’infiniment petits abandonnés par les cadavres aux mains impies qui les tripotaient rageusement. Car, en dépit de leur enfance éthérée, à cent pieds au-dessus du sol et des misères du monde, ces chers innocents, dès le premier duvet, dans le nid familial, sont accablés d’hôtes indiscrets. Il est vrai que le roi des animaux lui-même, le lion, n’en est pas épargné. C’est l’inconvénient majeur de la chasse aux jeunes freux lorsque, d’aventure, on est obligé de transporter personnellement son butin. Cela peut donner occasion à des scènes familiales douloureuses pour l’amour-propre du chasseur, mis en quarantaine sous son propre toit. Jean LURKIN.Le testament du tireur (*). — Sous ce titre, notre collaborateur, M. Jean Lurkin, a consigné, dans le style enjoué et alerte qui lui est si particulier, ses efforts, ses expériences et ses souvenirs de tireur, soit en chasse, soit aux pigeons. Les novices y trouveront des enseignements judicieux ; les anciens, l’écho de maintes réflexions et expériences personnelles. (*) Chez Mme Lurkin, 53, rue de la Victoire, Neuf-Mesnil, par Haumont (Nord) ; un ouvrage de 320 pages avec 40 gravures de Maissen, 300 francs (Chèques postaux Lille 115-96). |
|
|
Le Chasseur Français N°609 Août 1946 Page 234 |
|
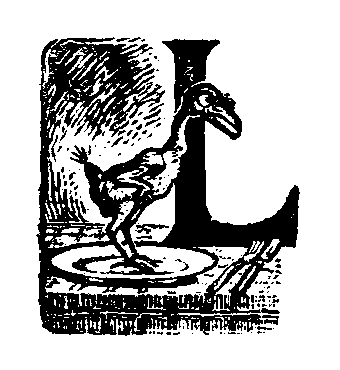 A chasse aux corbeaux, ou plutôt le tir des jeunes
freux sur les grands arbres de la colonie du parc de Vervoz (Ardennes), en
mai-juin, était considéré avant la guerre comme un divertissement mineur et
quelque peu puéril, une folâtrerie, prétexte à réunions, ébats et déjeuners.
Toute gravité s’en trouvait bannie, alors que n’importe quel autre genre de
chasse, fût-ce la tendue aux ortolans, en comporte une part. On y rajoutait
même des éléments de rigolade, tel, classique, le corbeau empaillé solidement
fixé dans une fourche au haut du plus haut sapin et qui encaissait, impavide,
les mousquetades et les imprécations du novice, celui-ci hypocritement
conseillé par le chœur critique des anciens :
A chasse aux corbeaux, ou plutôt le tir des jeunes
freux sur les grands arbres de la colonie du parc de Vervoz (Ardennes), en
mai-juin, était considéré avant la guerre comme un divertissement mineur et
quelque peu puéril, une folâtrerie, prétexte à réunions, ébats et déjeuners.
Toute gravité s’en trouvait bannie, alors que n’importe quel autre genre de
chasse, fût-ce la tendue aux ortolans, en comporte une part. On y rajoutait
même des éléments de rigolade, tel, classique, le corbeau empaillé solidement
fixé dans une fourche au haut du plus haut sapin et qui encaissait, impavide,
les mousquetades et les imprécations du novice, celui-ci hypocritement
conseillé par le chœur critique des anciens :