| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°611 Décembre 1946 > Page 335 | Tous droits réservés |
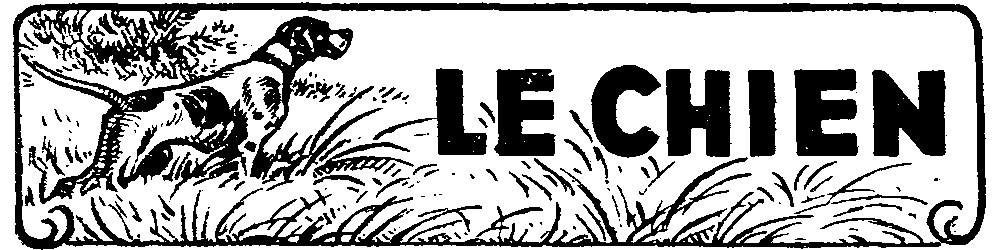
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
La « maladie » des chiens |

|
|
Le chien est exposé, comme les sujets de toutes les autres espèces animales, à contracter les maladies les plus variées et les plus graves ; mais, fait plus redoutable encore, beaucoup d’entre elles sont transmissibles à l’homme, et, si l’on veut bien songer à la promiscuité étroite dans laquelle le chien vit avec l’homme, on se convaincra de l’imminence du danger. La maladie est à coup sûr la plus connue des affections qui frappent le chien. Tout propriétaire la craint, la redoute, la traite, cherche à en préserver ses animaux, sans posséder sur la véritable nature du mal les connaissances indispensables au choix judicieux des méthodes de traitement et à leur convenable application. L’on se fait maintenant une idée assez précise de ce qu’est la « maladie » des chiens. Elle est assez analogue à la grippe de l’homme. Mais est-ce une raison suffisante quand on sait l’embarras qui préside à définir très exactement ce qu’est la grippe humaine ? Ne dit-on pas de celle-ci que, « malgré toutes les recherches bactériologiques, on n’est pas encore arrivé à identifier un microbe réellement spécifique ; aucun des germes incriminés n’a prouvé sa spécificité, y compris le fameux coccobacille de Pfeiffer, et, lorsqu’on examine les sécrétions au microscope, au moyen de cultures ou d’inoculations, on ne retrouve jamais que les microbes banaux, les hôtes habituels du rhino-pharynx ou de l’intestin ». Il en est de même en ce qui concerne la « maladie » des chiens. Dans une note présentée à l’Académie des Sciences (séance du 1er août 1927), le Dr Lebailly signalait que la méthode de vaccination par le virus formolé lui avait permis de vacciner contre la maladie du jeune âge du chien avec des résultats parfaits. Ici encore, aucun microbe spécifique n’était mis en évidence. La méthode d’ailleurs n’a pas toujours donné des résultats heureux. Aussi certains vétérinaires et non des moins connus, M. Demay en particulier, déclarent qu’« il faut reconnaître que nous ne possédons pas encore contre la maladie du jeune âge chez le chien de méthodes efficaces de traitement ou de prémunition, parce qu’aucune n’est vraiment spécifique. Toutes celles qui ont été préconisées et essayées, jusqu’à ce jour, donnent, après des séries heureuses, une suite d’échecs qui fixent le praticien sur leur valeur ». Qu’est-ce donc que la « maladie » ? Dans le principe — et ce paraît être un paradoxe — la « maladie » est une affection bénigne, elle se déroule en quelques jours ; elle se traduit seulement par de la fièvre, un peu de coryza, l’appétit disparaît, le malade est triste, c’est toute la « maladie » dans son essence. Si l’on recherche à ce moment le microbe en cause, les examens restent négatifs, et pourtant, sous cette forme, et sous cette forme surtout, la « maladie » est contagieuse et inoculable expérimentalement. Le laboratoire découvre que, dans cette période, c’est un virus filtrant qui intervient, c’est-à-dire un principe morbifique tellement ténu qu’il est capable de passer à travers les filtres qui, à l’ordinaire, retiennent les microbes ; et ce virus est si petit, sans doute, qu’on ne le voit pas au microscope, ce qui explique l’insuccès des examens bactériologiques. Les microbes visibles, donnés comme agents spécifiques de la « maladie », ne sont que des saprophytes, hôtes normaux des litières, tout au plus capables de créer, avec le concours de conditions naturelles favorisantes, des lésions septicémiques, pulmonaires ou intestinales. Mais ils sont impuissants à provoquer les exsudats virulents, les altérations oculaires et nerveuses, la grande virulence du sang, comme de reproduire la maladie en série, ainsi que le fait le virus de Carré, lequel, le premier, en 1926, signala la présence de ce virus chez l’animal infecté. Presque toujours, la « maladie » est beaucoup plus grave et ne se limite pas aux symptômes bénins décrits ci-dessus ; à la vérité, il ne s’agit plus de la maladie, mais de ses complications ; c’est ce que l’on voit, ce que l’on considère presque toujours comme la « maladie ». En réalité, les conditions morbides du début affaiblissent l’organisme et le laissent envahir par des microbes qui sont, à l’état normal, arrêtés par les barrières qui, sous forme de revêtement, tapissent l’arbre respiratoire ou le tube digestif. L’on assiste alors à l’apparition des formes pulmonaire, intestinale, et chacune de ces localisations évoluent comment autant de maladies distinctes, et souvent en même temps, ce qui fait la gravité du mal. Le problème ainsi posé, on se rendra mieux compte de la difficulté du traitement par l’étendue du champ sur lequel il faut combattre et la variété des ennemis qu’on y rencontre. Aussi il va de soi que nous ne pouvons envisager dans cette courte causerie les nombreux moyens de traitement prophylactiques ou curatifs préconisés pour conférer à l’organisme des chiens une résistance aux infections secondaires, qui compliquent si souvent et si gravement la « maladie ». La « maladie » des chiens est-elle transmissible à l’homme ? Cette question doit être résolue par l’affirmative, ainsi qu’on le verra par la déclaration suivante du professeur Nicolle, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis. « La maladie du jeune chien peut être contractée par l’homme sous la forme inapparente : voilà une constatation bien singulière et pourtant parfaitement exacte, comme le démontre l’expérience suivante : j’ai inoculé le virus de cette maladie à la fois à un homme et à des chiens. Le lendemain du jour où les chiens témoins ont présenté de la réaction thermométrique, annonçant le début de l’infection, j’ai prélevé le sang de l’homme et je l’ai inoculé à deux chiens. Ceux-ci ont fait la « maladie » et j’ai pu la transmettre à d’autres chiens. L’homme n’a pas présenté la moindre élévation de température, pas le plus petit symptôme. » Non seulement entre individus de même espèce, mais entre des espèces différentes peut donc s’effectuer un échange de virus qui provoque tantôt une infection à grands symptômes, tantôt une infection inapparente. Nous comprenons bien, maintenant, pourquoi une maladie semble éclore spontanément : l’homme ou l’animal peut sournoisement receler une infection inapparente. Et c’est ainsi qu’on peut concevoir la naissance, la vie et la mort des maladies infectieuses. MOREL. |
|
|
Le Chasseur Français N°611 Décembre 1946 Page 335 |
|