| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°612 Février 1947 > Page 396 | Tous droits réservés |
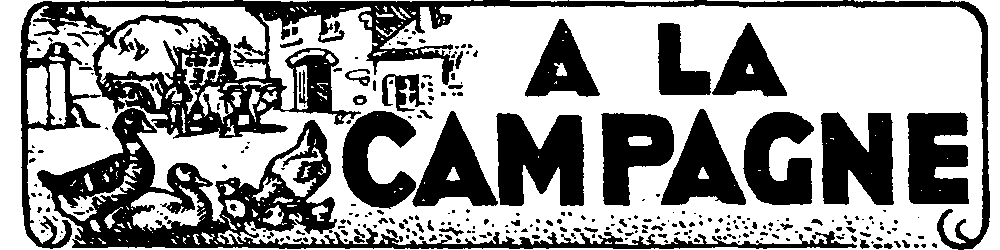
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Grande culture

|
En traversant les labours |

|
|
Un jour de décembre, le temps est gris, la tempête fait encore rage, mais il n’a pas beaucoup plu et les charrues sont dehors. C’est le moment de réfléchir sur l’une des opérations importantes exécutées par les cultivateurs, appelés d’ailleurs autrefois les laboureurs et en passe de devenir des agriculteurs ... On dit volontiers que le labour ameublit la terre ; d’autres préfèrent dire du labour qu’il prépare l’ameublissement. Je préfère la seconde acception, qui paraît mieux en rapport avec les réalités dans un grand nombre de cas. C’est pourtant exact, le labour suffit pour ameublir quand il s’attaque aux terres très légères : derrière la charrue, le sol retombe émietté, et le lit de semences est constitué sans que l’on ait quelque chose à faire ; le hersage qui suit le labour a simplement pour objet de niveler la partie superficielle et de faire disparaître les sillons ; encore est-il que, dans certains cas, on jette la semence à la volée, et l’enfouissement s’effectue avec un alignement relatif que l’on ne redoute pas. En général, le labour, qu’a précédé souvent le quasi ou pseudo-labour, façon de déchaumage qui a ouvert la terre plus ou moins tassée après la moisson, donne des mottes ou des bandes dans un état de dislocation fort inégal, et ce sont ces mottes ou ces bandes qu’il faut réduire. Comment y parvient-on ? comment donne-t-on à la couche arable cette structure plus ou moins fine, aux éléments plus ou moins rapprochés, très caractéristique pour chaque milieu et même pour chaque plante ? Ici intervient l’art du praticien qui a appris à tirer parti des circonstances atmosphériques en vue de poursuivre l’effet ameublissant de la grande façon. Une motte de terre exposée à la sécheresse, à la pluie, à la gelée, se disloque peu à peu, les débris qui résultent de la division se glissent entre les parties non atteintes, et l’ensemble forme progressivement ce milieu homogène qu’il faut toujours tendre à réaliser, en vue d’une circulation régulière et active de l’eau de particule à particule. Alors, puisque les influences naturelles et gratuites contribuent à préparer l’ameublissement, pourquoi ne pas en profiter au maximum et, dans cette intention, pourquoi ne pas réaliser le maximum d’écart dans le temps entre le jour du labour et le jour de la semaille ? L’intérêt des labours de fin d’automne, d’hiver, de ces labours d’ouverture, apparaît encore mieux à la lumière de ces simples observations. Toutefois, les choses ne sont pas toujours aussi nettes que cet exposé sommaire laisserait à le croire. Parmi nos terres cultivées, il en est qui, pendant des mois, conservent l’apparence de terres motteuses, même lorsque les intempéries ont passé ; ce sont les terres riches en argile, en mélange d’argile et de calcaire ; mais, dès qu’à l’élément argileux se mêle une proportion suffisante de sable, l’allure des phénomènes se modifie. Si le grain de sable est grossier, l’apparence de la motte se modifie peu ; mais, dès que le grain devient plus fin, dès que l’on arrive aux terres blanches, aux terres battantes, suivant l’expression si pittoresque et si vraie du praticien, l’éboulement des mottes est rapide. Progressivement, le relief du terrain aux sillons saillants se modifie et, si l’on est vraiment en terre battante, la surface du terrain se nivelle ; elle se ferme, elle n’offre plus de prise aux actions desséchantes des premiers soleils du printemps, et la couche superficielle reste froide, retarde l’entrée en action des instruments qui vont permettre une mise au point. Phénomène important qu’il faut savoir enregistrer jusqu’au niveau de cette sorte de plancher que la charrue dessine au-dessous de la couche remuée. Une terre fermée en surface ne permet plus l’action profonde des intempéries, de la gelée notamment qui a une influence considérable ; ainsi on a l’apparence de l’ameublissement en surface, mais la profondeur est inégale, conséquence extrêmement grave qui est méconnue par les observateurs non avertis. Conclusion sur ce point spécial : il faut commencer les labours d’hiver par les terres les plus réfractaire a à la démolition, par celles qui restent accessibles aux actions variées du temps, et terminer par les milieux à l’obturation trop rapide qu’il ne faut pas précipiter vers l’asphyxie. Autre conclusion qui se rapporte aux soucis du moment. Le mot motorisation est à l’ordre du jour : on conçoit immédiatement que la motorisation permet d’ouvrir rapidement les terres que l’on a hâte de voir remuer parce que l’on gagnera sur le jeu du lendemain. Ainsi s’oppose le travail relativement coûteux du tracteur tirant une charrue et le travail qui paraît moins coûteux parce qu’il occupe les attelages consommant les produits fourragers de la ferme, et l’on est content parce qu’inlassablement, même avant le lever du jour, les laboureurs partent aux champs ; on fait des journées, mais ces journées qui s’allongent, qui s’étirent, deviennent progressivement de mauvaises journées. Si l’on ne prend pas soin de réduire parallèlement la profondeur des labours qui durent, on risque de se trouver en février-mars devant des mottes qui réclameront un grand déploiement de herses, de canadiens, de rouleaux, instruments de dimensions variées, suivant la nature de la culture envisagée. Voilà à quoi pense le cultivateur qui voit les charrues tracer les sillons dans la plaine par un temps de grisaille. Et l’on discute des prix de revient des opérations, on discute depuis un siècle sur l’opportunité des labours plus ou moins profonds ; celui qui enchaîne les faits et les gestes de chaque jour, qui voit parallèlement le but à atteindre et les moyens qui mènent vers l’objectif, comprend ce qu’il fait et il est dans la bonne voie. Vérités anciennes ; il faut les redire, et, pour cela, tout simplement réfléchir en suivant les sillons, aussi bien le sillon tracé silencieusement par les bœufs que celui plus bruyant du tracteur. L. BRÉTIGNIÈRE,Ingénieur agricole. |
|
|
Le Chasseur Français N°612 Février 1947 Page 396 |
|