| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°613 Avril 1947 > Page 423 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Les deux chasseurs |

|
|
Très haut, au sommet du Cirque de Salles qui sépare la vallée de Sixt de celle de Chamonix, il y a entre le col de la Portettaz et celui du Dérochoir un immense entassement de blocs de pierre. C’est l’« Aiguille Écroulée », les restes de la ruine d’une des pointes des Fiz, ruine assez récente à en juger par la cassure encore nette des grands blocs, que les neiges de chaque hiver usent et arrondissent d’année en année. Il y a là, répandus sur le calcaire crevassé des lapiaz, un amoncellement énorme, cinq ou six hectares de débris empilés qui forment des ravins, des creux, des tas de pierres, des murs et des remparts branlants, entremêlés de quelques coulées de terre où poussent l’anémone glaciaire et le myosotis nain. Les chalets les plus voisins sont à des heures de marche, encore sont-ils abandonnés dès le début de l’automne par les troupeaux. Alors, il n’y a pas vie humaine à un jour à la ronde, et le désert rocheux, ses lacs et ses coulées de neige deviennent le domaine du silence et de la solitude.
Cet arc se bâtit, à trente pas des bouches des terriers, en roulant deux grosses pierres carrées que l’on dispose côte à côte, laissant entre les deux la place du canon de l’arme. Un autre bloc, posé en travers et à plat, couronne l’édifice. C’est un véritable créneau de tranchée. Il faut prendre la précaution de l’installer avec le soleil dans le dos, pour que le tireur ne soit pas aveuglé, et il faut également qu’il ne se profile pas sur le ciel, cette ouverture tantôt libre, tantôt bouchée par la tête et le corps du chasseur risquant de paraître suspecte. Cette petite bâtisse s’édifie la veille, ou au petit matin, avant le lever du soleil, alors que les marmottes dorment encore dans leurs trous, et, lorsque le chasseur vient occuper le poste, le gel givre encore les moindres brins d’herbe. Plus tard, lorsque le soleil donnera à pic sur les blocs de calcaire blanc, la chaleur concentrée deviendra vite saharienne ... Derrière mon arc de triomphe, allongé de tout mon long, mon sac de montagne devant le nez et ma carabine posée dans l’embrasure, je grillais et rôtissais ce jour-là le plus consciencieusement du monde. Après deux jours de marche enragée après les chamois, ce repos était certes le bienvenu. Je puis bien avouer que, comme les marmottes tardaient à paraître, je m’étais déjà une ou deux fois offert le luxe d’un quart d’heure de sommeil à poings fermés. Lorsque je rouvris les yeux, il y avait « du monde » dans mon champ de tir, trois ou quatre marmottons de l’année, gros comme des cobayes, qui couraient ça et là, apparaissaient, disparaissaient, exactement comme des rats dans un grenier. Bêtes impayables de drôleries, sympathiques, gaies et bouffonnes dans leurs attitudes, que je me serais bien gardé de déranger. Dans les trous voisins, il y avait quelques adultes de grande taille, à la fourrure sombre rayée de noir, et c’est leur venue que j’attendais. Certainement, leur sortie n’allait plus tarder ... Sans un bruit, au sommet d’un bloc, une grosse boule rousse se hissa. La marmotte s’installa, debout, les pattes de devant jointes, la tête haute, et tourna le museau à petits coups vers tous les points de l’horizon. Je savais que, si elle m’apercevait, elle lancerait en plongeant son strident coup de sifflet, et que je n’aurais plus devant les yeux qu’une rocaille déserte, où rien ne bougerait plus, toute blanche de soleil. Lentement, je levai ma browning 22 que j’avais prise ce jour-là en remplacement de ma Winchester de trop gros calibre, pour la tirer à la tête, désirant à la fois tuer net et ne pas abîmer la fourrure. Plantée à vingt-cinq mètres sur son caillou blanc, se détachant sur le ciel comme une pierre dressée, comme un de ces cairns que les ascensionnistes bâtissent sur les sommets, elle m’offrait une cible que, même en le faisant exprès, j’étais incapable de manquer. ... À ce moment, l’air ronfla comme au passage d’un boulet, un sifflement grandit, comme celui d’un avion qui se précipite, moteur coupé. D’un seul geste, je dégageai mon canon de mon créneau de pierre ... je savais, pour l’avoir déjà entendu, ce que signifiait ce ronflement de bombe. Un corps noir et fauve qui passe comme un éclair, courant au ras du sol, un choc au sommet du rocher, et tout avait disparu. Debout, je regardais les pierres nues. Plus un bruit, plus un frôlement. Je savais que l’aigle venait de piquer droit au sol, point minuscule qui, comme moi à terre, guettait lui aussi, du haut des nuages. Les ailes collées au corps, presque totalement repliées en fer de flèche, sans plus de surface portante qu’un moineau, il était tombé comme une pierre, descendant de mille mètres avec une vitesse de projectile, visant le sol à cinquante pas dans le dos de la marmotte immobile sur son piédestal. Au moment de se briser à terre, il avait étendu toutes grandes ses fortes ailes, d’un coup de frein net, qui aurait rompu tout autre musculature que la sienne, et son impulsion l’avait lancé, horizontal, rasant la terre comme une balle, avec une rapidité fantastique. C’est ainsi qu’il combat les lourdes proies, renversées par son immense puissance de choc, lançant soudain dans le vide les jeunes chamois et les petits veaux qui se risquent au bord des à-pics. En une fraction de seconde, je l’avais vu et entendu heurter brutalement sa proie ... et maintenant il n’y avait plus rien, plus une ombre, plus un souffle.
Je revins vers la marmotte. Elle était doublement morte, d’abord, de la balle que j’avais destinée à son ennemi et qui, tirée à la volée, l’avait frappée en pleine poitrine, mais aussi de l’attaque formidable du rapace. Dans la fraction de seconde où l’aigle l’avait roulée, un coup de bec lui avait fendu le crâne, net comme un coup de pioche. De plus, de chaque côté des flancs, la peau était déchirée et arrachée par l’étreinte des serres, mettant à nu les côtes et les intestins. La bête était lourde, une des plus grosses qu’il m’ait été donné de voir, pesant probablement de sept à huit kilos, très vieille aussi, comme l’indiquait sa denture usée. Étripée ainsi, la fourrure abîmée, je n’avais nulle envie de la rapporter jusqu’aux chalets. Je la posai bien en vue sur la pierre blanche où elle s’était dressée pour la dernière fois, jetai ma carabine en bandoulière et partis. Là-haut, l’aigle tournait toujours, impassible, et j’étais certain qu’aucun de mes pas, aucun de mes gestes ne lui échappait. Une demi-heure plus tard, arrivé à un col, je cherchai l’oiseau : il avait disparu. À la jumelle, je retrouvai, parmi les blocs de calcaire blanc, l’endroit de mon affût. L’aigle était là, posé, affairé à fouiller du bec une masse informe, et par instants il se redressait, les ailes pendantes, la tête haute, regardant de mon côté, et s’immobilisait comme un oiseau héraldique échappé de quelque blason. Pierre MÉLON. |
|
|
Le Chasseur Français N°613 Avril 1947 Page 423 |
|
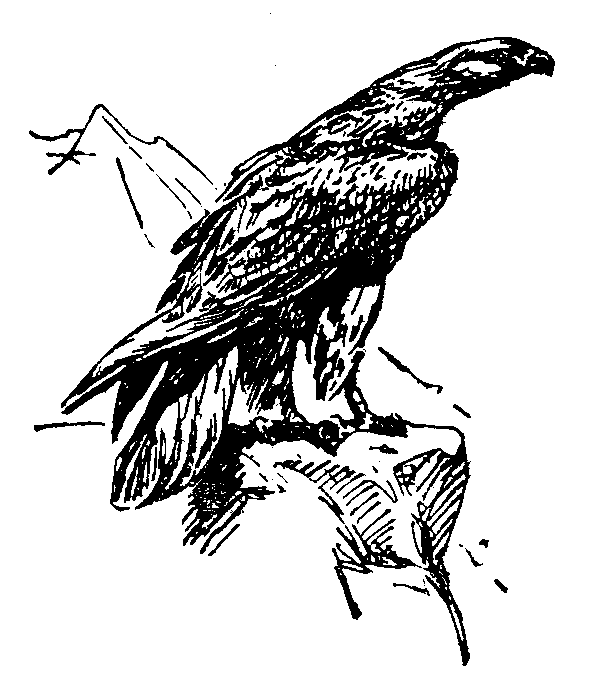 C’est le paradis des marmottes. Pourchassées sans
pitié partout ailleurs, « creusées » dans leurs terriers par les
bergers qui apprécient leur peau, leur graisse qui joue un rôle distingué dans
la pharmacie des Alpes et leur chair — d’odeur pourtant forte en civet
— les marmottes se sont réfugiées entre ces roches. Là, pelles et pioches
sont impuissantes, et leurs terriers forés sous les blocs mêmes sont des asiles
de tout repos. C’est une « ville de marmottes », une de ces réserves
naturelles sans lesquelles l’espèce serait depuis longtemps disparue. Toujours
à portée de quelque trou, elles y défient les chasseurs comme les renards,
leurs ennemis naturels, et ce n’est qu’en les tuant net, à la carabine, qu’on
peut espérer s’en rendre maître. Pour cela, il faut les chasser à l’affût,
derrière ce que les savoyards appellent « l’arc de triomphe ».
C’est le paradis des marmottes. Pourchassées sans
pitié partout ailleurs, « creusées » dans leurs terriers par les
bergers qui apprécient leur peau, leur graisse qui joue un rôle distingué dans
la pharmacie des Alpes et leur chair — d’odeur pourtant forte en civet
— les marmottes se sont réfugiées entre ces roches. Là, pelles et pioches
sont impuissantes, et leurs terriers forés sous les blocs mêmes sont des asiles
de tout repos. C’est une « ville de marmottes », une de ces réserves
naturelles sans lesquelles l’espèce serait depuis longtemps disparue. Toujours
à portée de quelque trou, elles y défient les chasseurs comme les renards,
leurs ennemis naturels, et ce n’est qu’en les tuant net, à la carabine, qu’on
peut espérer s’en rendre maître. Pour cela, il faut les chasser à l’affût,
derrière ce que les savoyards appellent « l’arc de triomphe ».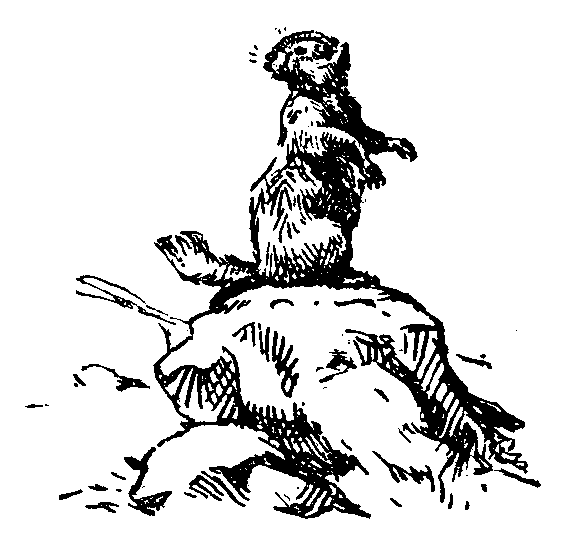 Un moment, une idée stupide me traversa
l’esprit : « ... la marmotte l’aurait-elle entraîné au
terrier ? » Puis j’éclatai de rire. En trois sauts, je fus sur la
pierre où s’était dressé mon gibier, avec ses lourdes allures de petit ours.
Rien ... Mais de l’autre côté du bloc, au bout d’une plaque d’herbe jaune
d’une dizaine de mètres, l’aigle et la marmotte faisaient un tas roux et brun
au pied d’un rocher. Je mis quelques secondes à comprendre. Au choc, il avait
lié sa proie entre ses serres puissantes, mais elle était trop lourde pour
qu’il pût l’enlever, et ils avaient roulé tous deux jusqu’au bas de ce bloc, où
l’aigle s’était assommé et étourdi. Pas pour longtemps. Sans doute m’avait-il
vu debout à mon tour sur la pierre. Il se dressa avec un cri aigre et mauvais.
À mon coup de feu, il fit un bond, les ailes à demi ouvertes, et se sauva en
cahotant entre les pierres, sautant par moments comme un énorme crapaud.
Peut-être était-il encore mal remis de son aventure : les têtes les plus
dures sont excusables de tourner quelque peu, après s’être cognées à une allure
de locomotive contre cinq ou six mètres cubes de caillou massif. Comme il passait
entre deux pierres, en plein découvert, j’abaissai mon arme ; je voulais
voir ce qu’il allait faire. À petits pas, se jugeant sans doute assez loin de
moi, il s’avançait vers le bord d’un banc de roches. Quand il fut sur la
pointe, dominant de cinq à six mètres le reste de l’éboulis, il se planta tout
droit, regardant vers moi. À deux ou trois reprises, il ouvrit ses ailes
énormes, presque en entier, puis les referma et les lissa de son bec. J’avançai
d’un pas ... alors il les étendit toutes grandes et sauta dans le vide,
tout de suite emporté au loin à grandes ramées puissantes. Un instant après, il
revint en planant, passa sans un mouvement à cent mètres au-dessus de ma tête,
insoucieux des balles que je faisais siffler près de lui, et se mit à monter lentement,
en tournant par grandes orbes ...
Un moment, une idée stupide me traversa
l’esprit : « ... la marmotte l’aurait-elle entraîné au
terrier ? » Puis j’éclatai de rire. En trois sauts, je fus sur la
pierre où s’était dressé mon gibier, avec ses lourdes allures de petit ours.
Rien ... Mais de l’autre côté du bloc, au bout d’une plaque d’herbe jaune
d’une dizaine de mètres, l’aigle et la marmotte faisaient un tas roux et brun
au pied d’un rocher. Je mis quelques secondes à comprendre. Au choc, il avait
lié sa proie entre ses serres puissantes, mais elle était trop lourde pour
qu’il pût l’enlever, et ils avaient roulé tous deux jusqu’au bas de ce bloc, où
l’aigle s’était assommé et étourdi. Pas pour longtemps. Sans doute m’avait-il
vu debout à mon tour sur la pierre. Il se dressa avec un cri aigre et mauvais.
À mon coup de feu, il fit un bond, les ailes à demi ouvertes, et se sauva en
cahotant entre les pierres, sautant par moments comme un énorme crapaud.
Peut-être était-il encore mal remis de son aventure : les têtes les plus
dures sont excusables de tourner quelque peu, après s’être cognées à une allure
de locomotive contre cinq ou six mètres cubes de caillou massif. Comme il passait
entre deux pierres, en plein découvert, j’abaissai mon arme ; je voulais
voir ce qu’il allait faire. À petits pas, se jugeant sans doute assez loin de
moi, il s’avançait vers le bord d’un banc de roches. Quand il fut sur la
pointe, dominant de cinq à six mètres le reste de l’éboulis, il se planta tout
droit, regardant vers moi. À deux ou trois reprises, il ouvrit ses ailes
énormes, presque en entier, puis les referma et les lissa de son bec. J’avançai
d’un pas ... alors il les étendit toutes grandes et sauta dans le vide,
tout de suite emporté au loin à grandes ramées puissantes. Un instant après, il
revint en planant, passa sans un mouvement à cent mètres au-dessus de ma tête,
insoucieux des balles que je faisais siffler près de lui, et se mit à monter lentement,
en tournant par grandes orbes ...