| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°617 Décembre 1947 > Page 615 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Chasseurs de chamois

|
« Monsieur Gaston » |

|
|
Plusieurs lecteurs m’ont demandé si l’on emploie les chiens courants à la chasse au chamois. La chose est parfaitement possible, et il fut un temps où, dans l’Oisans, le Chablais et la Grande Chartreuse, des lancers magnifiques s’effectuaient avec des meutes spécialisées, les chasseurs attendant à l’affût en des points de passage bien connus.
D’autre part, le chien peut constituer pour le chasseur un danger sérieux. S’il est quelque peu gros et s’obstine à suivre son maître dans des passages scabreux, il peut fort bien lui faire perdre l’équilibre. Il est impossible à tenir en laisse dans des coins où l’on a besoin des deux mains pour s’agripper, et, si on le laisse libre, il prendra un pied et fera fuir les chamois à des lieues à la ronde. Or, en montagne, l’homme est terriblement désavantagé sitôt que les bêtes sur pied s’écartent simplement d’un couloir et s’en vont à cent pas de l’autre côté d’une arête, cent pas qui, pour le chasseur, demanderont peut-être des heures de montée, de descente ou de traversée. Par contre, dans les chasses bavaroises ou autrichiennes, où le chamois est un gibier de tous les jours, les gardes emploient volontiers le « chien de piste », le retriever, qu’ils appellent « Schweisshund ». C’est avant tout un chien d’arrêt, la plupart du temps d’assez faible taille, petit griffon ou petit épagneul de pays, assez léger pour que, au passage d’un ressaut de rocher, son maître puisse le prendre sous le bras ou dans son sac. La plupart du temps, le chien, lors de l’approche et de l’attaque des chamois, reste en arrière, à l’attache, à l’endroit où l’on s’est débarrassé des sacs. Bien dressé, il ne geint ni n’aboie, et ne va pas fourrer son nez dans les provisions, se souvenant des raclées que ce genre de facéties lui a valu dans sa jeunesse. Lorsque l’on a tiré, si le chamois n’est pas resté sur place, on va chercher le chien. Il a été habitué à suivre la trace silencieusement, sans devancer les chasseurs de plus de quelques pas. Cela demande infiniment de patience, car, à l’encontre de ce qui se passe en plaine, l’emploi des laisses de dressage et des colliers spéciaux est impraticable dans les rochers et le sous-bois épais, et c’est uniquement sur l’obéissance du chien qu’il faut compter. J’ai vu un Schweisshund autrichien, suivant depuis vingt minutes une bête légèrement touchée, se coucher au moment où le chamois, qui s’était laissé approcher, invisible, à quelques mètres, repartait à fond de train sous son nez. Ce sont là des résultats qui en disent long sur les qualités et le mérite du dresseur. Comme il n’y a rien de lamentable comme de laisser agoniser une bête blessée à mort, je n’aime pas plus que les autres chasseurs perdre un chamois touché. À découvert, dans le rocher, celui qui chasse depuis pas mal d’années dans le même district sait, à peu de chose près, où et quand retrouver le chamois, de même que, en entendant un coup de feu lointain, il donne immédiatement un coup de jumelle à l’endroit exact où, dans dix minutes ou un quart d’heure, les bêtes alertées passeront à coup sûr, si elles viennent de son côté. Mais en forêt, c’est une autre histoire. Quand j’étais petit, je m’émerveillais en lisant dans Mayne-Reid et Gustave Aymard les exploits des Peaux-Rouges chercheurs de pistes. J’avoue que mon admiration pour eux a bien diminué depuis que, pendant plus de trente saisons, j’ai suivi à la trace dans les Alpes des chamois blessés ou non. En montagne, il n’y a qu’un petit nombre de passages, classiques, obligatoires, et, même dans un massif où il va pour la première fois, le chasseur devine au premier coup d’œil le chemin qu’a pris sa bête, tout comme le pêcheur de truite, au bord d’un torrent qu’il n’a jamais « fait », est certain de voir une touche derrière telle pierre ou dans tel remous. En plaine, il en est différemment, et mes essais de pistage de cerfs ou de chevreuils ont généralement été de complets fiascos. Mais si, à la rigueur, on peut se passer du « chien de piste », je n’en garde pas moins des trésors de reconnaissance à « Monsieur Gaston ». Le chien qui répondait à ce nom bizarre appartenait à un ami de régiment de mon père, un curieux homme, braco et contrebandier fini, qui logeait dans une cabane de bergers, été comme hiver, tout au pied de l’Obiou. Son corniaud invraisemblable ne bronchait point quand on l’appelait Gaston, il fallait lui donner du « Monsieur » avec son prénom. Monsieur Gaston, qui pesait tout mouillé 1kg,200, était une bête minuscule, que j’ai toujours soupçonnée de descendre d’une de ces levrettes grotesques si en vogue vers 1902 sous le nom de chiens de manchon. Son père, par contre, devait avoir été de plus grande taille, chien de berger ou chien de pays, véritable Société des Nations avant la lettre. Le maître de Gaston — pardon, de Monsieur Gaston — expliquait cyniquement que de tels croisements entre bêtes de tailles aussi différentes sont impossibles en pays plat et nécessitent des dénivellations que seule peut expliquer une forte pente du terrain. En tout cas, le résultat avait été un animal velu, hargneux, pointu de museau, aux petites dents aiguës — oh oui, la canaille ! — toujours grognon, prêt à mordre et de mauvaise humeur. Avec ça à moitié pelé, d’une jaune sale, et aussi peu photogénique que possible. Mais c’était la perle des chiens ! Mis en sentinelle près des sacs, il y restait une journée durant, mort de soif, tirant la langue, mais fidèle au poste et résistant même à la tentation de courir après les marmottes qui venaient siffler de toutes parts autour de lui. Mais lorsque, vers dix ou onze heures, nous avions besoin de ses services, il accourait au coup de sifflet du plus loin qu’il nous voyait gesticuler à son adresse, et, dès qu’il avait flairé le sang, il collait à la voie comme une sangsue. Infatigable, il ne s’arrêtait qu’arrivé au bord d’un torrent ou d’une paroi de rocher. Alors je le fourrais tout bonnement dans une des poches latérales de mon sac, et il se tenait tranquille, accoudé des pattes de devant, sa petite tête émergeant comme un guignol. Une fois seulement, au cours de nos chasses en commun, j’eus l’occasion de l’envoyer à tous les diables, un jour où je tenais par le bout des doigts et des semelles sur une dalle de pierre bien lisse, et où il se mit, sans doute pour m’encourager, à me lécher gentiment l’oreille droite ... La difficulté franchie, Monsieur Gaston, posé à terre, flairait la trace, reniflait un peu plus loin une goutte de sang ou deux, grognait à voix basse en découvrant des dents féroces et reprenait sa route à petits pas. Quiconque eût vu ce groupe de trois ou quatre chasseurs, vêtus en brigands de vieilles vestes innommables, avec des culottes rapiécées de partout, portant sacs, piolets, cordes et carabines ... et suivant religieusement ce cabot gros comme une puce qui semblait, et qui était bien, en fait, maître de la situation, se fût étranglé de rire. Mais, au bout d’une demi-heure, une heure au plus, le chien se couchait et se remettait à gronder, gueule ouverte, les yeux fixes. Après avoir bien remarqué le point qu’il regardait, nous sortions nos jumelles. Rien ... et soudain le chamois était là, à cinquante pas, couché, épuisé, une jambe rompue, prêt cependant à repartir au moindre mouvement en avant de notre part. Lentement, un des chasseurs mettait en joue. Au coup de feu. Monsieur Gaston ne bougeait pas, mais, sitôt que nous nous levions sans précautions, que nous nous mettions désormais à parler à voix haute, il avait compris et s’élançait. Toujours il arriva avant nous sur la bête, et nous le trouvions mordant des touffes de poil, léchant le sang des blessures, mangeant férocement les bouts de viande arrachés aux blessures par l’écrasement des dum-dum. Cette rage après le sang, de la part d’un chien de si petit calibre, était absolument déconcertante. Lorsque nous vidions la bête, il se gorgeait à éclater, grondant toujours dès qu’on faisait mine de l’approcher. Un soir, un dernier saut ayant jeté un chamois mourant dans le torrent, le chien s’y lança à corps perdu. Quand, avec une boucle de corde, nous eûmes réussi à crocher le chamois par les cornes, Monsieur Gaston, qui avait roulé dans l’écume et que nous pensions noyé à tout jamais, était là, cramponné à pleines dents au cou de la bête, d’où sortait, par le trou d’entrée de la balle, un mince filet de sang. Ce jour-là je ne pus me tenir de dire à son maître : — C’est une sale bête, ton chien. Regarde comme il rage, et les yeux féroces qu’il roule. On n’a pas idée d’un animal pareil. Le montagnard bourrait sa pipe, son long Martini entre les jambes. Il l’alluma et secoua la tête. — S’il pesait seulement dix kilos ... — Eh bien ! qu’est-ce que tu ferais ? — S’il pesait seulement dix kilos, je lui ficherais un coup de fusil ! Ils sont morts maintenant depuis bien des années, le chien et le braconnier, mais chaque automne, quand je décroche ma carabine, j’ai une pensée amie pour le grand gaillard maigre, aux cheveux embroussaillés, et pour le chien hargneux avec qui j’ai vécu de si belles heures, au sommet des grands bois et au pied des glaciers. Ces deux là, c’étaient des chasseurs comme je désespère de le devenir jamais, et ils vécurent une belle vie ... Pierre MÉLON. |
|
|
Le Chasseur Français N°617 Décembre 1947 Page 615 |
|
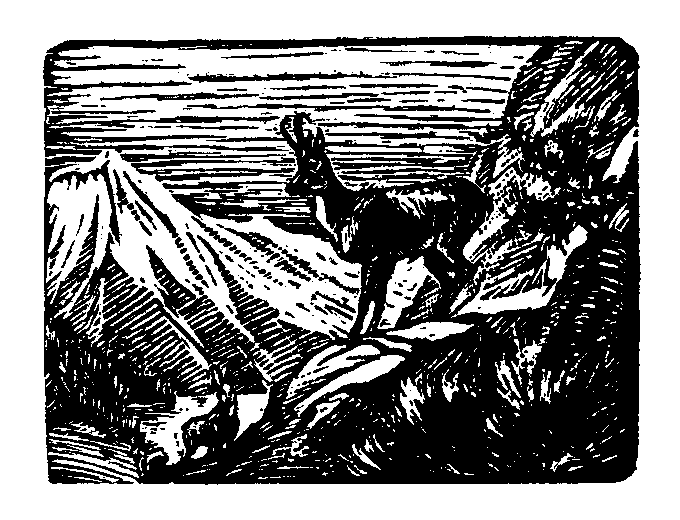 Mais l’emploi des chiens, pour qui aime le chien, a
quelque chose de pénible. C’est un bien triste spectacle que celui d’un courant
qui, sorti des forêts et des pâturages à la poursuite de quelque bouc, s’est
massacré les pattes dans la pierraille des éboulis, a brûlé ses pelotes à vif
dans la neige ou l’eau des torrents, et qui se traîne et gémit, chaque patte
laissant sur les rochers sa trace de sang. Et je ne sais rien d’aussi lugubre
que le hurlement du chien qui est monté, en suivant les chamois, sur quelque
vire où il est impossible d’aller le chercher, et qui ne peut plus descendre,
qui appelle pendant des jours et des nuits et, finalement, meurt de peur, de
froid et de faim, guetté par le tournoiement des corneilles.
Mais l’emploi des chiens, pour qui aime le chien, a
quelque chose de pénible. C’est un bien triste spectacle que celui d’un courant
qui, sorti des forêts et des pâturages à la poursuite de quelque bouc, s’est
massacré les pattes dans la pierraille des éboulis, a brûlé ses pelotes à vif
dans la neige ou l’eau des torrents, et qui se traîne et gémit, chaque patte
laissant sur les rochers sa trace de sang. Et je ne sais rien d’aussi lugubre
que le hurlement du chien qui est monté, en suivant les chamois, sur quelque
vire où il est impossible d’aller le chercher, et qui ne peut plus descendre,
qui appelle pendant des jours et des nuits et, finalement, meurt de peur, de
froid et de faim, guetté par le tournoiement des corneilles.