| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°618 Février 1948 > Page 9 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
L'odorat chez les oiseaux |

|
|
Dans deux articles parus en juin et en octobre dans Le Chasseur Français, mon ami Ganeval apporte une intéressante contribution à la question assez controversée de l’odorat chez les animaux, en particulier chez les oiseaux. Je viens apporter ici quelques pierres à cet édifice encore assez instable. La fumée de tabac était spécialement en cause. Il est classique, tous les chasseurs l’ont entendu dire, que l’on recommande aux tireurs postés à la chasse aux chiens courants ou à une battue de gros gibier de ne pas fumer. Je connais pourtant nombre de mes camarades dont la pipe ne s’éteint jamais qui ont un joli tableau de grosses bêtes à leur actif. Pour ma part, la cigarette ne quitte guère mes lèvres, ce qui ne m’empêche pas d’avoir, dans ma longue carrière, roulé un nombre assez imposant de sangliers et de chevreuils. Ce qui est sans doute plus efficient, c’est d’allumer brusquement l’herbe à Nicot au moment où un gibier vient dans votre direction, alors qu’on ne fumait pas auparavant ; l’animal dont les narines sont frappées par ce relent nouveau s’aperçoit qu’il se passe quelque chose d’insolite, se met en garde et change de direction. La conclusion logique serait donc de fumer sans arrêt, comme une locomotive. C’est assurément par un mécanisme analogue de discontinuité qu’agissent les perceptions auditives. Combien de fois ai-je pu, en chassant le cerf à courre, voir l’animal suivre sa route et venir sauter au milieu d’une file d’autos pétaradant ou d’un convoi de bruyants charrois de bûcherons ! Au contraire, si les véhicules s’arrêtaient brusquement ou, après un arrêt prolongé, se mettaient à démarrer, le cerf faisait aussitôt demi-tour. Il est pourtant certain que les animaux forestiers ne manquent ni d’oreille, ni de nez ; nous le constatons à l’époque du rut, où sangliers et cerfs se dirigent de fort loin vers les femelles. En ce qui concerne les oiseaux, tout le monde s’accorde à leur reconnaître une puissance de vision extraordinaire, mais beaucoup de naturalistes prétendent que le sens de l’odorat est peu développé chez eux. Il est certain que quelques grands voiliers marins, comme le « fou de Bassan », qui sont dépourvus de narines extérieures, doivent être assez peu favorisés pour l’odorat ; il est vrai qu’ils suppléent à cette carence par une vision extraordinaire ; leurs yeux, par le jeu de certains muscles et des sacs aériens, se transforment alternativement en télescope pour la vision lointaine et en loupe pour la vision rapprochée dans le milieu aquatique.
Dans une deuxième expérience, il fit jeter un cadavre de porc dans un ravin encombré de végétation, puis recouvrir d’une épaisse couche de broussailles, et attendit les événements. Au bout de quelques jours, il voyait « des vautours cherchant la proie passer par-dessus le champ et le ravin dans toutes les directions ; mais aucun ne découvrit celle qui y était cachée, bien que, sur ces entrefaites, plusieurs chiens lui eussent rendu visite et s’en fussent copieusement repus ». Il saigna ensuite un autre porc dans le voisinage, le recouvrit de feuilles et attendit. Cette fois, les vautours trouvèrent tout de suite le cadavre, s’abattirent et le dévorèrent en peu de temps. L’auteur explique que, cette fois, les oiseaux avaient pu apercevoir le sang frais et suivre ainsi la trace du cadavre. Cette interprétation, nous ne sommes pas obligés de l’adopter. Enfin, pour dénier aux vautours toute puissance olfactive, il mit deux jeunes oiseaux dans une cage grillagée sur une seule face ; les autres parois étaient épaisses et parfaitement étanches. Audubon constata que, lorsqu’il s’approchait sans aucun bruit avec de la nourriture du côté opaque, les oiseaux ne bougeaient pas, alors que, dès qu’ils apercevaient la proie au travers du grillage, ils se précipitaient avec avidité en criant leur joie. Dans son dernier article, Ganeval cite un fait qu’Audubon aurait interprété en faveur de sa théorie. « L’on sait, dit-il, qu’il suffit de quelques branchages sur une bête morte pour la dérober aux charognards les plus déterminés. Maintes fois, en Macédoine, j’ai vu pendant des heures les vautours arrondir dans le ciel leurs orbes immenses sans rien découvrir d’une proie masquée, alors même que le cadavre n’était plus qu’une puanteur atroce. » L’observation est parfaitement exacte, mais — nous reviendrons dans un instant là-dessus — il faut un déplacement de l’air pour transmettre les odeurs ; comme la fumée, à moins d’un calme absolu, celles-ci tendent plutôt à se rabattre horizontalement qu’à monter vers le ciel. Au surplus, les vautours sont prudents, et quelques présences humaines peuvent être un obstacle à la descente des rapaces. C’est ainsi qu’il m’est arrivé de voir au-dessus d’un pâturage, au col d’Aubisque, évoluer un vol de vautours à grande hauteur au-dessus d’un placenta et d’un poulain mort-né ; les charognards ne paraissaient nullement l’avoir localisé. M’étant éloigné et dissimulé contre une paroi de rocher, je pus voir les vautours piquer au sol, et, le temps de remonter jusqu’au milieu du plateau, toute la charogne avait été dévorée. Un autre fait m’a convaincu que les vautours pouvaient trouver une proie sans le secours de la vue. Un guide avec lequel je chassais l’izard et le coq dans les Pyrénées m’avait promis de me faire tuer un vautour ; pour me livrer à ce déduit assez peu ragoûtant, j’avais l’excuse de ma grande jeunesse. Nous partîmes donc un soir vers les pierrailles au-dessus du lac d’Iléou, emmenant un vieux bourricot galeux. Arrivés au lieu du sacrifice, nous mîmes fin à sa pénible existence d’une balle dans l’oreille, et le guide, après avoir ouvert le ventre du pauvre animal et mis ses intestins dehors, le couvrit de grosses pierres plates pour qu’il ne soit pas dépecé trop rapidement ; je trouvais la précaution superflue ; je dus me rendre compte le lendemain qu’elle était justifiée. La nuit tombait, pas de vautours en vue ; ils étaient certainement couchés. À vingt mètres du cadavre, sous une roche faisant une grotte naturelle, je passai ma nuit à grelotter et ne dormis guère ; pour comble d’infortune, le ciel se couvrit de nuages et nous étions en plein brouillard ; j’étais persuadé qu’une bredouille amère terminerait mon équipée. Aussi lorsque mon compagnon, à la fine pointe du jour, me dit d’ouvrir l’œil et de mettre des cartouches dans mon fusil, je crus à une bonne plaisanterie. Je n’eus pas le temps de pousser mes réflexions plus avant ; six immenses chauves-souris sortirent de la brume presque simultanément et se ruèrent sur le cadavre avec des claquements de bec et des bruits de déglutition pressée. Notre salve laissa sur place trois victimes, dont les plumes étaient déjà barbouillées de sang et de débris écœurants. Malgré la rapidité de notre tir, les nécrophages avaient eu le temps de mettre le bourricot en pièces ; je compris l’utilité des gros cailloux. En tous les cas, j’étais fixé ; ce ne pouvait être la vue qui avait permis à ces croquemorts d’arriver à la curée. Certains oiseaux de mer, goélands, procellaires, viennent de très loin pour des occasions de bombance dont il est impossible d’avoir connaissance par la vue. Lorsque les baleiniers des mers australes voient, non pas haut dans les airs, mais rasant l’eau, des vols serrés de malamoks et de pétrels se hâtant dans la même direction, ils savent que ces oiseaux ont connaissance de bancs de petits crustacés pélagiques et de céphalopodes, qui sont la « nourriture de baleines ». Ils n’ont qu’à suivre ces guides avisés pour rencontrer leur gros gibier. Voici encore un exemple typique. Un bateau est arrivé depuis quelques heures ayant dans sa cale une pêche de raies et de squales ; il n’y a pas un oiseau de mer en vol, le ciel est désert, c’est l’heure où tous les goélands sont rassemblés et somnolent à un mille ou deux d’ici sur les grèves du fond de la baie ; le patron vient à bord et, avant de débarquer sa marchandise, il se met à la parer et à la vider, ce qu’on appelle « habiller le poisson ». Il jette les foies et les tripes à la mer ; aussitôt, vous voyez de la grève lointaine émerger des flocons blancs, et de tout l’horizon arrivent les goélands qui, sans se soucier de votre présence, dans un concert de cris, se gorgent des débris de poissons. Posés à terre, très loin comme ils l’étaient, plus bas que le pont du bateau, leur rayon visuel ne pouvait absolument pas être frappé. D’ailleurs, j’ai pu constater que, lorsque le vent vient du large, les oiseaux sont bien plus longtemps avant de remuer que lorsque le vent porte de terre. Un dernier fait enfin, le plus intéressant, est celui qui a été observé en octobre 1945 dans la région où j’habite. Notre baie de Cancale fut envahie par des bancs de maquereaux et de spratts d’une densité inouïe ; la mer bouillonnait de poissons dont une quantité venait s’échouer au rivage ; j’insiste sur cette circonstance que cette invasion était locale et ne se poursuivait pas en amont de la baie ; les bancs séjournèrent une quinzaine environ. Les premiers jours, ce qui était normal, toute la population de goélands argentés, de mouettes rieuses et de cormorans de la région était présente à la curée et s’en donnait à cœur joie. Au bout d’une semaine, nous vîmes arriver du nord des vols innombrables d’une autre espèce de mouettes, des mouettes tridactyles, qui sont pour nous des hôtes assez rares et seulement au cours de l’hiver. Ces mouettes habitent le Nord de l’Écosse, les Féroé, Jean-Mayen et l’océan Glacial ; leurs colonies nicheuses du Pinmark sont célèbres. Jamais on ne vit rassemblement pareil : c’était un concert de cris assourdissants, la mer était littéralement couverte d’oiseaux qui se touchaient, on ne voyait plus l’eau sur toute la baie ; d’autant plus que ces mouettes pêcheuses, à l’encontre de leurs congénères, capturent leurs proies en nageant et en plongeant plutôt qu’au vol.
Il faut avouer que nous avons le tort, au point de vue des perceptions des sens, de raisonner de l’homme à l’animal et que celles-ci, au moins chez le civilisé, sont bien rudimentaires à côté de celles de nos frères réputés inférieurs. Si nous prenons le sens de l’orientation comme exemple, que vaut le nôtre à côté de celui d’une cigogne qui sait chaque printemps retrouver son nid d’Alsace ou de Hollande, après avoir fait une longue villégiature d’hiver en Afrique du Sud ? Dans ce cas, nous sommes bien obligés de faire intervenir autre chose que la vue ou l’odorat ; faute d’en savoir davantage, nous cherchons l’explication en invoquant le sens inconnu. Comment interpréter, par exemple, ce qui se passe pour certains papillons dont les femelles sont rares ? À peine une vierge de bombyx du chêne est-elle sortie de son cocon que, de plusieurs lieues, tous les mâles sont sur l’aile et se dirigent en ligne droite, à toute vitesse, vers la bien-aimée ; aussitôt que l’heureux gagnant de ce tournoi d’amour a vu couronner sa flamme, tous les prétendants qui étaient en route sont avisés à l’instant et suspendent le vol nuptial désormais sans objet. Ce sont les antennes qui ont servi d’élément informateur instantané. Nous savons aussi que la « ligne latérale », chez les poissons, leur transmet bien des connaissances qui nous paraissent merveilleuses. Pour revenir à la question de l’odorat chez les animaux, poil et plume, vous savez tous aussi bien que moi que votre chien trouvera mieux le gibier à bon vent qu’avec le vent dans le derrière, que, souvent, sous un coup de brise, il sera frappé à plein galop par l’effluve et s’immobilisera dans un arrêt cataleptique. De même un très bon chien chassant le nez haut passera sans rien manifester à côté d’un lièvre immobile, alors qu’un chien de moindre classe qui cherche les émanations au ras du sol ne laissera passer ni un jeannot ni un capucin. Le gibier n’a pas, comme veulent le croire certains chasseurs amis du merveilleux, le pouvoir de retenir son odeur. Un perdreau tombé absolument raide n’a plus la possibilité d’user d’une faculté si avantageuse ; n’empêche que bien souvent le chien passera dessus à plusieurs reprises sans en avoir la moindre connaissance parce que l’oiseau est immobile, alors que le perdreau encore palpitant sera de suite retrouvé. De tout cela je crois que nous pouvons conclure, sans trop de risque de faire erreur, que les oiseaux, à part ceux dont le système olfactif est rudimentaire, perçoivent parfaitement les odeurs, mais que ceux qui se trouvent dans les airs les perçoivent moins aisément que ceux qui se trouvent près du sol ; les effluves odorants, comme la fumée, ne montent que par temps très calme et, le plus souvent, sont portés horizontalement par la brise ; il faut un mouvement de l’air ou du sujet odorant pour que l’odeur se dégage, et celle-ci est d’autant mieux perçue qu’elle surgit brusquement dans une ambiance inodore, de même qu’un son même léger succédant au silence frappe d’avantage l’oreille qu’un son continu même assez intense. Au surplus, un cadavre bien recouvert de fagots ou d’un simple drap n’incommode pas l’odorat, mais, si vous le découvrez, vous êtes suffoqué ; c’est l’explication de l’histoire des vautours d’Audubon, et c’est pour cela que vous mettez une cloche sur votre fromage. J. OBERTHUR. |
|
|
Le Chasseur Français N°618 Février 1948 Page 9 |
|
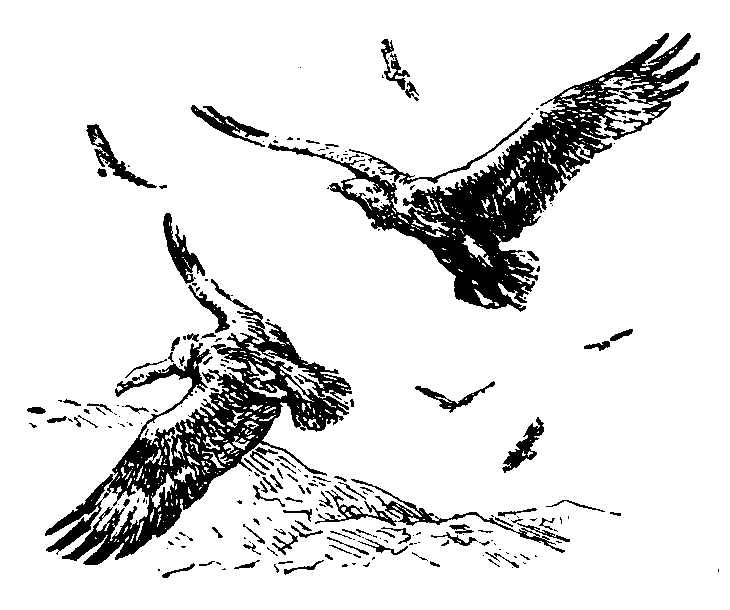 On a voulu étendre cette infirmité aux rapaces et on
a tendance actuellement à attribuer à la vue seule la possibilité d’atteindre
leur proie. C’est Audubon, le premier, qui a émis cette opinion basée sur des
observations dont le vautour noir d’Amérique était l’objet. Le naturaliste
commença par exposer bien en vue une peau de daim bourrée de paille, dans
l’attitude d’un animal mort naturellement. Au bout de peu de temps, un vautour
qui rôdait au-dessus de la plaine fondit sur le pseudo-cadavre, fit sauter les
yeux en argile peinte, puis s’attaqua à la peau, arracha quelques bribes de la
paille qui la remplissait et, n’ayant rien trouvé de comestible, s’envola,
dépité.
On a voulu étendre cette infirmité aux rapaces et on
a tendance actuellement à attribuer à la vue seule la possibilité d’atteindre
leur proie. C’est Audubon, le premier, qui a émis cette opinion basée sur des
observations dont le vautour noir d’Amérique était l’objet. Le naturaliste
commença par exposer bien en vue une peau de daim bourrée de paille, dans
l’attitude d’un animal mort naturellement. Au bout de peu de temps, un vautour
qui rôdait au-dessus de la plaine fondit sur le pseudo-cadavre, fit sauter les
yeux en argile peinte, puis s’attaqua à la peau, arracha quelques bribes de la
paille qui la remplissait et, n’ayant rien trouvé de comestible, s’envola,
dépité.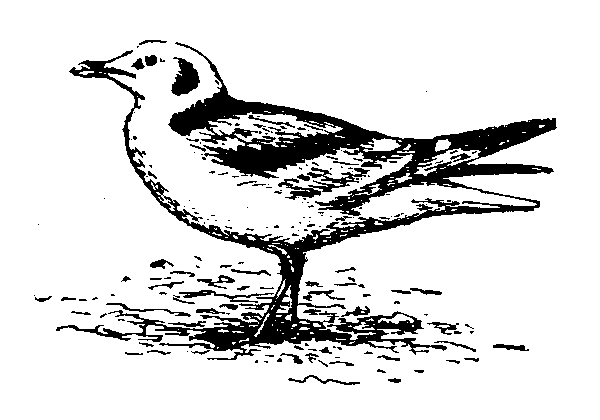 Or ces oiseaux n’avaient pas suivi les bancs de
poissons, ils étaient arrivés longtemps après le début de l’invasion. Comme il
y en avait des centaines de mille, il fallait bien admettre que c’était une
grande partie de la population de la mer du Nord et de l’océan Glacial qui
s’était déplacée pour le festin. Ces oiseaux, lorsque la table fut dégarnie,
nous quittèrent aussitôt. Comment toute cette population aviaire avait-elle été
avisée de l’aubaine ? Pas par la vue assurément. Il est, d’autre part,
certain que la couche de poissons morts qui restait sur les vases à marée basse
dégageait une telle pestilence que, bien loin en mer, on en percevait les
effluves.
Or ces oiseaux n’avaient pas suivi les bancs de
poissons, ils étaient arrivés longtemps après le début de l’invasion. Comme il
y en avait des centaines de mille, il fallait bien admettre que c’était une
grande partie de la population de la mer du Nord et de l’océan Glacial qui
s’était déplacée pour le festin. Ces oiseaux, lorsque la table fut dégarnie,
nous quittèrent aussitôt. Comment toute cette population aviaire avait-elle été
avisée de l’aubaine ? Pas par la vue assurément. Il est, d’autre part,
certain que la couche de poissons morts qui restait sur les vases à marée basse
dégageait une telle pestilence que, bien loin en mer, on en percevait les
effluves.