| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°622 Octobre 1948 > Page 239 | Tous droits réservés |
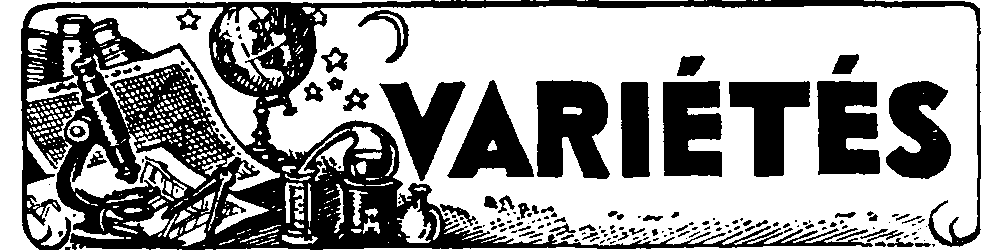
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Au Tibet

|
Chez les N'golo-Setas |

|
|
Fin 1939, en pleine guerre, les explorateurs Liotard et Guibaut partaient, pour la deuxième fois, afin de reconnaître les régions à peu près inviolées du pays des N’golo-Setas et le bassin du Tong, au Tibet. Trois serviteurs indigènes les accompagnaient dans ce voyage au cours duquel Liotard devait périr sous les balles des pillards. Les notes ci-dessous, prises en pays N’golo-Sefas, reflètent déjà le sentiment d’insécurité qui plane sur la petite caravane. 30 et 31 août. — L’été continue. Ce qui signifie dans ce pays paradoxal que des averses fréquentes nous ont empêchés de nous remettre en route et que, transis de froid, nous ne quittons guère notre tente. Le soir, il fait à peine 3 ou 4 degrés ; ce ne serait pas trop pénible si l’humidité n’était pas aussi pénétrante. Le sol, bien qu’incliné, est spongieux comme celui d’une tourbière. Ne pouvant rester assis, les pieds dans l’eau glacée, nous sommes presque toujours étendus sur nos lits de camp. Nos hommes, eux aussi, sont restés sous la tente. Ils ne paraissent pas s’y ennuyer. Les deux Tibétains qui n’ont rien d’autre à faire rient, plaisantent et se racontent des histoires. Je crois aussi qu’ils abusent de l’avantage d’être bilingues. Ils n’adressent la parole en chinois à Tzé que pour pouvoir se gausser de lui en tibétain. Mais Tzé, philosophiquement, ne semble guère s’en apercevoir. Il n’a qu’un souci : confectionner un foyer, j’ai pitié de lui lorsque je le vois accroupi dans l’herbe mouillée en train d’essayer de mettre le feu à des brindilles humides qui lui serviront à enflammer l’argol. Il y a auprès du campement d’énormes épandages dans lesquels on risque de s’enliser. Bientôt, car les troupeaux ne vont pas tarder à redescendre vers les basses régions, ces amoncellements de bouse de yak seront les seuls vestiges de leur passage sur le plateau. Les pasteurs ne laissent rien derrière eux, pas même des tombes. Au contraire de la Chine où les vivants sont obligés de disputer leur sol à l’armée innombrable des morts, le Tibet est une terre sans tombeaux. Les seuls qu’on y rencontre auprès des garnisons chinoises jurent dans le paysage et y paraissent plus tristement isolés d’être de pauvres gens morts en exil. Ici le cimetière est dans le ciel. Comme les lois de la matière interdisent à l’homme de se résorber sans laisser de traces, partout au-dessus de la houle des monts planent les tristes oiseaux qui se repaissent de cadavres. On dit que les grands vautours funèbres apparaissent quelques minutes après le trépas d’un être et qu’à des dizaines de kilomètres ils discernent le phénomène de la mort par un horrible sens dont ils sont seuls doués. Malgré le symbolisme de ce mode de disparition de la dépouille humaine, l’Occidental ne peut s’empêcher d’éprouver une profonde répulsion à l’égard de ces bêtes sacrées qu’aucun Tibétain n’oserait tuer. J’ai vu une fois, auprès d’un monastère, dépecer un cadavre. Les vautours se pressaient comme de gros dindons en un nuage de plumes et venaient prendre de la main des hommes des lambeaux de chair fétide. Les os eux-mêmes y passaient, broyés et pétris avec de la tsampa.
Il règne dans toute l’Asie une sorte d’indifférence au macabre qui frappe l’Européen et qui, à la longue, émousse sa sensibilité. Il m’est arrivé, en Chine, de dormir paisiblement dans des temples occupés par deux ou trois cercueils habités. Moins répugnants sont les seigneurs de moindre importance qui accompagnent les vautours. Le corbeau, gras et lustré, est presque sympathique. Il est espiègle et familier comme le sont tous les animaux au Tibet. La confection des repas l’intéresse vivement, alors que le vautour ne semble prêter attention qu’aux charognes. Son croassement est, avec le cri des marmottes, le seul bruit des solitudes tibétaines. Il fait penser à un ricanement ironique quelque peu agaçant. Les éperviers et les milans sont aussi très nombreux. Eux se nourrissent de préférence d’animaux vivants. Leur audace ne connaît pas de bornes. Un jour, un milan a piqué à mort sur le morceau de viande que Tzé venait de mettre à la casserole et l’a emporté dans ses serres. Le Chinois a essayé de se venger en dissimulant un poignard acéré sous un morceau de viande fraîche. Il en a été pour ses frais. Bien qu’installés tout à côté d’un vaste campement d’une cinquantaine de tentes, nous ne sommes pas gênés par nos voisins. Trois ou quatre cents personnes doivent vivre là dedans. Pourtant personne ne se risque à nous approcher, pas même les jeunes pâtres qui pataugent demi-nus dans les fondrières. Cette discrétion inhabituelle est un peu troublante. Je regrette l’encombrante curiosité des sédentaires des vallées qui nous considéraient comme des phénomènes zoologiques. Je devine trop quel sentiment de peur empêche ces pasteurs de nous observer même de loin. Aussi, les tentatives de Tchrachy pour nous procurer un guide n’ont-elles pas abouti. Il a bien pu convaincre un grand et beau garçon de venir discuter avec nous, mais le N’golo a invoqué divers prétextes pour ne pas nous accompagner. D’abord, il voulait s’adjoindre un compagnon de son choix pour ne pas revenir seul à travers des pays dont les pâturages n’appartiennent pas aux gens de sa tribu. Ensuite, il s’est étendu sur le danger d’abandonner les tentes où, disait-il, les hommes adultes ne sont pas assez nombreux pour résister à une attaque. Il a terminé en exigeant une rémunération tellement exorbitante que nous nous sommes demandé s’il ne l’avait pas fixée ainsi pour obtenir un refus. C’est l’avis de Tchrachy, qui a fini par se lasser de discuter avec lui. L’inquiétude de ce jeune guerrier n’est pas naturelle. Que l’appât d’un gain élevé ne suffise pas à la dissiper, voilà qui n’est guère rassurant. Je commence à me demander si le danger du voyage ne le préoccupe pas davantage que la sécurité de son campement et s’il n’y a pas quelque rapport entre ce refus à l’orientale et les mystérieux cavaliers que nous avons rencontrés il y a trois jours. Nos deux serviteurs tibétains semblent eux aussi avoir fait ce rapprochement, et c’est avec l’air soucieux qu’ils regardent s’éloigner le jeune guerrier N’golo.
André GUIBAUT. |
|
|
Le Chasseur Français N°622 Octobre 1948 Page 239 |
|
 Aux Indes, les Parsis ont amélioré le procédé :
ils exposent leurs morts dans des dakhmas, les fameuses tours du silence. Les
règlements modernes les ont obligés à établir au-dessus d’elles des systèmes de
grillages disposés en chicane pour éviter que les vautours, emportant au loin
les reliefs de leur repas, n’en laissent tomber des débris sur les habitations
voisines.
Aux Indes, les Parsis ont amélioré le procédé :
ils exposent leurs morts dans des dakhmas, les fameuses tours du silence. Les
règlements modernes les ont obligés à établir au-dessus d’elles des systèmes de
grillages disposés en chicane pour éviter que les vautours, emportant au loin
les reliefs de leur repas, n’en laissent tomber des débris sur les habitations
voisines.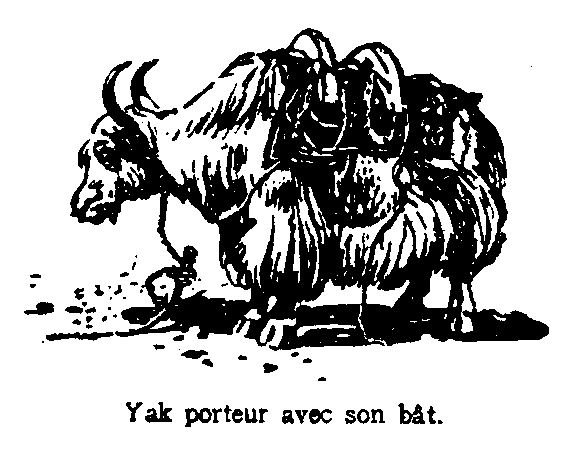 Guerriers, tous les adultes le sont plus ou moins
sous les tentes des nomades. Comme chez les autres pasteurs, l’homme est ici
quelque peu oisif. C’est la femme qui a la charge de presque tous les
travaux ; elle trait les bêtes, prépare la nourriture, tisse les poils des
yaks et confectionne les tentes et les vêtements. Les enfants gardent les
troupeaux, et les vieillards, très rares, car on ne vit pas vieux sur les
plateaux, balancent les outres en peau de chèvre qui servent à baratter le
beurre. À l’homme, au cavalier, incombe la protection de la tribu. Mais, comme
ce devoir n’est pas très absorbant, il se mêle volontiers aux rivalités des
chefs de tentes, aux intrigues qui se nouent au sein d’une confédération de
tribus. Friands de récits fantastiques, les superstitions d’un lamaïsme étrange
et mélangé de magie agissent sur lui comme un breuvage exaltant. Est-il besoin
de chercher plus loin l’origine et la cause des innombrables conflits, des
luttes violentes qui ensanglantent trop souvent ces hautes prairies où, loin
des fourmilières humaines, des hommes qui ont à leur disposition d’immenses
espaces et qui ne possèdent quasiment rien ne parviennent pas à vivre en
paix ?
Guerriers, tous les adultes le sont plus ou moins
sous les tentes des nomades. Comme chez les autres pasteurs, l’homme est ici
quelque peu oisif. C’est la femme qui a la charge de presque tous les
travaux ; elle trait les bêtes, prépare la nourriture, tisse les poils des
yaks et confectionne les tentes et les vêtements. Les enfants gardent les
troupeaux, et les vieillards, très rares, car on ne vit pas vieux sur les
plateaux, balancent les outres en peau de chèvre qui servent à baratter le
beurre. À l’homme, au cavalier, incombe la protection de la tribu. Mais, comme
ce devoir n’est pas très absorbant, il se mêle volontiers aux rivalités des
chefs de tentes, aux intrigues qui se nouent au sein d’une confédération de
tribus. Friands de récits fantastiques, les superstitions d’un lamaïsme étrange
et mélangé de magie agissent sur lui comme un breuvage exaltant. Est-il besoin
de chercher plus loin l’origine et la cause des innombrables conflits, des
luttes violentes qui ensanglantent trop souvent ces hautes prairies où, loin
des fourmilières humaines, des hommes qui ont à leur disposition d’immenses
espaces et qui ne possèdent quasiment rien ne parviennent pas à vivre en
paix ?