| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°628 Juin 1949 > Page 527 | Tous droits réservés |
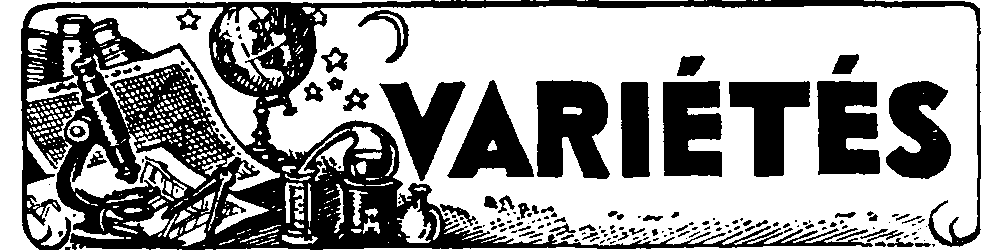
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

|
Pompiers d’autrefois |

|
|
Quelques exemples empruntés à des archives inédites permettront au lecteur de se rendre compte de l’organisation des pompiers au temps jadis. En 1388 et en 1394, la ville de Chartres commanda des « croichés », des anneaux de fer, des cordes et autres instruments pour « résister et obvier encontre la fortune du feu et pour abattre les maisons au cas que il en serait mestier, pour eschevier le péril du feu ». En 1506, les échevins, à la suite de l’accident survenu par la foudre à un clocher de la cathédrale, firent faire des échelles et des crochets de fer. En 1524, par suite d’attentats criminels commis dans plusieurs villes, il fut « enjoint à tous ceux qui ont puits, citernes en leurs maisons pour obvier aux inconvénients devenus en plusieurs villes de ce royaume, mesmement en la ville de Troyes, d’avoir plein un traversain d’eau à son huys, et tenus clos de nuyt les auvans et soupirails des caves et celliers ». En temps de sécheresse, dans les campagnes, on disposait de sortes de grandes seringues, afin de combattre les sinistres. En 1762 et en 1772, l’intendant de la généralité d’Orléans envoya une circulaire aux bourgades de son ressort, leur recommandant de faire l’acquisition de plusieurs pompes, de crochets, de seaux et de paniers. Ce matériel devait être confié à un maître maçon et à un maître charpentier au courant des mesures à prendre ; le représentant du roi promettait à ceux-ci une diminution d’impôts ; en contrepartie, l’établissement des arsenaux — encore fort rudimentaires — pouvait être financé par une taxe locale. On voit que, décidément, il n’y a rien de nouveau sous le soleil ... Dans certaines villes, des religieux se chargeaient du soin des pompes, achetées, parfois, à l’aide d’une loterie. C’est au commencement du XIXe siècle que les pompiers furent régulièrement organisés et pourvus d’une tenue martiale évoquant les empereurs romains joués par des comédiens en tournée. En 1816, à Chartres, le service de ces braves gens est double : ils doivent assurer le secours contre les incendies et aussi collaborer à la police municipale, conjointement avec la garde nationale. Le corps comprend un capitaine commandant, un lieutenant, un sous-lieutenant et « deux commissaires aux incendies », un tambour, des fusiliers, des travailleurs et dix-sept pompiers, répartis en escouades et encadrés de sergents et de caporaux. Certains hommes assuraient l’ordre sur les lieux du sinistre et sauvaient les meubles. Au feu, ils portaient simplement le casque, l’uniforme étant réservé aux fêtes et grandes manifestations ; il comprenait pour les pompiers un habit-veste de drap bleu de roi, aux retroussis de même couleur, avec collet, revers et parements de drap noir, passepoil rouge ; des fleurs de lis décoraient veste et boutons ; les officiers, eux, avaient droit à un vêtement plus soigné et un chapeau à la française. Le casque de cuivre sans chenille servait lors des incendies, celui à chenille orné d’un beau plumet rouge pour le service militaire. Ces soldats-bourgeois étaient armés d’un sabre-briquet. C’est cette tenue guerrière qui a tenté de nombreux dessinateurs du siècle dernier. Les caricaturistes du temps aiment à montrer ces braves gens coiffés à l’antique et faisant l’exercice avec des pétoires ancien modèle, tout comme des grognards de la Grande Armée. Le pompier est, sous Louis-Philippe, un objet de plaisanterie, ainsi que le garde national. Le sapeur villageois est criblé de quolibets ; on raille sa naïveté, et parfois celle-ci est bien réelle ; voici, à titre d’exemple, une lettre de remerciement d’un capitaine de pompiers à son maire, en 1865, et qui est authentique :
Vers la même époque, un poète quelque peu oublié, Boué de Villier, rimait les commandements du pompier français :
Coiffe un casque intrépidement. En vaillant pompier pomperas, À table, au feu pareillement. Monsieur le maire admireras Et ses cuirs inclusivement. Monsieur le préfet salueras Au port d’armes immuablement. Aux élections voteras En soldat du Gouvernement. Le Moniteur d’un sou liras En y croyant dévotement : Ton capitaine honoreras, La cantinière mêmement. Peut-être la croix recevras, À ton immense épatement. Enfin gras et ... casqué, mourras, Quelle noce à l’enterrement ! À cette époque, les compagnies de pompiers des villes possédaient, comme l’armée, des cantinières au pimpant uniforme et au petit baril tricolore. C’est à partir du règne de Louis-Philippe que nous voyons, dans maintes campagnes, les premiers éléments de secours contre l’incendie. À Boisville-la-Saint-Père, la première pompe fut achetée en 1847 ; la seconde fut acquise en 1869. Cette dernière était manœuvrée par douze hommes, lançait l’eau à 35 mètres de distance et donnait 350 litres à la minute ; elle coûta 751 francs. Elle était transportée sur les lieux du sinistre par le cafetier du village moyennant 8 francs par course. L’uniforme était composé d’une blouse bleue, d’un pantalon gris, d’un bonnet de police, ceinturon et casque, le casque légendaire, aujourd’hui orgueil de maints musées de province. En 1869, la garde d’artillerie du Mont-Valérien avait envoyé à ces braves gens vingt-quatre sabres, qui furent peut-être « le plus beau jour de leur vie » ... Les pompiers de Boisville touchaient, en 1877, une somme de 200 francs par an ; elle leur était remise à l’issue du banquet de la Sainte-Barbe, cette sainte étant — avec sainte Agathe en Alsace — leur vénérée patronne. Roger VAULTIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°628 Juin 1949 Page 527 |
|
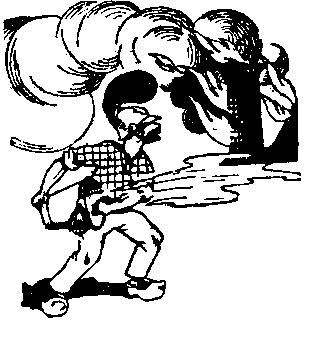 E problème des incendies a toujours été à l’ordre du
jour des villes et des communes rurales. Les maisons en bois de nos vieilles
cités médiévales, les chaumières villageoises offraient aux flammes des
éléments particulièrement combustibles. En quelques heures, une bourgade ou un
hameau pouvait être complètement détruit, ruinant ainsi des familles entières à
une époque où l’on ne connaissait pas encore les assurances.
E problème des incendies a toujours été à l’ordre du
jour des villes et des communes rurales. Les maisons en bois de nos vieilles
cités médiévales, les chaumières villageoises offraient aux flammes des
éléments particulièrement combustibles. En quelques heures, une bourgade ou un
hameau pouvait être complètement détruit, ruinant ainsi des familles entières à
une époque où l’on ne connaissait pas encore les assurances.