| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°630 Août 1949 > Page 616 | Tous droits réservés |

Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
Causerie médicale
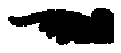
|
Tumeurs cérébrales |
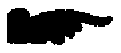
|
|
Ce sont là des affections heureusement rares, un peu moins cependant depuis qu’on a appris à les mieux connaître, et qui ont bénéficié des grands progrès de la neuro-chirurgie. Le cerveau est, en effet, un organe très tolérant, dépourvu de sensibilité propre et aujourd’hui accessible à l’intervention chirurgicale, grâce à l’instrumentation moderne. Mais avant d’en arriver à une opération, toujours sérieuse, il faut s’entourer de toutes les garanties, préciser les symptômes qui permettent de connaître la localisation et, si possible, la nature de la tumeur présumée. Pour cela, il faut au neuro-chirurgien, en plus de l’habileté manuelle et de la connaissance parfaite de l’anatomie cérébrale, des notions approfondies de physiologie et de pathologie nerveuses, à l’aide desquelles il pourra se livrer à une étude minutieuse et patiente du malade, pratiquer souvent à plusieurs reprises les examens pour déceler tel signe, parfois fugace, qui viendra éclairer le diagnostic. En dehors de l’examen systématique de tout le système nerveux, de tous les nerfs périphériques, il devra porter ses investigations sur les organes des sens, notamment sur l’œil et l’oreille, avec la technique et l’instrumentation des spécialistes de ces organes, aux lumières desquels il devra souvent faire appel. Les tumeurs du cerveau présentent un certain nombre de signes communs dus à la compression de l’organe ; ce sont les somnolences, les céphalées, les vertiges, les vomissements, les convulsions, parfois les contractures, chacun de ces symptômes devant être analysé très minutieusement. Les somnolences, avec crises de bâillements constatés par l’entourage, sont, chez l’adulte, un signe cardinal de tumeur cérébrale, au point que, pour beaucoup, l’insomnie doit en faire rejeter le diagnostic. Les céphalées ou « maux de tête » donnent souvent de précieuses indications par le siège des douleurs, leur fixité, leur mode d’apparition (après certains mouvements, par exemple). Le cerveau étant par lui-même insensible, ces réactions douloureuses traduisent une participation de ses enveloppes, des méninges, particulièrement sensibles lorsqu’elles sont congestionnées. La raideur de la nuque est aussi un signe méningé. Les vertiges trahissent une participation des centres d’équilibration en connexion étroite avec le nerf acoustique et ses noyaux d’origine. Les vomissements, dits cérébraux, ont pour caractère de se produire soudainement, sans nausées, « en fusées », particulièrement le matin, au réveil. Les convulsions peuvent donner de précieux renseignements sur le siège présumé des lésions, surtout si elles sont localisées à un membre ou à un segment de membre ; elles doivent être soigneusement différenciées des accès épileptiques, dont elles ont souvent les caractères. Les troubles mentaux ne fournissent que fort rarement des données utiles pour le diagnostic. Ce fut avec l’aphasie que débuta la localisation des lésions cérébrales, mais les recherches modernes ont montré que ce signe n’avait pas la rigueur que voulut lui assigner Broca. Les troubles de la vision et l’examen du fond de l’œil présentent une importance capitale. Bien entendu, rien ne doit être négligé, dans l’examen général du malade, de tous ses organes, de son attitude, de ses réflexes, le tout avec les examens de laboratoire aujourd’hui de rigueur avant toute intervention ; parmi ceux-ci, l’examen du liquide céphalo-rachidien est évidemment indispensable. En dernier lieu, il faudra procéder à la radiographie de face et de profil, à la radiographie stéréoscopique, parfois complétée par des techniques permettant une plus grande précision, comme la ventriculographie, radiographie pratiquée après insufflation d’air dans les ventricules cérébraux, à l’encéphalographie, faite après injection d’air par le canal rachidien, moyens d’investigation qui ne sont pas sans inconvénients et que l’on réserve à des cas exceptionnellement difficiles, après en avoir pesé les risques. L’artériographie, qui consiste à radiographier après injection d’une substance opaque dans les artères, est presque unanimement repoussée par la majorité des neuro-chirurgiens. Le succès d’une intervention chirurgicale dépend, comme dans d’autres cas, de la précocité du diagnostic ; il est donc intéressant de connaître ces principaux signes pour s’adresser, le cas échéant, à un médecin compétent, mais il ne faut pas que leur lecture sème l’effroi et ne fasse interpréter fâcheusement le moindre mal de tête ou telle crise passagère de somnolence due à un trouble purement digestif. Dr A. GOTTSCHALK. |
|
|
Le Chasseur Français N°630 Août 1949 Page 616 |
|