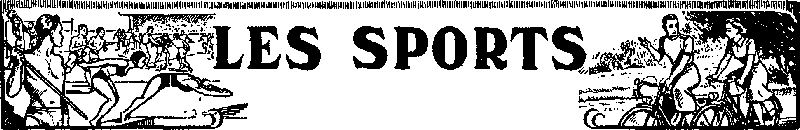| Accueil > Années 1950 > N°640 Juin 1950 > Page 353 | Tous droits réservés |
Le canoé

|
Rivières du Massif Central |

|
|
Seul groupe montagneux entièrement situé en France, le Massif Central donne naissance à un grand nombre de rivières orientées dans toutes les directions. Elles présentent généralement des caractéristiques communes : nées au pied des plus hauts sommets, et souvent formées par la rencontre de nombreux ruisseaux au point qu'il est parfois difficile d'identifier la source principale, elles serpentent d'abord sur le plateau au milieu des pâturages. Peu à peu elles vont emprunter une vallée, contourner une crête, forcer un éperon rocheux ; la pente s'accentuant et fortifiées par l'apport de nombreux affluents, elles se ruent à l'assaut des obstacles, creusent leur lit et s'enfoncent profondément au fond de gorges réputées. Puis, arrivées à la limite de la montagne, elles débouchent dans la plaine, et la transition est généralement instantanée. Il semble que, brusquement satisfaites de l'effort accompli, elles en ressentent d'un coup l'écrasante fatigue et éprouvent le besoin de se détendre en courant paresseusement au milieu d'un calme paysage. C'est dans la partie située entre le plateau et la plaine, là où la rivière coule en gorge, que le canoéiste trouve les plus beaux joyaux de notre réseau nautique. Le lit est rocheux et les rives d'un abord délicat, mais les parois sont généralement couvertes de végétation et de forêts ; il faut parfois parcourir une longue distance avant de trouver un emplacement suffisant pour camper. La route ou la voie ferrée suivent parfois les gorges ou les étroites vallées du Massif Central sans que leur présence soit une gêne pour le canoéiste, qui trouve partout la solitude dans un cadre sauvage que seul le pêcheur de truites parvient à atteindre par de rares sentiers. Ces rivières, outre l'attrait des sites et des régions qu'elles traversent, offrent au canoéiste la gamme complète des difficultés qu'il recherche. Cependant, quelle que soit l'importance des obstacles, leur caractère les apparente aux rivières du Jura précédemment décrites. Sauf en période de forte crue, il est rare de rencontrer un volume d'eau très important, engendrant des rapides ininterrompus à fortes vagues. Le lit présente généralement l'aspect d'un escalier irrégulier, provoquant des rapides rocheux, parfois très rapprochés dans les sections à forte pente, mais, le plus souvent, séparés par des planiols, ou zones d'eau calme, qui facilitent l'arrêt ou la reconnaissance. Il est rare que les rives soient accores ou encombrées au point d'interdire un éventuel portage ou un passage à la corde pour éviter un obstacle jugé infranchissable. De cette remarque, il ne faudrait pas déduire cependant que les rivières du Massif Central sont accessibles à tous et s'y engager à la légère en pensant contourner les passages difficiles. La meilleure époque pour descendre les rivières du Massif Central s'étend d'avril au milieu de juin ; plus tard, sauf en période très pluvieuse, il est rare de trouver une hauteur d'eau favorable. Les rivières du versant nord ne présentent pas de difficultés sérieuses ; elles sont d'un accès assez facile pour les canoéistes parisiens, qui consacrent deux ou trois jours à descendre la partie sportive. La plus fréquentée est la Creuse, avec un cours de 75 kilomètres du Busseau à la retenue du barrage d'Éguzon, de classe 2, sauf les gorges d'Anzême (cl. 3). Son affluent, la Gartempe, peut être descendu avec intérêt pendant 90 kilomètres, de Bersac-sur-1'Ardour à Montmorillon, avec des difficultés de même ordre. La Tardes et le Cher, en amont de Montluçon, constituent une croisière plus sportive (cl. 3-4). Affluent de l'Allier, la Sioule est une fort belle rivière de classe 3 dans la partie haute de Pontgibaud au barrage des Fades ; elle reste intéressante (cl. 2) pendant 50 kilomètres jusqu'à Ébreuil. À l'ouest, nous trouvons une rivière, la Vienne, très sportive en amont d'Eymoutiers, mais il est rare de trouver une hauteur d'eau favorable. En aval, navigation encore très plaisante jusqu'au confluent du Taurion. La Maulde, petit affluent de la Vienne, peut être descendue pendant 28 kilomètres, à condition de profiter d'une crue appropriée (cl. 3). Sur le versant sud-ouest, nous ne pourrons que citer pour mémoire la Dordogne et ses affluents ; ces rivières ont, en effet, payé un lourd tribut au progrès, et l'industrie hydro-électrique s'est emparée de leurs eaux. La Dordogne a été, la première, touchée en 1936 par la mise en service du barrage de Marège, noyant une gorge magnifique et une partie de rivière réputée parmi les plus difficiles à l'époque. L'oeuvre fut complétée, en 1943, par la construction du barrage de l'Aigle et demain elle sera définitivement terminée avec l'achèvement des ouvrages de Chastang et Bort. Conjointement ont été rayés ou vont disparaître de notre carte nautique les affluents de la Dordogne : le Chavanon, la Rhue, la Luzège, la Maronne, toutes rivières de grand sport. La Vézère a été moins touchée, et la partie haute est sportive jusqu'à Restivaux (cl. 3-4), mais il faut être renseigné sur le jeu des barrages et les parties infranchissables avant d'en entreprendre la descente. En aval et jusqu'à la Dordogne, la Vézère, pendant 100 kilomètres, est une rivière touristique sans difficultés (cl. 1-2). La Corrèze (cl. 2-3) peut être descendue en même temps que la Vézère si les eaux sont assez hautes. L'Auvézère est un affluent de l'Isle : classe 4 en amont de Genis, classe 2 en aval. Nous devrons consacrer une prochaine causerie aux versants sud et est tant les rivières du Massif Central sont nombreuses. Pourtant, bien que les citant toutes, nous n'avons mentionné que les parties accidentées que recherche le canoéiste sportif. Les plus importantes de ces rivières présentent encore, en aval, un grand intérêt touristique, et leur descente charmera tous ceux qui recherchent dans la pratique du canoé autre chose que de fortes émotions. Le plus bel exemple nous est fourni par la Dordogne. Après avoir été, entre Bort et Argentat, l'une de nos plus impétueuses rivières, elle reste, en aval de cette ville et jusqu'à la Vézère, soit pendant 200 kilomètres, une rivière vivante, aux belles falaises rocheuses, arrosant de vieux villages et toute une région réputée par ses châteaux, ses grottes et ses richesses gastronomiques. G. NOËL. |

|
Le Chasseur Français N°640 Juin 1950 Page 353 |

|