| Accueil > Années 1950 > N°646 Décembre 1950 > Page 730 | Tous droits réservés |
Cyclotourisme

|
Dans le sud marocain |

|
|
Les yeux collés aux vitres, je contemple ces chaînes de collines, que l'aube commence à teinter. Au delà, c'est le mystère. Le fascinant et prestigieux envoûtement des terres du Sud. Dans ma tête, mille pensées viennent assaillir ma rêverie. Que de difficultés, d'obstacles administratifs m'a-t-il fallu aplanir, pour être là en cet instant et me dire : « Dans quelques heures, tu prendras le départ ! » Le départ de cette randonnée saharienne cyclotouriste, à laquelle je pensais depuis longtemps et que depuis près de six mois je préparais, dans l'indifférence des uns, dans l'espoir, pour d'autres, de me voir aller au-devant d'un échec. Que de fois les avais-je parcourues, ces pistes, sur des cartes imprécises, relevant les points d'eau, supputant mes chances dans telles parties aux aspects montagneux, éliminant — si faire se pouvait — les passages « en sable », jalonnant mes étapes de points de repos, étalonnant les kilomètres qui, de Colomb-Béchar, au nombre de 1.500, me séparaient d'Agadir, que je voulais joindre par les pistes du Sud, jamais parcourues par un cycliste et si peu par de rares voitures. Le train, entrant en gare, arrêta le cours de mes pensées. Sur le quai, l'habituelle animation de ce courrier, tri-hebdomadaire, se manifestait. Ma bicyclette et mes quatre volumineuses sacoches, mises à quai, en intriguèrent plus d'un. Chacun voulut voir et toucher ce simple et merveilleux engin, avec lequel je me proposais, pendant ma période de vacances, de réaliser un impressionnant voyage. En avais-je, là aussi, tiré des plans, pour pouvoir emmener sans remorque le matériel indispensable. Et tout cela intéressait cette cohue, grouillante et sympathique. Il fallut que je donne des détails. Là, dans des encorbellements prévus, reposant sur des supports amovibles et recouverts par les sacoches, quatre bidons de deux litres chacun (réserve d'eau pour deux à trois jours) ainsi protégés du soleil et ventilés par la rotation des roues ; toile de tente, spécialement conçue également, légère, peu volumineuse, facile à dresser ou à plier par un homme seul et par tous les temps, sac de couchage, matelas pneumatique (pas absolument indispensable), tout cela arrimé sur les plates-formes avant et arrière, et maintenu par cordes et sandows. À mesure que mon paquetage se montait, les yeux de mes observateurs s'arrondissaient. De temps à autre, revenait le mot « maboul », que je n'ai pas besoin de traduire. J'en avais, hélas ! bien avant, entendu d'autres, beaucoup moins académiques. Une question se précisa. — Dis, missié, qu'est-ce qui « en a » dans tes sacoches ? Eh bien ! c'était très simple. Il y avait mes vivres de réserves, composés d'aliments condensés, une vingtaine de kilogrammes pour dix jours environ, une indispensable trousse d'outils, du linge de rechange, un nécessaire pharmaceutique et une trousse anti-venimeuse, des pellicules pour ma boîte à images. Chargée de ma bicyclette, la bascule de la gare accusa 62 kilogrammes, dont 50 kilogrammes de charge ; personnellement j'en faisais 83. Mais le tout était bien équilibré, et aucune gêne dans le pilotage ne se manifesta à l'ultime essai. À 16 h. 30, le jour même de mon arrivée, le 12 avril, sous un ciel noir, qu'un vent aux rafales hurlantes rendait plus lugubre encore, je pris le départ. Mais ce violent orage qui menaçait m'arrêta après 15 kilomètres, et une erreur de piste me fit retourner à Béchar, deux jours après, ayant, de ce fait, effectué 200 kilomètres qui n'étaient pas prévus. Partout, dans cette randonnée, sous des aspects divers, des passages fantastiques, parfois lunaires, toujours tourmentés, abrupts, arides, sauvages, désolés, à la végétation inexistante, se déroulent dans un enchantement sans cesse renouvelé. Les pistes dures, caillouteuses, sableuses par endroits, m'obligent fréquemment à mettre pied à terre, au point que mes chaussures auront vécu après 800 kilomètres, détrempées par l'eau des oueds, séchées par le « chergui », cuites par un soleil de feu, râpées par les cailloux. Aux approches des palmeraies, il m'arrive de croiser, à califourchon sur leurs bourricots, au trottinement hâtif et saccadé, des indigènes que ma présence en ces lieux laisse médusés. L'un d'eux, allant annoncer mon arrivée au chef de poste, pénétra, affolé, dans le bureau de l'officier. — Mon lieutenant ! viens vite. Il y a un « Roumi » qui se promène, ici, à bicyclette. C'était à Tissint, pays de Ben Barek, où la plus grande punition infligée aux gamins est de les priver de jouer au ballon. Au demeurant, ces hommes primitifs mais simples et bons, hospitaliers et délicats, ne manquaient jamais, à mon passage dans leurs « ksar », de me manifester leur sympathie en m'offrant le fameux « theï » à la menthe, que je savourais, paresseusement étendu sur de moelleux tapis aux couleurs chatoyantes et aux dessins harmonieux, éprouvant ainsi une bienfaisante détente morale et physique, car, entre 11 heures et 15 heures, la température sur les pistes atteignait 65°. Ceci ne m'incommodait d'ailleurs pas, et, selon le cas, je roulais, à tout heure, tête nue. Jusqu'à Agadir, que je touchais le 3 mai, après vingt et un jours de pistes, dont un seul de repos, le vent toujours de face fut mon ennemi le plus implacable. Chaud, suffocant, augmentant en violence à mesure que le soleil montait au zénith, mais ne cessant que, bien longtemps après que l'astre eut disparu à l'horizon, il soulevait, dans les planitudes, de gigantesques trombes de sable, dont les tourbillons vertigineux s'élevaient vers un ciel où nul nuage ne venait piqueter l'incomparable pureté. Un seul incident, semi-mécanique, contraria un instant ma randonnée. Entre Zagora et Agdz, mon porte-bagages arrière cassa aux pattes, et il me fallut rouler, tant bien que mal, avec une réparation de fortune, jusqu'à Bou-Azzer, à plus de 100 kilomètres, où je pus faire ressouder. Six crevaisons, sur un tel parcours, ne sont signalées que pour indication. Sur tout mon trajet, je fus l'objet, de la part des officiers, chefs de postes, des marques de sympathie les plus touchantes, et nombreuses sont les pages de mon livre d'or de route qui m'honorent de leur étonnement d'une réalisation qu'ils ne croyaient pas encore possible. La réussite de ma randonnée est une démonstration probante de l'oeuvre française au Maroc. Où naguère ne circulaient encore que chameaux et bourricots, ou les « rezzous » étaient partout, dans des terres ingrates, aux sites désolés, à la langue étrangère, aux ressources inexistantes, il a été possible à un homme seul, à bicyclette, de passer. C'est pour moi une grande joie d'avoir été le premier à le tenter et à le réussir. Fernand FIANDO. |

|
Le Chasseur Français N°646 Décembre 1950 Page 730 |

|

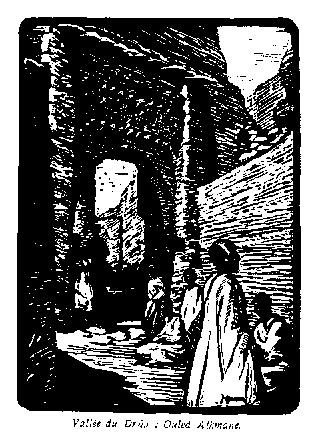 Paris est déjà loin. Dans le wagon de bois du petit
train qui roule vers Colomb-Béchar, la nuit s'estompe peu à peu.
Paris est déjà loin. Dans le wagon de bois du petit
train qui roule vers Colomb-Béchar, la nuit s'estompe peu à peu.