| Accueil > Années 1951 > N°647 Janvier 1951 > Page 5 | Tous droits réservés |

|
Passée en Camargue |

|
Lorsque le vent s'endort
|
Nous sortions de table (1). Guigues tournait encore son café dans sa tasse et récapitulait : « Le Président nous défend le lapin, la cuisinière défend le piveton à sa dame, et le canard se défend tout seul. Il fait clair, la mer est belle, la passée du soir ne sera pas avant cinq heures. Quoi faire en attendant ?» Je hasardai bêtement : « Pardi, la cour à la Gazelle. » Les grands yeux d'ambre me balayèrent d'un regard de reine qui aurait un cloporte à ses trousses : « Vous êtes bien gentil, mon pauvre vieux, mais ce que vous pouvez être idiot quand vous vous y mettez ! » Je baissai le nez sous le compliment : « Pardon, madame, je l'ferai plus. » Son maître et seigneur jubila : « Attrape, mon vieux, et continue, ça t'apprendra à faire le joli cœur, comme ça je ne serai plus tout seul à écoper. — Alors, reprit Guigues, un petit poker d'as pour tuer le temps ?» Le Popotame abattait un jeu écrasant, lorsque la porte s'ouvrit toute grande. Le sauveur entra, rouge et suant d'avoir tant couru. Notre sauveur, en l'espèce l'ami Gourchand, le mastroquet du bourg voisin que Guigues, un soir d'enthousiasme, avait sacré citoyen d'honneur des Enfores. Titre cent fois mérité par tant de vieilles bouteilles qu'il y avait sorties du fond de son carnier, et par tant de barres de glace qu'aux jours torrides d'ouverture il y avait charriées à là sueur de son front pour tenir au frais nos canards et glacer nos pastis. Il voulait parler : un peu la fatigue, un peu la grosse émotion, le souffle lui manquait, mais ses yeux et ses mains avaient une mimique désespérée. La voix lui revint enfin : « Hoï !... malheureux, elles sont là, et vous tapez la carte ! Vous ne savez donc pas ? Ils sont après faire une battue monstre au Galéjon, tant que les foulques s'ensauvent de partout, il en est parti gros vers chez vous, j'ai pris le vélo pour courir vous le dire, j'ai crevé sur des panicauts, à la draille de Corne l'orme, j'ai continué à pied, à la course, par l'eau, par le sec, j'ai passé les trois roubines en embarquant à chaque, et tout ça... tout ça.., Hoï, pauvre Gourchand, tu te tues, et voilà... tu trouves ces messieurs à s'amuser, tranquilles comme s'ils étaient chez toi, à jouer leurs consommations ! Hoï ! pauvre bonne mère, ce qu'il me faut souffrir... » Guigues n'avait pas attendu, il avait bondi à l'échelle du pigeonnier, vers la lucarne haute d'où l'on découvre tout l'horizon marin. D'en bas, je l'entendis : « Messieurs, c'est vrai, il y en a tant sur la baïsse que l'eau a disparu. » * * * Les gens qui ignorent la foulque et ses battues s'étonneront peut-être de cette affirmation de mon frère d'armes et crieront qu'au moins il exagère. Ce serait le mal connaître, il n'a jamais dit que la vérité, du moins la vérité telle qu'il la voit. Donc. pour ceux qui ne savent pas, la foulque est cette énorme poule d'eau — judelle en Bourgogne, blérie chez les Picards, parfois improprement appelée macreuse, — grosse d'apparence comme un colvert, copieusement rembourrée d'un matelas gris d'ardoise, casquée d'ivoire, pesant près d'un kilogramme, hôte habituel des grands étangs, où elle vit en colonies innombrables, et qui se chasse en battue. Dans la Somme, la Woëvre, les Dombes, ces battues sont modestes. Sur les étangs marins de Provence et Languedoc, ce sont des battues monstres. Les barques, au nombre d'une centaine, armées d'un fusil ou deux, avancent en demi-cercle, acculant les bancs noirs vers une des extrémités. D'autres chasseurs de moindre importance s'y trouvent à terre, en rangs pressés, si pressés que parfois un même oiseau reçoit dix coups de fusil pour faire ensuite l’objet d'âpres disputes. Les foulques, enserrées de toutes parts, se lèvent, et leur envol fait un bruit de tonnerre. Certaines vont se faire tirer sur les rives, mais le gros de la troupe revient en arrière, forçant au-dessus de l'escadre et s'y fait massacrer en un feu d’artifice digne d'un 14 juillet. Lorsque l'étang s'y prête par une forme allongée, les vols vont se regrouper à l'autre extrémité. On déjeune à bord des barques, l'on fait demi-tour et l'on recommence. C'est le cas à Bolmon, au sud du clair étang de Berre, que, depuis leur wagon, entre Arles et Marseille, les voyageurs novices prennent d’abord pour la mer. La première « anglade » y commence vers 9 heures. A 11 on casse la croûte, et la seconde anglade s’achève vers 15 heures.
Donc, ce 31 janvier, je ne pensais qu’à massacrer ces foulques stupides chassées du Galéjon et que nous allions à notre tour persécuter sur la baïsse. Il pouvait y en avoir quelques milliers, et il restait encore de l’eau autour, assez d'eau pour notre flotte. L'escadre se composait d'un barcot piloté par Lacroix, lourd comme un ponton et qui naviguait à peu près comme une brique, et du négafol de Gourchand, ancré chez nous pour la saison. Un niégafol est un dangereux instrument, tenant plus de la périssoire que de la barque, qui chavire au moindre faux mouvement et dont le nom provençal indique qu'il noie les gens assez fous pour s'y risquer (2). En tout, six fusils pour tenir les postes au nord de la baïsse et nos deux navires de guerre remontant du sud pour nous rabattre le gibier. Ce ne serait qu'une miniature de battue. Ceux qui l'ont pratiquée savent qu'à la moindre alarme la foulque abandonne les rives, s'en éloigne au maximum, se groupe et se refuse à y retourner tant qu'elle n'y est pas contrainte et forcée. Elle sait l'ennemi devant, elle le voit derrière sur ces bateaux maudits et se refuse pourtant à s'échapper par les flancs. Cela se prolonge durant tout le traque, même après l'envol. Pourquoi ? Dans un livre célèbre, Tony Burnand, grand connaisseur des choses du marais, pose la question et donne la réponse : « Pourquoi ne passent-elles pas tout simplement la lagune pour aller se poser ailleurs ? Pourquoi faut-il qu'elles restent là, à ne pas empiéter sur les rives de leur étang, à s'y heurter à toute hauteur, comme a un grillage ? Pourquoi ? tout simplement parce que sans cela il n'y aurait pas de battues de macreuses. » La nôtre commençait. Du même poste qu'à l'aube, je regardais la même étendue d'eau, toujours aussi calme. Le soleil l'avait chauffée et mettait sur elle une fine buée d'argent, estompant les lointains. Au travers du halo lumineux, j'apercevais le grand banc noir reposant en sûreté. A la jumelle, je cherchai les petits groupes qui, tranquilles, s'étaient égaillés vers les rives et couraient sur les grèves. Au bout d'un certain temps, quelques-uns, puis d’autres, regagnèrent l'eau et s'éloignèrent rapidement vers le large. Je devinai que les barques venaient, la buée me les masquait encore, mais déjà les foulques comprenaient leur avance et se laissaient porter vers moi. Puis j'entendis un bruit distinct, le heurt d'une perche ou d'un sabot contre une planche du bachot. Un souffle de brise éclaircit la buée, la ligne des oiseaux se précisa, et, derrière elle, les embarcations parurent. Les oiseaux se dérobaient vite devant la menace, la fusillade du matin au Galéjon était encore toute fraîche dans leur mémoire. Quelques canards qui, rassurés par le calme, étaient revenus à la baïsse se levèrent, prirent de la hauteur et franchirent indemnes la ligne des postes. Cela valait mieux, un coup de fusil hâtif eût gêné la difficile manœuvre des bateliers. Sur cet étang trop large pour deux seules barques, ils progressaient par amples bordées qui ne laissaient pas place aux dérobades. Je me rencognai au fond de mon affût et j'attendis. Sur son rebord, mes cartouches de rechange étaient rangées, à prise de main, j'étais paré. Un petit peloton d'avant-garde remontait vers la lône d'Arribado, qui étendait vers ma droite ses deux cents brasses d'eau vive ; je laissai passer pour ne rien compromettre. A 300 mètres de moi, la ligne, longue d'autant, s'engageait dans la tenaille des postes. Son long trait de pinceau noir barrait le golfe d’une rive à l'autre ; derrière elle, les barques gagnaient : plus rien ne l'eût fait dévier, son sort était joué. Je commençais de distinguer des blocs plus compacts, d'identifier des bêtes une par une. Devant la ligne, deux gros oiseaux venaient les premiers, devançant les macreuses ; je les voyais très ras sur l'eau, le plat dos émergeant seul, une tête fine et forte au bout d'un col raide ; ils plongeaient souvent et, chaque fois, reparaissaient avec un peu plus d'avance sur les foulques. Grèbes huppés ou cormorans ? D’ailleurs, qu’ils soient « scorpis » ou « sardineaux », de toute façon gibier immangeable. Je ne m'en promis pas moins de les tirer de préférence s'ils venaient : j’aime les coups de fusil hors série. Les barques talonnaient les derniers retardataires, je devinai que Gourchand, là-bas, lâchait sa perche ; il se dressa, envoya ses deux coups de pétoire. Le tonnerre de l’envol ébranla la baïsse, et la charge des oiseaux m'arriva: dessus. Les deux gros me vinrent les premiers, en pointe, volant bas dans un battement d'ailes large et bien frappé. Cormorans. A quarante pas, je les attaquai ; l'un fit son plouf dans l'eau, l'autre entama une verticale, mais sans la puissance de flèche des canards, il n 'était pas encore bien haut lorsqu'il dégringola devant mon affût. Juste le temps de le voir à terre, essayait un rétablissement sur l'appui de sa queue raide, et de croiser l'éclat mauvais de son méchant petit œil vert. Et puis aux foulques. A peine rechargé, les premières me dépassent. Pan ! dans un groupe. On ne devrait jamais « tirer dans le tas », j'en suis puni, tout juste si l'une accuse et s'en va se perdre... J'en double une isolée, trop derrière ; elle file aussi. La foulque est un oiseau bête à tirer à son envol, lorsqu'elle rame l’eau pour se lancer, mais, lorsqu'elle a pris sa vitesse, elle file comme un dard et devient d'autant plus trompeuse que son battement précipité fait illusion. Joignez-y ses pieds démesurés qu'elle allonge à l'horizontale, qui trompent et font tirer trop en arrière. Or le plomb dans les pattes ne compte pas plus pour le carnier que dans la queue du renard ou celle du faisan. En outre, la foulque. « encaisse » terriblement. Combien n'accusent rien, s'en vont au diable et ne s'arrêtent que pour mourir. Un autre paquet, vite, deux cartouches. Et pan ! et pan ! cette fois avec toute l'avance voulue : une foulque raide à l'eau, l'autre rebondit derrière moi sur le sable. Un vol me traverse sur la lône, je choisis celle de tête, trois s'abattent en une gerbe d'éclaboussures. Partout la fusillade, la charge est brisée, les oiseaux tournaillent en tous sens, rejetés d'un poste à l'autre, des isolées me viennent, il en tombe, il en file, l'épaule me cuit, la tête me sonne, et, presque d'un coup, revient le silence. Tout ce qui n'a pas forcé en avant a rebroussé pour se remettre à l'autre bout de l'étang. Longeant la rive au plus près, les deux barques s'en vont reprendre la baïsse au plus loin, puis remontent, ramenant vers nous les rescapées, du moins celles qui « n'ont pas encore compris ». Pas bien nombreuses, car la plupart, après deux battues, ne se laissent plus manœuvrer et se sont évanouies dans l'espace. Pourtant il m'en revient un peu, j'en descends encore, une demi-douzaine peut-être — on ne compte guère en ces instants de presse. Mais ce qui me fait un tout autre plaisir, c'est que, de son bachot croisant devant moi, Lacroix m'a hélé : « Aï retrouva voste coui verd. » Et, à bout de bras, il agite mon colvert du matin. Rien que pour celui-là je donnerais toutes les éponges noires qui flottent inertes devant moi. Maintenant les barques ont accosté pour prendre à leur bord un fusil de renfort et puis partir à la relève des morts, que l’on repêche avec un salabre (3), et à la recherche des blessées. Là, il faut un homme manœuvrant la perche à l'arrière et un fusil à l'avant, prêt à coiffer de petit plomb les désailées qui plongent et ne reparaissent en surface ou n'y risquent le bec qu'une seconde, dans une direction toujours inattendue, et redisparaissent aussitôt. Le Popotame monta au lourd barcot qui s'enfonça d'un cran. Mon poids plume me valut le négafol qui file sur la moindre lancée, vire comme un poisson de roche et dont la souplesse convient au ramassage. Une heure plus tard, la macabre cueillette était achevée, et tout ce qui avait flotté sur la baïsse était à bord. Le plancher de mon embarcation était noir de foulques, et, bien mieux encore, sur le tas sombre se détachait le plastron immaculé de mon garrot retrouvé blessé, retiré, reblessé, refusant de se rendre, assommé enfin d'un: coup de perche, au bout de vingt plongées, de je ne sais combien de virages et d'encore bien plus de risques d'un bain malencontreux. Au retour à la Cabane, Guigues annonçait selon l'usage le tableau qu'il venait d'inscrire au livre de chasse : « Colverts, deux ; col roux, un ; boui blanc, un ; sarcelles, deux ; cormorans, deux ; foulques, quatre-vingt-dix-huit ; et les deux choses, oui, les deux machins, les deux trucs, quoi ! de ce braco. Julie ! oh ! Julie ! demandez à ce brigandasse ce qu'il offre. » Nuit noire, la descente des Cadeneaux, en dessous d'elle. Marseille et sa rade flambant de tous leurs feux. L'octroi. La Rosalie de Guignes a pris la file des voitures. Notre gibier dort sous son camouflage. Un gabelou se penche à la portière : « … à déclarer ? — Rien, brigadier »,. répond rituellement mon camarade. Mais, moi, j’ai une conscience : « Si, si, monsieur, deux cormorans. — Deux escorpis, ça paye pas, au contraire. Mais c'est rigolo, personne n'a rien ce soir, vous êtes au moins le millième à me déclarer la bredouille. — Fait trop beau, brigadier ; avec des temps pareils, la Camargue et rien, c'est tout du même. Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas lorsque le vent s'endort ! » Dans la file des autos, un type pressé klaxonnait. Le gabelou nous libéra, d'un plat de main sur la tôle : « Hé bé ! s'il s'est pas réveillé pour dimanche, restez chez vous et faites une pétanque, ça sera mieux... Allez, passez... » Aux mains souples de Guignes, Rosalie repartit. Mon vieux frère saluait poliment : « Adieu, brigadier. » Albert Ganeval.
(1) Voir Le Chasseur Français de décembre 1950. |

|
Le Chasseur Français N°647 Janvier 1951 Page 5 |

|

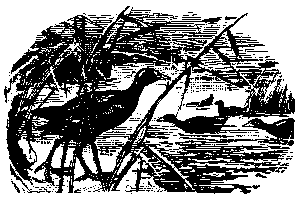 C'est là, je croîs, la reine des battues, ou plutôt ce
l’était. La grande base d'aviation de Marignane, son trafic intense ont porté
bien du tort à Bolmon. L'inconscience de certains pilotes, qui se sont amusés à
piquer sur les bancs de foulques, voire même à les mitrailler sans aucun
profit pour personne, puisque les victimes sont perdues pour tout te monde,
a beaucoup contribué à rejeter les foulques vers les grandes lagunes
languedociennes, demeurées plus hospitalières. Celles-ci, Vic, Mauguio, Méjean,
ont aussi de belles battues. Ce qu'il s'y voit de gibier ? Récemment, dans La
Sauvagine, Pocky — ce pseudonyme cache un grand sauvaginier — citait des
chiffres. Il n'est pas rare que les étangs soient fréquentés par des bandes de
30.000, 40.000, 50.000 foulques. On comprend le fracas de leur envol si l'on
pense que tous ces oiseaux se lèvent ensemble et qu'avant de pouvoir décoller
ils tracent sur plusieurs mètres dans l’eau le long sillon de leurs lourdes
pattes festonnées. Ce qu’il s'y tue ? Le Petit Marseillais du 5 décembre
1902 cite les chiffres de la battue de la semnaine : 4.263 foulques pour les
barques (chiffre officiellement recensé par l'adjudicataire) et plus de 2.000 pour
les piétons. Personnellement, je n'ai pris part qu’à une battue à Bolmon,
contrariée par un temps de cochon et un tel déluge que l’on dut renoncer à la
seconde anglade. La première avait tout de même fait, malgré la pluie, 1:784 victimes,
rien que pour les barques. Si Bolmon a beaucoup perdu de sa valeur, les étangs languedociens
ont conservé la leur. Pocky confirme leurs chiffres de 3.000 à 4.000 pour les
barques et 2.000 à 3.000 pour les piétons. Un joli tableau, on le voit : six à
sept tonnes d’oiseaux. Aussi, le lendemain de ces massacres, à Marseille, les
devantures des poulailleurs de la grouillante rue Longue-des-Capucins sont
noires de foulques, que se disputent les amateurs. Amateurs de quoi ? je me le
demande, car c'est là triste gibier empestant le marécage et la sardine. Si l’homme
était sage, il n'y brûlerait pas sa poudre. L'homme, hélas ! est le pire
des animaux féroces et met sa joie à faire le mal. Je ne dis pas cela seulement
pour autrui, et j'en fais mon mea culpa. Si maintenant je répugne de
plus en plus à tirer pour rien, pour le plaisir, un animal indigne de la casserole,
qui ne nuit à personne, qui n’est même pas un trophée, en ce temps là je n'étais
qu’une brute à fusil, heureuse de tuer. Puissent mon remords et mon aveu persuader
quelques-uns de rester modérés dans leurs destructions, d'avoir un peu pitié des
humbles bêtes et de respecter parfois leur vie.
C'est là, je croîs, la reine des battues, ou plutôt ce
l’était. La grande base d'aviation de Marignane, son trafic intense ont porté
bien du tort à Bolmon. L'inconscience de certains pilotes, qui se sont amusés à
piquer sur les bancs de foulques, voire même à les mitrailler sans aucun
profit pour personne, puisque les victimes sont perdues pour tout te monde,
a beaucoup contribué à rejeter les foulques vers les grandes lagunes
languedociennes, demeurées plus hospitalières. Celles-ci, Vic, Mauguio, Méjean,
ont aussi de belles battues. Ce qu'il s'y voit de gibier ? Récemment, dans La
Sauvagine, Pocky — ce pseudonyme cache un grand sauvaginier — citait des
chiffres. Il n'est pas rare que les étangs soient fréquentés par des bandes de
30.000, 40.000, 50.000 foulques. On comprend le fracas de leur envol si l'on
pense que tous ces oiseaux se lèvent ensemble et qu'avant de pouvoir décoller
ils tracent sur plusieurs mètres dans l’eau le long sillon de leurs lourdes
pattes festonnées. Ce qu’il s'y tue ? Le Petit Marseillais du 5 décembre
1902 cite les chiffres de la battue de la semnaine : 4.263 foulques pour les
barques (chiffre officiellement recensé par l'adjudicataire) et plus de 2.000 pour
les piétons. Personnellement, je n'ai pris part qu’à une battue à Bolmon,
contrariée par un temps de cochon et un tel déluge que l’on dut renoncer à la
seconde anglade. La première avait tout de même fait, malgré la pluie, 1:784 victimes,
rien que pour les barques. Si Bolmon a beaucoup perdu de sa valeur, les étangs languedociens
ont conservé la leur. Pocky confirme leurs chiffres de 3.000 à 4.000 pour les
barques et 2.000 à 3.000 pour les piétons. Un joli tableau, on le voit : six à
sept tonnes d’oiseaux. Aussi, le lendemain de ces massacres, à Marseille, les
devantures des poulailleurs de la grouillante rue Longue-des-Capucins sont
noires de foulques, que se disputent les amateurs. Amateurs de quoi ? je me le
demande, car c'est là triste gibier empestant le marécage et la sardine. Si l’homme
était sage, il n'y brûlerait pas sa poudre. L'homme, hélas ! est le pire
des animaux féroces et met sa joie à faire le mal. Je ne dis pas cela seulement
pour autrui, et j'en fais mon mea culpa. Si maintenant je répugne de
plus en plus à tirer pour rien, pour le plaisir, un animal indigne de la casserole,
qui ne nuit à personne, qui n’est même pas un trophée, en ce temps là je n'étais
qu’une brute à fusil, heureuse de tuer. Puissent mon remords et mon aveu persuader
quelques-uns de rester modérés dans leurs destructions, d'avoir un peu pitié des
humbles bêtes et de respecter parfois leur vie.