| Accueil > Années 1951 > N°649 Mars 1951 > Page 132 | Tous droits réservés |

|
Faits divers |

|
|
Samedi 9 décembre. Je l'ai manquée. Lamentablement manquée. Et deux fois de suite. Pourquoi ? Parce que c'était la première de la saison et que l'émotion a été trop forte ? Je ne sais. Mais je suis rentré fort marri de ma mésaventure et, je l'avoue, honteux d'une maladresse inexplicable. Pourtant, au second coup ... Une belle bécasse, vous savez ... Nous battions un petit bois de chênes verts pour essayer de tirer un lapin, car poursuivre les perdreaux en plein découvert, en fin de saison, est parfaitement inutile. Surtout qu'il soufflait sur le plateau un petit mistral tout juste bon à vous geler nez et oreilles. Deux hectares à peine de taillis dru et épais, coupé en long et en large de quelques petites allées, en bordure de la voie du petit tacot de Nîmes à Saint-Gilles, aujourd'hui abandonnée comme la pauvre gare en ruines qui porte encore, au-dessus de l'horloge sans cadran, l'inscription « Saint-Bénezet ».
Je me postai au carrefour de deux petites allées, tandis que mon compagnon allait battre la remise avec son chien. Un instant plus tard, celui-ci donnait quelques coups de voix. Était-ce elle ou un lapin ? L'arme prête, j'attendais-la sortie de la bête, plume ou poil, quand un bruit se fit dans le fourré et elle sortit brusquement devant moi, à quelques mètres, et se posa au pied d'une touffe. Elle avait fait seulement ce petit saut de crapaud, dont la bécasse est coutumière lorsqu'elle hésite à s'élever ou qu'elle veut ruser avec le chien. J'avais une cartouche à croisillon pour le tir à courte distance et envoyai mon coup à terre, vers la belle ; hélas ! au même instant, m'ayant aperçu, elle s'enlevait d'un bond et passait derrière un gros chêne vert sans me permettre de la doubler. A dix mètres, à terre, et manquée ! Était-ce possible ? J'en étais consterné. — On la retrouvera, on la retrouvera, me dit mon compagnon. Et je restai au poste, remâchant mon infortune, tandis qu'il repartait à sa recherche. Ce ne fut pas long. Dix minutes à peine et le chien la remettait sur l'aile. Elle redescendait le bois vers l'endroit où nous l'avions levée pour la première fois, rasant la cime des touffes drues des chênes verts. A trente mètres, je lui envoyai un coup de dix qui lui fit perdre l'équilibre. Et je m'attendais à la voir culbuter quand je la vis se remettre d'aplomb et disparaître derrière le taillis. Il nous fut impossible de la retrouver, morte ou vivante. J'en ai ronchonné de dépit toute la soirée et ruminai encore ma malchance tout le jour suivant. Mais le surlendemain, racontant ma mésaventure à un confrère,-j'appris qu'elle avait été ramassée morte, la veille, à vingt pas d'où nous la cherchions et en bordure du taillis. Je ne l'avais donc pas manquée, mais simplement tirée avec un trop petit plomb qui ne l'avait pas arrêtée net. Jeudi 21 décembre. Il fait un froid vif. Les vignes submergées sont recouvertes de glace et, par endroits, les fossés qui ont débordé sur la route en ont fait une patinoire dangereuse. Sur le chemin qui mène à la chasse, c'est pire encore : le gel de la nuit a fait monter l'humidité et, à présent que le soleil donne, il l'a transformée en une piste glissante, où mon compagnon a grand'peine à nous maintenir. A gauche, un fossé bordé de tamaris ; à droite, en contre-bas, les vignes inondées fit des terres défoncées d'où il serait impossible de sortir. Entre les deux, juste la place de la voiture qui zigzague comme une folle. Mon chauffeur donne de grands coups de volant à droite, à gauche, accroche les touffes de tamaris. Arriverons-nous au bout ? Et il faut maintenir une vive allure, car si on ralentissait ce serait pire : on risquerait de s'arrêter et, alors, inutile de songer à repartir ; ce serait du patinage sur place. Enfin, ça y est. Un coup de volant et nous voici roulant sur le pré, à travers les touffes d'enganes. On a eu chaud ... — Nous ne sommes pas fichus de repartir ce soir, me dit l'ami Ch ... Belle perspective ... Il est midi. Un beau soleil brille dans un ciel d'un bleu immaculé. Nous déjeunons dans la voiture. Et en chasse. Il faut d'abord tuer quelques lapins, car Noël est là et il faut bien, au moins, le civet. Coup sur coup, chacun de nous roule le sien. Nous allons continuer quand mon compagnon m'arrête et, à voix basse : — Voyez, là, les sangliers, me dit-il. Nous n'en croyons pas nos yeux. À une centaine de pas à peine, en plein découvert, trois sangliers sont là, le groin baissé, semblant brouter en toute quiétude : deux bêtes rousses et une noire. Ils suivent une bordure de tamaris, s'arrêtent, repartent, aussi calmes que des chèvres ou des moutons au pâturage, Nos deux coups de feu ne les ont donc pas effrayés. Malheureusement, nous n'avons ni balles ni chevrotines ; rien que de la grenaille pour lapins et bécassines. J'ai bien une cartouche de quatre, mais à quoi bon à quatre-vingts mètres ? Je décide une tentative d'approche. Si je pouvais les avoir à quelques mètres seulement ! Ils filent tout doucement, traversent les tamaris, puis je ne les vois plus. Ils ont dû passer sur la chasse voisine. Belle occasion perdue. Je rebrousse chemin et aperçois Ch ... qui me fait de grands gestes dans une direction opposée à celle où je les ai vus s'éloigner. Qu'a-t-il donc vu ? Canards ou vanneaux ? Je fais le détour indiqué, puis reviens vers lui. Il a l'air désespéré ! — Ils étaient là, ils étaient là ! Je les avais à quarante mètres, tous les trois sur ce levadon, à me regarder. Ils avaient rebroussé chemin dans le fossé quand vous les avez suivis. Ah ! ... si vous aviez continué quand je vous faisais signe ! Ils vous auraient éventé et seraient revenus vers moi. Alors deux, j'en tuais ! Je ne les aurais pas manqués. Pas à la tête, j'aurais tiré : « Aqui ! là ! ». Et il ponctua son exclamation par un retentissant coup de paume sous son aisselle gauche. — Je n'ai jamais vu ça : des bêtes qui ne font pas attention aux coups de fusil, qui viennent repasser là où nous étions cinq minutes plus tôt et où j'ai même jeté le mégot de mon cigare. Jamaï, nou, ou aï pa vist. Voulioù mouri aqueli besti. (Elles voulaient mourir, ces bêtes.) Deux, j'en tuais, je vous dis. Et pas à la testo, aqui, tiràvi (Et pas à la tête, je tirais.) Et, de nouveau, le grand coup de paume retentit contre son large flanc. — Nous en mettions, pour rentrer, un sur chaque garde-boue. Il reste là, planté sur ses longues jambes, dressant, sur le marais sa haute stature, fusil en bandoulière, les yeux perdus dans le vague, l'amertume au coin des lèvres. Je suis navré de n'avoir pas compris le sens de la, manœuvre que m'indiquaient ses grands bras, agités comme des ailes de moulin. Nous repartons à la recherche des lapins ; mais, je le vois, il est distrait et laisse l'arme à la bretelle. De temps en temps, il s arrête, fait un grand geste, puis repart, tête baissée. Et quand je m'approche, me regarde d'un air navré : Voulioù mouri, aqueli besti. Refrain que plusieurs fois, dans la soirée, je l’entendrai se dire à mi-voix à lui-même : « Et deux, j'en tuais. » Mardi 26 décembre. Un déplacement familial, à l'occasion des fêtes de Noël, m'a amené ici, dans cette ville du Centre que traverse la Loire. La neige tombe, fine et gelée. Tout est blanc et le fleuve est pris sur toute sa largeur, d'une rive à l'autre. Les gens passent, emmitouflés et pressés. Les voitures qui circulent sont à moitié blanches. En aval du pont, dans le port du canal, des péniches sont prises dans la glace. Les grues, les ponts et échafaudages métalliques se dressent et paraissent encore plus noirs sur le fond blanchâtre du ciel. En amont, une partie du fleuve, aux abords de la petite île couverte de touffes, d'arbustes et de buissons, subsiste une bande d'eau libre qui paraît toute sombre entre la glace qui l'enserre : cent mètres sur dix environ. A droite, non loin de la rive, un canot à moteur essaie de traîner une drague, afin de briser la glace. Je contemple le paysage, ce décor hivernal qui me rappelle que c'est là un bien beau temps pour la chasse. Un gros vol d'étourneaux passe à faible hauteur, traverse le fleuve et va se perdre au-dessus des toits de la ville. Là-bas, soudain, du coin de la petite île, se détache un gros point noir, puis un autre, et ce sont quatre oiseaux qui se mettent à nager dans le peu d'eau libre qui reste. Ce ne sont pas des canards ; pas des grèbes non plus : les grèbes sont bien plus petits et plongent à tout instant. Des poules d'eau peut-être ? Mais l'un d'eux monte sur la glace, je vois son dos arrondi et bombé, son cou tendu ; j'ai reconnu une foulque. Ce sont des foulques, en effet, les fameuses macreuses du Midi. Elles vont maintenant à la queue leu leu, dans le sillage l'une de l'autre, indifférentes au bruit du canot qui pétarade et des autos qui passent sur le pont. Les voici au bout de la bande d'eau libre ; elles se rassemblent et tiendraient bien toutes quatre dans un mouchoir. A bonne portée, pas une ne s'échapperait. Un gamin — dix ans à peine — passe, tenant en laisse un joli épagneul breton. Un fils de chasseur certainement. Il s'arrête et contemple, lui aussi, les évolutions des oiseaux. Puis il se rapproche de moi. — Canards ou poules d'eau, monsieur ? — Des foulques, mon petit. Des morelles, comme vous les appelez ici. Le chien se dresse contre le parapet, essayant de voir. Son nez en frémit de désir. Puis il s'en va, entraîné par son jeune maître. Je reste encore là, fouetté par la neige et la bise glacée. De nouveau, passent, pressés, des étourneaux : un vol, puis un autre encore. Il doit faire mauvais ailleurs, les oiseaux se déplacent. Au loin, soudain, une ligne noirâtre coupe le ciel ; puis des points noirs se précisent et se rapprochent. Bientôt je les distingue : des canards. Ils passent assez haut, une dizaine. Leur file déployée suit le fleuve. Ils vont franchir le pont du chemin de fer, quand un train s'y engage en trombe, jetant un gros nuage de fumée blanche. Leur ligne se disloque un instant, puis, reformée, continue sa route et se perd bientôt à l'horizon brumeux où ciel, terre et fleuve se confondent en une même teinte d'un blanc sale. En bas, les foulques continuent leur manège. FRIMAIRE. |

|
Le Chasseur Français N°649 Mars 1951 Page 132 |

|

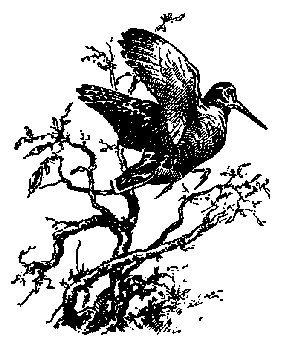 On avait tiré une paire de lapins quand, soudain, nous
l'entendîmes s'envoler dans le taillis. J'entrevis, de trop loin, sa silhouette
et repérai la remise. Une bécasse ! Ce mot seul me fait tressaillir. Elle
n'était pas sortie du bois. Un petit vol d'une cinquantaine de mètres seulement
vers une touffe de chênes blancs dont le feuillage, encore paré des tons de
rouille de l'automne, tranchait sur le vert sombre du fourré.
On avait tiré une paire de lapins quand, soudain, nous
l'entendîmes s'envoler dans le taillis. J'entrevis, de trop loin, sa silhouette
et repérai la remise. Une bécasse ! Ce mot seul me fait tressaillir. Elle
n'était pas sortie du bois. Un petit vol d'une cinquantaine de mètres seulement
vers une touffe de chênes blancs dont le feuillage, encore paré des tons de
rouille de l'automne, tranchait sur le vert sombre du fourré.