| Accueil > Années 1952 > N°661 Mars 1952 > Page 179 | Tous droits réservés |

|
Conakry |

|
Chef-lieu de la Guinée française
|
J'avais un désir, c'était de connaître l'Afrique noire, cette Afrique qui devient le rendez-vous des reporters. On afflue maintenant en Afrique, mais bien plus pour y travailler que pour villégiaturer ou, éventuellement, vivre en farniente, car l'époque déjà lointaine du chasse-mouches et du hamac n'appartient plus qu'à quelques vieux rois déchus.
Ce n'est qu'après avoir laissé les derniers contreforts du Fouta-Djallon et le mont Kakoulima (1.100 m.), ainsi que l'escale de Coyah, que nous nous engageons, après quelques vallons, dans l'immense plaine parsemée de bananeraies et de palmeraies. La route, bitumée depuis Coyah (53 km.), permet de rouler tranquillement et de contempler aisément cette vaste étendue qui conduit à la mer. Plus on approche de celle-ci, plus la plaine devient par endroits marécageuse : c'est le poto-poto ; seuls, les palétuviers, aux feuilles vert-cinabre, rehaussent le ton de cette nature un peu morne. Des rizières bien petites se cachent à proximité des marigots, où somnolent parfois de petits crocodiles que l'on appelle plus souvent « caïmans ». Au kilomètre 15, commence l'activité. C'est ici que se situe l'aérodrome, avec son hangar, son restaurant réputé et sa station radio toute neuve. En se rapprochant de la ville, un hôtel-restaurant-dancing confortable : le Lido, reçoit les passagers d'Air-France et d'Aigle-Azur qui font escale au chef-lieu. Tout près de là, en empruntant la route touristique qui s'élève sur un mamelon appelé « Bellevue », on découvre toute cette agglomération cachée dans un bouquet d'intense végétation de : manguiers, palmiers, cocotiers, flamboyants, papayers, frangipaniers, bougainvillées, fromagers et autres arbres encore ... Seuls émergent de cette frondaison les bâtiments neufs à plusieurs étages, quelques toits de tôle ondulée qui jettent une note discordante sur cet ensemble de la nature qui fait de Conakry la Perle du Sud. En regardant la presqu'île sur la droite, on aperçoit le port, avec ses vastes docks, la silhouette tantôt fine, tantôt ramassée, des bananiers ou cargos. À l'horizon se détache le bloc des îles de Loos, dont les plus importantes : Kassa et Tamara, sont le but de promenades agréables que les Conakryens et les touristes ne manquent pas de faire. Reprenons la route intercoloniale, où nous entrons dans la cité industrielle, le futur Tainakry des urbanistes. Dépôts d'essence, de matériaux de construction, fabriques de jus de fruits, sociétés diverses (bananières ou minières) ont choisi cette banlieue pour s'y établir et donner naissance à ce nouveau village. Après avoir franchi la ligne du chemin de fer, nous nous acheminons vers le pont de Tulbo ; ce pont, constitué par une large bande de terre, prolonge la presqu'île du Kaloum à l'ancienne île de Conakry. À l'extrémité du pont, deux voies s'ouvrent pour entrer dans cette ville au pourtour de 12 kilomètres qu'agrémente une jolie corniche. La première voie est la route du Niger, bitumée comme la plupart des artères de la ville ; bordée de manguiers, elle nous conduit directement vers centre ville en laissant à droite et à gauche le quartier indigène de Sandervaya, les dépendances du chemin de fer, la mission catholique et son imprimerie. Nous voici au marché. Les alentours sont habités presque exclusivement par des commerçants syriens et libanais, qui ont la majeure partie du commerce bien en main. Ils sont établis dans des maisons de style mi-européen, mi-africain, et vendent dans leurs boutiques désordonnées des tissus, de la quincaillerie, des colifichets et articles de pacotille. Faisons une halte sur cette place du marché bordée de flamboyants aux bouquets de fleurs rouges. Tous les jours, au matin notamment, le marché est le pôle attractif de la population indigène parmi laquelle les boys coursiers ou boys cuisiniers viennent faire leurs achats. Deux halles abritent des marchands de toutes sortes et des cordonniers. Le marché est également entouré de stands, où les dioulas (petits marchands de table) vendent à la fois des cigarettes, des médicaments, de la parfumerie, de la mercerie, de la bonneterie, et d'autres choses encore ... Il y a aussi les inévitables vendeurs de sandales, babouches en cuir ou nylon de couleur vive, de gris-gris (talismans), de sacs en caïman et en iguane, etc. Dans l'atmosphère aux odeurs fortes du beurre de karité et des poissons fumés, grouille une foule multicolore ; toutes les couleurs de la palette y sont représentées. Par-ci, par-là, s'éparpillent les groupes de marchandes de légumes, de fruits, de volailles, de moutons, de sel, de calebasses (grosse écorce de fruit servant de récipient aux Africains). On vend par petits tas ou par boîtes de cigarettes vides : pour 10 francs, pour 20 francs ... La balance apparaîtra peut-être en ce demi-siècle, puisque M. Paul Béchard, ex-gouverneur général de l'A. O. F., a déclaré dans un axiome qui lui est cher : « L'ère du pionnier est finie, celle du technicien commence. » Perdu dans un coin, un marchand de meubles rustiques attend le client. Dans un angle de la place, la halle à la boucherie s'élève, survolée en permanence par les charognards (espèce de vautour au cou décharné), toujours avides de tripaille. À l'intérieur se pressent contre les grilles les femmes indigènes, porteuses de leurs bassines, ou cuvettes, dans lesquelles se mélangent légumes, fruits, viande, huile de palme. Bien entendu, les récipients contenant ces provisions sont portés sur la tête, comme c'est la coutume en Afrique noire. Une boucherie européenne est installée, dotée d'une chambre froide ; devant la vitrine, les boys cuisiniers sont en extase devant la présentation de la viande et des plats de charcuterie. Ne quittons pas la place sans jeter un coup d'œil sur un nouvel hôtel de sept étages, dont le rez-de-chaussée est occupé par une papeterie, une pharmacie et un marchand de tissus ; c'est un immeuble moderne, avec balcons circulaires, que les petits Africains regardent de leurs yeux ronds. Prenons l'avenue du Gouvernement, qui fait suite à la route du Niger. D'abord l'école des filles, de nombreux commerçants grecs, syriens et libanais, la B. N. C. I., le Commissariat de police, d'importantes maisons de commerce françaises, le jardin public, où est érigé le monument aux morts ; au fond du jardin, la Chambre de commerce, qui resplendit de blancheur. Nous sommes dans le quartier neuf de la ville. Les bâtiments à plusieurs étages, d'allure métropolitaine, aux façades crème ou blanches, contrastent avec le vert éclatant des manguiers et fromagers (arbres énormes) qui bordent les avenues. Sur une place, et à proximité de la Mission catholique pour jeunes filles, se dresse une des plus belles cathédrales de l'A. O. F. ; conçue dans un style XXe siècle, elle est digne d'une grande capitale. Le jour y pénètre par des vitraux de couleurs vives, allant du bleu le plus pur au rouge le plus éclatant. Elle est ornementée par des fresques solidement peintes. Derrière ce lieu de recueillement, s'étale la place du Gouvernement, avec ses jardins, la statue du gouverneur Ballay ; le Palais du gouverneur et les services administratifs l'encadrent. Non loin de là le Palais de justice, le lycée Vanvolenhoven, le Conseil général, avec sa salle immense et ses tableaux non moins grands, la mairie, le cinéma, la petite hutte-dancing, le cercle de l'U. A. S. T. et ses tennis, le peloton de gendarmes, très bien situé dans un cadre de verdure, constituent un quartier relativement calme. Sur un boulevard très mouvementé, qui commence au port et finit au phare de Boulinet, se succèdent de grosses maisons de commerce françaises, agences maritimes, la banque de l'A. O. F. et, dans une rue adjacente, la poste et ses dépendances, et la maison de la radio. C'est cette première artère que prennent les passagers faisant escale pour quelques heures avant de repartir pour Abidjan ou Dakar. On distingue immédiatement si le bateau « monte ou descend », car l'élégance des passagers est déterminante sur ce point. Ceux qui viennent du sud sont vêtus plus modestement, coiffés de casques usagés, de shorts et chemisettes un peu passés, l'allure libre, la robe « maison », le teint bronzé ; ce sont en principe les veinards qui repartent en congé de quatre ou six mois. Les nouveaux venus ont l'allure étriquée, les casques et vêtements rutilants de blancheur, le pli au pantalon, la robe modèle Carven ou Christian Dior, et la capeline très rue de la Paix. C'est ainsi que tous les quinze jours ou trois semaines nous arrive un souffle de fraîcheur métropolitaine ... Mais, comme dans beaucoup de villes coloniales, il n'y a pas que de belles choses à voir ; il y a également les vieilles cases indigènes, toutes basses, couvertes de tôles rouillées, sales, délabrées, des tas d'ordures au coin des rues. Les trottoirs, larges pour la plupart, sont encombrés soit par des véhicules, soit par les couturiers et brodeurs, qui étonneraient plus d'une midinette. Connaissant l'essentiel de centre ville, revenons vers le port pour nous arrêter quelques instants à la gare. Semblable dans l'ensemble à une de nos stations de province, elle est malgré tout plus animée, surtout le matin. Chaque jour partent soit un train de marchandises, soit un omnibus, soit un express (36 heures pour 654 km.). Il n'y a qu'une seule voie de Conakry à Kankan, et celle-ci a un mètre de large. Il faut voir la cohue pour monter ou descendre du train ... Par les portières, par les fenêtres, sortent gens et bagages multiples, sans compter les volailles ... Je vous assure que les wagons ne restent pas longtemps propres. Que ce soient des premières, des secondes ou des troisièmes, l'indigène ne fait pas de différence : on ne change pas les mœurs d'un peuple du jour au lendemain. Dirigeons-nous vers le pont du Tumbo en empruntant la route de la Corniche dans le sens habituel, c'est-à-dire vers le port. La circulation est assez dense, étant donné le parcours touristique. Tout d'abord, voici le garage administratif, les ateliers de réparations, dépôts de bulldozers, pelles mécaniques, matériel nécessaire à l'entretien des routes ou la mise en oeuvre, la centrale électrique qui alimente la ville et ses abords immédiats, les constructions neuves et coquettes des diverses maisons de commerce et de transit, le stade Marius-Moutet, le petit port de pêche et le grand port de commerce, où s'effectuent notamment les chargements de bananes (régulièrement toutes les semaines à destination de la France). Port en eau profonde, il est protégé contre l'ensablement par une grande digue. Il est constitué par les quais bananiers et quais paquebots ou cargos. On construit actuellement un port minier, car la presqu'île du Kaloum a été mise en exploitation depuis quelques années pour le minerai de fer. Le terre-plein est très étendu, les magasins généraux nombreux, l'équipement succinct, mais moderne, et le rail suit les quais. Un bassin abrite les remorqueurs, et une petite rade fermée artificiellement reçoit les bateaux de plaisance et vedettes destinées au trafic entre le port et les îles. Dans la périphérie du port, on remarque la place qui se caractérise par un énorme fromager séculaire, le Service des douanes, le Commandement du port, les Travaux publics, le Collège technique, la Compagnie des chargeurs réunis, Air-France et le Service des mines. En tournant près de la Compagnie française de l'Ouest Africain, on monte vers la trésorerie, les jardins du Palais, la nouvelle imprimerie. En s'arrêtant un instant sur cette partie de la Corniche, nous découvrons, coupant l'horizon, les îles de Loos : Kassa et Tamara. Dans la première, une célèbre pêcheuse très connue en Afrique : Mme Anita Conti, y a installé des pêcheries ; on les distingue très bien avec des jumelles. Dans la deuxième, des Canadiens exploitent de la bauxite ; à l'extrémité de cette île a été élevé le phare de Tamara, qui commande loin en mer. Ce groupe d'îles a gardé son pittoresque quant à la végétation luxuriante, les habitants y sont peu nombreux. Seul, le pénitencier reçoit beaucoup de « pensionnaires ». C'est à cet endroit de la Corniche que les Européens aiment à se promener le soir au clair de lune ou à contempler en hivernage toute la féerie des couleurs des couchers de soleil de septembre. La particularité du lieu est déterminée en outre par l'implantation des cocotiers, qui courbent leurs troncs vers la mer. Continuons maintenant vers le phare de Boulbinet, qui commande le chenal ; nous découvrons le coquet immeuble du cercle de l'Union, où ont eu lieu les réceptions, la jolie demeure de l'administrateur-maire et le marché aux poissons. C'est ici que la population européenne et africaine vient se ravitailler en capitaines, anguilles, raies, limandes, soles, colins, et quelques crustacés ; c'est le quartier de Boulbinet et hélas ! celui du cimetière également. C'est aussi le coin des pêcheurs, des fabricants de filets, des tisserands et des piroguiers. Peu de maisons européennes, si ce n'est une nouvelle école construite en bordure de corniche. Plus loin, sur un promontoire, est installé l'Institut français d'Afrique noire, sorte de musée et centre d'études. Nous arrivons à l'hôpital, caché dans la verdure des palmiers et cocotiers, aux bâtiments flanqués de galeries sur lesquelles se reposent les convalescents. Puis la route descend vers les habitations du Camp militaire, Radio-Conakry, la Maison du combattant : c'est le quartier de Téménétaye. Nous voici au terme de notre circuit de douze kilomètres, après avoir surpris sur notre droite de petites voiles triangulaires qui oscillaient au gré du vent sur la mer relativement calme. Si nous repassons le pont du Tumbo, en allant vers la route touristique, nous trouvons sur notre gauche le village de Camayenne, où est aménagée une petite plage, agrémentée par un restaurant-bar-dancing, le rendez-vous des « nocturnes ». En longeant la côte, on passe devant le camp des gardes-cercles, le nouveau collège, et il me faudrait pousser jusqu'au kilomètre 14 pour apercevoir la belle plage de Dixin, où le tout Conakry se rassemble le dimanche en fin d'après-midi. Mais cette cité n'est pas seulement belle par sa nature. Elle l'est aussi par la gracieuseté de ses femmes indigènes, dont le buste droit, l'allure majestueuse, la richesse de leurs atours forment le plus brillant attrait. Les enfants sont charmants et bien potelés. Les hommes, grands pour la plupart, n'ont pour toute élégance que leurs boubous (grande chemise de nuit à larges manches) ou vêtements de toile blanche. La ville compte 2.500 Européens environ et une trentaine de mille d'indigènes. Le ravitaillement est renouvelé chaque semaine en ce qui concerne les légumes et fruits venant de France, et il est satisfaisant pour l'indigène. Les fruits locaux sont : la banane, l'orange, la mandarine, la goyave (saveur de la fraise), la papaye, la mangue (dont l'odeur d'essence térébenthine fait « reculer » au début des premières bouchées) et, si l'on veut, la pastèque. Quant au climat, dont on parle tant, il y a des Européens, habitant la Guinée depuis une vingtaine d'années, qui se portent très bien ; tout dépend de la vie qu'on mène ; la colonie demande une certaine discipline au point de vue sanitaire ; il faut la respecter et, si la bouteille de Champagne n'est pas exclue, bien au contraire (de temps en temps ça donne un « coup de fouet »), les apéritifs anisés ne sont pas les boissons qui conviennent ; on en abuse vite. Il y a deux saisons : la première, qui est sèche, de novembre à mai (moyenne : 26 à 28°), renferme une bonne période, de décembre à mars, où la température est clémente. La deuxième : de juin à octobre ; c'est l'hivernage, ou saison des pluies ; la transition des deux saisons est la plus rude, orages et tornades se succèdent pendant environ trois semaines, puis les pluies commencent à tomber par intermittence et d'une façon régulière en juillet-août, et même septembre. La pluviométrie oscille entre 4 et 5 mètres, contre 0m,650 à Paris. Chacun chausse ses bottes et revêt son imperméable pour quatre mois. L'autochtone, suivant sa condition sociale, imite l'Européen ou se couvre de chapeaux mous peints au ripolin (c'est pas si bête ! ...), de feuilles de bananier, de sacs, de tôles, ou même de bassines retournées ... on va suivant ses moyens ... Le lecteur ne s'étonnera pas si je lui dis qu'au moment des grosses pluies les petits négrillons sont heureux de s'ébattre en tenue d'Ève dans les caniveaux ou sous les jets d'eau que déversent les gouttières. Mais après la pluie le beau temps, et le cycle de la vie continue, les entreprises renaissent avec le soleil, les visages deviennent radieux et, si l'on a « respiré un peu » pendant l'hivernage (moyenne : 22 à 25°), on est encore plus content de subir malgré tout la chaleur sèche et la joie de profiter des plaisirs de la plage. BASTIEN. |

|
Le Chasseur Français N°661 Mars 1952 Page 179 |

|

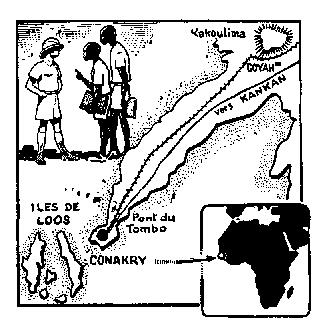 Que connaissais-je de Conakry ? Des impressions
diverses que j'avais recueillies dans une documentation livresque, où les
narrateurs voient les choses de la nature et de la vie sous un angle différent.
Ce que les uns trouvent magnifique, les autres le trouvent bien tout au plus.
Quant aux anciens coloniaux consultés sur la Guinée, et notamment Conakry, peu
dans l'ensemble donnent une idée favorable et cet avis repose surtout sur la
question du climat réputé malsain. Entrons dans le vif du sujet et
dirigeons-nous vers cette presqu'île du Kaloum sur laquelle est construite
Conakry. C'est par la route intercoloniale qui traverse la Guinée d'est en
ouest, c'est-à-dire de Kankan en passant par Kouroussa, Dabola, Manou, Kindia,
que nous arriverons dans la banlieue de cette cité. Sur la plupart du parcours,
la route suit le rail du Conakry-Niger, et le voyage est sensiblement de même
intérêt et de même durée, car on s'arrête souvent, il fait chaud, pour couvrir
les 716 kilomètres qui séparent la Haute-Guinée de la Basse-Guinée.
Que connaissais-je de Conakry ? Des impressions
diverses que j'avais recueillies dans une documentation livresque, où les
narrateurs voient les choses de la nature et de la vie sous un angle différent.
Ce que les uns trouvent magnifique, les autres le trouvent bien tout au plus.
Quant aux anciens coloniaux consultés sur la Guinée, et notamment Conakry, peu
dans l'ensemble donnent une idée favorable et cet avis repose surtout sur la
question du climat réputé malsain. Entrons dans le vif du sujet et
dirigeons-nous vers cette presqu'île du Kaloum sur laquelle est construite
Conakry. C'est par la route intercoloniale qui traverse la Guinée d'est en
ouest, c'est-à-dire de Kankan en passant par Kouroussa, Dabola, Manou, Kindia,
que nous arriverons dans la banlieue de cette cité. Sur la plupart du parcours,
la route suit le rail du Conakry-Niger, et le voyage est sensiblement de même
intérêt et de même durée, car on s'arrête souvent, il fait chaud, pour couvrir
les 716 kilomètres qui séparent la Haute-Guinée de la Basse-Guinée.