| Accueil > Années 1952 > N°662 Avril 1952 > Page 252 | Tous droits réservés |
Notes de voyage

|
Le coco de mer |

|
|
Depuis de nombreuses semaines, les pluies de la mousson de sud-ouest avaient ramené à Bombay son climat de serre chaude de tous les étés. La poussière des étroites ruelles de l'inextricable quartier de Bazaar était transformée en une boue profonde que les vaches sacrées avaient quittée pour aller se protéger des averses sous les rebords des toits des vieux temples aux couleurs criardes, ou les abris délabrés et illusoires d'arrière-boutiques ouvertes à tous les vents. L'atmosphère était remplie d'une pluie chaude qui vous faisait étouffer sous votre imperméable. J'avais hâte, ce soir-là, d'arriver à mon bord, où la douche était le seul moyen d'effacer pour un temps les effets par trop sensibles de cette ambiance d'étuve. Le spectacle de l'arrivée sur rade d'un bagalla (1) fit cependant que je m'attardai sur les quais. C'était un de ces voiliers arabes aux formes archaïques déjà familières sans doute aux compagnons de Sindbad le marin, et qui, en mettant à profit les changements périodiques de la mousson pour naviguer toujours vent arrière, ont assuré depuis l'Antiquité des relations régulières entre l'Inde d'une part et les pays de l'Arabie et de la côte orientale d'Afrique de l'autre. L'équipage était assemblé sous l'unique immense voile blanche encore vertigineusement gonflée, paré à amener dès que l'ordre en serait donné par le nacouda. Celui-ci, revêtu de ses plus beaux atours, avec un turban à macaron emplumé, se tenait à l'arrière, à deux pas de l'homme de barre, et mesurait d'un regard de seigneur le fond de la rade pour y choisir son point de mouillage. L'ensemble avait incontestablement une allure de conte de Mille et Une Nuits, que rehaussait encore les dimensions un peu exagérées du pavillon rouge-sang de Zanzibar hissé à la poupe, et dont le claquement annonçait la venue imminente d'un autre grain. Lors de ma première rencontre en mer avec un bagalla, je m'étais promis de visiter à l'occasion un de ces curieux navires. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous avions passé entre les atolls Horsburgh et Cardieva, dans les Maldives, cap au sud-ouest, pour rechercher plus au sud une mer maniable, car la mousson d'été soufflait frais, et on rencontre en cette saison dans toute la partie nord du golfe d'Oman, depuis les archipels des Laquedives et des Maldives jusqu'à Socotora, une mer démontée. Sur la longue houle agitée et couverte de traînées d'écume, le vaillant petit voilier nous croisa à contre-bord, chevauchant sous sa grande voile latine, et, bien appuyé par elle, il ne semblait même pas tanguer. Pratiquement il fuyait devant la mer, car la houle n'arrivait que tout juste à le dépasser, et les coups de mer venaient mourir en quelque sorte contre le grand tableau sculpté et peint qui protégeait son arrière. Un tel navire, entièrement construit en bois de teck, représente l'aboutissement d'une expérience deux fois millénaire. Il serait difficile d'y apporter des modifications susceptibles de mieux l'approprier au service pour lequel il a été conçu.
C'était un homme d'une quarantaine d'années, un peu grisonnant, mais bien musclé et ayant des allures de forte personnalité. Son anglais était assez imprégné de pidgin, mais on voyait qu'il avait l'habitude de s'en servir. « Le mot dhow, me dit-il, que vous venez d'employer et qui est en usage chez les Anglo-Saxons pour désigner nos boutres, est inconnu en arabe. Nous les appelons sambouks jusqu'à 70 tonnes de déplacement et bagallas au-dessus. Quelques-uns déplacent jusqu'à 400 tonnes. Ce qui les caractérise, c'est leur avant élancé, à étrave très inclinée et se prolongeant droit jusqu'au point de tirant d'eau maximum de la quille. C'est cette construction qui assure au navire la stabilité longitudinale que son allure particulière rend nécessaire. Le pont va en s'élevant vers l'arrière, qui est surélevé comme celui des caravelles de vos ancêtres. Comme eux, nous le protégeons de la mer par un tableau renforcé. » Le mât, court et trapu, solidement encastré dans la quille, s'incline sur l'avant et supporte près de la pomme une antenne en bois flexible d'une longueur énorme, gréée presque à la verticale, sur laquelle est enverguée la voile. Souvent les grands bagallas sont munis d'un petit phare d'artimon au gréement analogue. Ces navires atteignent 28 mètres de longueur, avec une largeur de 7 et un tirant d'eau de 4 mètres. Après une visite complète du navire sous la conduite de mon cicérone, j'allais enjamber le bastingage pour me retirer, lorsqu'un homme déposa près de l'échelle un fruit de la taille d'une grosse courge, mais double, comme un abricot, ou plutôt comme deux noix de coco aplaties et accolées, recouvertes de fibres. « Vous connaissez la noix des Seychelles ? » me dit le nacouda en le désignant. J'en avais entendu parler. Elle provient du palmier dit « des Seychelles », que l'on ne trouvait autrefois que dans les îles Praslin et Curieuse de ce groupe. Les hommes de l'équipage l'avaient trouvée en mer et, par tradition, avaient fêté l'événement avec une joie primitive, tout comme l'auraient fait leurs pères au temps de jadis, à cause des croyances qui s'attachaient alors à ce fruit. Celui-ci, en soi, n'offre rien de particulier, si ce n'est sa forme et ses dimensions, puisqu'il a facilement 40 centimètres de diamètre et un poids de 20 kilogrammes. Mais il a une histoire qui mérite d'être notée. Pendant des siècles, et encore très récemment, on n'avait en effet aucune idée de sa provenance. À de rares intervalles il venait s'échouer sur les côtes de Malabar ou même de la presqu'île malaise et au delà, le plus souvent dans les atolls des Maldives ; quelquefois on en trouvait un en mer. Alors, comme aucun arbre ne semblait le produire, une légende remontant aux origines de la navigation arabe expliquait qu'il se développait au fond de la mer. On l'appelait ainsi tour à tour coco de mer, noix de Salomon, ou encore noix maldive. Le nacouda me dit que les rois maldives, qui ont depuis toujours monopolisé le commerce dans leurs atolls, en exportaient autrefois des quantités considérables vers le continent indien. Le temps n'était pas trop loin où ils contraignaient leurs sujets de leur remettre, sous peine de mort, tout coco de mer échoué ou repêché aux abords de l'archipel. Bien entendu, à cause de sa grande rareté et de son origine mystérieuse, le fruit était considéré comme très précieux, et on lui attribuait les propriétés médicinales les plus incroyables, y compris celles de la thériaque, ce médicament vieux comme le monde qu'on disait inventé par Mithridate, et qui aurait été un antidote universel contre l'empoisonnement. On comprend dès lors que, dans leur crainte constante d'être empoisonnés, les souverains de tous les pays firent rechercher la fameuse noix à prix d'or. En 1602, l'amiral hollandais Hermanson, qui en avait été gratifié par un prince hindou, rapportait son cadeau en Europe, où sa réputation mystérieuse l'avait déjà précédé. L'empereur Rodolphe II (1552-1612) ne put s'en procurer une qu'au prix de 4.000 florins, somme fabuleuse à l'époque, et la coupe ciselée qu'il en fit faire se trouverait encore dans un musée de Vienne après avoir été considérée pendant des siècles comme un des plus précieux talismans de la cour autrichienne. Encore en 1741 le savant botaniste Rumphius, alors gouverneur hollandais de l'île d'Amboïne, dans les Moluques, écrit dans son Herbarium amboineum, une flore de son île, que la curieuse noix provenait d'un arbre sous-marin. Le fait est intéressant, parce qu'il montre à quelles distances le fruit est quelquefois emporté par les courants ... Le voile ne se leva qu'en 1769, lorsque le gouverneur d'une petite île du groupe des Seychelles ordonna une enquête sur la flore du pays ; c'était le duc de Praslin, et l'île reçut plus tard son nom. Les dimensions du magnifique palmier que l'on découvrit à cette occasion sont à la mesure de son fruit, puisqu'il atteint 40 et même 50 mètres de haut et se pare de feuilles de 7 mètres avec un éventail de folioles de 4 mètres de largeur. Aucun arbre actuellement connu ne produit un fruit dont le poids et la grandeur égalent ceux du sien. L'arbre reçut le nom de palmier des Seychelles (Lodoica sechellarum), sous lequel il est maintenant universellement connu. On raconte qu'un capitaine français faisant route sur les Indes passait à Praslin peu de temps après la découverte du mystère. Devançant l'ébruitement de la nouvelle avec un sens pratique qu'il faut lui envier, il acheta et fit ramasser toutes les noix disponibles dans l'île pour les transporter au plus vite à Calcutta, où la vente de sa cargaison lui rapporta une fortune ... L'arbre est la seule espèce du genre Lodoica. Ses fleurs sont dioïques. Dans la fleur femelle, l'ovaire en forme de poire est divisé en trois loges et porte un stigmate trilobé. On sait depuis très peu de temps seulement que le fruit ne met qu'une année à mûrir au lieu de sept et même dix comme il était communément admis et comme voulut de bonne foi me faire croire mon nacouda. Il est vrai que le fait n'est pas facile à contrôler ... Le noyau de la jeune noix renferme un liquide laiteux, agréable à boire. Avec le temps, ce liquide devient gélatineux. À la maturité, il s'est transformé en une matière ferme et coriace. Plus récemment, le palmier des Seychelles a été naturalisé dans l'île Maurice et dans les Indes. Aux îles Praslin et Curieuse, ses pays d'origine, il se trouve depuis quelques années sous la protection d'une loi spécialement édictée par les Anglais, qui se sont très raisonnablement souciés de la conservation de son intéressante et si curieuse espèce. René R.-J. ROHR,Capitaine au long cours. (1) On dit aussi « bagla ». |

|
Le Chasseur Français N°662 Avril 1952 Page 252 |

|

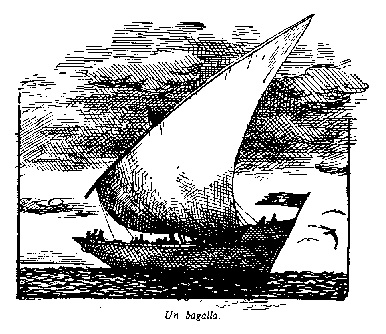 À Bombay, il se produisait au moment de l'accostage de
mon canot le long du bagalla une certaine effervescence sur le pont de
ce dernier. Sans doute les visites d'hommes blancs devaient y être rares, car
le nacouda courait en personne pour faire placer une échelle, et il me
reçut avec un certain cérémonial. Mais, lorsque je me fus présenté avec les
raisons de ma visite, son air froid fit place à un aimable sourire. Visiblement
flatté, il me fit les honneurs de sa chambre, où nous nous mîmes devant une
petite table très basse sur laquelle un café à la mode arabe fut bientôt servi.
À Bombay, il se produisait au moment de l'accostage de
mon canot le long du bagalla une certaine effervescence sur le pont de
ce dernier. Sans doute les visites d'hommes blancs devaient y être rares, car
le nacouda courait en personne pour faire placer une échelle, et il me
reçut avec un certain cérémonial. Mais, lorsque je me fus présenté avec les
raisons de ma visite, son air froid fit place à un aimable sourire. Visiblement
flatté, il me fit les honneurs de sa chambre, où nous nous mîmes devant une
petite table très basse sur laquelle un café à la mode arabe fut bientôt servi.