| Accueil > Années 1952 > N°665 Juillet 1952 > Page 397 | Tous droits réservés |
Vieux souvenirs

|
L'ouverture |

|
|
L'année scolaire achevée, la distribution des prix du collège terminée, nos parents nous munissaient, mon jeune frère et moi, d'un billet de chemin de fer pour la gare la plus proche d'Annoire. Ce billet constituait pour nous une récompense autrement précieuse que les gros livres dorés sur tranches que nous ne lisions jamais. Depuis la rentrée, nous aspirions à cet instant ineffable où nous partirions pour l'humble village jurassien qui représentait dans notre esprit le plus enchanteur des paradis terrestres. Et ce qu'il y avait de surprenant c'est que, loin d'être déçus, la réalité dépassait nos espérances : nous retrouvions le pays, la vieille maison, le grand verger, plus merveilleux encore que lorsque nous les avions quittés l'année précédente. Nous y étions attendus par quelques camarades de notre âge, en vacances comme nous et qui, comme nous aussi, ne paraissaient guère à la maison paternelle que pour y manger et pour y dormir. Cette règle, en ce qui nous concernait, souffrait toutefois une exception une journée par semaine : c'était celle où grand'mère et tante chauffaient le four. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de boulanger dans le village et chaque famille cuisait son pain. Ce n'est point que, mon frère et moi, nous eussions des dispositions particulières pour le métier de mitron, et nous n'étions pas d'un très grand secours ; mais il y avait alors une telle abondance de tartes, de brioches, de gâteaux que, pour un jour entier, la gourmandise nous rendait casaniers. Pour le reste de la semaine, il y avait liberté de manœuvre : parties de pêche dans la Sablonne ou dans le Doubs, baignades bruyantes et prolongées, courses à travers champs et forêts, etc. Les jours de mauvais temps étaient consacrés à l'organisation de tours pendables dans les granges, dans les écuries, dans les maisons de culture où la bande était plus redoutée que le choléra. La veille de l'ouverture, celle-ci s'accrut d'une unité ; mais d'une unité de choix : le Dôlois Henri R ..., de peu notre aîné. Il venait d'avoir seize ans et son père, pour marquer cet heureux anniversaire plus que pour célébrer ses succès scolaires, l'avait équipé comme Tartarin, muni d'un permis de chasse et expédié chez nos amis dont il était l'invité. À l'aube du grand jour, précédés d'Henri en grande tenue, nous prîmes la direction des champs. Nous n'avions pas de chiens et il fut décidé que les indigènes, — c'était de nous qu'il s'agissait — armés de bâtons, feraient office de rabatteurs. Nous nous déployâmes donc en tirailleurs, si l'on peut dire, derrière l'heureux chasseur patenté. À la fin du siècle dernier, Annoire comptait quinze fois moins de chasseurs et cent fois plus de gibier ; mais il fallait tout de même bien voir celui-ci et, autant que possible, l'attraper ; or c'est précisément là que des difficultés insoupçonnées se présentèrent. Avec nos bâtons, nous fauchions les luzernes, nous tapions dans les maïs, faisant un potin et un ravage du diable ; mais ces coquines de cailles, ces maudites perdrix partaient toujours du côté où il ne fallait pas, ou bien encore s'envolaient derrière les buissons et les champs de maïs. Et puis, en se levant, elles faisaient tant de bruit que le chasseur, malgré un sang-froid qu'il eût été imprudent de mettre en doute, était tout de même un peu impressionné pour tirer à temps et surtout pour tirer juste. Toujours fut-il qu'après deux ou trois heures de cet exercice, bien qu'Henri eût tiré un stock impressionnant de cartouches, nous arrivâmes près de la digue des Illets avec un pressentiment assez pénible : celui de la bredouille. On se fatigue, du reste, incroyablement vite du métier de rabatteur, particulièrement quand on fait lever tant de gibier et que l'on ne pourra même pas en montrer une plume à ses petites amies. Et puis il y a ce soleil qui commence à chauffer et qui vous coupe les jambes. Enfin, c'est toujours le même qui tire et, au fond du cœur, un sentiment de convoitise de plus en plus impérieux pour l'unique fusil vient, par surcroît, saper votre persévérance. Nous avions franchi la digue au delà de laquelle s'étendaient les prés qui bordaient le Doubs. De belles vaches blanches, tachées de roux, paissaient paisiblement. À l'ombre d'un vieux saule, son chien fidèle couché près d'elle, une petite bergère gardait le troupeau. C'était une petite noiraude assez délurée, connue dans le pays sous le surnom de la Moutette.
Les indigènes, un moment déconcertés, ne tardèrent pas à discerner tous les avantages qu'ils pourraient retirer d'une semblable situation : — Passe-nous au moins ton fusil ! s'exclama l'un de nous. Après quelques hésitations, Henri nous tendit l'arme et ses cartouches. Nous n'attendions que cela et, en courant, nous regagnâmes les champs à la poursuite du gibier. Tout ce qui volait : pies, corbeaux, alouettes, de près ou de loin, était salué d'un coup de feu. Lorsque l'un de nous avait manqué d'éborgner une villageoise, ou bien lorsque les insultes d'un paysan à qui nous avions fait siffler du plomb trop près du bonnet devenaient trop menaçantes, ou bien encore lorsque l'heureux porteur du fusil avait manqué de tuer un copain, l'arme était passée au suivant : c'était un accord tacite. Après quelques petits ennuis de ce genre, assez tard, mais ramenant triomphalement une pie aux reflets d'émeraude, nous nous retrouvâmes à la maison. Nous y trouvâmes grand-mère, courroucée, qui nous mit au pain sec et à l'eau. Des gens, qui visiblement ne comprenaient pas la plaisanterie, étaient venus l'avertir que, si nous recommencions, ils iraient chercher les gendarmes. Quant à Henri, on n'entendit plus parler de lui jusqu'à la chute du jour. À ce moment, les vaches regagnant l'étable, on le vit, un bâton à la main, derrière le troupeau, aidant la Moutette à ramener les bêtes. Il faut bien croire que cette vocation tardive et subite pour le métier de vacher, vocation dont son père fut mystérieusement et rapidement averti, dut rencontrer dans sa famille quelques oppositions, car le lendemain un télégramme le rappelait sans délai à la maison paternelle. Nous sûmes plus tard que la réception qui l'attendait, avait manqué d'enthousiasme. Il paraît même que l'auteur de ses jours ponctua ses observations d’une bonne paire de claques. Mais après tout, ce ne sont là que les petits inconvénients du métier, du métier de chasseur, il va sans dire. On raconte, dans le pays, que cette année-là il n'y eut guère que la Moutette qui pût vraiment se féliciter de l'ouverture de la chasse. Léon VUILLAME. |

|
Le Chasseur Français N°665 Juillet 1952 Page 397 |

|

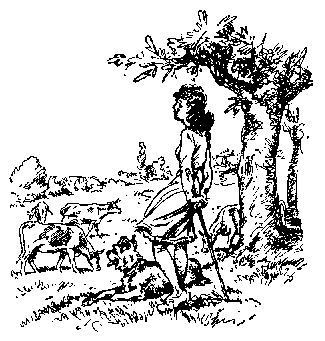 À la vue de ce groupe pastoral attendrissant, notre
chasseur tomba instantanément en arrêt ; puis, sans plus de façons, s'en
fut s'asseoir près de la jeune fille. Celle-ci, nullement effarouchée, parut,
au contraire, enchantée de cette compagnie et se montra aussi gracieuse que si
elle avait accueilli un prince charmant.
À la vue de ce groupe pastoral attendrissant, notre
chasseur tomba instantanément en arrêt ; puis, sans plus de façons, s'en
fut s'asseoir près de la jeune fille. Celle-ci, nullement effarouchée, parut,
au contraire, enchantée de cette compagnie et se montra aussi gracieuse que si
elle avait accueilli un prince charmant.