| Accueil > Années 1952 > N°670 Décembre 1952 > Page 711 | Tous droits réservés |

|
Alexandre, mon professeur |

|
|
Mon coiffeur s'appelait Alexandre ; à l'inverse du roi, il n'avait rien de grand ; il était de petite taille, avait une petite voix et portait une petite barbe en pointe, seul point commun, peut-être, avec les empereurs ; dans ma petite ville, il n'était pas plus « grand coiffeur » que ses collègues ; mais, c'est certain, il était grand chasseur. Aussi, parmi sa clientèle, comptait-il de nombreux nemrods, et je n'étais jamais impatienté en attendant mon tour. Avec admiration j'écoutais les histoires de chasse que chacun racontait sous la tondeuse ou le rasoir ; mais c'était surtout lui qui faisait le rapport de ses nombreux exploits. S'il en était parfois d'imaginaires, aucun des auditeurs ne paraissait les mettre en doute ; car beaucoup venaient là et y restaient après avoir été servis pour le plaisir d'écouter ses histoires. À un âge où rien encore ne laissait prévoir ma future passion, un esprit attentif en aurait deviné le germe en me voyant, tout yeux et tout oreilles, suivre les divers incidents du spectacle. Écouter n'était rien, en effet, si l'on ne pouvait voir les gestes d'Alexandre, ses attitudes et ses jeux de physionomie ; il s'identifiait avec ses personnages et, s'il mimait un chien, sans qu'il le dise on reconnaissait bien l'allure de son braque ou celle du pointer du cafetier ; ses yeux prenaient une expression canine ; il imitait avec ses bras les mouvements des pattes de devant, et celles de derrière avec ses jambes ; mais le fouet n'était pas oublié, représenté par le rasoir. Cet instrument tenait un rôle primordial dans les démonstrations, tantôt fusil et tantôt queue de chien. Dans ce dernier état, fermé, tenu à pleine main au bas des reins, il était fouet de braque ; ouvert, tenu entre deux doigts, il frémissait de toute sa longueur quand il était fouet de pointer. Je sus ainsi très tôt que l'attitude de l'arrêt classique comportait une patte levée, le cou tendu, les yeux figés et le sabre rigide. Le chien parfait reste toujours pour moi l'image d'Alexandre à l'arrêt dans le miroir de son salon. Pour remplir ces diverses fonctions, le sabre voltigeait autour des joues et du nez des patients sans leur inspirer de terreur ; le notaire était seul à ne pas s'y être habitué ; il n'était pas chasseur. Si, par malheur, Alexandre faisait un doublé comportant une volte-face, on voyait le notaire blêmir plus que la mousse savonneuse, sa barbe frémissait, son cou rentrait dans ses épaules, tandis qu'il assurait qu'il était très pressé ; mais, quand le chien retombait en arrêt, il respirait quelques secondes. Ne disposant que le lundi d'une journée entière, Alexandre se rattrapait tout le mois de septembre en faisant chaque jours une courte sortie, le matin de bonne heure, à midi ou le soir, dans les champs les plus proches. C'est sans doute pour cette raison qu'il était grand chasseur de cailles. Il en parlait avec passion ; peut-être me l'a-t-il un peu communiquée. Le Larousse dit vrai en donnant à ce nom d'oiseau la signification d'une épithète doucereuse à l'égard d'une femme ; car Alexandre n'employait jamais d'autre mot pour s'adresser à la sienne. Il prononçait, d'ailleurs, call-ieu ; aussi ses auditeurs ne furent pas surpris de la rime étrange du vers qui le sacra poète : lorsque le temps est orageux, le lièvre il se cache-eu ... La caille était aussi plus propice que d'autres gibiers aux mimiques du chien coulant dans les sillons des chaumes et tenant l'arrêt si longtemps qu'un jour, se trouvant à court de cartouches auprès du pont qui sautait le canal, frontière de la ville, il eut le temps d'aller chez lui pour se ravitailler en munitions ; à son retour, son chien, confiant, était encore à l'arrêt sur la caille. Mais lièvres et perdreaux étaient aussi les sujets d'exploits mémorables ; les capucins faisant la cabriole et les oiseaux foudroyés en plein vol m'apparaissaient comme autant de prouesses dont le héros se rangeait, dans mes rêves, aux côtés de Buffalo Bill. De la bécasse il ne parlait qu'avec mystère, et le respect dans lequel il tenait cet oiseau fit sur moi une telle impression que je devais toujours lui conserver un véritable culte. Ainsi, je crois que mes cheveux d'enfant sont responsables du ferment qui devait plus tard faire éclore une passion qui domina ma vie. Quand en vint le moment, Alexandre choisit mon fusil, puis mon chien, une griffonne de six ans, en me disant, avec raison, qu'à un jeune chasseur il fallait un vieux chien, n'ayant rien à apprendre et devant enseigner. Son chien à lui était toujours un braque du pays, c'est-à-dire un braque français, plus ou moins pur peut-être, mais que mes souvenirs me représentent bien typé ; en ce temps là, on avait peu de chiens nantis d'un pedigree, on s'arrangeait entre chasseurs pour conserver telle ou telle lignée des sujets les meilleurs en chasse. Les notions de dressage se résumaient à quelques vieux slogans, la pratique faisait le reste et presque tous les chiens auraient rendu des points aux vedettes modernes ; ils tenaient un arrêt de pieu, avaient des nez d'été et cette intelligence meurtrière justifiant ce que disait mon professeur : faites confiance à votre chien, il en sait plus que vous. Un jeune était aussitôt réformé si, au premier contact avec les cailles, il n'arrêtait pas fermement : l'arrêt ne s'apprend pas, c'est un instinct, me disait Alexandre. Il m'apprit à confectionner mes cartouches moi-même ; pour celles destinées aux cailles, il avait un procédé bien à lui : il versait la grenaille de plomb dans un disque en papier de soie qu'il pliait en cornet et qui se déployait au sortir du fusil ; dans les chaumes, ces corolles blanches jalonnaient parfois son chemin et permettaient de compter ses victimes ; mais, quand il le pouvait, il récupérait ses papiers. Il m'enseigna que l'allure du chien et du chasseur, quand ils recherchent les perdreaux, n'est pas celle convenant à la découverte du lièvre et la mise à l'essor des cailles et des bécasses, que le tir des lapins et des grives exige des réflexes prompts, alors que celui de la caille et, dans certains cas, du perdreau se résume dans ce slogan : « Du calme, épaule posément, elle t'en laissera le temps ; tire haut la caille ou rien à faire, sous la queue c'est la terre. » J'appris aussi de ses leçons à discerner selon le temps les tenues probables des divers gibiers, l'aspect des bois propices aux bécasses, les remises possibles des perdreaux et les coins préférés des lièvres, qui « à la Saint-Martin sont au bord des chemins », en d'autres temps dans les labours durcis et non dans ceux fraîchement remués, et plutôt dans le tiers périphérique qu'au milieu. Il m'avait fait, bien entendu, abonner au Chasseur Français, qui devint aussitôt mon bréviaire, et je lui récitais par cœur les « conseils du mois au chasseur », qui étaient pour lui un évangile. Il puisait dans de vieux numéros, que je n'avais pas lus, des histoires savoureuses dont le regretté Lajarrige emplissait son « compartiment des chasseurs ». Il m'emmenait tous les lundis explorer quelques coins nouveaux ; nous prenions parfois l'omnibus à cheval, nos bicyclettes sur le toit de la voiture pour le retour, et j'avais l'illusion d'aller explorer des régions que l'éloignement relatif entourait pour moi de mystère ; mais, la plupart du temps, nous allions à vélo, nos chiens suivant derrière ; les autos étaient peu répandues. Ces randonnées me faisaient découvrir des bois que je prenais pour des forêts sauvages, des vallons et plateaux que je croyais déserts et réservés seulement au gibier. J'en ai gardé le goût de prospecter des coins nouveaux et cette conception de la chasse qui ne trouve à s'épanouir que dans l'espace et m'a toujours fait étouffer dans une enceinte aux frontières fermées, fût-elle giboyeuse. À la saison des cailles, je l'attendais le soir sur le bord du canal ; il arrivait à son pas de chasseur à pied, s'inquiétait de savoir si je n'avais pas déjà manqué quelque gibier que nous puissions chercher à la remise, et les pétales blancs que semaient nos fusils, dans le soleil couchant, ressemblaient à des pâquerettes. Plus tard dans la saison, je n'attendais pas le lundi pour chasser la journée entière et je faisais mes premiers pas tout seul ; mais, le soir, en rentrant, j'allais lui en rendre compte et lui présenter mon tableau. Un jour, je lui apportai une pièce nouvelle dont il ne m'avait jamais fait la description. « Ah ! veinard ! me dit-il. Une outarde canepetière ! » Il n'en avait jamais tué, et vous pensez si j'étais fier de marquer à mon âge un point sur un tel professeur ! Mais je crois avoir eu plus de joie, le jour que je revins avec ma première bécasse. Il m'avait bien décrit l'endroit où chaque année, pour la Toussaint, il donnait rendez-vous à sa belle ; je m'y étais dirigé tout droit. Pourtant, en le quittant, je fus en proie à un remords ; il m'avait dit : « Nous l'aurions tuée ensemble lundi ! » Et j'avais comme l'impression de lui avoir volé quelque chose. Il m'a appris beaucoup de vérités parfois d'une façon originale, autant qu'inattendue ; ainsi, le sens de certains mots et expressions que seuls comprennent les chasseurs gascons, leur signification variant selon les circonstances. Il m'avait dit qu'il fallait respecter les levrauts; mais, ayant vu peu de lièvres sur pied, j'éprouvais des difficultés à estimer leur âge ; or j'étais scrupuleux, surtout quand je chassais avec mon professeur. Un jour, dans un sainfoin, un animal bondit à l'arrêt de ma chienne. Lapin ? lièvre ? levraut ? J'optai pour un lapin, ce qui libérait ma conscience ; mais, quand il fut à découvert, je vis bien que c'était un levraut qui devait peser une livre et me félicitai de l'avoir par deux fois manqué. Il me dit ironiquement : « Vous l'avez parfumé ! » C'était son expression, terme professionnel, disant bien ce qu'il voulait dire : action du vaporisateur ! — « Heureusement ! lui répondis-je, il devait encore téter ! » Ce fut sans doute pour souligner ma maladresse qu'il ajouta, simulant un regret : « Un lièvre comme un petit âne ! » Un peu plus loin, dans le même sainfoin, la hase sauta sous ses pieds. Je la pris d'abord pour un chien, mais je vis Alexandre épauler, tirer et ... parfumer à son tour. J'appris ainsi avec consolation qu'un bon chasseur est aussi sujet à faiblesses : « Peuh ! ... me dit-il avec mépris, j'ai tiré machinalement tout en pensant à autre chose ; mais je n'aurais pas dû : il était comme un petit chat ! » Sans doute ces contradictions auraient dû me rendre perplexe sur la façon d'évaluer l'âge et le poids des lièvres, si je n'avais déjà compris que l'importance d'un gibier dépend de celui qui le tire et varie selon qu'il est tué ou manqué. Je ne fus pas le seul qui profita de ses leçons, car il a dressé plus d'un jeune avant et après moi, et je crois que certains lecteurs s'approprieront ces souvenirs. D'autres évoqueront un autre type, se rappelant celui qui fut leur moniteur. Mais aujourd'hui, de moins en moins, les jeunes se confient à l'expérience d'un ancien. Le gibier se fait rare en nos chasses banales, il faut beaucoup courir pour garnir le carnier ; les jeunes ont de bonnes jambes, elles leur servent mieux, souvent, que les leçons, et les vieux, désarmés, leur savoir et leurs chiens devenus inutiles, les voient courir comme des lévriers, en short, sans les comprendre et sans les envier : ils ont eu la meilleure part, celle du temps des Alexandre. Cher professeur ! Si j'ai voulu lui rendre hommage ici, c'est pour toucher à travers sa mémoire celle d'une génération à peu près disparue aujourd'hui : ces vieux chasseurs ruraux qui eurent le bonheur de pratiquer la chasse au temps de sa splendeur, qui connaissaient si bien le gibier et le chien, qui leur vouaient une passion non frelatée et pour lesquels la chasse était une raison de vivre, ayant encore tout son sens. Unis par Le Chasseur Français, premier et seul journal qui avait su les comprendre, façonnés dans le même esprit, ils ont fait avec lui la vraie chasse française, qui consiste à chercher, à vaincre et à aimer un gibier naturel dans des conditions naturelles. Je ne suis pas de ceux qui veulent en sonner le glas ; si bien des choses ont changé, qu'une seule demeure : le sens français du mot chasser. GARRIGOU. |

|
Le Chasseur Français N°670 Décembre 1952 Page 711 |

|

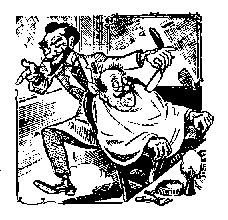 Parmi les souvenirs de notre enfance, les séances chez
le coiffeur se classent au rang des pensums, des promenades en famille le
dimanche, des visites aux médecins et autres corvées analogues ; c'est
sans doute pourquoi des salons de coiffure parisiens remplacent les hauts
tabourets par des chevaux de bois. Moi, je n'ai pas connu le supplice du scalp,
et me faire tailler les cheveux, lorsque j'étais enfant, m'était un grand
plaisir, que j'attendais même avec impatience.
Parmi les souvenirs de notre enfance, les séances chez
le coiffeur se classent au rang des pensums, des promenades en famille le
dimanche, des visites aux médecins et autres corvées analogues ; c'est
sans doute pourquoi des salons de coiffure parisiens remplacent les hauts
tabourets par des chevaux de bois. Moi, je n'ai pas connu le supplice du scalp,
et me faire tailler les cheveux, lorsque j'étais enfant, m'était un grand
plaisir, que j'attendais même avec impatience.