| Accueil > Années 1952 > N°670 Décembre 1952 > Page 763 | Tous droits réservés |
Notes de voyage

|
Baobabs géants |

|
|
La physionomie orientale d'un certain nombre de villes arabes enchâssées depuis le golfe Persique jusqu'au canal de Mozambique dans les rives multicolores de l'océan Indien ne laisse jamais de faire revivre dans le souvenir du voyageur étranger de lointaines images des Mille et une Nuits. Ses hésitations pour l'attribution de la couronne resteront partagées entre Mascate et Dar es-Salam jusqu'au jour où il aura visité Zanzibar, la plus jeune peut-être, mais de loin la plus enchanteresse. Située dans une île bordée de récifs coralliens, qui mêlent une teinte de turquoise au vert émeraude de la mer ensoleillée, Zanzibar étale en effet devant ses yeux, dans un épanouissement de couleurs, un tableau inoubliable, dans lequel la présence de l'électricité et d'automobiles sur un fond de cocotiers agités par le vent de mer ne porte aucun préjudice au caractère arabe à peu près intact des maisons, des navires et des gens.
Je n'ai jamais pu me lasser du spectacle offert dans son animation matinale, par une rade ensoleillée, alors surtout qu'elle est balayée par une bonne brise. Et le nom de Zanzibar signifie, paraît-il, fille du vent. Une centaine de bagallas aux poupes surélevées se balançaient à l'ancre ou à quai, dressant vers le ciel leurs antennes élastiques alourdies du poids de l'immense voile ferlée (1). C'était la flotte de Zanzibar, très commerçante, revenue des Indes ou de la Perse, chargée de dattes et de tapis, et s'apprêtant à y retourner avec les épices, le café, le thé et le sucre de l'île. Accroupis dans leurs minces ngallawas à traversier, sous une voile à faire peur, des pêcheurs souahélis rentraient dans la rade qu'ils traversaient à une vitesse étonnante pour écouler au marché aux poissons les produits variés de leur travail nocturne. L'odeur nauséabonde des quartiers environnants me guidait facilement dans la recherche de ce marché. Mais, arrivé sur les lieux, je me suis gardé d'y pénétrer, tant me sembla peu appétissant le contact du mélange grouillant d'humanité poisseuse qui s'y pressait bruyamment entre des étalages trop rapprochés. Il y avait là, en plein soleil, de grosses tortues à bec, couchées sur le dos, des pieuvres diverses, informes masses grises toutes barbouillées de sécrétions noires, des raies, toutes les variétés de poissons et cette horreur, comestible, paraît-il, qu'on appelle bêche de mer, et que les Chinois recherchent à cause de ses soi-disant propriétés aphrodisiaques. Le tout offrait un spectacle que, même ignorant la langue du pays, les natures délicates seront bien inspirées de ne pas trop approcher. J'éprouvai plus de satisfaction à m'attarder au marché tout proche des produits du pays, qui donne partout une image fidèle des activités locales. Il en émane, comme de tous les marchés du monde tropical, cette odeur épicée, indéfinissable, mais nullement désagréable, qui a le don de vous laisser le souvenir exact de l'ambiance où vous l'avez connue. Elle peut même, plus tard, vous donner la nostalgie du pays visité. Ici l'omniprésence de la girofle la rendait plus caractéristique. De lourdes charrettes aux roues pleines, péniblement traînées par des ânes ou, avec moins d'effort, mais plus lentement, par de minuscules buffles aux bosses vacillantes avançaient sous les cris des conducteurs, au milieu de la foule, qui s'écartait toujours le plus tard possible contre les tas de comestibles, les rouleaux de tapis ou des pyramides composées de magnifiques coffres en bois précieux garnis de serrures et de renforts en laiton finement travaillés. Car on fait de belles choses à Zanzibar ... De nombreux artistes sont attelés, dans leurs boutiques ouvertes, à décorer avec une richesse d'imagination étonnante et beaucoup de soin les objets en laiton les plus divers de leur fabrication. Ailleurs, le don artistique des Arabes se donne libre cours dans l'ornementation des portes en bois de teck des maisons même situées dans des quartiers apparemment pauvres. L'habitude constante d'en couvrir la surface d'une théorie de fortes pointes pyramidales en fer est originaire des Indes, où les familles aisées protégeaient ainsi au temps des luttes féodales l'entrée de leur maison contre les éléphants de leurs adversaires. Beaucoup de ruelles de Zanzibar sont cependant si étroites qu'il serait difficile à ces pachydermes d'y pénétrer et à plus forte raison de se présenter de front devant l'une des portes. Les automobiles ne peuvent circuler que dans certains parcours, et elles se font alors souvent précéder par un crieur, car il faut qu'à leur passage les piétons s'aplatissent contre les murs. Si les emplacements des maisons de la ville en pierre des Arabes et des Hindous ont apparemment été choisis sans le moindre scrupule d'alignement, la situation devient critique quand on franchit l'espèce d'arroyo qui sépare ces quartiers de Ngambo, l'inextricable dédale des cases de la ville africaine aux innombrables impasses, où il est préférable de ne s'aventurer qu'en compagnie d'un guide. Les Noirs de Ngambo constituent, en effet, à peu près la moitié de la population de la ville. La diversité de la vie dans les rues de Zanzibar est, sans nul doute, un de ses principaux attraits. Dans un grouillement constant s'y croisent Arabes du pays, du golfe Persique et d'Arabie, Hindous et Parsis, ces derniers au port toujours allier. Toutes les races de l'Afrique noire sont représentées. Les Arabes, aux barbes teintes, sont vêtus du kan-zou, sorte de chemise de nuit très large, et coiffés de turbans ou de petites chéchias blanches en toile. Les variations des costumes vont d'ailleurs à l'infini, mais ils indiquent infailliblement le pays d'origine de leurs propriétaires. Les Parsis restent fidèles à leur petit bonnet de velours violet ou foncé orné de riches broderies d'or ; on voit d'amples pantalons en coton bleu ou blanc et même des sarongs. Les femmes musulmanes sont voilées et comme camouflées jusque sur la tête dans une sorte de large manteau noir sans forme appelé pourdah, auquel ressemble le kanga des femmes souahélies, un peu moins lugubre avec ses rayures en couleurs vives. On peut les observer surtout dans les nombreux bazars où elles passent le meilleur de leur temps en bruyants bavardages et rires, qui jurent singulièrement avec l'austère costume imposé par les usages islamiques. L'élégant sari clair des femmes hindoues retient plus agréablement le regard de l'étranger. Il est souvent porté par des femmes à la figure si belle que la pierre précieuse fixée à l'aile de leur nez n'arrive pas à les déparer, ou que les bagues en or dont quelques-unes ont orné jusqu'aux orteils de leurs pieds passent inaperçues. Au marché, dans les bazars, les rues et sur les quais, retentit à longueur de journée le gong aigu des vendeurs de café. Ils frappent de leurs coupes métalliques une énorme cafetière en laiton pour attirer la clientèle qui forme cercle autour d'eux, sans cesser de traiter bruyamment ses affaires. Chose curieuse, le chiffre des offres et des demandes s'exprime dans une sorte de langage secret par la position des doigts des traitants, qui réunissent à cet effet leurs mains sous une pièce d'étoffe de couleur. Ce procédé de marchandage discret est d'ailleurs répandu sur toute la côte orientale d'Afrique ... L'intense commerce de Zanzibar a eu pour effet la création dans l'île d'un beau réseau routier, dont j'ai eu l'occasion de voir une partie en me rendant à Chwaka. C'est une localité située à l'entrée d'une assez grande baie de la côte est, bien abritée derrière le Ras Michamwi, mais parfaitement impraticable pour les navires à cause du plateau madréporique qui s'y étend et qui évoque à basse mer la vision d'un jardin ensorcelé aux plantes étranges et immobiles d'un monde ossifié de cauchemar. La route contourne par le sud les collines Masingini, petit massif de 300 mètres d'altitude à peine, aux flancs couverts de girofliers (Eugenia aromatica), qui constituent l'une des principales richesses de l'île. Coupant à travers de belles palmeraies, elle évite divers vallonnements avant d'arriver vers le centre de l'île au village de Dunga pour traverser enfin une région plate de steppes parsemées de loin en loin de vieux baobabs. Le premier de ces arbres que je vis de près avait un tronc si prodigieusement épais que je tins à m'y arrêter. Il avait effectivement 32 mètres de tour ... Alors le consignataire arabe, dont nous étions les passagers, nous dit en riant que les baobabs de Zanzibar et de Pemba, l'île située plus au nord, avaient la réputation d'être les plus gros du monde. Dans ces conditions, on pose automatiquement la question de l'âge d'un tel végétal, d'autant plus qu'il ne semble pas en exister de jeunes individus. D'après le nombre de couches ligneuses annuelles, on est arrivé à des chiffres de plus de 5.000 ans ! L'arbre que nous contemplions aurait donc déjà existé à cet endroit avant le début de la civilisation sumérienne et longtemps avant que Hammourabi posât les fondations de l'empire de Babylone ! Ce serait, d'après les apparences, une espèce en voie d'extinction, un laissé pour compte d'un autre âge, ayant depuis longtemps cessé de produire de nouvelles générations. Jamais, en effet, on n'a constaté au cours d'une longue existence humaine la moindre modification dans la forme d'un baobab vivant. Aussi, dans certaines langues indigènes, son nom se traduit par « arbre de mille ans ». Voici donc un tronc démesuré dont les branches, en comparaison, et malgré leur longueur de plus de 20 mètres, semblent atrophiées et ne sont couvertes d'un mince feuillage que pendant les cinq mois de la saison des pluies. On l'a appelé Adansonia digitata, en souvenir du Français Adanson qui l'a décrit en 1750, à l'occasion d'un voyage au Sénégal, et pour indiquer la disposition digitée de ses feuilles d'une forme tout à fait analogue à celles du marronnier d'Inde. Il fait partie du groupe des bombacées, qui comprend d'autres géants tropicaux et appartient à la famille des malvacées. La corolle de la belle fleur, blanche mais malodorante, du baobab atteint les dimensions d'une assiette, et son épais massif d'étamines jaunes achève d'évoquer l'idée d'un œuf dur coupé en deux. En dépit de l'aspect cireux de cette fleur, elle passe très vite, pour donner naissance à un fruit en forme de gros concombre de 40 centimètres de long, à écorce ligneuse, dont les Noirs se servent pour faire des réservoirs et des instruments de musique, et dont, dans de nombreuses langues, le nom signifie « pain de singe ». Le bois du baobab, aux fibres très larges, est d'une contexture si molle qu'on peut y enfoncer sans grand effort une canne à pointe ferrée. L'arbre y maintient à toutes les époques une considérable réserve d'eau, qu'il protège de l'ardeur du soleil par une écorce de 10 centimètres d'épaisseur, d'aspect lépreux et de la couleur terreuse de la peau d'éléphant. Cette écorce, pressée par les voyageurs avertis, cède l'eau qu'elle contient, comme un linge tordu après le lavage. Souvent l'intérieur des vieux troncs est pourri, se creuse et forme réservoir d'eau ou bien, pendant la saison sèche, un excellent abri de la grandeur d'une spacieuse chambre d'habitation. Les arbres particulièrement volumineux évoquent ainsi de véritables petites forteresses massives, qui servent dans certaines régions de l'Afrique de sépulture des morts. En raison de ses particularités, le baobab joue d'ailleurs, partout, un rôle considérable dans l'imagination des Noirs. Certaines tribus lui attribuent des propriétés magiques bienfaisantes, d'autres le contournent de loin, surtout la nuit, le disant habité par de mauvais esprits. Au Soudan, il fait l'objet d'une véritable adoration. Très souvent on voit ses branches servir de support aux ruches de bois en forme de gros tubes des apiculteurs indigènes, qui atteignent les branches élevées en s'aidant comme d'une échelle d'une suite de gros bâtons enfoncés dans le bois ... On prépare dans le pays avec les feuilles du baobab une tisane recherchée. Séchées à l'ombre et réduites en poudre, elles servent en outre à augmenter l'alimentation des Noirs. De même, les fleurs donnent avec de l'eau et des extraits de plantes sucrées une boisson agréable et rafraîchissante. On retire aussi une huile appréciée de la graine du fruit, dont la pulpe, au goût acidulé, devient mangeable après une savante préparation. Cette pulpe est quelquefois pilée et fermentée pour donner un médicament contre les fièvres putrides. Enfin, on se sert d'une farine obtenue en écrasant les cosses, pour faire avec du lait un excellent pain amer, mais nourrissant. On dit aussi que les Noirs réussissent à tirer des fruits gâtés une sorte de savon sans prétentions. Enfin, si le bois est inutilisable, l'écorce de l'arbre donne un raphia de qualité médiocre utilisé localement à la confection de cordages et de tissus primitifs. À l'exception du Congo, le baobab se rencontre en Afrique dans toute l'étendue compris entre les tropiques. Toujours logique, la nature a fait prendre au tronc de certaines espèces diverses formes très régulières de bouteilles, soit hautes et droites, ou basses et ventrues. Ce fait est particulièrement remarquable en Australie, où les baobabs supportent des périodes de sécheresses d'un degré inconnu dans les steppes africaines. L'affirmation soutenue à l'unanimité par les planteurs et les chasseurs africains de l'inexistence de jeunes individus de baobab est difficile à contrôler. Par contre, on sait comment l'arbre se comporte après sa mort et que, même alors, il n'imite pas ses grands frères de la haute forêt équatoriale. Contrairement à eux, il reste debout et s'effondre lentement sur lui-même ; sa grande masse se plisse et prend la forme d'une tige de botte en cuir mou qui s'affaisserait le long de la jambe, sans cesser pourtant de contenir pendant de longues années encore au profit des voyageurs altérés de considérables quantités d'eau. Isolés sous le soleil torride des steppes africaines, ces cadavres de géants évoquent vaguement de vieilles ruines solitaires et sans ombre. À moins d'études spéciales, il est difficile de dire si cet effondrement ne serait pas l'œuvre des termites ou de quelque champignon microscopique encore inconnu. Ce serait à voir. Mais l'extraordinaire longévité du baobab rend la possibilité de ces observations très rares, et, du reste, à notre époque de prospection minière et de recherche d'uranium, les missions scientifiques qui parcourent les régions chaudes semblent de préférence se livrer à d'autres préoccupations ... René R.-J. ROHR,Capitaine au long cours. (1) Voir « Le coco de mer », Le Chasseur Français, avril 1952. |

|
Le Chasseur Français N°670 Décembre 1952 Page 763 |

|

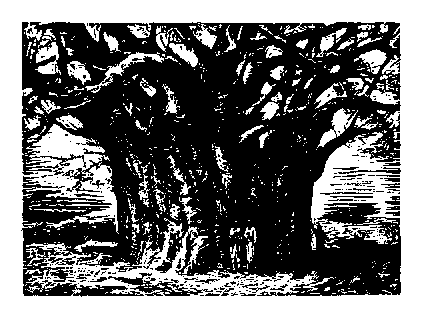 Bien abrité du large, le port vous reçoit au bout d'un
quai garni d'entrepôts aux multiples et fortes senteurs d'épices, qui vient
s'incurver en avant, du côté de la terre, pour vous présenter comme sur un
plateau le palais du sultan, éclatant de blancheur au milieu de son jardin de
palmiers et de fleurs. Sans quitter le rivage, la route de sable clair, qui le
sépare de la rade, s'étend sous vos yeux avec son mouvement continuel de gens
de couleur aux costumes larges et clairs que la brise fait flotter. Et,
dominant la scène du haut d'un mât blanc placé dans l'un des jardins, le
drapeau rouge pourpre de Zanzibar achève encore de souligner le cachet exotique
des lieux.
Bien abrité du large, le port vous reçoit au bout d'un
quai garni d'entrepôts aux multiples et fortes senteurs d'épices, qui vient
s'incurver en avant, du côté de la terre, pour vous présenter comme sur un
plateau le palais du sultan, éclatant de blancheur au milieu de son jardin de
palmiers et de fleurs. Sans quitter le rivage, la route de sable clair, qui le
sépare de la rade, s'étend sous vos yeux avec son mouvement continuel de gens
de couleur aux costumes larges et clairs que la brise fait flotter. Et,
dominant la scène du haut d'un mât blanc placé dans l'un des jardins, le
drapeau rouge pourpre de Zanzibar achève encore de souligner le cachet exotique
des lieux.