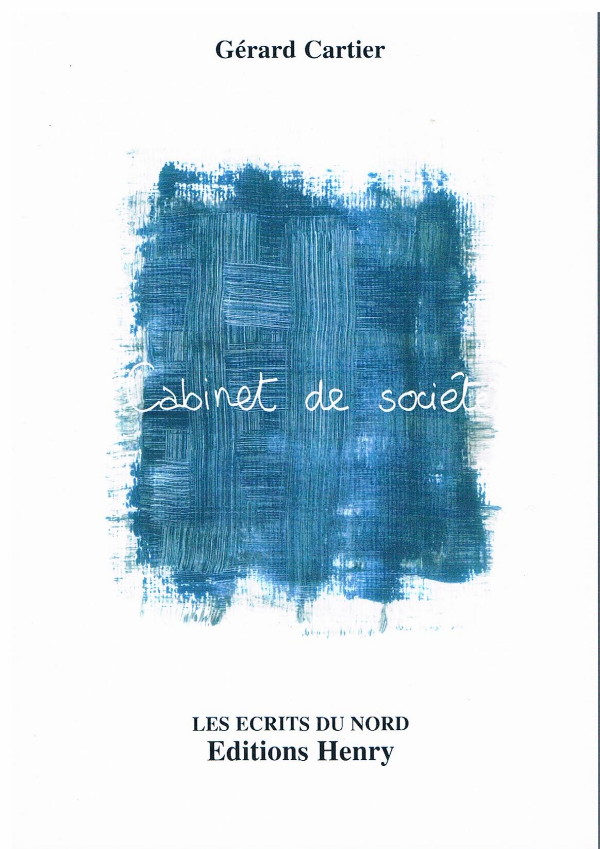La
boîte en fer blanc
(Robert Desnos)
Nous passons sans papiers la frontière.
L'Est, c'est cette ville ensevelie dans un nuage où une noce
sans
mariée nous tient éveillés toute une
nuit, serrés dans un étroit lit
d’auberge. Au-delà, c'est la Bohème : des architectures
italiennes sous un ciel moutonnant, des forêts abandonnées
que
les trains traversent avec lenteur dans un jet de sifflet pour
écarter les bêtes, de vastes étangs
où l'on saurait mourir. C’est l’été 75, nous
sommes si jeunes, rien
ne nous est refusé. La vieille Fiat 128, bleue comme Lady
Roxelane Pervenche, erre insouciamment sur les routes
désertes
du socialisme réel. Au porche des usines, au fronton crasseux
des églises, de grandes banderoles rouges
semées d’accents et de cédilles
exaltent ce qui fut et ce qui sera. Ce qui sera, je ne sais pas le
deviner ; ce qui fut n'est déjà plus
qu’une fumée au vent.
Un
soir, en chemin vers Prague, échappant aux bois montueux
où nous nous étions fourvoyés, une flèche
à l'angle d'une route nous immobilise brusquement. Une citadelle
affleure au loin dans la plaine. Ce
n’est qu’un ressaut d'ombre à peine détaché de la
campagne verdoyante,
mais je l'ai tant rêvé, que rien ne pourra me dissuader de
ce que l'en ai fait : une forteresse semée de ruines, endormie
sous une flamme charbonneuse, vaste tumulus bruissant du souffle des
machines, où au fond des caves, entassés dans les replis
des murs, des bêtes fiévreuses suffoquent sous la cendre.
Le mont du purgatoire. Nous détournons les yeux. Nous n’irons
pas vers ce qui puissamment
nous appelle. Trop de crimes,
trop de douleur. Cette ombre me
restera à jamais au fond de l’œil,
obsédante, comme un moucheron qu’on
échoue à retirer du coin du mouchoir et qui moisit en
aigrissant la vue. Terezin !

Au retour, je tiens
l’argument que je cherchais en vain
depuis des semaines, couvrant à l'aveugle un accordéon
de feuilles d’ordinateur. C’est un paysage
solitaire où le soir descend et fait luire les feuillages. Dans
l'ombre,
des grappes d’églantiers : la scène est au printemps. Une
rumeur de tôles
brinquebalées s'élève dans la plaine embrunie. Du
kommando de Flöha, poussé par les SS dans les Montagnes
Noires, ne
restent que quelques fantômes charriés dans des
remorques agricoles. Desnos frissonne parmi ses derniers compagnons,
décharné, presque nu, les yeux myopes sous ses lunettes
brisées. Il ne voit pas la
colline au loin, la forteresse et les fumées qui stagnent. Il ne
voit pas le printemps qui réinvente les couleurs. Ce
qu’il a été, il l’a
oublié, la boîte en fer blanc où il gardait ses
poèmes a disparu dans la débâcle. Les mots
étaient vains. Il
n’en reste rien.
Cet été-là, pourtant, un journal
pragois publie un dernier poème à Youki :
J’ai
rêvé tellement fort de toi,
J’ai tellement marché, tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu’il ne me reste rien de toi,
Il me reste d’être l’ombre parmi les
ombres
D’être cent fois plus ombre que l’ombre
D’être l’ombre qui viendra et reviendra
dans ta vie ensoleillée.
Aux premiers jours de juin, peu
après la libération du camp, un
étudiant tchèque avait lu son nom sur la liste
des malades du Revier.
Scrutant les
mourants alignés dans le bloc, il avait reconnu un visage :
celui de ce voyant endormi sous une ampoule, photographié
autrefois dans Nadja, à l’époque des sommeils,
qui
rêvait à voix haute à l'étage du Cabaret
du Ciel et donnait aux fantômes rendez-vous à plus tard. –
Connaissez-vous Robert Desnos,
poète
français… – Oui ! Oui ! C’est
moi...
Il retrouve un instant la lumière et les mots : la
liberté, les amis dispersés du Cabaret du Ciel, l’amour
de Youki. Puis il ferme les yeux. Parlez-moi...
Racontez-moi des histoires... Il remue les lèvres
en silence sous une ampoule rouge. Le quatrième jour, on
l’emporte.
La fumée monte, c'est l'époque du sommeil, le voici cent
fois plus ombre que l’ombre. Les mots qui semblaient
dictés du fond de la tombe coururent invinciblement,
se répandant de langue en langue et bouleversant les
cœurs. La mort embrassée par avance donnait un sens poignant
« au seul poème
trouvé sur lui ». Robert Desnos quittait
le monde par la porte des légendes.
On tenta de le retenir dans l'effroi de la
réalité. On publia le récit de ses
derniers jours : « J’ai soigné
Robert Desnos dans les Baraques du Sud de Terezin à partir
du 4 juin, où je l’ai découvert,
jusqu’à sa mort le 8 juin 45. On n'a rien trouvé sur lui,
pas un vers, pas un mot, il n’était plus capable
d’écrire ». On voulut
démontrer que le dernier
poème
à Youki n’était qu’un malentendu, la traduction
malheureuse dans les Lettres Françaises
des vers publiés en tchèque à
l’été 45 ; que ceux-ci avaient déjà
été donnés dans la même langue quinze ans
auparavant ; qu'ils n’étaient que la
traduction libre d'une strophe écrite dans la force de
l'âge, en 1926, pour un autre amour, la
Mystérieuse :
J’ai tant
rêvé de toi, tant marché,
parlé, couché avec ton fantôme
qu’il ne me reste plus peut-être, et pourtant,
qu’à être fantôme parmi les
fantômes et plus ombre cent fois que l’ombre qui se
promène et se promènera allègrement
sur le cadran solaire de ta vie.
On crut que l’implacable
enchaînement des preuves suffirait à dissiper la
légende. Mais comment boucher l’oreille avide de merveilleux,
comment refuser le chant qui monte de
l’au-delà ? On donne encore ici et là,
dans les pages des livres et dans celles d’Internet,
mystérieusement arraché à la nuit, le dernier
poème de Robert Desnos. Le
voyageur immobile de Theresienstadt, enroulé dans un chiffon
sous une ampoule rouge, le visage momifié dans la stupeur du
typhus, le voici au rendez-vous des fantômes. Il restera à
jamais cette ombre parmi les ombres, ce
voyant assoupi sous la borne penchée, qui rêve
à voix basse, cent fois plus ombre que
l’ombre...
C’est dans cette lumière équivoque que
j’ai commencé La nature à
Terezin.
Arpentant une ville à demi documentée et à demi
rêvée, poursuivant dans l'ombre une figure fuyante, j'ai
cherché mon chemin vers le bas.
Des années durant, les livres propitiatoires répandus
à mes pieds et l’œuvre de Poussin sur
les genoux, croyant moi-aussi que ces
sortes d’histoires ne perdaient rien à conserver
quelque chose de l’ancienne manière de peindre
», j'ai mis en application la leçon de Reynolds et
mêlé au récit les traces de la fable :
Orphée, les partisans dans leurs grosses Tatras noires,
l’étoile rouge de Joukov et les vapeurs de l'enfer.
Mais quelle fable opposer à la
réalité ? Le livre butait sur le silence. Le froid
terrible, le corps qui se vide, les
os affamés, la pensée nue
fixant sa fin, de cette matière ingrate peut-on faire un
chant ? Rien ne pouvait être sauvé. Un survivant,
peut-être, se sera souvenu quelques temps d’un long poème
écrit
sur des feuilles de papier à cigarette, une ode obscure et
sonore que
Robert Desnos avait lu une nuit, dans les blocs de Flöha, avant de
la confier à la boîte en fer blanc que le précieux Rödel gardait
toujours sur lui.
Le même compagnon d'infortune, ou un autre, se sera souvenu
pendant quelques années des
marches forcées dans les Erz-Gebirge, des SS en
déroute poussant devant eux leurs troupeaux
d’esclaves, et de
Rödel, trop faible pour les suivre fusillé
à la hâte sur un talus. Avec lui disparaissait la
boîte en fer blanc, et Le Cuirassier Nègre,
et tout ce qui rattachait encore Desnos à ce qu’il avait
été. Une fin muette donne-t-elle une
leçon plus parfaite ?
Au bout de la Nature, pourtant, j'avais
tracé le plan
d’un autre livre qu’un plus habile pourrait écrire, ou un plus
sage :
1. Paris,
la nuit d'hiver (42-44).
2. Wir trinken dich nachts...
3. Le voyage
4. Le bûcher. une boîte de fer
noircie.
Bien plus tard, je e suis mis en tête de
tout reprendre et d’affronter cette nuit primitivedont
j’avais autrefois dressé le plan sans croire
devoir l’écrire un jour. Refuser toute pitié, repousser
toute émotion,
dépouiller les vers de tout ornement. Embrasser la
matière nue : la chaux, le bois
créosoté des lits superposés, la faim et le froid.
Faire de son livre une cellule. Quinze ans avaient
passé depuis qu'obliquant vers Prague nous avions laissé
sur la gauche, au milieu des prés, la colline ombreuse.
Dans une époque déjà
immémoriale, deux prisonniers SS avaient porté le
corps de Desnos sur le bûcher. Sur sa poitrine, entre ses
bras croisés, on avait glissé une branche
d’églantier en fleurs. Le feu, puis le vent, avait
emporté l’homme des sommeils.
in Cabinet de Société (Henry, 2011)
Version initiale in Europe n° 851 (mars 2000)
Haut de page