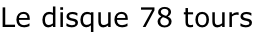
Disques à gravure verticale
En même temps que les disques à gravure latérale (dits « disques à aiguilles »), plusieurs compagnies diffusent à la Belle-
En 1896, les frères Pathé fondent à Paris leur compagnie d'enregistrement de phonogravure verticale sur cylindre, associé à un procédé de reproduction par pantographe. Après une première tentative infructueuse, ils lancent leurs premiers disques en novembre 1906, en gravure verticale, en profondeur, comme pour leurs cylindres, avec pointe de lecture saphir. Les premiers disques Pathé s'identifient par leur étiquette gravée et se jouent du centre vers l'extérieur. Ils reprennent bien souvent d'anciens enregistrements édités sur cylindre. Des disques de 17, 21, 24, 29, 35 et 50 cm de diamètre sont mis sur le marché entre 1907 et 1915. La vitesse de lecture est fixée à 80 tours par minute et le départ se fait à l'extérieur. La couleur de l'étiquette indique une catégorie et un prix : le noir, les nouveautés, le bleu et le marron, les variétés, le vert, l'opéra, l'opérette, les solos instrumentaux, les orchestres symphoniques, le jaune les extraits d'opéra et le gris clair, d'autres enregistrements. En 1927, Pathé lance en France ses premiers disques à aiguille, sous l’appellation « Actuelle », sans arrêter la production de disques à saphir. Le catalogue indique les disques à aiguille par la lettre X. En janvier de la même année, la firme se lance dans l'enregistrement électrique. En 1928, la firme anglaise Columbia achète Pathé. En 1932, la compagnie arrête la production du disque à saphir.
Évolutions, innovations et déclin
Dès février 1925, les disques sont enregistrés électriquement. En France, l'enregistrement électrique arrive à l'automne 1926 pour le gramophone, en décembre de la même année pour Odéon et Columbia et en janvier 1927 pour Pathé. La radiodiffusion concurrence le gramophone pour la consommation musicale domestique. À cette époque, les constructeurs doivent préciser que les enregistrements acoustiques et électriques peuvent être lus indifféremment sur gramophones eux-
En 1931, RCA Victor tente de commercialiser un disque 33 tours, avec un sillon de même largeur que celui du 78 tours. C'est un échec, mais il en sort le disque enregistrable enduit en acétate de cellulose, qui servira à l'enregistrement légal des radiosa jusqu'à l'introduction de l'enregistrement magnétique.
L'édition en 78 tours cesse aux États-
En 1948, Columbia invente le disque microsillon en vinyle qui remplacera le 78 tours. C'est à cette époque qu'on commence à parler de 78 tours, pour les distinguer des formes de disques plus modernes, dits 33 tours et 45 tours. Peu avant son remplacement définitif, le 78 tours a fait l'objet d'une norme de la Commission électrotechnique internationale, visant à assurer la meilleure compatibilité des disques de toutes les productions avec les lecteurs de toutes les marques.
Vitesse de lecture et durée de l'enregistrement
La désignation « 78 tours » ne s'applique aux premiers disques que par extension rétrospective. Jusqu'au début des années 1930, ces disques pouvaient être enregistrés à des vitesses variant de 60 à 120 tours par minute ; chaque fabricant et chaque maison de disque établissait ses choix sans aucun accord sur les vitesses.
De 1905 à 1915, les disques à saphir Pathé allant du centre vers l'extérieur inscrivaient sur leurs pochettes brunes cartonnées cousues : « Les disques Pathé s'écoutent à une vitesse de 90 à 100 tours par minute ». Les disques Pathé de 1915 à 1930 environ, se reconnaissent à leur étiquette centrale représentant un coq, ainsi qu'à leur pochette bleue en papier. Ils tournent à 80 tours.
En 1925, lorsque la généralisation des appareils électriques amena la nécessité d'une unification de la vitesse de rotation, Edison utilisait 80 tours par minute, d'autres 82 tours par minute. Victor, la compagnie prédominante en Amérique, avait adopté 78 tours par minute dès 1901, et sa vitesse fut adoptée.
En cas de nécessité d'augmentation du temps d'enregistrement, la vitesse pouvait être légèrement réduite durant la gravure en studio afin de gagner les quelques secondes manquantes. La lecture un peu plus rapide de moins de 5 %, soit un demi-