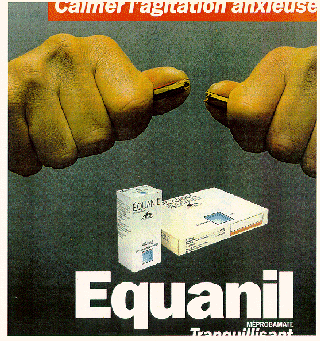
2.3 Comment communiquer un concept ?
2.3.1. Quel que soit le contenu que l'on donne à la notion de concept la question de la communication d'un concept soulève une difficulté de taille, du moins lorsqu'on l'examine du point de vue de la phénoménologie : une idée abstraite et générale est présente à l'esprit d'une personne (par exemple un publicitaire). Celle-ci produit un existant ou un fait à partir de cette idée (une affiche, un clip vidéo, un texte, une annonce radio) et la perception de cet existant par des interprètes fait que cette même idée (ou une idée équivalente, ou proche) est présente à l'esprit d'autres personnes. Comment décrire cette sorte de mouvement de l'idée originelle qui transite, en quelque sorte, par des existants ou des faits de l’esprit de l’un dans les esprits des autres? Et s'il y a une sorte de codage comment agissent ces codes, comment s'établissent-ils dans le corps social et comment et pourquoi se transforment-ils ? Le modèle que nous exposerons apportera une réponse à ces questions ; les cas d'école que nous allons analyser doivent donc être considérés comme une introduction à ce modèle. Ils nécessitent cependant de s'entendre avant toute chose sur le contenu des principaux termes utilisés.
2.3.2 Nous donnons à la notion de concept le contenu suivant : un concept est une classe d'objets ou de choses existantes (des chaises, des maisons, des enseignants...) ou des classes de faits concernant des objets existants ou imaginaires (l'habitat, la thérapie, la liberté, la mécanique, le pouvoir, la destinée, ...). Chaque concept a une extension qui est la classe des objets (par exemple, toutes les chaises passées, présentes ou à venir) qui "tombent sous le concept" selon l'expression de Frege. Il a aussi une intension qui correspond à la classe totalisée dans le terme de la langue qui le désigne par convention. Ces classes sont constituées sur la base de correspondances formelles (c’est-à-dire concernant la forme de relations qui les caractérisent) qu'il est possible d'établir entre les objets ou les faits qui tombent sous le concept. Ces correspondances s'établissent grâce à des schémas de perception c'est-à-dire de certaines structures (appelées "stuctures relationnelles") présentes d'une certaine façon dans chaque perception des objets ou des faits.
2.3.3 Dire qu'un objet ou un fait "tombe sous un concept" c'est dire que dans la perception (actuelle ou antérieure) il y a des éléments caractéristiques qui permettent de rattacher cet objet ou ce fait au schéma général du concept. Le mécanisme de ce rattachement est totalement intériorisé par l'interprète? Cela signifie que, bien qu'il perçoive une chose singulière ou un fait singulier, c'est une idée abstraite et générale qui occupe son esprit. Tout se passe comme si une loi, une règle générale et impérative avait fonctionné suivant une habitude ou disposition de son esprit au point que le concept lui advient à l'esprit comme s'il était impliqué dans la nature même des choses. Cette loi gouverne les existants et les faits d'une façon qui lui apparaît comme nécessaire. Il en est de même pour les rapports entre des classes d'objets ou des classes de faits qui ont un certain caractère de régularité; ils lui apparaissent comme autant d'instances de lois de la nature, au sens où on l'entend dans les sciences positives, y compris les sciences humaines. Il s'ensuit que la représentation d'un concept et, à fortiori de relations entre concepts, passera obligatoirement par la mise en oeuvre de ces lois ou habitus auxquels les producteurs de la représentation aussi bien que leurs interprètes sont soumis. Ceci nous indique d'emblée une difficulté. En effet, si les uns et les autres -pour autant qu'ils appartiennent à la même aire culturelle- y sont soumis, il n'y sont pas soumis de la même façon, car ils n'ont pas forcément des expériences équivalentes des classes d'objets ou de faits qui constituent l'extension du concept et déterminent donc leur intériorisation par les acteurs sociaux. En d'autres termes, le problème de la représentation du concept doit nécessairement être placé dans le champ de la communication. Retraduit au niveau de la communication publicitaire le problème peut s'exprimer ainsi : les concepteurs d'un message publicitaire ont collectivement une ou plus ou moins grande certitude que les objets qu'ils vont produire (affiches, clips, vidéo etc...) tombent chacun sous tel ou tel concept. Mais ceci est la singularité de leur rapport individuel et/ou collectif (en tant que groupe de décision) à ces sortes de lois de l'esprit qui s’actualisent en eux. Les individus qui constituent la cible visée n'ont pas nécessairement le même rapport. Toute la problématique de la réussite de leur projet est dans la plus ou moins grande adéquation entre les deux singularités actualisées par la communication : celle du groupe qui produit les représentations et celle du groupe visé qui les interprète. La recherche de cette adéquation nécessite une connaissance approfondie des modes interprétatifs des diverses cibles possibles (souvent des catégories sociales) et une bonne conscience de son propre mode interprétatif et des éventuels écarts qu'il peut présenter vis-à-vis des normes sociales en vigueur au moment de la production des représentations. C’est une question qui mérite d’être sur le plan théorique. Nous le ferons en définissant tout signe comme un "médium pour la communication d'une forme" (Peirce) et nous suivrons grâce au modèle mis en place les avatars possibles des cheminements d'une forme depuis l'esprit du publicitaire jusque dans celui du public qui perçoit ses productions. Auparavant nous allons analyser plusieurs productions publicitaires répondant à des approches différentes (nous voulons dire phénoménologiquement différentes) de la problématique évoquée selon le concept à transmettre, le médium utilisé et la cible visée.
2.3.4 Très souvent le concept est indiqué à l'interprète par le terme de la langue qui le désigne.On s'assure ainsi que d'autres concepts que pourraient induire le fait sont éliminés et que l'interprétation se fera suivant l'axe recherché. C'est le cas de la publicité d'Equanil, un tranquillisant qui s'attaque à l'agitation anxieuse...
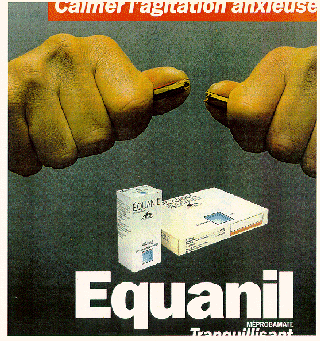
Le fait représenté est représenté selon le mode authentique même si un examen approfondi montre qu'il s'agit sûrement d'un artefact (en effet, un crayon entier tenu comme sur la photographie dans une main occupe à lui seul toute la longueur ce qui montre que ce sont deux crayons cassés à des extrémités différentes qui ont été utilisés). Il est clair que la rupture du crayon tombe sous le concept d'agitation anxieuse, au sens où il est admis, parce que trés courant, que des personnes énervées peuvent casser des crayons, la force qu'elle appliquent à ces objets étant l'extériorisation de tensions internes qui se libèrent à cette occasion. Il s'agit là d'une loi ou habitude acquise par l'observation des autres ou analyses de soi-même ; C'est cette loi qui était présente à l'esprit du concepteur.Le mode d'être de la loi, en tant qu'elle gouverne des faits, nous le traduisons comme suit : le fait dyadique authentique (c'est à dire la dyade mains/crayon réalisée dans la rupture du second par les premières) est incorporé dans une triade (mains/crayon/anxiété). C'est l'anxiété, présente à l'esprit du concepteur (une intension) qui a déterminé le choix d'un fait dans l'extension du concept. Le pari de la communication c'est que la perception d'un élément de l'extension produira chez tout interprète la présence à l'esprit du concept recherché. Au vu les circonstances et la cible (un public de médecins) le pari est évidemment gagné. Une petite remarque cependant : en mettant en scène des mains d'homme on a exclu une grande partie de l'extension, ce que l'emploi du mode dégénéré aurait évité (utilisation de mains "ambiguës" photographiés ou dessinées).
2.3.5 Le risque pris par la publicité du Duphaston 10 est nettement plus important.
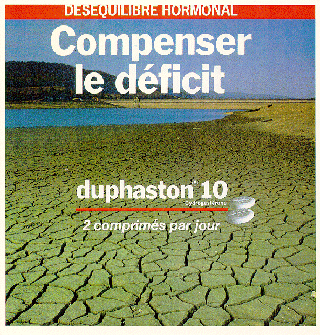
Le concept représenté est le concept du déficit ; le fait choisi représenté selon le mode authentique, est le déficit en eau d'un barrage avec ses conséquences sur les portions de terre découvertes. Aucun des éléments représentés, en dehors des termes de la langue, n'est en rapport avec les éléments réels qui ont motivé la représentation et qui sont les humains et leurs hormones. Cependant les relations qu'entretiennent la terre et l'eau d'une part, le corps et les hormones d'autre part sont semblables sous le rapport suivant : si dans chaque dyade (terre, eau) et (corps, hormones) le second terme est altéré le premier l'est aussi. Autrement dit la similitude consiste dans la relation constitutive des deux dyades (il s'agit bien entendu d'une métaphore visuelle qui peut-être explicitée). Le pari du concepteur est donc que la triade (terre, eau, déficit) qui incorpore la dyade (terre, eau) produira dans les conditions de l'interprétation, à savoir la lecture par un médecin d'un magazine qui lui est destiné, la triade (corps, hormones, déficit). Dans ces conditions le risque n'est pas très grand, on en conviendra aisément. Il y a cependant un autre pari qui est nettement moins gagné d'avance ,c'est celui qui motive réellement la publicité, à savoir le pouvoir de compenser ce déficit. Le seul support est le verbe "compenser" ; aucun élément visuel n'est capable de le soutenir et seule une opération de l'esprit réalisée à partir du fait photographié peut y conduire. Il s'agit clairement d'une inférence (abductive) selon laquelle si, dans un magazine médical, on représente un dégât quelconque, c'est évidemment dans le but d'y porter remède. Peirce cite l'exemple d'un ivrogne exhibé par les dames de l'armée du Salut dans le but de montrer, par contraste, l'excellence de la tempérance ! Cet exemple illustre bien le fait que la signification finale peut être obtenue au terme d'un processus inférentiel plus ou moins complexe portant sur les données immédiates de la perception du signe.
2.3.6 Il est intéressant de comparer la publicité du Duphaston 10 à celle du Vectarion qui traite aussi d'un déficit (oxygène).
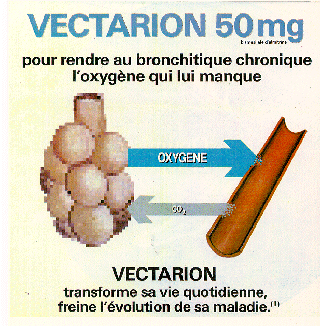
Cependant, à l'aide de flèches (convention graphique), on y représente son intervention spécifique sur le déficit au moyen d'un accroissement significatif de l'épaisseur de la flèche oxygène. Le propos est encore renforcé par un choix des couleurs et des intensités lumineuses qui s'oppose a celles de l'autre flèche. Ici l'utilisation du mode dégénéré pour la représentation du fait a permis, grâce au symbolysme de la flêche, de diagrammatiser l'action du médicament et de livrer à l'interprète un produit fini qui s'obtient sans aucune suggestion. Mais peut-être l'efficacité de la publicité est-elle liée à la participation active de l'interprète au processus de construction des significations ?
2.3.7 Par contre sur la page de couverture d'un bulletin de liaison de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale le concept de "dangerosité du tabac" est représenté de façon qu'on pourrait appeler "mixte" si on le rapporte aux deux cas précédents.

En effet des deux éléments constitutifs de la dyade (revolver/ cigarette) le premier contrairement au second n'a pas de relation directe avec le fait de fumer. A fortiori la relation qui les lie ne peut être qu'une construction de l'esprit qui doit établir ce parallélisme du point de vue de la comparaison des effets respectifs du tabac des balles tirées par un revolver. Cependant dans cet exemple, comme dans les précédents, aux inférences prés, on retrouve toujours un fait sous un concept, avec des variantes qui tiennent au mode de représentation, authentique ou dégénéré, du fait.
2.3.8 La publicité du magasin Morabito est d'une nature sensiblement différente.

Ecartons sur la photographie du magasin lui-même (dans la partie inférieure) qui représente un fait d'existence pour nous intéresser à sa partie supérieure. Il s'agit là encore de la représentation photographique d'un existant, les plaques à l'angle de la rue Saint Honoré et de la place Vendôme. Mais il est clair que cette photographie n'a pas pour seule fonction de nous indiquer l'adresse du magasin avec une visée purement informative. La signification se situe à un autre niveau, lequel d'ailleurs n'efface pas le niveau de l'information brute. En effet selon une convention sociale établie (ici établie par le fait que des commerces de luxe se sont concentrés dans la rue St Honoré et la place Vendôme avec une prédilection de cette dernière pour les bijoux) et activée par la seule perception de l'image-photo des plaques ce sont la mode d'une part et les bijoux d'autre part qui sont présents à l'esprit unis dans le concept de "distinction". Comme dans les cas précédents, il y a bien une liaison réelle entre le concept et la représentation puisqu'on peut effectivement constater l'existence de magasins de grand luxe en ces lieux. Cependant, ce n'est pas cette liaison qui donne son caractère à la signification mais le fait que ces lieux aient été sélectionnés pour représenter le luxe et la distinction. En termes courants ils ont valeur de symbole et nous leur conserverons ce nom. Il y a bien comme dans les exemples précédents des lois ou habitudes qui sont sollicitées et instanciées mais il y a quelque chose de plus (ou de moins) perceptible dans l'arbitrarité des dénominations : la rue Saint Honoré aurait pu aussi s'appeler rue de la Paix et la place Vendôme, place de la Concorde ! En d'autres termes, et le slogan ne fait que le souligner, la dyade (rue St Honoré/ Place Vendôme) représentée de façon authentique par la proximité des plaques de rue est incorporée dans une triade (rue St Honoré, place Vendôme, luxe et distinction). Elle crée la présence à l'esprit d'un interprète de notre culture (c'est à dire ayant intériorisé la spécialisation de ces lieux dans les commerces de la mode et des bijoux au plus haut niveau) de la triade (mode, bijoux, luxe et distinction). Mais rien en dehors de cette intériorisation ne garantit cette signification ; une personne étrangère par exemple, qui l'ignorerait, n'aurait d'autre recours que de se rendre dans ces lieux (ou de se renseigner), de faire le constat de la présence de boutiques de mode et de joailleries pour accéder à cette convention sociale. Il la partagerait avec nous dès qu' il construirait la même signification que les "initiés". Dans ce cas le concept est bien construit au-dessus des faits qu'il gouverne, mais le mode de connexion est social et nécessite donc une expérience préalable (collatérale) pour être présent à un esprit. Ce n'était pas le cas dans les exemples précédents dans lesquels les existants et les faits présentés ainsi que leurs rapports ne dépendaient ni de l'esprit du concepteur, ni celui de l'interprète. Ils n'avaient qu'à être constatés par l'un et par l'autre tout en étant incorporés, comme tels, dans leurs triades respectives (anxiété, déficit). Les lois actualisées dans chaque cas étaient un en-dehors à connaître (dans l'ordre du monde physique ou biologique). Dans le cas qui nous occupe elles relèvent d'un accord avec un consensus social qui doit être reconnu et qui, par ce fait même est validé (et éventuellement transformé, sous certaines conditions, comme nous aurons l'occasion de le voir).
2.3.9 A la différence du cas précédent la photographie de la publicité du Crédit Lyonnais n'a aucun rapport, en ce qui concerne les existants représentés, avec le concept de bonne gestion de l'épargne. Il s'agit moins d'un jeu sur la sémantique du terme "orientation", qui est par ailleurs une métaphore, que de la visualisation pure et simple de cette métaphore. La dyade ("jungle" des placements/épargnants) est représentée de façon symbolique par la relation qui la constitue, c'est-à-dire un certain parcours virtuel (sous forme de flux financiers variables) de l'épargnant dans cette jungle. Cette relation est visualisée par la direction de la boussole dont le N a été remplacé par le logotype du Crédit Lyonnais. Cette substitution "recolle" le plan strictement bancaire et la difficulté de s'orienter dans un milieu à risques. Dans ce cas le travail de l'esprit consiste à partir de la visualisation de la seule relation et, en s'appuyant sur le contexte (et le texte, bien sûr), à reconstruire les termes des deux relations. Il s'agit moins d'inférence logique que de connivence profonde avec le consensus social établi autour du terme "orientation", d'une véritable institutionnalisation de son sens métaphorique.
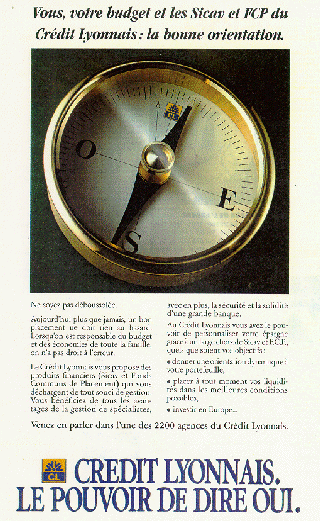
2.3.10 Nous terminons ce panorama des différentes manières de communiquer un concept par l'analyse d'une publicité comportant un argument. Il nous a été difficile de trouver des exemples qui ne soient pas essentiellement de type linguistique, l'image n'intervenant que pour illustrer l'un des termes du raisonnement du type : "Si vous prenez le scrabble Duplicate pour un Scrabble classique, vous risquez une crampe du thalamus "ou encore "puisque ce n'est pas dangereux pourquoi ne pas faire les essais nucléaires en Normandie ?" (Greenpeace) ou "Fuji, c'est réussi". En fait un raisonnement mobilisant deux propositions (si p, alors q) est difficile à représenter sur une page à moins de la diviser en deux parties (comme dans les publicités du type "avant-après" relatives à la perte de poids, chute des cheveux et autres produits miracle). Le domaine d'élection de ce type de représentation est le clip vidéo ou le film publicitaire. Toutes les démonstrations filmées qui apportent la preuve d'un effet ou bienfait quelconque appartiennent à cette catégorie (et elles sont nombreuses). Là aussi les faits peuvent être présentés de façon authentique (photographies par exemple) ou dégénérés (graphismes) et faire appel ou non à des symboles. On conçoit qu'à ce niveau-là la complexité s'accroît et seule une méthodologie systématique pourra en venir à bout. Cependant, la palette des exemples que nous avons présentés donne une bonne idée des genres de distinctions que la théorie sémiotique est capable de produire. Bien entendu ces distinctions apparaîtront alors plus fines et plus opératoires qu'elles peuvent apparaître sur ces cas d'école.
| Pour toute remarque, contestation ou suggestion : |  |
Pour continuer : Comment communiquer selon les trois modalités?