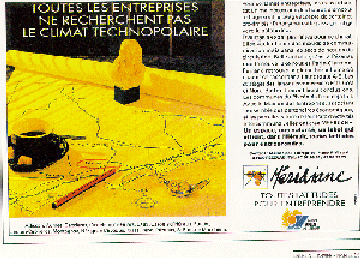
2.4 Comment communiquer une combinaison de qualités, de faits, de concepts ?
2.4.1 Tous les exemples de communication d'un concept que nous avons analysés nous ont conduit à faire appel à la notion de triade, cette triade étant à chaque fois construite à l'aide d'un fait dyadique et d'un concept présent à un esprit. Ce dernier est une sorte d'esprit universel dans lequel esprit du concepteur et esprit de l'interprète sont pour ainsi dire soudés. En fait, l'un et l'autre sont des particularités de cet universel, une sorte de loi (plus précisément une régularité supposée d'un futur indéfini) qui règlent les rapports des individus aux objets désignés par les signes qu'il produisent ou qu'ils interprètent. Comme tout fait, le fait dyadique incorporé dans la triade peut être représenté sur le mode authentique ou dégénéré ; sa représentation est constituée d'une configuration de qualités monadiques. Ainsi, d'un point de vue strictement formel, on a une série de présuppositions : toute triade présuppose une dyade qu'elle incorpore ; toute dyade présuppose des monades qui la constituent .Partant de la monade, chaque "niveau" ou mode d'être est constitutif du suivant ; cela nous conduit à tirer la conclusion nécessaire selon laquelle communiquer un concept implique de communiquer un fait ce qui implique à son tour de communiquer des qualités. Comme dyade et triade configurent en fait l'ensemble de toutes les qualités perçues par l'interprète, il s'ensuit que la signification d'une production quelconque résidera exclusivement dans sa forme de relations.
Pour aller plus avant dans l'explicitation de ces formes de relations qui vous paraissent fondamentales car elles constituent pour nous l'essence même de la signification, il convient d'expliciter la monade, la dyade et la triade afin de mieux voir comment ces structures formelles sont imbriquées les unes dans les autres.
2.4.2 Une qualité générale, nous l'avons vu, est une et sans parties : d'une chose rouge on peut dire qu'elle est rouge, ou plutôt que le rouge est en elle. Elle pourrait être à demi rouge (et donc porter d'autres couleurs) mais elle ne peut être rouge à demi ; le rouge ne se divise pas. En cela, toute qualité générale est une monade, c'est à dire une unité fermée, n'entretenant aucune relation susceptible de l'altérer comme qualité : le rouge d'une chose peut perdre ou gagner en vivacité mais la chose restera rouge jusqu'au point ou plus aucun rayon lumineux issu d'elle ou réfléchi par elle n'appartiendra à une certaine fréquence lumineuse. La monade ne peut qu'être constatée ; elle apparaît comme l'ultime division de l'analyse de nos perceptions ; nous ne pouvons aller au-delà. Cela tient à la forme de relation qui la caractérise qui est uniquement réflexive, c'est-à-dire qu'elle ne peut entretenir de relations qu'avec elle même. Elle peut donc seulement être identifiée avec ses manifestations antérieures lorsqu'elle est perçue : telle chose est rouge, telle autre aussi, une troisième chose l'était ; chaque rouge particulier perçu incarne (ou incarnait) cette qualité générale, la matérialise mais, du point de vue phénoménologique, c'est toujours decla même qualité dont il est question.
2.4.3 La dyade est la forme de relation spécifique d'un fait ou d'un existant car factualité et existence consistent en oppositions, actions-réactions. C'est la raison pour laquelle l'analyse formelle pourra toujours y distinguer deux choses constitutives qui dans le fait, en un certain sens, ne font plus qu'une. Nous avons vu l'exemple du carreau de marbre et de la perceuse liés par le fait "trou dans le carreau". Il n'y a pas d'une part un carreau de marbre et d'autre part une perceuse ; le trou est un fait authentiquement dyadique dans la mesure ou il requiert pour être ce qu'il est et le carreau de marbre et la perceuse. Maintenant chacune de ces deux choses est une entité qui a sa qualité sui generis (qualités anomiques dans chaque cas : la qualité générale qui caractérise le mode d'être universel des carreaux de marbre n'est pas nommée par la langue, pas plus que celle des perceuses). Le fait "trou" unit ces deux qualités en une entité formelle d'ordre supérieur, la dyade. Quant à une chose matérielle seule regardée comme un existant, c'est-à-dire comme s'opposant à d'autres choses, ici et maintenant, elle relève pour cette raison du même schéma formel que le fait.
2.4.4 Le cas de la triade est plus complexe. Nous avons vu que sa nécessité était apparue avec la communication d'un concept. Elle répond à la forme de relations par laquelle l'esprit appréhende le monde extérieur, c'est à dire le monde des faits et des existants dyadiques. Donc nécessairement l'un des termes de la triade sera de l'ordre de l'esprit, non du spirituel, mais aura à voir avec la détermination d'un esprit. Nous voulons dire par là ce qu'est un esprit quelconque lorsque des faits, des existants ou des classes de faits ou d'existants y sont présents. De plus la triade incorporera nécessairement encore une dyade : c'est ce formalisme qui permettra de capter le mode d'appréhension des formes dyadiques du monde extérieur par les formes triadiques du monde intérieur. Mais sous quel rapport ? Nous verrons plus loin toutes les possibilités pour une forme triadique d'incorporer des formes dyadiques authentiques ou dégénérées et des formes monadiques. A l'étape actuelle nous constatons l'imbrication nécessaire des trois formes de relation évoquées ci-dessus; Elles nous ont permis de décrire les phénomènes de la communication publicitaire en nous contraignant à prendre en compte des niveaux phénoménologiques qui peuvent ne pas apparaître au premier abord. Nous allons expliciter cette démarche sur un nouvel exemple particulièrement adéquat à ce propos.
2.4.5 Il s'agit d'une publicité institutionnelle relative à l'annonce de la création d'un parc d'activités industrielles dans la région de Pézénas, nommé Méridiane .
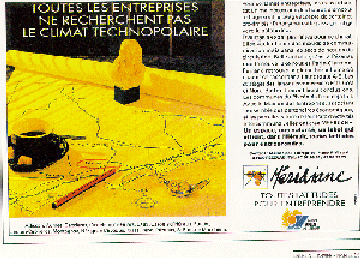
Nous ne considérons que la photographie qui, il faut le remarquer, est une composition dans laquelle aucun élément existant du site en question ne figure. Ce message est construit de façon à communiquer selon les trois modalités et cela de manière quasiment autonome dans chacune d'elles. La communication selon la qualité est clairement dévolue à la tasse de café qui produit la présence à l'esprit d'un sentiment de "qualité de l'accueil" à l'exclusion du fait qu'on peut boire du café à Pézenas, ce qui ne présente aucune originalité et est exclu d'emblée par tout interprète. On voit donc que c'est la qualité sui généris de la tasse de café qui participe à la communication et pas le fait lui-même dans laquelle cette modalité est incorporée. Par contre la représentation cartographique, la focalisation du lieu sur la carte au moyen d'un trait de crayon rouge, la boussole qui la situe dans l'espace sont autant de faits qui assurent une communication forte selon la seconde modalité, car ils sont tous en connexion réelle avec l'espace physique à présenter. Ils présentent cet espace sur le mode dégénéré puisque, comme nous l'avons déjà remarqué, aucun élément du message visuel n'est en connexion physique avec l'objet réel. C'est au buste de Molière qu'il revient de supporter la communication selon la troisième modalité. Bien qu'il ait manifestement une fonction instrumentale (celle d'empêcher la carte de s'enrouler) il représente évidemment une référence culturelle aujourd'hui très appréciée dans le monde des entreprises. Les concepteurs font confiance à l'interprète pour qu'il reconnaisse le buste de Molière (un existant représenté sur le mode dégénéré) dans un premier temps, puis qu'il se remémore que Molière et sa troupe firent de longs séjours à Pézenas entre 1650 et 1658, ce qui établit une connexion existentielle entre l'homme célèbre et la ville et ,enfin, pour qu'il le replace dans les fonctions qu'il remplit dans la culture universelle (ce qui en fait un représentant de la culture en général). On voit ici combien est importante la hiérarchie des modalités : un interprète peut reconnaître Molière et ignorer sa relation avec Pézénas ; la valeur "culturelle" de cet élément du message sera bien présente à son esprit (car reconnaître le buste de Molière présuppose un rapport antérieur avec le personnage), mais il n'en créditera pas spécialement Pézénas et pourra n'y voir qu'une volonté des concepteurs de mettre l'ingrédient "culture" comme un ornement arbitrairement surajouté. La crédibilité du message en souffrira et la vivacité des sentiments crées en sera affectée. Un autre interprète, informé du fait, peut ne pas élargir à la culture en général et y voir un atout ; Pézénas s'approprierait Molière pour faire valoir l'idée que cette ville doit avoir des qualités particulières pour avoir attiré et retenu quelque temps un personnage de cette importance. Ces possibilités d'interprétation du buste de Molière montrent bien que l'imbrication des modalités peut conduire à la situation suivante : un message peut être interprété à un niveau phénoménologiquement inférieur au niveau auquel il a été émis. Il y a une sorte "d'entropie phénoménologique" dans la communication qui, en l'absence d'apport nouveau d'information ou d'inférences "néguentropiques" conduit à une sorte de dégradation du message. C'est une possibilité qui est inscrite dans sa nature même. Il y a encore une autre leçon qu'on peut tirer de cet exemple : la communication est probablement plus forte, plus tendue, plus efficace lorsque tous les niveaux impliqués participent de façon à la fois autonome et intégrée à la construction de la signification pour un interprète. Comparons à la publicité du Duphaston dans laquelle la particularité du barrage représenté ne joue aucun rôle puisque tout autre barrage, pourvu seulement que son étiage soit au plus bas, aurait pu faire l'affaire. Autrement dit le fait qui supporte le concept et la qualité sui generis des existants représentés ne collaborent pas de façon intégrée; il n'y apas synergie des modalités.
2.4.6 Au terme de cet ensemble d'analyses conduit selon nos propres catégories, nous pensons avoir mis en évidence le caractère directement opératoire des trois modalités de la communication. Nos critères de distinction entre ces modalités sont d'ordre phénoménologique c'est-à-dire incorporent non seulement ce qui représente et ce qui est représenté mais encore l'esprit de l'interprète auquel l'objet (qualité, fait ou concept) est présent. Le lecteur aura bien compris que nous nous sommes en fait livré à une préparation ayant pour finalité d'ouvrir la voie à une présentation systématique appuyée sur des justifications explicites d'une théorie générale de la communication publicitaire regardée comme une activité de production et d'interprétation de signes.
| Pour toute remarque, contestation ou suggestion : |  |
||
| Télécharger les 6 fichiers. (1 129 Ko) |