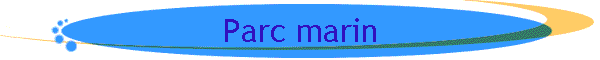
|
|
|
|
Pour le Parc Marin d'Iroise
État de la question ;une longue gestation (voici l'historique.)
Parc marin; report ou enterrement? Voilà vingt ans que la proposition a été lancée. Nos
rappelons que le projet de Parc Marin des Iles Chauzey a échoué dans les
années 70. Aussi, le report de l’enquête publique d’année en année
depuis 2003 est motivé par le fait que la législation des parcs nationaux ne
s’appliqueraient pas au domaine maritime. Nous ne voulons pas croire que
l'inadéquation du projet avec la loi de 1960 (celle sur les parc nationaux)
n'est qu'un prétexte pour se débarrasser du projet de parc marin. Le motif invoqué n'est pas fondé, pour la simple et bonne
raison que dès la présentation des avants projets et lors de l'enquête préalable
tous les partenaires savaient que la loi sur les parcs nationaux terrestres n'était
pas applicable. Plus fort, les responsables argumentaient à loisir sur le fait
qu'il s'agissait bien d'inventer un nouvel outil adapté au milieu marin, de
forger un nouveau savoir-faire maritime, susceptibles d'être exportés ailleurs
dans le monde. La science administrative française n'est plus ce qu'elle était.
On espérait pourtant remplacer l'introuvable décentralisation par le fameux et
nouveau "droit à l'expérimentation". Eh bien non, peut être la
prochaine fois, peut être l'année prochaine, ou plus tard encore. De fait une
des vraies raisons pourrait bien être le devoir impérieux d'économie dans les
ministères dans cette époque de déficits généralisés. Il reste un devoir qui doit être rempli par l'administration et/ou la mission du parc vis à vis des citoyens, usagers et professionnels, c'est le devoir de transparence financière. Le bilan financier du pré projet "parc marin", depuis le lancement des études de faisabilité de 1993 jusqu'à ce jour, doit être établi et présenté publiquement. A) Une chance et un défi maritimes à la Pointe de Bretagneun écosystème exceptionnel reconnu La Mer d’Iroise concentre dans ses eaux une exceptionnelle richesse de la flore et de la faune reconnue par 6 catégories de protection du milieu : de la zone d’intérêt communautaire à Natura 2000. L’idée d’un Parc Marin National d’Iroise est née en 1988 de la création par l’UNESCO d’une réserve de biosphère à Ouessant et à Molène, bientôt étendue à l’Ile de Sein. Ces multiples reconnaissances, nationales et internationales, des fonctions de l’écosystème de la mer d’Iroise fondent la proposition visant à une protection durable et une maîtrise concertée de l’exploitation de ses ressources marines. L’adaptation au milieu marin de la législation des Parcs Nationaux est une opportunité à saisir pour l’écosystème marin, élargi et cohérent, de la Mer d’Iroise. Une chance économique et écologique Dans ce territoire fragile aux ressources limitées et sensibles, nous apprenons tous les jours que la " qualité environnementale est le premier atout d’une mise en valeur économique ". Aujourd’hui, les professionnels de la mer de Bretagne et d’ailleurs, explorent sur leurs zones de pêche, les principes et conditions d’une gestion raisonnée de leurs métiers, seule capable d’assurer la pérennité de leurs activités. Les contraintes environnementales sont des données incontournables pour le développement d’un tourisme de qualité et de loisirs, respectueux du milieu. Dans les années 1970, un projet similaire de parc marin aux Iles Chausey a échoué. Aujourd’hui, il n’y a plus d’école à Chausey, deux fois moins de bateaux, de pêcheurs en activité, et différentes espèces de coquillages et de crustacés ont quasiment disparu. Rien n’est donc sûr.. Un véritable enjeu de concertation responsable. Une concertation réussie entre les multiples usagers, acteurs, riverains d’un territoire marin est un véritable défi et une aventure continuellement recommencée. Les Schémas d’Aménagement et d’Utilisation de la Mer (SDAU) les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), se sont trop souvent cantonnés dans la réalisation d’études scientifiques, d’états des lieux, qui, pour être essentiels, n’ont cependant pas permis la mise en place d’une dynamique de gestion concertée. Les contrats de baie ou de rade, après des lancements tonitruants paraissent aujourd’hui en panne. Il y a toujours manqué la création simultanée d’une agence interdisciplinaire et interprofessionnelle d’animation et de suivi, dotée de moyens à la hauteur des enjeux. L’outil Parc Marin, par l’institution délibérée d’une véritable entité maritime nouvelle, représente une opportunité formidable pour imaginer, organiser, faire vivre, une concertation, un suivi, une mise en valeur exemplaires d’un site d'exception. C’est le défi présenté aux acteurs et partenaires de ce territoire. Il repose sur l’implication volontaire et concertée des usagers qui y travaillent, y vivent, et en jouissent Le Parc National Marin, sera alors un nouveau et beau symbole de l’attachement des Bretons à leur patrimoine maritime. B) Un projet de gestion intégrée de la Mer d’Iroise.Les deux approches du Parc Marin On nous assure qu'il s'agit là d'un projet original, qu'il n'y
pas d'antécédents, et que le rôle de la concertation est justement une élaboration
collective d'un produit nouveau, qui servira, même, de référence par la
suite; Alors, il faut être clair. Ainsi
Si dans le cadre des premières zones "réserves de Biosphère" existantes, le schéma d'organisation est déjà ficelé (n'y a t'il pas un directeur? Un comité scientifique de suivi ?), l'organisation administrative des autres zones dans le cadre du Parc marin doit faire appel à une participation active des usagers et acteurs maritimes. Et cette organisation doit être différente. Pour nous, il est clair que nous retrouvons, dans le cadre du Parc Marin élargi, la problématique de gestion intégrée d’une zone marine , qui rappelle les Schémas de Mise en Valeur de la Mer et les contrats de Baie. le Parc Marin d'Iroise = Un Schéma de Mise en
Valeur de la Mer d'Iroise Aujourdhui, après de nombreuses tergiversations, le projet est plus ou moins
reporté jusqu’au moment où l’on aura défini un statut juridique pour les
parc marins, étant entendu que le statut de parc national ( terrestre) n’est
pas adapté. De fait, il suffirait d’essayer de faire appliquer une
sorte de schéma de mise en valeur de la mer à la zone concernée. Nous savons très bien que ces schémas de mise en valeur de la mer n'ont pas
bonne presse. Un seul a vu le jour en France. Il est tout d'abord nécessaire
d'en expliciter les raisons et de dire pourquoi dans le cadre du projet de Parc
Marin cette procédure retrouve une nouvelle vigueur.
Les SMVMs sont souvent restés lettre morte parce que dans le même
temps où l'on débloquait le financement des études scientifiques, économiques
sur la zone considérée, on n'instituait pas parallèlement l'organisme chargé
du suivi et de l'animation de ces programmes. La Préfecture chargée
d'instruire les SMVMs n'avait pas pour mandat, ni d'ailleurs l'administration
des affaires maritimes, de faire vivre ces Schémas. Les études étaient donc
rangées dans les tiroirs jusqu'aux prochains financements d'études complémentaires.
Dans le cas du parc marin, c'est très différent puisqu'une structure
d'animation et de suivi est mise en place dès le départ avec des moyens
importants. Donc la structure d’animation d’un SMVM existe déjà;
c’est « la mission du parc » qui bénéficie de moyens. La participation des usagers et des acteurs du monde marin à la réflexion sur ces SMVMs a trop souvent été bloquée par le fait que l'on annonçait, dès le début, le contexte d'hostilité réciproque dans lequel se déroulait l'instruction; conflits d'usage, activités contradictoires et compétitrices, etc.. En fait cet état d'esprit s'exacerbait à chaque rencontre ou intervention. Dans le cadre du Parc marin, sans nier ces conflits, la procédure est différente puisqu’une nouvelle phase a été mise en place; celle de la consultation préalable. Enfin, il semble qu’une volonté de construction permanente, pas à pas, non figée, est annoncée. C'est une sorte d'aventure collective, qui s'inscrit dans la durée, et, sur laquelle les usagers doivent avoir prise. Ainsi normalement, si la règle du jeu est respectée, les conditions de participation devraient être mieux remplies. Le projet du Parc Marin possède donc un atout essentiel; la volonté de l'Etat
de mettre en place les moyens de fonctionnement d'une structure de suivi et
d'animation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce projet nécessite une réflexion
approfondie sur la manière dont les usagers, riverains et responsables feront
vivre cet espace. Le risque de construire une machine bureaucratique, par
nature, contradictoire avec la notion même de développement durable, n'est pas
nul, loin s’en faut.
Il serait donc utile de bâtir sur chaque zone du vaste territoire du parc,
des modalités de participation différenciées. Ainsi, il apparaît dès à présent
que la Baie de Douarnenez, sous-ensemble de la zone parc, nécessite par exemple
un pilotage spécifique afin d'être au plus près des préoccupations
marines locales. Le Parc marin aura un intérêt, s'il développe, suscite ou amplifie des dynamismes locaux. Les problèmes de pollution, de dégradation des milieux, les volontés de développement économique durable, de reconquête de la qualité des écosystèmes deviennent aussi de la responsabilité et de la compétence du parc. Ceci est incompatible avec une administration technocratique et pyramidale.
Une des questions généralement soulevées est la non-intégration de la
rade de Brest dans la zone Parc. Outre, les craintes vis à vis de l'importance
de la Ville de Brest par rapport aux autres collectivités ou la présence de la
Marine Nationale avec la sanctuarisation nucléaire supposée de la Rade, une
autre raison serait tout à fait valable. C'est que la Rade de Brest bénéficie
déjà d'un Contrat de Baie et donc normalement d'un programme de protection et
de mise valeur. Si la Baie de Douarnenez avait pu bénéficier d'un tel contrat, point n'aurait été besoin d'un point de vue strictement maritime et environnementaliste de l'inclure dans la zone parc. (Voir "la baie et le parc".) De quelques propositions
La proposition faite concernant le CA ne nous satisfait pas. Tout d'abord, nous avons remarqué l'absence de représentation des associations environnementalistes et des associations locales. Ensuite, nous souhaitons une organisation qui ne soit pas figée dès le départ et qui s'adapte aux réalités du terrain. Il faut une véritable décentralisation des pouvoirs d'orientation, de définition des objectifs, et d'initiatives. Nous craignons que la sur-représentation des administrations et institutions éloignées de la vie locale ne débouche sur un empilement d'études de toutes sortes et sur des décisions prises ailleurs. Enfin, il ne faudrait pas oublier que si le Parc est national, il demeure aussi un élément de la vocation maritime régionale. A ce titre la Région Bretagne est sous représentée par rapport à la présence multiforme des ministères et administrations d'Etat.
En restant dans ce même état d’esprit,, nous proposons que le siège social du parc soit éclaté sur le territoire du Parc. Notre proposition consiste en la création de 4 à 5 "Portes" du parc qui mises en réseau, permettra une meilleure communication et présence sur tout le territoire concerné. Nous refusons la création d'un siège social, figé dans le granit et le marbre, qui deviendrait bien vite plus un outil touristique de prestige et de promotion de la ville côtière du siège que la vitrine d'une valorisation du territoire maritime dans son ensemble.
Si le Parc Marin représente une opportunité pour développer des activités marines dans le sens du développement durable, il n'en demeure pas moins qu'il doit également intervenir et s'engager dans la résolution des problèmes de dégradation du milieu. Ces interventions et participations ont bien entendu des volets financiers. Pour revenir sur la question de la reconquête de la qualité des eaux des bassins versants, il est important de faire remarquer que l'instauration des contrats de baie apporte un surplus de 10% d'aides aux travaux sur les stations d'épuration. Le Parc Marin se doit aussi de proposer de telles facilités et point n'est besoin d'une étude supplémentaire pour arriver à cette conclusion.
Parc Marin, l'observateur doit être placé en mer. Parc Marin côtier, il
est clair que l'état des zones terrestres limitrophes concerne également le
parc. La préservation et la mise en valeur des côtes et du littoral ne peuvent
laisser indifférents les responsables de cet espace maritime. Ainsi l'esthétisme,
la qualité d'une construction littorale doit aussi s'apprécier en se plaçant
en mer. Si les maisons regardent la mer, il est aussi important de savoir
que les bateaux regardent la terre. Le mitage littoral est une aussi bien une
catastrophe terrestre, qu'une défiguration maritime. Le parc a aussi une
responsabilité de préserver la qualité de ce paysage maritime côtier qui
jusqu'à présent demeure un de nos grands atouts locaux.. PROJET DE GESTION INTÉGRÉE D'UN ECOSYTEME MARIN CÔTIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Espace réservé aux indications sur les droits de
propriété ou autres.
|