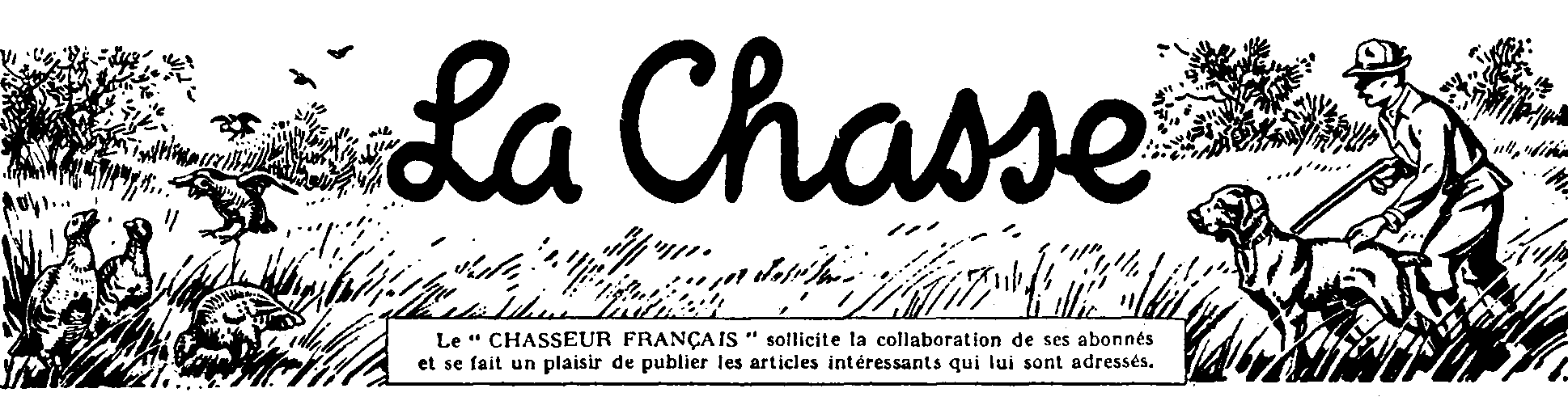| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°596 Février 1940 > Page 73 | Tous droits réservés |
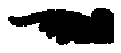
|
Chasses et choses de Pologne |
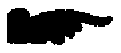
|
|
Quelque part sur le front — suivant le terme consacré — mes yeux, parcourant le Chasseur Français, tombent sur une étude concernant l’Élan en Pologne (1). Et aussitôt en foule, jaillissent les souvenirs de mon séjour là-bas — 1919-1923 — souvenirs d’amis exquis : où êtes-vous maintenant ? Quel pays, quelle vitalité, quelle foi en l’avenir ! Quels rêves vers une Pologne grande, forte, libérée. Son douloureux martyre nous atteint ; nous la retrouvons et nous l’aimons, tout ardente dans sa foi chrétienne et dans son patriotisme, concrétisée dans cette appréciation de ceux qui ont vu combattre son armée en septembre 1939 et ont décerné au soldat polonais ce magnifique éloge : « Brave, instruit, robuste, ayant à un très haut degré l’amour de sa patrie, le soldat polonais a, à matériel égal, largement dominé ses adversaires. » Que bientôt finisse pour elle ce cauchemar déjà vécu en 1916. 1919, débâcle allemande ; les légions grises de Pilsudski libèrent le pays, les légions bleues de Haller arrivent de France à la rescousse. Le Russe est déjà là, il tient l’Ukraine. Chassé de Lwow, Tarnopol, le Sereth, le Zbrucz, l’Ukraine est déblayée, l’Ataman Petlioura renvoyé dans ses steppes. La Pologne respire : 1920 et Toukaczeski sont encore loin. On s’organise, on vit, on vit intensément, comme on a vécu dans les années qui ont suivi la guerre. Le Français peut promener de la Baltique à la mer Noire son auréole de prestige, les cœurs s’ouvrent à lui et le cœur polonais est chaud, vibrant et sincère. Période splendide où les difficultés et les mesquineries quotidiennes n’ont pas encore percé la vague d’enthousiasme et de foi dans une Europe que l’on vient de reconstruire. Quel magnifique pays de chasse offrait alors la Pologne à un passionné de ce sport, appelé à parcourir en tous sens ces contrées, toujours en contact avec ce gentilhomme polonais si imprégné de culture française. Au Nord, entre Lithuanie, Lettonie et Russie, du Niemen à la Dwina, pays de forêts et de lacs alternant avec des terres cultivées. Variété et densité de gibier comme il n’en doit pas exister ailleurs en Europe. Loups, renards de tous poils et toutes les espèces de sauvagine. Perdrix grises, gelinottes, tétras. Toute la gamme des gibiers d’eau, toutes les variétés de canards, tous les genres de grands et petits échassiers. Bécasses : slomka, la grande rousse qui niche au bois ; bekass la petite grise qui niche à la limite des marais ; et enfin le grand lièvre russe qui atteint 16 livres (de 420 grammes) et dont la fourrure grise, d’un blanc argenté par places en hiver, double concurremment avec la fourrure d’été du petit renard blanc sibérien, les grands manteaux de voyage russes en peaux de rennes ou de poulains. À l’Ouest, la Poznanie, grandes terres à blé, betteraves et pommes de terre, alternées de grandes forêts de pins. Terre ravie autrefois par l’Allemagne, chasses organisées à l’allemande, très vives en perdrix grises, lièvres et surtout chevreuils : les fauves à longs bois droits en dague et, plus petits, les gris à bois légèrement en lyre, daims, cerfs. Au Sud, les Carpathes dont les massifs élevés et relativement difficiles : beskides occidentales (Tatras) et beskides orientales (frontière roumaine), renferment de gros animaux, ours et lynx et dont la partie plus perméable est riche en chevreuils et sangliers et renferme ces légendaires dix-cors des Carpathes dont pas un chasseur digne de ce nom n’a poursuivi jusqu’à réalisation la capture. Au Sud-est, les plateaux de Podolie, l’Ukraine pays des Terres noires, pays de blé et de chanvre, pays de larges ondulations sans arbres avec de larges coupures marécageuses formées par les affluents du Dniester : Gnila-Lipa, Zlota-Lipa, Sereth, Zbrucz, marécages où s’ébat toute la gent aquatique et où l’on rencontre sur les plateaux, avec l’inévitable canepetière, le Drapp ou grande outarde. Enfin à l’Est, l’un enserrant l’autre, la grande forêt : Bielowicza Puszcza et les marais de Pinsk. Il faut avoir séjourné plusieurs mois dans ces contrées et y avoir chassé en été et en hiver pour se représenter ce que ces deux mots signifient. La forêt, c’est l’ancienne réserve des Tsars qui avaient fait construire à son centre un rendez-vous de chasse et une voie ferrée y accédant ; 152.000 hectares d’un seul bloc et une infinité de boqueteaux, bois, petites forêts surgissant des marais environnants qui l’encadrent. De l’eau et du bois. Comme bois, deux essences principales : le pin rouge, au fût droit ne cassant pas à la neige, et le bouleau argenté. Au pied, l’eau. Au dégel, le pied de chaque tronc et les racines proches forment point d’appui pour le pied ; entre les arbres, c’est le bain jusqu’au genou. En été, tout ce sous-bois est envahi de baies sauvages, myrtilles, fraises, airelles rampantes. Dans un compte rendu de la visite du maréchal Goering au maréchal Rydz-Smygli, un journaliste en mal de linguistique a traduit Bielowicza Puszcza par Forêt de la Tour Blanche : c’est purement grotesque. Bielowicza est Bielowicza comme Fontainebleau est Fontainebleau ; quant à Puszcza, c’est intraduisible en langue française. Ce mot est à la forêt ce que le « Wild » est au nord Canadien, la « brousse » à l’Afrique centrale, le « Maquis » aux montagnes de Corse : cela exprime, avec la force créatrice de la végétation, la solitude, la désolation, le vide, la rigueur du climat joints à une étendue indéterminée : c’est la Puszcza. C’est l’une des deux dernières réserves des « Zubr » (bisons) la seconde étant au Caucase. C’est la limite sud du parcours du « Los » (élan) ; il s’y cantonne volontiers avant de reprendre son existence erratique en Lithuanie, Lettonie et Finlande, c’est l’habitat du « Glucew » (grand tétras), du « Trzecew » (petit tétras), des « Jazonbek » (gelinottes), pays des cerfs, des daims, des chevreuils, des sangliers. L’épaisseur de la couche de neige, souvent 1 mètre, la rigueur de la température, -30° à -40° pendant l’hiver, éliminant tous les sujets chétifs, l’abondance de la nourriture due à la chaleur estivale qui monte souvent à 30°, la tranquillité absolue dont ils jouissent (le fusil était interdit au paysan russe) sont à la fois une sélection et une condition de développement optimum pour tout ce gibier qui atteint des grosseurs nettement supérieures à celles de nos contrées. J’ai personnellement abattu un solitaire qui pesait 16 puds (256 kg.) et l’on m’a assuré que, du temps des Tsars où on les nourrissait avec du seigle en hiver, on en voyait de 18 et même 19 puds (300 kg.). Un ouvrage extrêmement intéressant, mais malheureusement très rare en librairie, Bielowicze in deutscher verwaltung, décrit l’exploitation de la forêt de Bielowicze pendant l’occupation allemande de 1916 à 1918. À côté de la technique forestière très bien traitée, l’auteur étant un officier spécialiste allemand ayant fait, je crois, un stage à notre école de Nancy, tout ce qui a trait à la chasse ou à l’exploitation du gibier, pour employer son expression, est raconté avec un humour, très grossier, à la prussienne, mais suggestif. Le vieux roi de Bavière, enragé chasseur, a rejoint, à son arrivée à Varsovie, le train de l’armée allemande. Avant que cette dernière n’entreprenne l’exploitation méthodique et n’apeure le gibier, il faut qu’il tire les plus belles pièces, et surtout les bisons. Le soldat, à qui peut-être les restrictions commencent à faire oublier la discipline, ne se fait pas faute de puiser à pleines mains dans ce providentiel garde-manger. Les bisons, raconte-t-il, étaient si sots qu’ils suivaient les voitures chargées de fourrage (ils étaient ainsi alimentés en hiver) et venaient d’eux-mêmes s’offrir aux cuisines roulantes. L’Auerhahn (grand tétras) nous attendait et tombait de lui-même dans la marmite. Quoi qu’il en soit, le vieux roi fit de fort beaux tableaux, mais si faciles qu’il ne continua pas à tuer ces gros taureaux au pâturage. Il se consola en envoyant leurs dépouilles au præparatorium de Dresde où on les mit en état pour les générations allemandes à venir. L’exploitation, fut, à vrai dire, méticuleusement montée : 300 scieries et une fabrique de conserves de viande qu’alimentait une compagnie de chasseurs. En 1919, quand je visitais ces contrées, la forêt n’avait pas l’air d’avoir trop souffert de cette exploitation ; les Allemands sont méthodiques même dans leurs déprédations et le gibier chassé de la forêt était très abondant dans les bois d’alentour. Il restait, d’après les dires du garde chef polonais, de 20 à 30 bisons. Ils allaient presque disparaître pendant l’offensive russe de 1920. Cette splendide forêt est entourée d’une ceinture de marais, d’une largeur de 200 kilomètres et d’une longueur de 500 à 600, partant de Brest-Litowsk dans la direction de l’Est et du Nord-est. C’est un plateau central dont les eaux sont en partie drainées sur le Bug et la Vistule par le canal Oginski, et l’autre partie sur le Dnieper et la mer Noire par le Pripet, long ruban d’eau de 800 kilomètres. C’est le paradis de la faune aquatique où croît la meilleure nourriture des canards, la « manne » de Pologne. Il faut avoir vu à la fin du jour, en août, ce tourbillonnement de canards allant en tous sens le long de la ligne Brest-Antopol-Pinsk, pour se faire une idée de la densité du gibier d’eau dans ces parages. Ce qui le retient aussi, c’est la surabondance de poissons qui est une des nourritures principales de l’autochtone. Le moindre ruisselet de 50 centimètres de large sert aux ébats des brochets que l’on pêche au trou d’air avec une pelle à manier le grain. On en fait de grandes provisions en hiver, soit fumés, soit en conserve. Quant aux anguilles, très abondantes aussi, on va les chercher lorsqu’elles hivernent en paquets sous la couche de glace des mares peu profondes. Voilà passées rapidement en revue les possibilités de chasse qu’offrait ce beau pays en 1919. Les moyens de communication étaient parfois précaires, et il fallait souvent faire de grands détours, pour aborder certaines contrées. Dans la partie orientale en particulier, 50 à 100 kilomètres en voiture ou en traîneau étaient chose courante, mais on était bien payé de ses peines. Colonel P. P.(1) Voir numéro de décembre 1939. |
|
|
Le Chasseur Français N°596 Février 1940 Page 73 |
|