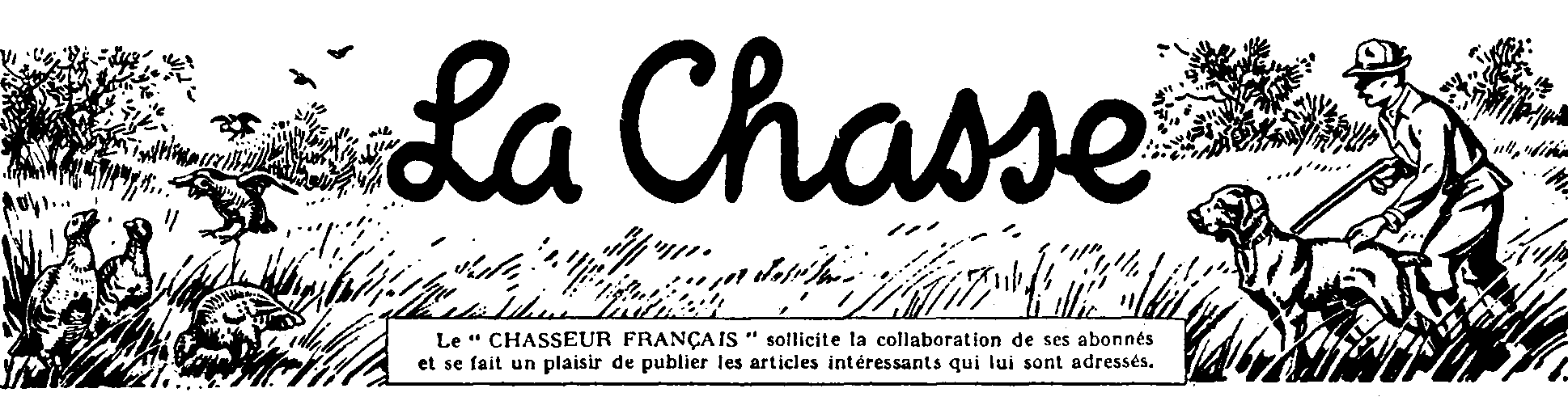| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°598 Avril 1940 > Page 195 | Tous droits réservés |

|
Toujours les mouettes |

|
et autres oiseaux.
|
Dans notre dernier numéro, j’ai dit que la question de la familiarité des mouettes passionne beaucoup nos amis les Anglais, et aussi maintenant bien des Français. J’aurais beaucoup à ajouter à ce que j’ai écrit sur ces charmants oiseaux : mais je veux dire seulement aujourd’hui que les habitants d’un petit port sont à même d’apprécier tous les jours la justesse de mes observations. En effet, il y a, dans ce port de mer, des détachements de militaires anglais qui ont à leur service un certain nombre d’autocars pour leurs déplacements. Ils rentrent en ville pour prendre leurs repas à la fin de la matinée, mais ils n’oublient pas celui de leurs voisines les mouettes et, chaque jour, ils partent en autocars, souvent nombreux, et se rendent sur une digue auprès de la mer pour porter aux mouettes des environs les restes de leur déjeuner. Et les mouettes accourent prendre aux mains de leurs amis, assis dans leurs autos, tout ce qu’on leur offre de si bon cœur ! J’ai dit que je parlerais aussi des goélands dont la familiarité diffère peu de celle des mouettes quand ils se savent en sécurité. Si j’ai eu en captivité pas mal de mouettes devenues mes hôtesses très familières, j’ai eu aussi quelques goélands. Je me souviens de l’un d’eux particulièrement. Il était chez lui à la cuisine, venait faire un tour à notre table dans la salle à manger à l’heure des repas, puis l’après-midi, quand il faisait froid, il allait tranquillement dans la chambre de ma sœur, de plain-pied avec le jardin, se coucher sur le tapis devant le feu. Il était chez lui partout, et toujours dans la maison il était très propre, ce qui pourra sembler extraordinaire. Il a vécu longtemps, mais a eu une triste fin qui pourrait passer pour assez drôle, si je ne l’avais regretté comme on peut regretter un chien fidèle. Mon jardin surplombait un autre jardin en contre-bas. Or, quand il faisait beau, mon goéland avait coutume d’aller prendre un bain de soleil couché sur un petit mur séparant les deux propriétés. Un jour, pour je ne sais quelle raison, il tomba du haut de ce mur dans le jardin voisin. C’est là que l’affaire se corse. Ce jardin dépendait d’un immeuble habité par deux personnages importants : l’un un littérateur de talent, l’autre son ami, bien connu aussi en ce temps dans le monde aristocratique. Mais tous deux absolument ruinés au point de ne pas toujours manger à leur faim. Ils ne se firent aucun scrupule de s’emparer de mon malheureux goéland, de le tuer, de le faire rôtir et de s’en régaler, ce qui prouve qu’ils n’étaient pas difficiles, car les goélands, j’en ai goûté parfois, quand ils sont à l’état sauvage, sont un triste morceau à se mettre sous la dent, et doivent être à peu près immangeables quand ils ont vécu en captivité. J’ai pardonné à mes voisins en raison de leur situation. Dans la même propriété, et dans une autre que j’ai habitée depuis, j’ai eu une autre, j’allais dire amie, qui portait un nom charmant illustré dans une des fables de La Fontaine. Elle se nommait Perrette. C’était une oie tout simplement, mais issue d’une oie domestique et d’un jars sauvage. Elle m’avait été donnée toute jeune. J’ai eu longtemps Perrette chez moi, peut-être encore plus familière que mon goéland. Comme lui, elle était chez elle dans ma maison, déjeunant souvent avec nous et visitant toutes les chambres, même celles des étages supérieurs. Elle vivait de plus en pleine liberté, dans mon grand verger traversé par une petite rivière, chère à mes canards appelants, très familiers aussi, et avec lesquels elle faisait très bon ménage. Mais ce qui caractérisait Perrette, c’est qu’elle se comportait avec moi et avec les miens absolument comme un chien. Fût-elle très éloignée dans le verger, elle accourait au moindre appel, puis nous accompagnait partout. Quand ma sœur et une de nos cousines, en été, allaient s’asseoir au milieu du verger auprès de la rivière, Perrette arrivait aussitôt, puis se couchait à leurs pieds, comme aurait pu faire un chien, attendait qu’elles se déplacent et elle les suivait partout, même sur la route voisine quand elles allaient s’y promener. Perrette a terminé ses jours en paix. Ayant dû quitter ma propriété, je n’ai pu l’emmener avec moi en ville. Un de mes cousins, qui possédait une grande propriété où il existait deux étangs peuplés surtout de canards à moitié sauvages et de quelques oies domestiques me la demanda, et je la lui confiai volontiers : c’est en ce paradis des oiseaux d’eau qu’elle a terminé ses jours à vingt-trois ans, âge raisonnable pour une oie. Elle avait à sa disposition une petite île où se trouvait un petit bâtiment dont elle avait fait son logis. Cependant elle avait couvé une année dans les couverts des bords de l’étang. Tout cela, ce sont de vieux souvenirs que j’aime encore à évoquer comme ceux d’un temps heureux. Louis TERNIER. |
|
|
Le Chasseur Français N°598 Avril 1940 Page 195 |
|