| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°599 Mai 1940 > Page 261 | Tous droits réservés |

|
La chasse au chien courant |

|
Le sanglier (1).
|
Mais je leur ai vu prendre de nombreux cochons. Deux maintenant chassent avec le Grand Saint Hubert ! ... L’autre chasse ses souvenirs, ce qui ne vaut guère mieux ... Quoi qu’il en soit, même avec nos anglo-français modernes — qui sont, on peut le dire, des chiens à vitesse prolongée, capables de prendre bien plus rapidement que les races de l’Ancienne Vénerie — un seul relais est nécessaire. Il est généralement assez facile à donner : les sangliers venant presque toujours se faire battre dans les endroits les plus fourrés des forêts, c’est là où il faudra placer les hardes. Par exemple, il sera prudent de ne découpler que seulement après que l’animal de meute aura vidé ces enceintes où il est bien capable de faire remuer du change. Il est plus facile de prendre un quartanier ou un grand solitaire qu’un tiers-an ou une petite laie ragote : cela n’a rien d’étonnant, un jeune chien court mieux qu’un vieux et un jeune gars de dix-huit ans est plus agile qu’un homme frisant la cinquantaine. Rien n’est comparable à l’attaque d’un sanglier par une trentaine de chiens de vautrait ; découplés sur une bonne brisée, ils sont partis en trombe, bondissant les uns par-dessus les autres, se bousculant pour mieux goûter la voie ; puis les rapprocheurs, les vrais ténors, ceux dont tous les autres reconnaissent la supériorité, ont pris le commandement ; tout cela file sous bois, dans le concert des récris et des voix hautaines que soutient la trompe du piqueux. Les veneurs, s’ils le peuvent, trottent aussi sous futaies : « Au coûte à Vagabond ! Perce, les valets ! Perce ! » Et Vagabond, et Homard, et Francœur, Hélice, Hirondelle, Gerfaut, Giboulée, emmènent la voie en criant à pleine gorge. Soudain tous s’arrêtent ; ce vieux routier de Vagabond et Broussaille aboient leur goret à la bauge ; mais il déboule, le poil hérissé, avec tout le vautrait à ses trousses, avec ces récris furieux et frénétiques que l’on n’entend qu’à un lancer de sanglier : « Wlôô ! Vlôô ! » Au galop, debout sur les étriers, un des veneurs galope à sa suite ; les trompes éclatent de la joyeuse fanfare du sanglier, c’est lancé ! Ah ! le beau moment et quels souvenirs cela nous rappelle ! Les vieux amis, les bons chiens, les rudes chevaux qui galopaient, comme disait la fanfare, « au plus fort des halliers » ! Si quelques-uns lisent ces lignes, même au delà des mers lointaines, qu’ils se redisent, comme cette héroïne romantique : « Allons, le bon temps reviendra ! ... » Il importe encore plus à la chasse du sanglier qu’aux autres, que le début du courre soit mené à plein train ; pour cela, il faut suivre de très près la meute ; je sais bien que ce conseil est plus facile à donner qu’à suivre ; mais le piqueux devra se tenir en queue des chiens pour les soutenir et les exciter de la voix et de la trompe : c’est très important. Le sanglier ne ruse pas ; l’odeur forte qu’il dégage, surtout quand il est échauffé, permet facilement aux chiens de suivre sa voie. La seule difficulté est le change et, comme nous le disions, ce sont les chiens seulement qui seront capables d’y apporter remède. Vouloir reconnaître par corps un sanglier au cours d’une chasse est œuvre de novice. Il change d’aspect à plaisir ! Vous l’avez vu à l’attaque franchir une route, sur une crête, parmi des herbes blanches : il vous a paru énorme, hérissé et noir comme du jais. Une heure après, vous l’apercevez dans un fond de coteau se faufilant dans des genêts : il a diminué de moitié et vous semble tout gris, c’est pourtant le même animal. Souillé de boue, il devient jaune ou marron ; bref, il ne faut pas, à cette chasse-là plus qu’aux autres, se fier à ses yeux, mais bien à ses chiens, car — et nous ne le répéterons jamais assez — le fond de la chasse c’est le chien, il en est l’alpha et l’oméga, et le bon veneur est celui qui sait le comprendre et s’en servir. Parfois un sanglier ira battre l’eau, non comme un cerf ni un chevreuil, mais il coupera fort bien un étang ou une rivière. Ceci n’apporte pas de grandes difficultés. On reconnaît qu’un sanglier est malmené lorsque, s’arrêtant de percer, il se fait battre au fourré. Ceci, toutefois, n’est pas une indication formelle ; certains sangliers, au contraire, quand ils ont quelque répit, bricolent ainsi dans les grands forts ; cette manœuvre leur permet d’augmenter leur avance ; nous l’avons vu bien des fois. Mais notre animal court depuis quatre heures, nous lui avons découplé, fort bien, notre relais, et le voici qu’il se fait battre, cherchant un lieu propice pour tenir le ferme. Généralement, c’est un mauvais endroit pour nous, quelques fourrés bien épineux où les chiens ont peine à se mouvoir et ne peuvent attaquer qu’un à un ; c’est ainsi qu’a lieu la grande casse, et le veneur doit y mettre fin au plus vite, à coup de carabine le plus souvent. Certains vautraits découplaient à ce moment-là des mâtins, des terriers ou des dogues destinés à coiffer la bête-noire ou à l’obliger de détaler. Ce système nécessitait une camionnette qui transportait ces auxiliaires de la fin : était-ce bien nécessaire ? La chasse du sanglier doit-elle comporter absolument cette boucherie de chiens qu’exige un hallali prolongé avec un goret qui ne veut pas s’avouer vaincu ? Pour notre part, nous ne le croyons pas ; si un sanglier fait tête en un endroit où tous les chiens du vautrait peuvent l’aboyer, on le sert au couteau ; si le lieu est vraiment difficile, on le finit au fusil, il n’y a pas de déshonneur à cela, et il vaut mieux découpler fusilio que faire découdre ses meilleurs chiens ; surtout si l’on n’est point un « nabab » qui achète — sans compter — ses remontes en France et en Angleterre. Pourtant l’usage de ces mâtins, roquets, bulls-terriers ou airedales, peut rendre des services à l’attaque avec un sanglier qui fait tête et refuse de partir ; eux se chargeront de le faire décamper et épargneront la vie des chiens courants, dont on n’est jamais assez ménager. Certains sangliers sur leurs fins semblent hébétés et s’en vont trottinant, la tête basse, en une sorte de ferme roulant qui n’en finit plus ; le mieux alors est de les servir au fusil ; sans cela la nuit arrivera, et vous laisserez vos meilleurs chiens dans les bois, aux trousses de leur animal qu’ils ne veulent pas abandonner. D’autres s’acculent franchement à un obstacle quelconque, stères de bois, rochers, fourré d’épines, etc., et là font tête, chargeant furieusement les chiens qui les serrent de trop près. Certains tiennent en plein fourré : ce ne sont pas les plus faciles à servir, comme nous l’avons déjà vu. Avec des chiens mordants, nombreux et braves, il est relativement aisé de servir un sanglier au couteau ; avec quelques chiens mous et hésitants, c’est une imprudence, et le chasseur risquerait d’y récolter quelque stupide blessure sans amener la conclusion cherchée. Le sanglier mort, le piqueux lève la trace droite qu’il tresse pour la présenter à la personne à qui le maître d’équipage fait les honneurs. Certains chiens répugnent à faire curée et ne veulent point toucher à la chair du sanglier ; c’est pourtant un excellent moyen de les confirmer dans la voie des bêtes noires, en leur donnant confiance, le chien étant trop intelligent pour s’épouvanter d’un animal qui est susceptible de lui fournir un substantiel repas. En faisant cuire la viande, c’est assez facile de leur faire manger ; mais, ainsi, elle manque de saveur et de haut goût de carnage, ce qui lui fait perdre de ses vertus éducatives. Pour forcer les chiens à faire curée, on les prépare à cette venaison par un jeûne un peu prolongé et jusqu’à ce qu’ils se décident à en manger ; du reste, il n’y a que le premier pas qui coûte. Guy HUBLOT.(1) Voir numéros de Mars et Avril 1940. |
|
|
Le Chasseur Français N°599 Mai 1940 Page 261 |
|
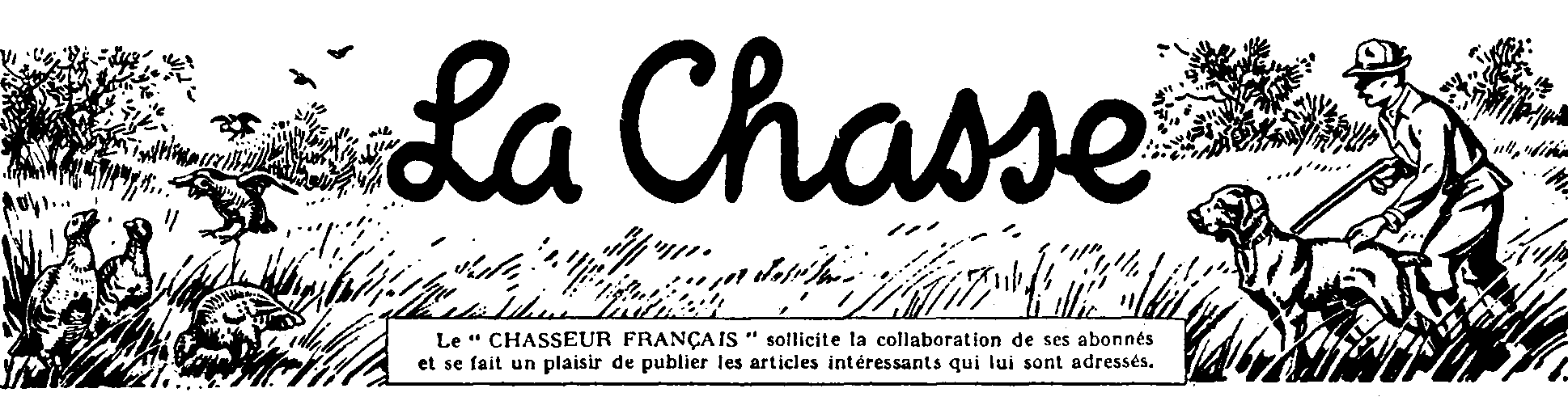
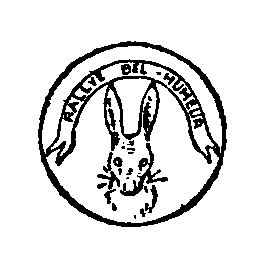
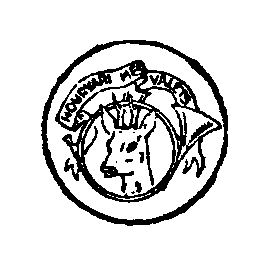 Il est permis de donner un relais à cette chasse-là ;
même à vue, découplant bas et roide, quitte à reprendre les chiens de meute
pour les faire rallier par la suite. J’ai connu trois veneurs qui, il y a déjà
bien longtemps, malmenaient les cochons d’une drôle de manière ; deux
chassaient à cheval, le fusil à la botte, mais aussi la trompe au col, car ils
s’en servaient davantage ; le troisième suivait en auto, dans une vieille
conduite intérieure qui bravait la mode mais dont le moteur — de gros alésage
— avait gardé sa jeunesse. Ces trois fanatiques ne découplaient qu’une
dizaine de chiens, anglo-français, croisement de briquets et de chiens d’ordre,
ou de griffons et de foxhound. Chassant comme des furieux, cela n’allait jamais
assez vite ; les cavaliers appuyaient les — ou le — chiens de
tête, indiquant, grâce à un code à eux (coups de langue à la suite du
bien-aller), la direction de la chasse au confrère motorisé. Celui-ci, qui
connaissait la forêt comme ses poches, était à tous les passages ; il
rattrapait les traînards, les mettait dans la voiture et quatre ou cinq
enceintes plus loin les découplait aux trousses du goret ; il véhiculait
ensuite les chiens qu’il venait d’arrêter, pour les redonner à leur tour
quarante ou cinquante minutes plus tard. Ainsi, ayant presque toujours sur le
dos des chiens frais, les malheureux sangliers en voyaient de rudes, surtout
que les deux cavaliers qui fonçaient, leur fond de culotte à vingt centimètres
de leur selle, étaient là pour tayauter des bien-aller, toujours la trompe aux
lèvres. Ces trois phénomènes arrivaient ainsi à prendre des sangliers qu’ils
servaient au fusil — c’est entendu — mais ceci pour ménager leurs
chiens, car leurs moyens financiers n’auraient pas pu résister à trop de
casse ; et puis un « vautrait » de dix chiens ne peut pas se
permettre de ces fantaisies-là ...
Il est permis de donner un relais à cette chasse-là ;
même à vue, découplant bas et roide, quitte à reprendre les chiens de meute
pour les faire rallier par la suite. J’ai connu trois veneurs qui, il y a déjà
bien longtemps, malmenaient les cochons d’une drôle de manière ; deux
chassaient à cheval, le fusil à la botte, mais aussi la trompe au col, car ils
s’en servaient davantage ; le troisième suivait en auto, dans une vieille
conduite intérieure qui bravait la mode mais dont le moteur — de gros alésage
— avait gardé sa jeunesse. Ces trois fanatiques ne découplaient qu’une
dizaine de chiens, anglo-français, croisement de briquets et de chiens d’ordre,
ou de griffons et de foxhound. Chassant comme des furieux, cela n’allait jamais
assez vite ; les cavaliers appuyaient les — ou le — chiens de
tête, indiquant, grâce à un code à eux (coups de langue à la suite du
bien-aller), la direction de la chasse au confrère motorisé. Celui-ci, qui
connaissait la forêt comme ses poches, était à tous les passages ; il
rattrapait les traînards, les mettait dans la voiture et quatre ou cinq
enceintes plus loin les découplait aux trousses du goret ; il véhiculait
ensuite les chiens qu’il venait d’arrêter, pour les redonner à leur tour
quarante ou cinquante minutes plus tard. Ainsi, ayant presque toujours sur le
dos des chiens frais, les malheureux sangliers en voyaient de rudes, surtout
que les deux cavaliers qui fonçaient, leur fond de culotte à vingt centimètres
de leur selle, étaient là pour tayauter des bien-aller, toujours la trompe aux
lèvres. Ces trois phénomènes arrivaient ainsi à prendre des sangliers qu’ils
servaient au fusil — c’est entendu — mais ceci pour ménager leurs
chiens, car leurs moyens financiers n’auraient pas pu résister à trop de
casse ; et puis un « vautrait » de dix chiens ne peut pas se
permettre de ces fantaisies-là ...