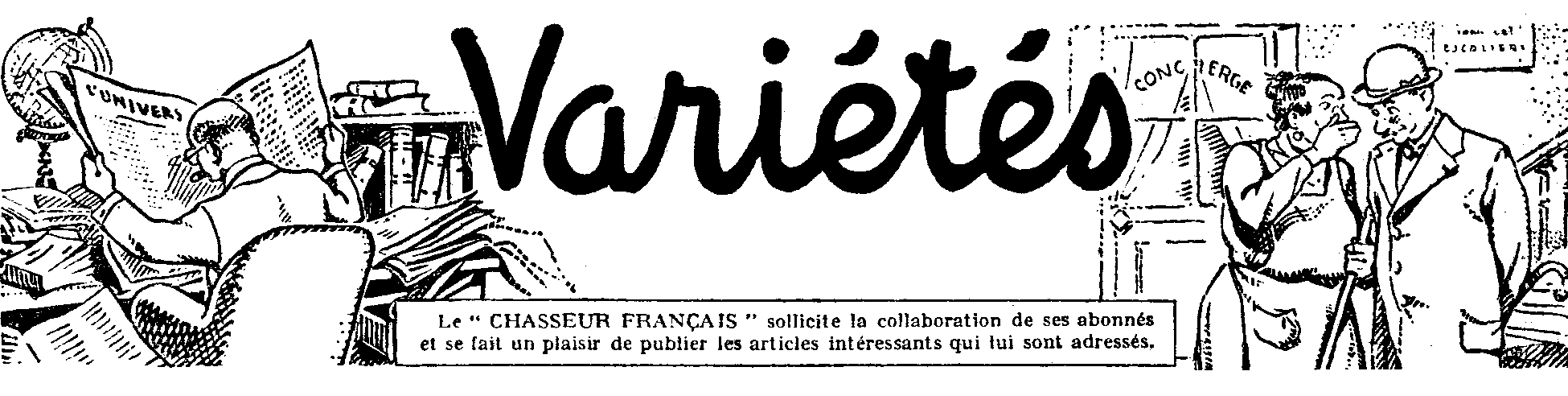| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°600 Juin 1940 > Page 382 | Tous droits réservés |
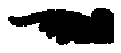
|
Cinéma d’amateur |
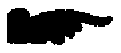
|
Quel format choisir ?
|
Le film standard, utilisé dans l’industrie cinématographique et dans l’exploitation des salles publiques, a une largeur de 35 millimètres, et les images ordinaires de ce film ont une dimension de 18 x 24 millimètres (pour le film « muet »). Les films adoptés par les amateurs ou les semi-professionnels, pour la prise de vues, et plus encore pour la projection, sont plus étroits, d’où leur nom de films étroits ou de films réduits. On peut ainsi employer le film de 16 millimètres, c’est-à-dire de 16 millimètres de largeur, le 8 millimètres, qui est en réalité un film de 16 millimètres coupé en deux suivant l’axe, et, enfin, le film 9mm,5 spécialement utilisé en Europe, et surtout en France. Cette division des formats n’a rien d’anormal ; il existe bien de nombreux formats en photographie, et il y a des modèles de 9 x 12 centimètres, ou plutôt de 6 x 9 cm représentent désormais les appareils de grand format, et des modèles de 6 x 6 centimètres, de 4 x 4, ou de 24 x 36 millimètres qui constituent les appareils de petit format. En cinématographie, le 16 millimètres, de même, est le grand format ; les petits formats sont le 9mm,5 et le 8 millimètres. Plus la largeur du film est grande, plus les dimensions des images à enregistrer sur sa surface sont importantes, et moins le film compte évidemment d’images distinctes, pour une même longueur, puisque la hauteur de chaque image est plus grande. Les images portées sur le film servent ensuite à la projection, mais la cadence de projection, c’est-à-dire le nombre d’images projetées par seconde, est la même pour tous les formats. Il y a évidemment intérêt, au point de vue de l’économie, à obtenir la plus longue durée de projection, avec le minimum de longueur de film ; c’est là une raison pour choisir le format le plus réduit, si l’on cherche l’économie. Plus le film est réduit, d’autre part, plus les appareils correspondants, de prise de vues et de projection, sont eux-mêmes réduits, et, par suite, moins coûteux et plus faciles à employer. Le film de 16 millimètres porte une image de 7mm,8 x 10mm,5 ; le film de 9mm,5, une image de 6mm,5 x 8mm,5 ; et enfin, le film de 8 millimètres, une image de 3mm,7 x 5 millimètres. Mais il ne suffit pas de comparer les largeurs du film et les formats des images, si l’on veut effectuer une étude comparative exacte des trois formats. Lorsqu’on examine une bande de film, on remarque sur cette bande des perforations de petites dimensions, de formes approximativement rectangulaires ; ces perforations sont disposées à droite et à gauche des images, pour le film de 16 millimètres, sur un côté seulement pour le film de 8 millimètres, et, suivant l’axe, pour le film de 9mm,5. À quoi servent ces perforations ? Pour obtenir la projection cinématographique, le film doit se déplacer d’un mouvement saccadé mais régulier, dans l’appareil de prise de vues, comme dans le projecteur, à l’aide d’un mécanisme autrefois actionné à la main, mais qui est maintenant automatique, et mis en action par un moteur à ressort ou électrique. L’entraînement ne peut se faire par pression, car on risquerait de détériorer les images placées à la surface du film ; les perforations permettent aisément cet entraînement, à l’aide de dents et de griffes mobiles venant engrener dans les ouvertures. Les perforations sur le film de 16 millimètres occupent une certaine surface, à droite et à gauche des images, ce qui restreint la surface disponible pour les images elles-mêmes. Dans le film de 8 millimètres, les perforations ne se trouvent que d’un seul côté ; la surface du film occupée est donc plus faible, et une plus grande partie du film peut servir efficacement à porter les images. L’entraînement ne s’effectue que d’un côté ; mais le procédé n’a pas d’inconvénient pratique, et la régularité du mouvement demeure satisfaisante. Dans le 9mm,5, les perforations sont disposées suivant l’axe du film, de telle sorte qu’elles ne réduisent pas la surface disponible des images, et seulement très peu la hauteur de celles-ci. Pour le film de 16 millimètres, la surface d’une image est de 80 millimètres carrés : la surface totale du film correspondante étant de 122 millimètres carrés, le coefficient d’utilisation, ou rapport de la surface des images à la surface totale du film, est de 0,65. Pour le film de 8 millimètres, la surface d’une image est de 18mm2,5, la surface de film correspondante de 30mm2,5, et le coefficient d’utilisation de 0,60. Pour le 9mm,5, enfin, la surface d’une image est de 55mm2,2, la surface de film correspondante est de 71mm2,6 et le coefficient d’utilisation de 0,77. C’est donc ce film qui présente le plus grand coefficient d’utilisation, et qui peut être considéré comme le format le plus économique du monde. Malheureusement, cette disposition des perforations suivant l’axe du film et dans l’intervalle horizontal des images, peut présenter parfois quelques inconvénients pour la régularité de l’entraînement et offre surtout des dangers de rayures très gênantes de la surface de l’image, si l’on n’a pas à sa disposition une caméra et un projecteur parfaitement étudiés au point de vue mécanique et soigneusement entretenus. Notons encore qu’il est un format plutôt destiné au semi-professionnel, et à la petite exploitation qu’aux amateurs, mais encore très employé pour la projection en France, le 17mm,5, réalisé en coupant de moitié un film de 35 millimètres, et dont l’entraînement est assuré par des perforations latérales. Le format de l’image du film muet est de 9 x 13 millimètres. Le film le plus réduit et de meilleur rendement, le 9mm,5, est ainsi le plus économique ; pour ceux qui craignent les inconvénients des perforations centrales, le 8 millimètres, format le plus récent, d’origine américaine, constitue, par excellence, le format d’amateur. Mais ce film très réduit porte des images vraiment minuscules, de surface quatre fois inférieure, évidemment, à celle du 16 millimètres ; cette réduction des dimensions de l’image n’offre-t-elle pas de graves inconvénients ? Malgré les progrès des émulsions, des appareils de prise de vues et des projections, des procédés de développement et de tirage, on ne peut tout de même obtenir avec une image aussi réduite une projection de surface aussi grande qu’avec un film de 16 millimètres, ou un film standard ; le grossissement nécessaire serait tel qu’il ferait apparaître les moindres défauts, et même le « grain » de l’image, et nécessiterait des procédés de refroidissement complexes, pour éviter la détérioration du film. Avec un film de 8 millimètres, il faut donc normalement se contenter d’une largeur d’écran de l’ordre de 1 mètre ; c’est très suffisant pour la projection d’amateur normale, et cela ne pourrait être gênant que pour des grandes salles, pour l’enseignement, la documentation, la petite exploitation, dans les écoles, les patronages, les foyers du soldat, les cantonnements, dans ces multiples installations, si nombreuses aujourd’hui. Pour augmenter la surface de la projection, obtenir des images de 2 à 4 mètres de base, il faut alors avoir recours, d’abord au 9mm,5 puis au 16 millimètres, à défaut du 17mm,5. Le 16 millimètres paraît actuellement le format idéal, aussi bien pour la projection que pour la prise de vues, et ne présente qu’un seul inconvénient : son prix élevé, particulièrement sensible lorsqu’on effectue des prises de vues. Il n’y a pas que les dimensions de la projection qui soient limitées, en principe, par l’adoption, d’un film de format très réduit ; il y a aussi plus ou moins le sujet des images choisies, surtout à l’enregistrement. Si la largeur et la surface des images sont très réduites, il devient moins facile d’y faire figurer, d’une façon agréable, des vues très larges et très détaillées de paysages, des monuments, des panoramas, des foules, comportant un grand nombre de personnages ; les meilleurs résultats sont obtenus avec des gros plans de portraits en buste ou en pied et la difficulté provient essentiellement de la réduction de l’image projetée. Ceci ne signifie pas que l’adoption d’un film très réduit, comme le 8 millimètres, limite exclusivement le champ des possibilités du cinéaste, mais simplement que les dimensions de la projection, pour obtenir des résultats vraiment agréables et artistiques, doivent être adaptées au format même du film, si l’on ne veut pas, en voulant toujours améliorer le résultat final, diminuer réellement la qualité des résultats obtenus. En résumé, et d’après ces indications, quel format faut-il choisir ? Si l’on a les moyens suffisants, tant pour l’achat des appareils de prises de vues et de projection que pour celui des films, aucune hésitation ne paraît possible. Le 16 millimètres, dont il existe des émulsions variées et remarquables, aussi bien en noir qu’en couleurs, constitue un véritable format universel substandard, se prêtant à la représentation de tous les sujets. Le prix élevé du 16 millimètres est moins gênant pour la projection seulement, lorsqu’on se contente de louer des films édités industriellement ; là encore, il offre toutes les possibilités, aussi bien pour constituer des programmes récréatifs, que pour l’enseignement et la documentation scientifiques. Mais, si l’on considère le problème de la prise de vues plus spécialement, et même, en général, celui de la projection pour l’amateur moyen, en ces temps difficiles, le facteur économique prend une importance qui n’est pas à négliger ; les prix des bobines de film vierge sont très élevés, et, malheureusement, il ne faut guère espérer des diminutions de prix. Aussi, l’amateur porte-t-il plutôt son attention vers un format économique, permettant d’utiliser avant tout un appareil de prise de vues très léger et très réduit, un projecteur extrêmement simple, et de faibles dimensions. Il porte donc ses préférences vers le 8 millimètres, qui constitue, à l’heure actuelle, le film idéal du débutant et de l’amateur moyen. Quant au 9mm,5, l’image qu’il porte est plus grande que celle du 8 millimètres, et presque aussi haute que celle du 16 millimètres, ce qui permet, en particulier, d’établir des projecteurs bi-films servant à volonté pour le 16 ou pour le 9mm,5 ; on peut certainement obtenir avec le 9mm,5 de bonnes projections, de surface relativement grande ; l’inconvénient réside, comme nous l’avons montré, dans l’entraînement par perforations centrales, qui exige de grandes précautions, pour la construction des dispositifs d’entraînement, et leur entretien. Les émulsions des films vierges, destinés à la prise de vues, sont également moins variées que pour le 8 millimètres, et il n’existe pas encore d’émulsions en couleur pratiques. Malgré tout, ce format conserve, avec raison, de nombreux partisans en France. P. HÉMARDINQUER,Ingénieur-conseil. |
|
|
Le Chasseur Français N°600 Juin 1940 Page 382 |
|