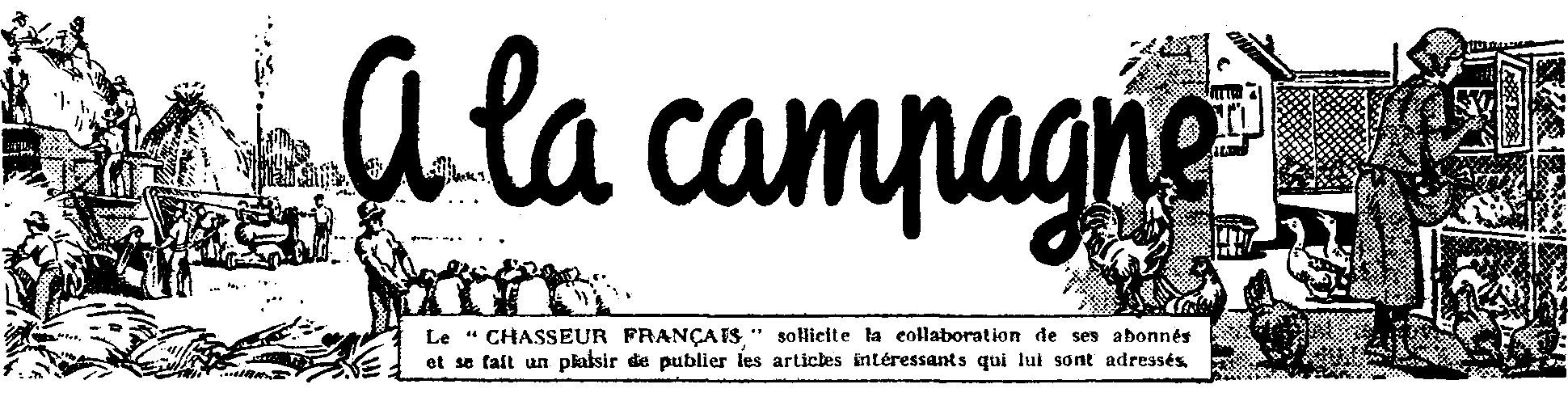| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°601 Septembre 1941 > Page 427 | Tous droits réservés |
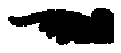
|
Apiculture |
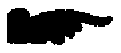
|
Répression de l’essaimage secondaire.
|
L’essaim subséquent « est volontaire et capricieux, dit Collin ; il rentrera et sortira peut-être plusieurs fois avant de se fixer quelque part. D’autres fois, il se jettera comme une tourbe indisciplinée dans une ruche étrangère ; ou bien, se jouant de tous vos efforts, il prendra un vol rapide et droit comme la balle pour aller je ne sais où dans une cheminée abandonnée, dans un trou de vieil arbre. Une autre fois, quoique rassemblé dans une ruche, il l’abandonnera quelques heures après pour retourner à la souche ou s’enfuir pour toujours ... » Souvent un essaim secondaire est assez fort pour faire une bonne ruche dans la saison ; mais il en est autrement de l’essaim tertiaire et quaternaire et de tout essaim subséquent à faible population, qui n’arrivera pas à faire ses provisions d’hiver et doit être rendu à sa souche. Cette restitution ne se fait pas le jour même de la sortie de l’essaim, car, le plus souvent, il sortirait de nouveau vingt-quatre heures plus tard, et, pour le recueillir, on aurait probablement plus de peine que la première fois. On remet l’opération au lendemain matin, ou même au lendemain soir. « Lorsqu’il y a un certain intervalle, dit Hamet, les jeunes reines se recherchent et se livrent combat, ou celle qui reste va détruire ses concurrentes au berceau et c’en est fait de l’essaimage. Quand la souche ne chante plus, il n’existe plus de reines au berceau ; les deux jeunes, celle de l’essaim et celle de la souche, se livrent combat et la mort de l’une ou de l’autre donne la paix à la famille ». Pour prévenir la diminution considérable des provisions qui résulte des sorties et des rentrées successives de l’essaim subséquent, pour s’épargner les soucis de sa mise en ruche, les praticiens ont recours à plusieurs expédients. 1° Dès la sortie de l’essaim primaire, enlever toutes les cellules maternelles, moins la plus belle. Si la colonie n’a pas encore commencé ces cellules, on attend une huitaine de jours pour faire l’opération, que l’on renouvelle huit jours plus tard. Ce procédé, dans la pratique, laisse beaucoup à désirer, car la cellule réservée peut ne pas éclore, et, par une erreur facile à commettre, surtout avec les ruches à rayons fixes, on en laissera peut-être plus d’une ; dans ce cas, un essaim subséquent pourra sortir au moment où on s’y attend le moins. Cette éventualité parait avoir échappé à M. Collin, qui, prévoyant le cas où la cellule réservée viendrait à ne pas éclore, conseille d’en réserver deux. 2° Mettre l’essaim primaire à la place de sa souche, et celle-ci à une place vacante du rucher. La perte de ses butineuses ralentit la récolte, diminue la chaleur intérieure dans la souche, qui ne pense plus à essaimer. 3° Mettre l’essaim primaire à la place de sa souche et celle-ci à une place disponible, et, quand les reines ne chantent plus dans la souche, lui rendre l’essaim, avec sa place primitive. 4° Rendre l’essaim à la souche et tuer ou enlever la reine. Au bout d’une semaine, chercher chaque soir à entendre le chant des reines. Dès que vous l’aurez entendu, retournez à la ruche le matin suivant et détruisez toutes les cellules royales. S’il vous arrive d’en oublier quelques-unes, il sortira un essaim que vous rendrez à la souche. 5° Introduire dans la souche de l’essaim primaire une poignée d’abeilles prise à un deuxième ou à un troisième essaim. Dans l’agitation qui en résultera, les gardiennes des cellules maternelles quitteront leur poste pour s’enquérir de ce qui se passe, et une des reines prisonnières sortira de sa cellule et ira tuer ses sœurs au berceau ; dès lors, il ne pourra plus y avoir d’essaimage. 6° Décapiter les faux-bourdons au berceau le jour même de la sortie de l’essaim primaire ou un peu plus tard l’un des deux jours suivants, si l’on n’a pu le faire ce jour-là. Ce procédé consiste à désoperculer avec un couteau bien aiguisé les cellules de mâles, de façon à leur découvrir la tête. Les cadavres seront ensuite trouvés dehors, car les abeilles les sortiront aussitôt. Ce massacre a le double avantage d’empêcher l’essaimage secondaire et de supprimer des bouches inutiles. 7° Dzierzon déclare que, dans la plupart des cas, l’essaimage secondaire se trouvera supprimé par l’introduction d’une jeune reine dans la souche qui a donné l’essaim primaire. Et il ajoute : l’introduction d’une jeune reine ou d’une cellule royale dans une ruche dont on enlève la mère a pour effet d’empêcher tout nouvel essaimage, mais seulement chez les colonies faibles ou chez celles, qui, après avoir été fortes, ont été affaiblies. Chez les ruchées fortes, au contraire, l’essaimage se trouverait ainsi provoqué. 8° Placer la souche essaimée en chapiteau sur la ruche de l’essaim primaire. On commence par mettre l’essaim sur le siège de la souche et celle-ci tout à côté. Au bout d’une semaine, on place la souche au-dessus de l’essaim, sans communication entre les deux colonies. Deux semaines plus tard encore, ou trois semaines après la sortie de l’essaim, on retire les cadres de la ruche supérieure et on en brosse les abeilles devant l’essaim. On utilise ensuite à son gré les rayons brossés. Les abeilles disposeront de l’une des reines à leur choix, et on aura ainsi une forte colonie sans augmenter le rucher. 9° Faire perdre graduellement ses butineuses à la souche de l’essaim primaire. Une autre méthode, conseillée par le Dr Miller, consiste à placer l’essaim sur le siège de la souche et celle-ci tout à côté. Cette souche est déplacée plusieurs fois, de manière à ce que son entrée regarde différentes directions ; puis finalement on la porte ailleurs, en sorte que toutes ses butineuses vont rejoindre l’essaim. C’est la méthode, un peu simplifiée, qu’a adoptée James Heddon qui l’expose comme suit : l’essaim primaire prend la place de la souche. Celle-ci sera mise à côté en tournant son entrée vers le Nord, au lieu de l’Est vers lequel elle était orientée auparavant. Dès que la nouvelle colonie se sera mise au travail et aura bien remarqué son emplacement, c’est-à-dire au bout de deux jours, la souche sera remise parallèlement à l’essaim. Les deux colonies regarderont donc maintenant l’Est et se toucheront presque. Tout en reconnaissant chacune leur propre ruche, elles se trouveront par rapport aux autres colonies sur un seul et même emplacement. Deux ou trois jours avant la sortie possible d’un second essaim, soit le cinquième ou le sixième jour après le départ du premier, à une heure où les abeilles sont actives, on enlève la souche pour la porter ailleurs. La souche finit ainsi par perdre toutes ses butineuses qui vont renforcer l’essaim et la fièvre d’essaimage est coupée. La privation de ses butineuses pour la souche ne s’opère ainsi que graduellement, ce qui a une grande importance pour la santé du couvain. L’éclosion journalière des jeunes abeilles répare les pertes au fur et à mesure. On donne à l’essaim la hausse de la souche, et il constitue une colonie de rapport qui donnera presque autant que si la ruche n’avait pas été divisée. Le rucher se trouvera aussi par là-même accru d’une unité. Tels sont les principaux moyens auxquels on peut avoir recours pour la répression de l’essaimage secondaire. Pour notre compte, nous préférons le dernier, mais chacun choisira celui qui lui conviendra. P. PRIEUR. |
|
|
Le Chasseur Français N°601 Septembre 1941 Page 427 |
|