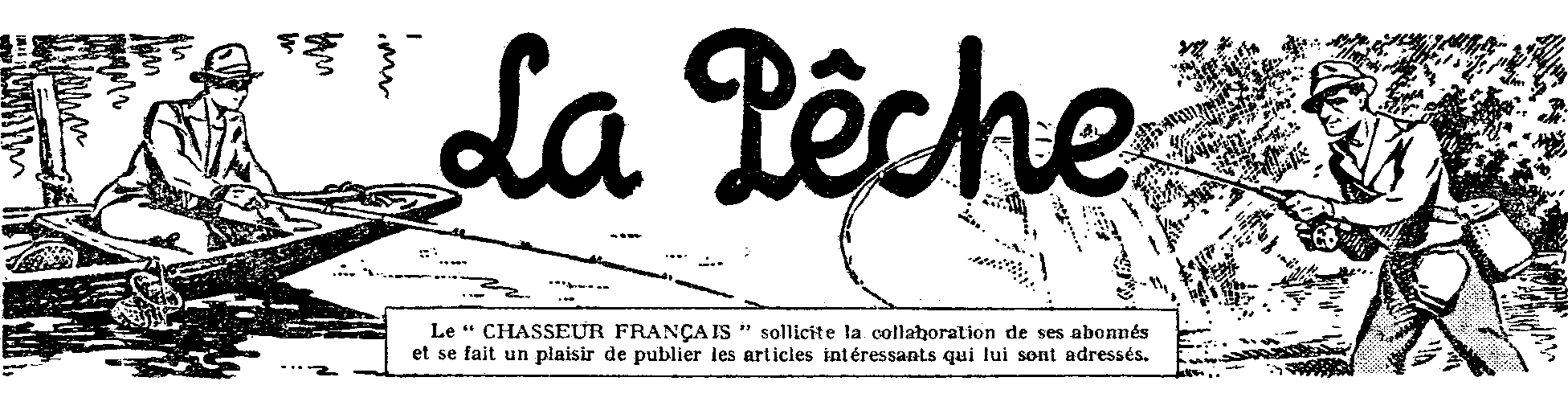| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°602 Octobre 1941 > Page 466 | Tous droits réservés |
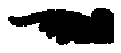
|
Le lancer léger |
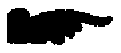
|
Le chevesne (1).
|
Je vous disais qu’en été, véritable saison de la pêche du chevesne, celui-ci fréquentait soit les parties les plus aérées de la rivière, c’est-à-dire les courants vifs, les chutes, les bouillons, soit les fosses profondes, si des ombrages surplombant en rafraîchissent les eaux. Par temps clair et calme, avec vent léger du secteur Sud à Ouest, ils aiment s’embusquer en surface, soit dans les courants, soit sous les buissons et arbrisseaux, attendant la chute des insectes. C’est par ces journées-là que le succès du lanceur léger est le plus probable. Par les jours frais et gris, avec vents du secteur Nord ou Est, les chevesnes cherchent plutôt leur nourriture dans les fonds, sur les coups amorcés, négligeant les insectes et autres animalcules. Dans ces conditions, on les prend plutôt à la ligne flottante qu’au lancer. J’ai déjà eu l’occasion de répondre à des lecteurs qui me posaient, avec quelques variantes, à peu près la question suivante : « Me conseillez-vous l’achat d’un équipement de lancer léger ? J’habite à X ... au bord d’une rivière qui ne contient ni brochet, ni perche, ni truite, mais où il y a beaucoup de chevesnes et de vandoises. La qualité de la chair du poisson m’est indifférente, je pêche pour le plaisir de la capture. Croyez-vous que je sois certain de prendre beaucoup de chevesnes ? Si oui, j’achète l’équipement. » Je leur ai toujours répondu, honnêtement, à peu près ceci : « Il est toujours utile de posséder l’équipement de lancer léger. Il serait bien extraordinaire que vous n’ayez pas dans vos environs un autre cours d’eau ou un étang où se rencontrent brochets et perches, ou un ruisseau à truites. Mais si réellement vous n’avez que du chevesne et de la vandoise, je ne puis vous affirmer avec certitude que vous voua amuserez avec ces seuls poissons. La vandoise ne mord au lancer qu’accidentellement. Le chevesne ? Je vous l’ai dit, il y a des eaux où on n’en prend presque jamais au spinning et d’autres où il ne mord que très capricieusement. Je sais bien qu’avec une canne à lancer léger et un « tambour fixe » on peut toujours pêcher à la petite plombée, soit à la cerise, soit au fromage, à la tripe de poulet, etc., suivant les saisons. Nous verrons cela bientôt. Mais voulez-vous acheter un équipement pour cela ? À vous de juger. Notez tout de même que, dans la plupart des rivières contenant du chevesne, on s’amuse beaucoup avec ce poisson, surtout dans les eaux claires et rapides. » Voilà ! Vous ne m’accuserez pas ensuite de vous avoir « mis dedans ». Pour en revenir au « comportement » (comme on dit à présent quand on veut suivre la mode) du chevesne suivant les saisons, disons que, dès les premiers froids, il gagne les fonds, les remous abrités, où l’eau est moins froide que dans les parties courantes de la rivière. Mais, loin de cesser de se nourrir comme la plupart des autres cyprinidés, il n’hiberne pas, il est sans cesse en quête de nourriture vivante ou morte. Cependant sa capture à la petite cuiller est alors très aléatoire. Il est devenu paresseux et ne se lance plus en pleine course sur les appâts rapides, comme en saison chaude. Il mord à la ligne flottante, surtout aux appâts organiques : sang caillé, tripe, moelle épinière de bœuf, hachures de boyaux de porc, etc. ... Mais aussi au vif. Et le pêcheur au lancer peut le capturer au poisson mort, soit tournant, soit dandiné. Mais ce n’est qu’une possibilité, non une certitude. S’attaquer uniquement au chevesne dans ces conditions serait vraiment très aléatoire. On le prend par accident, en pêchant la perche ou le brochet. Les appâts.— Lorsqu’on ne connaissait que le lancer « lourd », on prenait beaucoup moins de chevesnes qu’à présent, même dans les eaux où ce poisson est une victime désignée du « spinning ». Le problème me tracassait, lorsque je pêchais dans l’Ain, en eaux basses d’été, où la truite ne donnait guère par temps clair et eau limpide, tandis que les parties profondes contenaient de gros chevesnes de une à quatre livres, qui ne demandaient qu’à s’accrocher. J’en prenais d’ailleurs pas mal avec des devons de plomb que je fabriquais moi-même, car j’avais compris qu’il fallait des appâts les plus petits possible et tout de même assez lourds pour être lancés (il nous fallait environ 15 grammes ; c’était du lancer lourd léger). Cela allait dans ces gouffres de trois, quatre mètres de profondeur et davantage. Mais en eaux peu profondes, cela n’allait plus. On pouvait lancer des appâts de faible densité tels que poissons de bois, ou poissons morts peu plombés, qui s’enfonçaient peu, mais alors, pour avoir un poids suffisant, on était amené à employer des appâts trop grands qui ne tentaient le chevesne que rarement. (Il y a des exceptions, bien entendu. Tous ceux qui traînent des cuillers dans la Seine savent qu’on prend des chevesnes avec les plus grandes cuillers à brochets.) Je me disais alors souvent : si on pouvait lancer à distance suffisante des appâts tournants très petits, on prendrait beaucoup de chevesnes. La solution fut trouvée quand le lancer léger se répandit chez nous. Mais le principe reste toujours le même : plus l’appât sera petit, meilleur il sera, s’il s’agit de chevesnes. D’autre part, il devra posséder une densité suffisante, bien entendu, pour atteindre le poids nécessaire et être lancé loin, ce qui est nécessaire, le plus souvent, étant donnée la grande timidité du chevesne. Avec la gamme des cannes dont nous pouvons disposer, le poids minimum de l’appât peut aller de 1 à 8 ou 10 grammes. Il y a de la marge ! Le chevesne est très éclectique en ce qui concerne les appâts. Pourvu qu’il soit assez petit et se déplace lentement et irrégulièrement, n’importe quel appât de spinning, tournant, ondulant ou vacillant, artificiel ou naturel, rapporte le même nombre de captures d’un jour à l’autre. Un petit devon court, tournant bien, argenté pour l’eau un peu louche, bariolé pour l’eau claire, a toujours du succès. Le fameux Rublex de caoutchouc est certainement parmi les plus efficaces. Et il a le grand avantage d’être vendu par paires, l’un tournant à droite, l’autre à gauche, ça qui permet de changer d’appât lorsque la ligne commence à donner des signes de vrillage, dans un sens ou dans l’autre, afin de détordre le fil. Les petits « poissons nageurs » sont excellents aussi. Et également, bien entendu, les vairons frais ou conservés au formol, montés sur des montures à hélice ou sur des montures vacillantes, genre « Triel ». Mais étant donné que, pour le moment, le chevesne donne en général tout aussi bien sur la petite cuiller que sur n’importe quel autre appât, il n’y a, me semble-t-il, aucune raison pour lui servir autre chose, au moins en bonne saison, été et automne. Je mets à part les grosses mouches à hélice qui, nous le verrons, réussissent certains jours où la cuiller ne « donne pas ». Mais ce sont des appâts de l à 2 grammes, qui nécessitent la petits canne de 200 grammes. La cuiller plombée en tête, le plomb tout contre la palette, présente, semble-t-il, toutes les qualités demandées à un appât pour chevesne. Elle peut être à peu près aussi petite qu’on le veut et le plomb qui lui est adjoint lui donne le poids voulu pour jouer son rôle, suivant les divers emplacements. Ce rôle étant de tourner sans vitesse excessive, mais assez vite pour offrir au poisson une silhouette floue, indécise, qui lui permette d’imaginer quelque tête inconnue de lui (car je pense que c’est ce qui se passe dans la cervelle d’un poisson qui voit passer une cuiller et qui ne la prend ni pour un poisson, ni surtout, comme on nous l’a dit, pour une « coccinelle ... » !). Et aussi d’avoir juste le poids voulu pour pouvoir être manœuvrée le plus lentement possible, sans descendre assez bas pour s’accrocher. Ce qui dépend de la profondeur de l’eau, de la vitesse du courant et de la façon dont on pêche : en amont, en aval ou en travers. A. ANDRIEUX.(1) Voir no 601 de septembre 1941. |
|
|
Le Chasseur Français N°602 Octobre 1941 Page 466 |
|