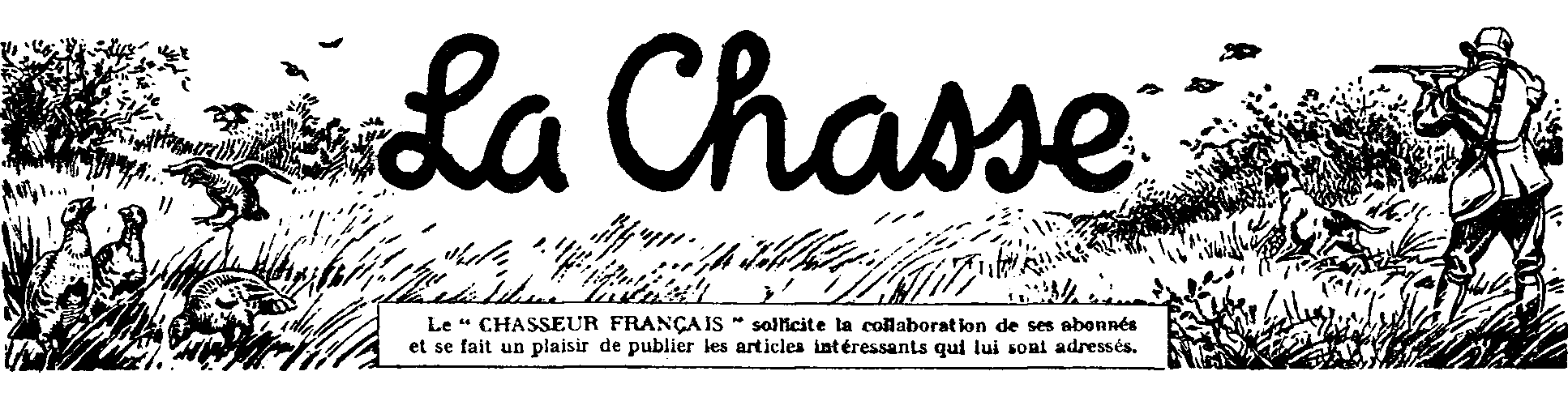| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°603 Novembre 1941 > Page 517 | Tous droits réservés |

|
Au fond de l’allée de l’étang |

|
|
Avec un peu de couleur et de l’eau, on ferait une jolie aquarelle, en prenant l’allée de l’étang, droite, percée en plein bois, à travers la masse des chênes et des pins, au sol élastique et doux, tapissé de gazon fin, vraie piste d’entraînement. On la peindrait au moment où le soleil, incliné, jette sa lumière atténuée, enveloppante, provoquant ces ombres sveltes, fines, allongées, si charmantes et donnant à tout comme un aspect intime de paix, de repos, après l’intense vie du jour. Tout est calme et recueillement. Mais c’est le propre habituel de l’étang que de jeter dans l’âme une pointe de mélancolie. On se rappelle les tas de légendes dont ses sites furent animés, peut-être quelques drames aussi. On voit cette eau calme, paisible, sommeillante, d’aspect inoffensif, et l’on se souvient d’enlisement, on devine la vase perfide ; on admire les jeux de lumière, des bleus, des irisements, et des tons tout à coup apparaissent louches comme de mystérieux ferments ; on hume de douces senteurs de menthe, — senteurs de joncs, — et l’on perçoit en même temps comme un frisson. Bref, l’on admire en se méfiant cette posée de l’étang, quand, débouchant d’un coin de bois, on voit la nappe unie tel un miroir, couleur d’acier, métallique comme des coulées de mercure, où se mirent les grands arbres mélancoliques ; son eau est dorée et comme lourde, tachée en maintes places par l’affleurement à la surface d’une lente décomposition, celle des plantes recelées dans les profondeurs. Les nénuphars de l’arrière-saison s’y étalent à profusion, à maints endroits, avec des airs de plateaux chinois ; sur l’un des bords, on devine tout un enchevêtrement d’herbes vigoureuses auxquelles, depuis longtemps, l’on n’a point touché — car il y a peut-être trois générations qu’on l’a laissé devenir sauvage, comme à l’abandon — et, au bord des masses de joncs, on voit se refléter dans la nappe solitaire les grands arbres de la rive, semblant dormir en quelque creux de vallon. Dans les méandres de la queue, quelques souches d’usage, et puis, près d’un gros chêne, un fort paquet de joncs. L’autre bord est net, comme une pièce d’eau de parc, dont le contour se dessine en une demi-ceinture de plage ; sous les pieds, c’est un sable fin, qui, dans l’eau limpide, descend par une pente insensible et donne envie de patauger. Et, isolé, un très gros vieux chêne, noueux, laid, mais bon, semble garder l’étang en ce paysage solitaire. La majesté du couchant rayonne sur toutes choses, tout se teint de pourpre et d’or.
Comme deux amis, on voyait deux soleils Venir au-devant l’un de l’autre. Une paix profonde est descendue sur la plaine. Peu à peu le ciel s éteint, la violence du couchant s’apaise, la pourpre s’atténue en des tons orangés qui pâlissent à leur tour, et, bientôt, il ne restera plus à l’horizon qu’une lueur plus claire au point où le soleil a disparu. Mais la vie n’est pas encore endormie sur l’étang. On y devine qu’un monde inconnu, jamais dérangé par les hommes, un univers mystérieux et grouillant, heureux dans sa liberté, pullule sous ces herbes, ces eaux limoneuses, ces vases assoupies. Il semble même que la venue du crépuscule ait éveillé là tout un monde qui n’attendait que l’obscurité pour se mettre en mouvement. Les carpes sont sorties de leurs retraites, elles montent à la surface de l’eau qu’elles trouent de leurs ébats ; on entend les « floc ! floc ! » des brochets, qui ont commencé la chasse pour leur repas du soir ; dans le hallier serré des joncs, les poules d’eau, rassurées par le calme complet, s’égayent en poussant de petits cris aigus. Tous ces bruits se mêlent et se fondent en une sorte d’harmonie, harmonie des sens, des murmures, harmonie des lumières, du ciel pâli, de l’étang qui s’obscurcit. Il s’en dégage un charme pénétrant. Mais voici un petit nuage noir qui se lève à l’horizon et s’avance vivement, et en sens inverse des flocons dorés éparpillés dans le ciel. Il s’avance en pointe vers l’étang, grossissant, s’allongeant toujours davantage et traçant des courbes qui le font ressembler à un immense serpent. Tantôt sa masse, opaque, s’abaisse vers le sol, tantôt elle se redresse vivement dans les airs. Dans un affreux tumulte et comme dans un souffle de tempête, avec des cris stridents, après avoir tournoyé deux ou trois fois en spirales, il s’abat tout à coup sur plusieurs arbres voisins. C’est une quantité innombrable d’étourneaux qui sont arrivés en tourbillonnant d’un mouvement uniforme, volant serrés les uns contre les autres. Maintenant chaque branche d’arbre est garnie d’autant d’oiseaux qu’elle en peut porter. Après quelques minutes de repos en colonnes, ils s’élancent, glissent en ondoyant sur la surface de l’étang et s’abattent sur les roseaux, qu’ils font plier sous leur poids. À peine installés, ils commencent des bavardages sans fin, criant tous à la fois et produisant un tintamarre formidable. Sans doute chacun raconte les aventures de la journée : combien de vermisseaux, de larves, de grillons, de sauterelles il a mangés, combien de grappes de raisin il a becquetées ; il indique les bons endroits, il débite quelques histoires plaisantes. Certainement, les choses se passent ainsi, car, de temps en temps, un piaillement général vient témoigner de la satisfaction unanime causée par les récits des loustics de la bande. Le lendemain, par la belle journée d’été, sous l’ardeur du soleil brûlant, la vie continue de plus belle. Les insectes vont, viennent, bourdonnent, tombent à la surface de l’eau, disparaissent dans un imperceptible remous, englobés par les poissons qui chassent. Des essaims de minuscules moucherons dansent en tourbillonnant dans les raies de lumière, des libellules aux couleurs variées et aux ailes transparentes planent au-dessus de l’eau et se posent légèrement sur la moindre brindille. Une poule d’eau, immobile, perchée sur un piquet qui sort de l’eau, avec son plumage noir, et le cachet blanc de sa tête, semble une merlette en blason tombée de l’écu d’un ancien chevalier. Plus loin, une mère, au milieu de sa petite famille, offre un touchant spectacle et forme un des plus gracieux tableaux. Les jeunes, semblables à de petites boules noires, nagent tout à leur aise, sans cependant trop s’éloigner de leur guide, et fendant l’eau avec une rapidité que l’on ne rencontre ordinairement que chez les gyrins ou tourniquets du bord des mares. Les fourrés de joncs retiennent la faune des passereaux chanteurs, composée de fauvettes riveraines, la Rousserole turdoïde, la Phragmite des joncs, dont le chant n’est pas mélodieux comme celui des fauvettes terrestres. Il se compose de plusieurs phrases très variées, composées de notes pleines et fortes, et est tout imprégné de saveur locale, dont les motifs et les discordances pivotent autour du vocable de la grenouille, ressemblant autant à un coassement qu’au chant d’un autre oiseau. Pas de note douce, ni flûtée, et toute la chanson n’est qu’une sorte de grognement Et, néanmoins, ces sons successifs ne sont pas trop désagréables, ils ont même quelque chose de gai, et il y a une certaine bonne humeur dans la façon dont ils sont lancés. Si on les compare au cri plus que discordant des espèces aquatiques, ils disposent certainement pour eux l’observateur à porter un jugement plus favorable. Pour mon compte, j’aime à entendre ce chant : il ne me ravit pas d’admiration, mais il me cause toujours un certain plaisir. R. VILLATE DES PRUGNES. |
|
|
Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 517 |
|