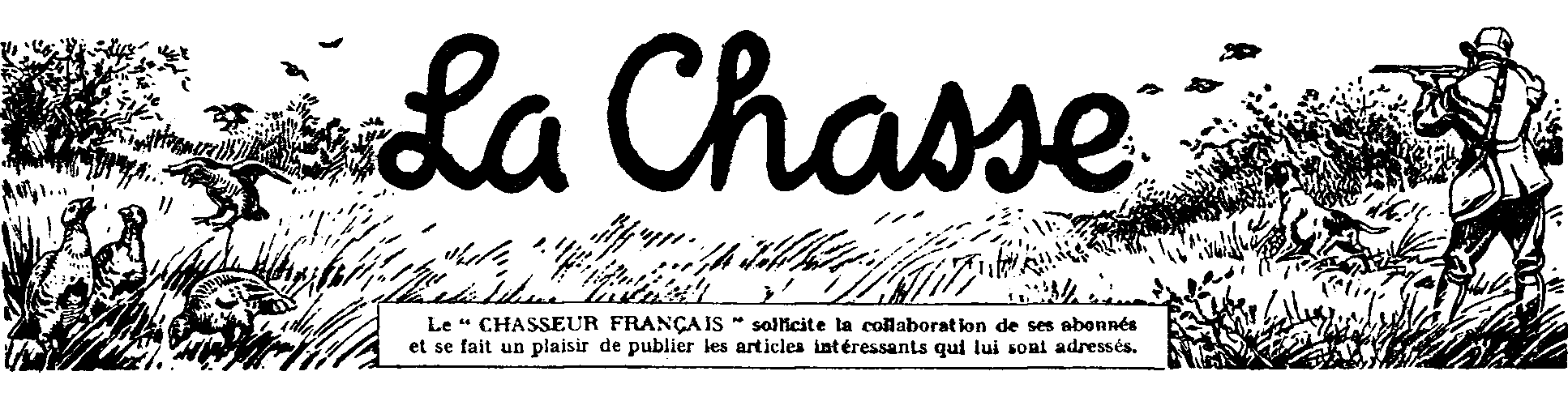| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°603 Novembre 1941 > Page 519 | Tous droits réservés |

|
En tournant les pages |

|
|
Tout jauni, serrant ses pauvres feuillets cornés dans une vieille couverture verte, Chasseur du Midi gisait là, oublié, poussiéreux sur la plus haute étagère de la bibliothèque. Je le découvris par une de ces journées, si rares en Provence, où le ciel pleure en longues averses noyant la campagne embrumée. Les heures, qui fuient si rapidement alors que le soleil luit, paraissent alors interminables ... Allongeant les fortes semelles, encore humides d’une brève sortie, vers les flammes, me voilà, un siècle en arrière, arpentant avec Bresson, auteur de l’ouvrage, les garrigues languedociennes. Poussant à un haut degré le noble sport, il nous indique ce qu’est un disciple en saint Hubert digne de ce nom. « Le vrai chasseur ne se laisse distraire par rien : les chagrins domestiques, les réprimandes, même la voix chérie de l’objet aimé ne doivent avoir prise sur lui. Il prend exemple sur son chien, il suit tous les mouvements de sa queue, car sa queue est comme un livre où il lit aussi couramment qu’un capucin dans son bréviaire ... Le fusil à la main, il n’est plus de ce monde. » L’auteur, fils de Camargue, paraît digne de foi, dans son journal de chasse, il nomme ceux qui l’accompagnaient — rarement les mêmes — le lieu, le nombre de coups et les pièces abattues. Ce devait être un fin fusil, peu d’amorces brûlées pour rien, puis écoutez ceci : « Le 22 juin 1848, nous revenions du bois de Clarensac. J’étais assis sur le devant du char à bancs avec Jules Peyront. Je recommandai à celui-ci de faire aller son cheval au grandissime trot afin de tirer mes deux coups de feu sur les deux premiers oiseaux qui traverseraient la route. Ce qui fut dit fut fait ; le cheval partit au grand trot. Dix minutes après, deux oiseaux qui traversaient la route à plein vol tombèrent l’un à droite et l’autre à gauche du char à bancs. » Tout d’abord, j’avais, pensé, trouver dans ces pages des récits cynégétiques lourds de victimes. Je m’étais trompé. L’ouvrage commence par le tableau détaillé de la dernière campagne de chasse (avril 1851 - avril 1852). On est d’abord très surpris de constater que, tout au long de l’année, la poudre parle librement. En avril lapins et cailles garnissent le carnier. Mai et juin ; mêmes espèces agrémentées de quelques lièvres. Juillet : voici le tour des halbrans, des jeunes perdreaux — sûrement très tendres — et des cailleteaux. Et cela continue en août, malgré la chaleur atroce. Puis, tenez-vous bien, on trouve ce petit fait divers dont vous goûterez l’ironique saveur : « La chasse est affichée. L’ouverture a lieu, dans le Gard, le 20 août. » Et notre ami, la conscience tranquille, poursuit perdreaux et cailles, dans les environs de Nîmes. La plus forte sortie comporte cinq perdreaux et un lièvre. Mais lorsque, abandonnant les garrigues, il se rend « au Daladel », chasse gardée riche en lapins et sauvagine, c’est une autre affaire. Du 17 novembre au 27 décembre, il tue « noblement » 225 pièces : sarcelles, canards, énormément de lapins. Déjà, l’usage du furet lui parait odieux, il s’écrie : « J’ai fait cesser ce braconnage. Si on continuait à fureter comme on l’a fait jusqu’à ce jour, le Daladel finirait par n’être qu’un pays de chasse ordinaire. » Le tableau général 1851-1852 s’élève à 630 pièces : 388 lapins, 64 cailles, 42 canards, 36 bécassines, 32 perdreaux, 23 sarcelles, 11 lièvres, 3 bécasses, 2 renards, 1 chat sauvage, puis des grives, étourneaux, poules d’eau. Évidemment ce tableau est coquet, mais on est surpris de compter si peu de lièvres et 32 perdreaux seulement. Je suis persuadé que dans la même région un chasseur moyen abat aisément une trentaine de perdrix durant quatre mois d’ouverture. On peut objecter qu’il y a un siècle armes et munitions laissaient fort à désirer. C’est entendu, mais le gibier était moins farouche et peu traqué ; ceci doit compenser cela. O chasseurs, mes frères, qui vous désolez, clamant sur tous les tons : « Il n’y a plus rien à tirer », écoutez ce cri d’alarme poussé par Bresson, en 1852. « Nos pères, avec leurs petits fusils, tuaient autant et même plus de gibier que nous. Avant la première révolution, il y avait beaucoup plus de gibier qu’aujourd’hui, car il y avait bien moins de chasseurs. J’ajouterais même que le gibier était bien moins sauvage. Quelle différence aujourd’hui ! ... Il y a cent chasseurs pour dix pièces de gibier, et le braconnage est poussé à un point tel que, si l’on n’y prend garde et si l’on n’y met ordre, il n’y aura bientôt plus dans nos pays ni lièvres, ni perdreaux. Il s’est délivré cette année 831 permis de chasse. Admettez seulement que chaque chasseur ait tué 4 perdreaux dans le mois de septembre ! » On sourit amusé à la sauvagerie du gibier et au nombre des chasseurs, 831 permis. Tout ceci me rend optimiste. Essayons de nous représenter ces contrées, il y a un siècle. La culture intensive méconnue laissait en friche une partie des terrains, sûrs abris pour le gibier. On venait à peine d’établir les premières voies ferrées. Les déplacements, fort longs par route, protégeaient ainsi les espèces sédentaires et de passage, de nombreux coins restant inexplorés ou rarement battus. Et, malgré ces conditions si favorables, le gibier paraissait diminuer puisque l’auteur prophétisait à brève échéance la fin de lièvres et perdrix. L’espèce chasseur serait-elle sujette à se plaindre en tout temps ? ... Ou le poil et la plume possèdent-ils des ressources insoupçonnées ? Car, enfin, il y a un fait : cent ans ont transformé nos régions et la façon de vivre, et pas à l’avantage du gibier. Tout d’abord extension des cultures, défrichements de landes, emploi des engrais permettant avec l’aide des machines de ne point laisser reposer le terrain ... Adieu le couvert de hautes herbes à proximité du sainfoin ou du chaume riche de milliers de grains perdus ! ... Le nombre de porteurs de permis va crescendo à la campagne comme à la ville. Non contents de tirailler en leur petit coin, les voilà mettant à profit les moyens de locomotion rapides réduisant à néant les distances. Ah ! s’il y a du perdreau à X ... 120 kilomètres, un coup de démarreur et, deux ou trois heures après, quatre ou cinq nemrods, accompagnés de chiens, parcourent le plateau. Finis les paradis cynégétiques où le gibier, dérangé deux ou trois fois dans la saison, semblait s’offrir aux coups. Et les armes ? ... O pauvre ancêtre de 1840, qui t’en allais la poudre et le plomb au flanc. Tu devais avoir le feu sacré ! ... Je vois tes pauvres doigts gourds sous la morsure de l’hiver, versant la mort dans l’âme de ton « Piston ». Et les jours de pluies ! ... Si dans le paradis des chasseurs — tu l’as mérité — tu nous observes maniant ces chefs-d’œuvre de précision qui nous enlèvent même le souci de retirer les étuis, tu dois penser : Quels veinards tout de même ! Impossible de suivre le sillage de nos exploits aux nuages bleus. Abolis les brouillards artificiels et les coups de tonnerre. Les perdreaux sont devenus farouches, malgré cela, de temps à autre, un sec crépitement descend noblement l’un d’eux à cinquante pas. Nos terribles moyens de destruction aggravés par les crimes des bracos — il y en a toujours ! ... — n’ont pas anéanti le gibier. Dans les sèches et pierreuses garrigues, la perdrix rouge continue à se défendre, les lapins y sont nombreux. On tue encore quelques lièvres, et, aux passages d’automne, les rousses bécasses nous visitent. Puis, écoute, les grosses bêtes noires que tu croyais disparues à tout jamais sont revenues. Va sur les plateaux aux fourrés de chênes verts avoisinant la Cèze, tu m’en diras des nouvelles ... Ah ! pardon ! j’oubliais que tu étais au paradis ... Demeurons optimistes. Les chasses gardées, les sociétés locales maintiennent le gibier. Si nous savons nous imposer quelques restrictions et repeupler, nous pourrons — dussions-nous voir le XXIe siècle — réaliser quelques jolis tableaux. A. ROCHE. |
|
|
Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 519 |
|