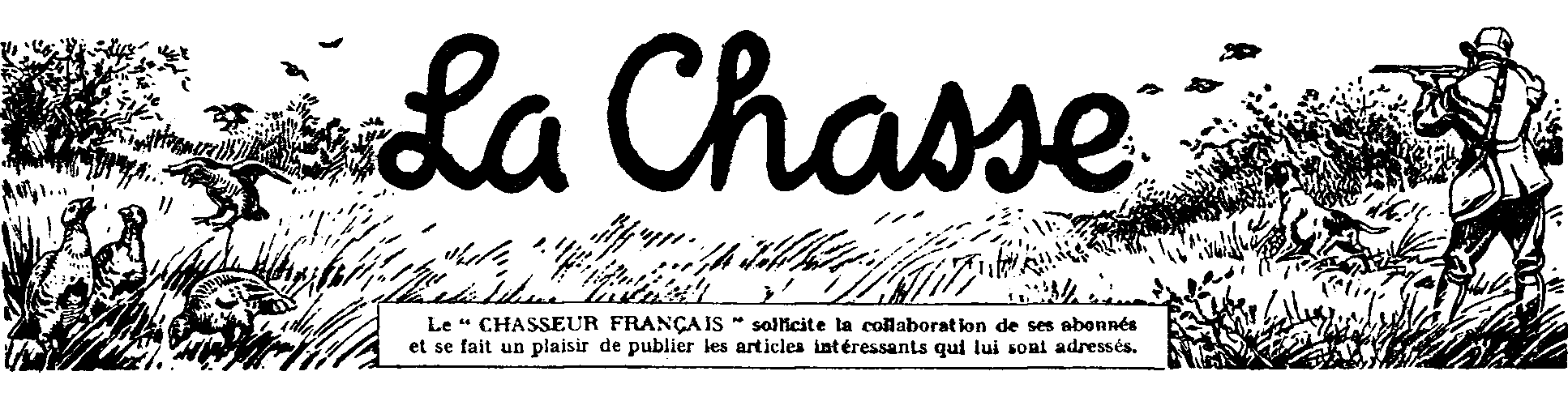| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°603 Novembre 1941 > Page 523 | Tous droits réservés |
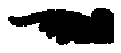
|
Échos de partout |
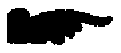
|
La chasse au XVIIIesiècle.
Combat entre un tigre et un sanglier.
La Chasse au XVIIIe siècle.— Ce que l’on appelait les plaisirs du souverain était entièrement différent des chasses seigneuriales ; le roi se réservait non seulement les forêts et les terres domaniales, mais encore des territoires fort vastes autour de chaque château ou maison royale, sur lesquels le domaine n’avait aucun droit de propriété. On indemnisait les seigneurs en leur donnant d’autres chasses. Il y avait toute une administration spéciale : le grand veneur avait sous ses ordres un capitaine de chasses dans chaque balliage, dont les fonctions étaient entièrement distinctes de celles des membres de la maîtrise. Le souverain se réservait la chasse exclusive du cerf, considéré comme gibier royal. Il était donné des permissions de chasse gracieuses et ordinairement gratuites, sans limitation de durée. Les textes du XVIIIe siècle sont muets sur l’exercice de la chasse par les roturiers, bourgeois ou habitants de la campagne. Aucun texte ne la défend. Les édits contiennent seulement des défenses concernant le port d’armes qui s’appliquent à tous les roturiers non militaires et l’obligation pour les paysans de couper le jarret à leurs chiens et de leur attacher un billot au col. Les roturiers ne pouvaient avoir de fusil et les engins de chasse étaient prohibés ; ils ne pouvaient donc chasser. Certains modes de chasse étaient interdits : les lacets, filets, pipées étaient défendus ; il en était de même des fusils pouvant se démonter facilement, ce que les ordonnances appelaient les armes brisées. Les chasseurs devaient observer un temps de clôture imposé pour protéger les récoltes, ainsi que les pontes ou portées ; ce temps de clôture partait du moment où les crains étaient en tuyau et allait jusqu’à la récolte. L’édit de 1729 fixe les dates du 15 mars au 15 août, période de cinq mois. D’autres édits avaient pour but la protection des œufs, couvées et protection des petits chevreuils et lièvres, afin d’assurer la protection des espèces. L’ordonnance de 1704 contenait des dispositions importantes pour l’admission des gardes-chasses, la rédaction de leurs procès-verbaux, compétence des gruyers et des maîtres pour les délits commis sur les terres du domaine ; quant aux peines, elles étaient sévères, les amendes étaient énormes et la défense de les modérer était d’une grande sévérité. La responsabilité des parents et des maîtres pour les délits des enfants et des serviteurs y était établie. En cas de récidive, les peines corporelles étaient le fouet, la marque et les galères, pour les roturiers. La sévérité a toujours été très grande jusqu’à la fin de l’ancien régime. Les animaux réputés nuisibles, tels que le loup, le renard, le blaireau, pouvaient être tués en tous temps par les seigneurs et leurs permissionnaires ; leurs peaux, appartenaient au lieutenant de louveterie. Les paysans pouvaient aussi tuer les animaux nuisibles, mais avec les seuls moyens permis aux roturiers, c’est-à-dire les pièges ; aussi voit-on, dans les cahiers de 1789, des plaintes irritées et des doléances contre le monopole des seigneurs. Louis TESTART. Combat entre un tigre et un sanglier.— À la fin de l’hiver, au commencement de 1896, au Tonkin, près de Dong-Trieu, le poste de Ben-Chau, situé au fond d’une gorge boisée, véritable décor de potiche chinoise, était occupé par une section de tirailleurs tonkinois que renforçaient dix soldats d’infanterie de marine. Le commandement était assuré par un jeune adjudant énergique et prudent. Un soir, la nuit commençait à peine, le maire du village, Ly-Tap, chef de partisans et grand chasseur, se présente au poste, demandant à parler à l’adjudant. Pendant qu’on lui ouvrait, il disait en sabir aux marsouins d’aller chercher leurs fusils parce que : il était là, en train de se battre avec le « vieux cochon de montagne » (sanglier solitaire). Ces deux animaux étaient bien connus des marsouins, qui tous avaient souvent espéré les chasser. Le sanglier vieux solitaire, grand ravageur des champs de patates, avait essuyé leur feu plus d’une fois, mais il portait bien le plomb, ne craignait guère plus la balle Lebel que celle des fusils à piston modèle 1842 des partisans. Quand il avait été touché, il disparaissait quinze jours ou un mois, puis, guéri, se montrait à nouveau. Quant à il ... — le monsieur, disaient les marsouins — c’était le tigre (on ne doit jamais prononcer son nom), un vieux solitaire aussi. De nombreuses fois, il avait été salué à balles au jugé en rodant autour du poste. Il était souverain de la forêt avec le sanglier. Quel conflit était-il survenu entre eux ? On l’ignore, mais le duel était bien engagé. Naturellement, l’adjudant éconduisit Ly-Tap, lui disant qu’aucune vie humaine n’étant en danger il ne laisserait sortir personne la nuit pour une chasse semblable. Tout seul, notre Annamite n’osait s’y aventurer. Les marsouins grognèrent, mais durent se contenter, comme leur chef, de se tenir aux parapets avec leurs armes en écoutant les cris, soupirs et autres bruits du combat qui dura plus de deux heures. Le lendemain, au petit jour, l’adjudant et ses dix hommes allaient sortir quand Ly-Tap arriva ; il les conduisit à trois cents mètres. La brousse était arrachée sur un cercle de six à sept mètres de diamètre. La terre remuée faisait penser à un manège préparé pour le dressage d’un cheval. Le tigre gisait là, complètement éventré, déchiqueté, exsangue. Son vainqueur était parti. Une trace permit de suivre sa piste. À quinze cents mètres. Ly-Tap, qui menait la chasse, cria que le sanglier était là. Lui aussi était mort. Debout, affaissé sur lui-même, complètement lacéré par les griffes et crocs de son adversaire, il était complètement saigné, mais n’avait reçu aucune blessure très grave. Les deux animaux étaient si abîmés qu’il fut impossible de les écorcher afin de garder le souvenir de leur lutte. Victor TILLINAC. |
|
|
Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 523 |
|