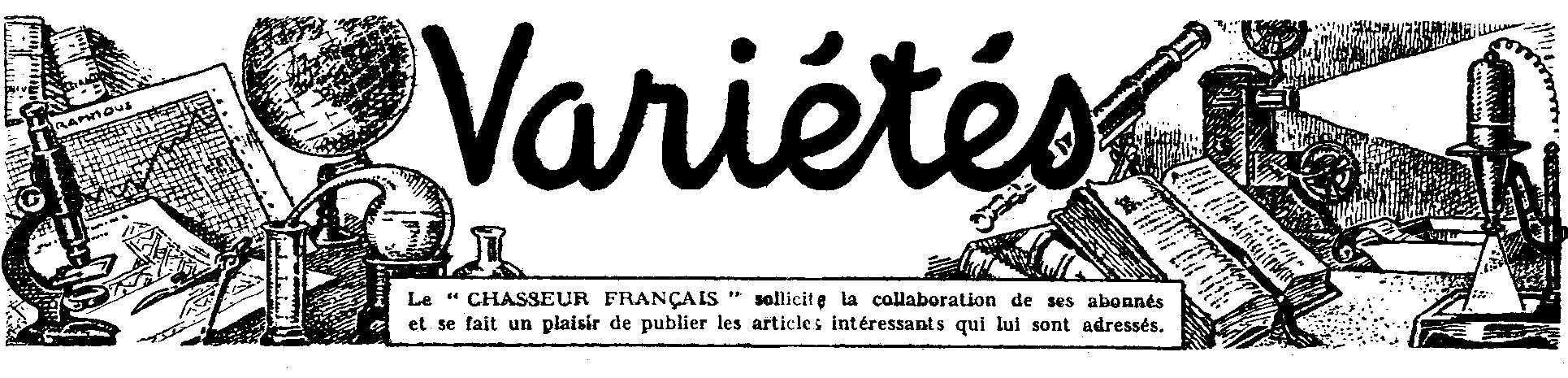| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°603 Novembre 1941 > Page 574 | Tous droits réservés |
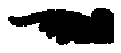
|
Nos oiseaux de cage |
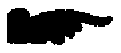
|
Oiseaux de pays (suite).
|
Le Bruant des roseaux ou Cynchrame schénicole est un joli oiseau à la tête et à la gorge noires. Une bande blanche partant du bec sépare ces deux taches noires et se joint à un collier blanc plus large sur la poitrine que derrière la tête. C’est un oiseau très gai, très remuant que l’on ne rencontre que dans la plaine et toujours à proximité de l’eau. En captivité, il demande plus de soins que les autres Bruants, mais il est très amusant par son mouvement perpétuel. Le Bruant doré se voit assez souvent en cage. Le mâle est marron en dessus et jaune en dessous ; il a un collier marron et, en belle saison seulement, une tache noire au haut de la gorge. C’est encore un oiseau de plaine fréquentant les roseaux et les buissons. Le Bruant zizi, bien connu en France, est vert et noir en tête. Deux larges bandes jaunes se voient au-dessus et au-dessous de l’œil. L’ensemble est brun strié de noir. Le Bruant à tête rousse vient plutôt rarement en France. Il est très recherché comme oiseau de cage, en raison de ses couleurs : jaune vert dessus, jaune franc dessous, le cou et la poitrine roux. Le Bruant cendrillard est peu apprécié en captivité. C’est d’ailleurs un oiseau quelconque, brun marqué seulement de jaune en tête et au cou. Le Bruant familier ne se trouve qu’en Afrique du Nord. Ce petit oiseau s’apprivoise très facilement. Il a un peu les habitudes du moineau, niche dans les murs, par exemple. Sa livrée brune est relevée de gris bleu en tête, à la nuque et à la poitrine. Son chant, quoique faible, est assez plaisant. Il existe encore d’autres Bruants : le Bruant à tête grise (Emberiza fucata), le Bruant à sourcils jaunes (Emberiza elegans), le Bruant à ventre jaune (Emberiza flaviventris), le Bruant roux (Emberiza rutila), le Bruant masqué (Emberiza personata), le Bruant de Bonaparte (Emberiza ciopsis), le Bruant à tête blanche (Emberiza leucocephala), le Bruant lapon (Calcarius laponicus) ou mieux le Plectrophane lapon (Plectrophanes laponicus) connu encore sous le nom de Bruant alouette et qui a un long ergot comme celle-ci, très joli et très agréable oiseau de cage ; le Bruant des neiges ou mieux Plectrophane des neiges (Plectrophanes nivalis), le Bruant de roche (Fringillaria tahapisi), le Bruant du Cap (Fringillaria capensis) habitent l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Europe centrale, mais ne se voient pas en France à l’état libre. Par contre, le Proyer ou Bonnetier (Miliaria europea) y est commun. C’est un oiseau gris brun très voisin des Bruants qui ne présente aucun intérêt en captivité. Le pinson (Fringilla cælebs) est l’oiseau-type des Fringillidés. Une explication me paraît nécessaire, tant sur le nom vulgaire de pinson que sur l’appellation scientifique. Buffon nous dit, et cela est parfaitement exact, que « son bec est très fort et qu’il sait très bien s’en servir pour se faire craindre des autres oiseaux, comme pour pincer jusqu’au sang les personnes qui le tiennent ou qui veulent le prendre ». Du reste, on écrivait autrefois « pinçon ». Le mot latin cælebs paraît inexplicable. Pourquoi, en effet, qualifier de célibataire un oiseau dont le nid est le plus harmonieusement et le plus confortablement construit ? Un oiseau qui vit par bandes pendant plusieurs mois de l’année ? Comme dans toutes les espèces, il y a, évidemment, quelques vieux mâles qui vivent solitaires, mais ce sont là des exceptions desquelles on ne saurait conclure à une habitude. Nous trouvons chez les pinsons deux espèces européennes. Et d’abord le pinson commun ou vulgaire (Fringilla cælebs). Tout le monde connaît cet oiseau répandu dans la France entière. Son port fier et noble, ses riches couleurs et son chant, ainsi que la facilité que l’on a de le nourrir, en font un oiseau de cage et de volière très apprécié. La femelle est un peu plus petite que le mâle. Chose remarquable, le bec est bleuâtre en belle saison et couleur de corne en hiver, la pointe restant toujours noire. Les pinsons sont des oiseaux assez querelleurs, les batailles entre eux sont fréquentes ; j’ai encore vu, tout récemment, chez moi, un mâle tuer sa femelle. Dans leurs migrations, les sexes voyagent séparément, les femelles toujours les dernières, avec un retard de quinze jours environ. Entre eux, à l’état de liberté et surtout à l’époque des amours, les mâles rivalisent pour le chant, mais les pinsons captifs participent à de véritables et sévères concours de chant pour lesquels les amateurs se passionnent. Les petits artisans surtout (chaudronniers, cordonniers, tailleurs, horlogers, etc.) possèdent des pinsons et envoient dans les concours leurs meilleurs chanteurs. On rapporte qu’un amateur offrit une vache pour un pinson. Ces concours ont lieu surtout, ou du moins avaient lieu, en Belgique et en Allemagne. Les connaisseurs distinguent et apprécient une vingtaine de chants différents qu’ils désignent par des noms assez surprenants : le chant du vin perçant, le mauvais chant du vin, l’huile de pin, la bonne année folle, la bonne année du Harz, le cavalier, etc. Des paris élevés s’engagent souvent dans ces concours. Le pinson des Ardennes (Fringilla montifringilla), appelé aussi pinson des montagnes, a une livrée plus sombre et moins jolie que le pinson ordinaire. On le rencontre plus au Nord. Eux aussi voyagent en bandes, parfois mêlés aux autres pinsons ; dont ils ont à peu près les mœurs. Ils fréquentent aussi les linottes, les verdiers, etc. Le pinson des Ardennes chante moins et moins bien que le pinson ordinaire, la nourriture est la même. En définitive, ce n’est pas un oiseau intéressant en captivité. Le gros-bec commun (Coccothraustes coccothraustes) ne serait, d’après le Dr Sharpe, qu’une sous-famille des Fringillidés. Ceci est d’ailleurs très contestable. La variété européenne se montre accidentellement dans les régions où on ne la voit pas d’habitude. C’est ainsi que dans les Pyrénées centrales, on en a vu ces dernières années. C’est un gros oiseau robuste et vigoureux, cependant plus petit que le merle. Le bec est bleu en été, couleur de nacre en hiver, la tête marron, les pattes chair, ou marron, la gorge noire, la poitrine et les flancs cendrés marqués de rouge, le dos roux, les ailes noires, marquées de blanc. La femelle a des couleurs plus ternes et est plus petite que le mâle. Le bec est énorme et puissant. C’est un oiseau du Nord, qui n’est que de passage dans nos régions méridionales. On le trouve alors près des maisons, dans les jardins potagers, et il se montre peu craintif. Le gros-bec est grand amateur de cerises, mais il n’en mange pas la pulpe. Il casse le dur noyau et mange la graine qui y est contenue. Il mange aussi les céréales et diverses graines. Bien qu’il détruise aussi les hannetons et les insectes, on peut le considérer surtout comme un oiseau nuisible. Son chant n’a rien de remarquable, il est même plutôt déplaisant. Les gros-becs ne sont guère recherchés comme oiseaux de cage, ils sont méchants pour les autres oiseaux et ne donnent guère d’agrément ... Cependant, ils s’apprivoisent assez facilement. Leurs coups de bec sont terribles et ils ne lâchent pas prise facilement. Les becs-croisés paraissent être l’animal de transition entre les passereaux et les perroquets. La famille des Loxiidés se rapproche en effet beaucoup de ces derniers oiseaux tant par les formes extérieures que par les mœurs. Le bec seul suffit à distinguer les Loxiidés de tous les autres oiseaux. C’est, en somme, un véritable bec de perroquet, à cette différence essentielle près, cependant, que les mandibules, n’étant pas dans le même plan, ne s’emboîtent pas l’une dans l’autre, mais se croisent franchement, d’où le nom de bec-croisé. La mandibule supérieure déborde l’inférieure, soit à droite, soit à gauche. La tête et les muscles du cou sont très forts, mais beaucoup plus d’un côté que de l’autre. Ce sont des oiseaux sylvestres, qui vivent en société presque exclusivement dans les forêts de conifères. Ce sont encore des oiseaux du Nord, mais leurs pérégrinations sont fort étendues. Ils arrivent un beau matin et en grand nombre, se conduisent absolument comme s’ils étaient familiers du pays, y restent deux, trois jours, parfois vingt-quatre heures, et disparaissent comme ils sont venus, sans laisser le moindre retardataire. Le rouge-vermillon ou groseille est, chez eux, la couleur dominante. On distingue trois variétés : le bec-croisé des sapins, le bec-croisé des pins, le bec-croisé à bandes. Le bec-croisé des sapins (Loxia pytiopsittacus) ou bec-croisé perroquet, est le plus grand, il a environ 0m,33 d’envergure. Le bec-croisé des pins (Loxia carvirosta) ou bec-croisé ordinaire, appelé aussi bec-croisé commun, mangeur de pommes de pins, est plus petit et ne dépasse guère 0m,30 d’envergure. Le bec-croisé à bandes (Loxia tænioptera), dit aussi bec-croisé lipascié (Loxia beucoptera), est encore plus petit que les deux précédents et son bec est plus faible. Tous se nourrissent de graines de conifères. Leurs migrations sont très irrégulières et dépendent surtout de l’abondance de leur| nourriture. En captivité, ils sont intéressants par leur familiarité, et le chant du mâle n’est pas désagréable. J. DHERS. |
|
|
Le Chasseur Français N°603 Novembre 1941 Page 574 |
|