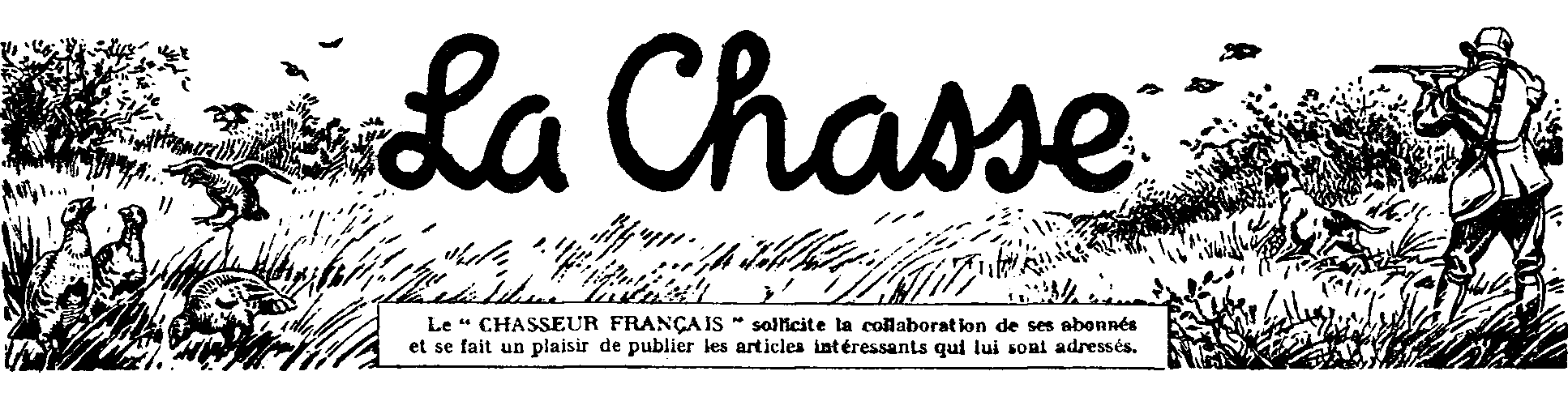| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°605 Janvier 1942 > Page 8 | Tous droits réservés |

|
Un tigre en transe |

|
|
Pourquoi ne raconterais-je pas, à mon tour, une histoire de chasse ? Seulement, voilà, je suis totalement dépourvu d’imagination et incapable d’écrire ce que je n’ai pas vécu. Aussi, vais-je me rabattre sur une de ces chasses, ou plutôt semi-chasses, qui se déroulent toujours au moment où l’on s’y attend le moins. J’entends bien mes lecteurs : pourquoi, dans ces conditions, présenter une histoire ? Il n’y a qu’à laisser le récit sur son vrai terrain de chasse ! J’aime mieux répondre tout de suite que ma dignité de vieux chasseur colonial blanchi sous la bretelle de fusil restera ainsi à l’abri de la critique, si l’on ne veut pas me croire ... Or donc, il y a de cela quarante ans, j’achevais de dîner en compagnie de mon associé et ami Lussan, dans le grand hangar de transit ouvert à tous les vents au terminus sud de la petite voie ferrée de l’île de Khône, située dans le Mékong, à la frontière du Laos et du Cambodge. Lussan avait la chasse dans le sang ; il la poussait même jusqu’à la témérité, et cependant son coup de fusil manquait trop souvent de précision. Cela ne l’empêchait pas d’envoyer aux journaux cynégétiques de la Métropole des récits de chasses collectives où il s’attribuait toujours le coup de grâce. Il soignait fort son style qu’il agrémentait d’inimitables imparfaits du subjonctif : « Afin que nous convergeassions vers la clairière ... » Impossible de faire mieux, et cela me vexait quelque peu, car, si j’en avais eu le goût, je n’aurais jamais pu l’égaler. Ce soir-là, après avoir desservi nos tables pliantes de voyage, le boy de service vint nous prévenir que nos lits Picot étaient dressés entre des piles de caisses et prêts à nous recevoir, moustiquaires en place, draps ouverts et photophores individuels allumés sur une caissette, en guise de table de nuit. Lussan me passa un de ses journaux reçu la veille, sur lequel figurait précisément une chasse au cerf « rusa », à laquelle j’avais participé en expédiant la balle finale, et me dit : — J’installe Julot sous mon lit pour qu’il me réveille en cas d’alerte, bien que j’aie le sommeil léger, car je me méfie de Susu. Quant à mon récit, j’espère qu’il t’endormira plus vite et plus profondément que d’habitude. Bonne nuit et à demain. Il me faut préciser ici que Julot était le nom d’un jeune chien que mon ami soignait et dressait en bon maître qu’il était. Pour ce qui est de Susu, c’était un pauvre vieux tigre tout décrépit et plutôt inoffensif qui, depuis longtemps, avait installé son quartier général dans les environs pour chasser les rats monstrueux qui pullulaient dans les hangars. Ces indésirables voyageurs avaient été importés là avec les marchandises de transit provenant des navires caboteurs et fluviaux, et s’étaient sans doute croisés avec les rats de bambous du pays (nesokia) plus gros qu’eux encore. Le nom de Susu, qui signifie « simple », « débonnaire », avait été donné au félin par les Laotiens, qui appréciaient fort sa qualité quasi domestique de ratier ! Ce lamentable tigre incapable de chasser normalement, car il avait perdu presque toutes ses griffes, finissait timidement sa vie dans ce coin de forêt entourant les hangars presque toujours déserts et se nourrissait nuitamment de ces rats de poids. Il avait trouvé la bonne place et tenait à la garder. Aussi, évitait-il de la compromettre et n’opérait-il que de façon discrète. D’ailleurs, la locomotive « Paul-Doumer », qui, tel un navire, portait ce nom de gouverneur aussi bien à bâbord qu’à tribord, se faisait un malin plaisir de pousser un sifflement strident quand elle arrivait à Kône-Sud deux ou trois fois par semaine, ce qui mettait Susu en un tel état qu’il en avait les sueurs et des battements de cœur ... Mais revenons à Lussan. Je savais ce que représentait le sommeil léger de mon ami, qui avait l’habitude de dormir comme un plomb et de ronfler comme un sonneur de cathédrale. La lecture du récit cynégétique de Lussan me suffoqua une fois de plus. Il s’était à nouveau attribué le coup de fusil qui avait mis fin à notre chasse, alors qu’il m’appartenait. Bien qu’habitué à cette innocente manie, j’en ressentis quelque humeur, et j’allais quand même me laisser glisser dans les ailes et les bras de Morphée lorsqu’un ronflement puissant et sonore m’avertit que mon ami m’avait cette fois, et sur ce terrain, réellement devancé. Je me sentis lésé, car, avec un pareil tintamarre, il était difficile à un honnête chasseur de s’endormir. Et puis, il n’avait même pas soufflé sa bougie, dont le reflet me tapait dans l’œil ! Ma mauvaise humeur s’accrut. Je sifflai, d’abord modérément, plus fort ensuite, enfin avec mon sifflet de chasse. Rien n’y fit. Cette fois, la hargnerie m’empoigna ... Quand nos obligations commerciales ou nos grandes chasses exigeaient que nous couchions (Lussan eût écrit couchassions) à la belle étoile, mon ami et moi avions toujours un revolver à notre portée. Le mien se trouvait à l’intérieur de mon oreiller de porcelaine, qu’il est souvent d’usage d’utiliser en Extrême-Orient tropical, quoique dénué de moelleux, mais si rafraîchissant. J’avais vingt-cinq ans, le geste prompt et précis, l’œil clair, le cœur chaud ... Placés comme nous l’étions, je pouvais sans danger ajuster la bougie du confrère en notre saint patron Hubertus et tirai. Le verre du photophore vola en éclat, la bougie s’éteignit. — Hein ! Quoi ? entendis-je Lussan, qui, cette fois, se réveilla. — Oh ! rien de grave, dis-je, désinvolte, cette fois calmé par mon geste inconsidéré. Susu était là près de ton lit, cherchant sans doute à enlever ton chiot qui ronflait en harmonie avec toi. — Ah ! le s ... riposta Lussan, qui saisit à son tour son revolver qu’il plaçait, lui aussi, sous son oreiller de cuir bourré de kapok, car il ne dérogeait à ses habitudes sybaritiques que lorsqu’il était à la chasse. À nous deux, Susu ! Et, bondissant de son lit, il s’en fut en pyjama, les pieds nus. Deux minutes ne s’étaient pas écoulées que j’entendais une volée de coups de revolver dans la nuit. Je me précipitai à mon tour. Cette stupide plaisanterie pouvait mal finir pour mon ami que j’aimais comme un frère, malgré ses rapines cynégétiques. Le remords m’envahissait déjà. J’arrivai juste à temps pour voir Lussan décharger la dernière balle de son arme sur le malheureux Susu, qui, épouvanté par ces détonations répétées et intempestives, avait pris, sur le ballast de la voie, ses pattes à son cou. Le hasard avait voulu que le pauvre bougre de félin se trouvât précisément à l’affût de quelque rat, près de l’endroit où mon ami était apparu. — Il en tient, me dit-il haletant. Mais quel culot ! prendre mon Julot pour un rat ! Le lendemain, nous partions à Khong et dînions chez M. Gaillard, le commissaire du gouvernement de la province, qui nous avait aimablement invités. On parla « tigre » parce que, quelque temps auparavant, un rôdeur de cette espèce était tombé de nuit à Khône-Nord, dans un puits en construction, et avait poussé de tels rugissements désespérés que les gens du quartier risquaient de passer une nuit blanche. On dut le fusiller à bout portant pour le faire taire. — C’est comme moi, enchaîna Lussan. Je venais de m’endormir paisiblement hier soir à Khône-Sud, quand Susu, le tigre ratier, a tenté d’enlever mon chiot qui était sous mon lit. Mais je ne dormais heureusement que d’un œil et je m’apprêtais à l’abattre, quand Cheminaud, me devançant, lui a décoché, sans le toucher, une balle de revolver de nuit à travers sa moustiquaire et mon photophore. Alors, d’un bond, d’un seul, j’étais sur le tigre, et pan, pan, pan ... Ma hargne de la veille se réveilla soudain. — Écoute, Lussan, interrompis-je, si tu le tues, je te f ... une gifle. — Alors, continua imperturbablement mon ami, dans la nuit, vous comprenez, pour une fois manquant mon but, je l’ai raté ... Guy CHEMINAUD. |
|
|
Le Chasseur Français N°605 Janvier 1942 Page 8 |
|