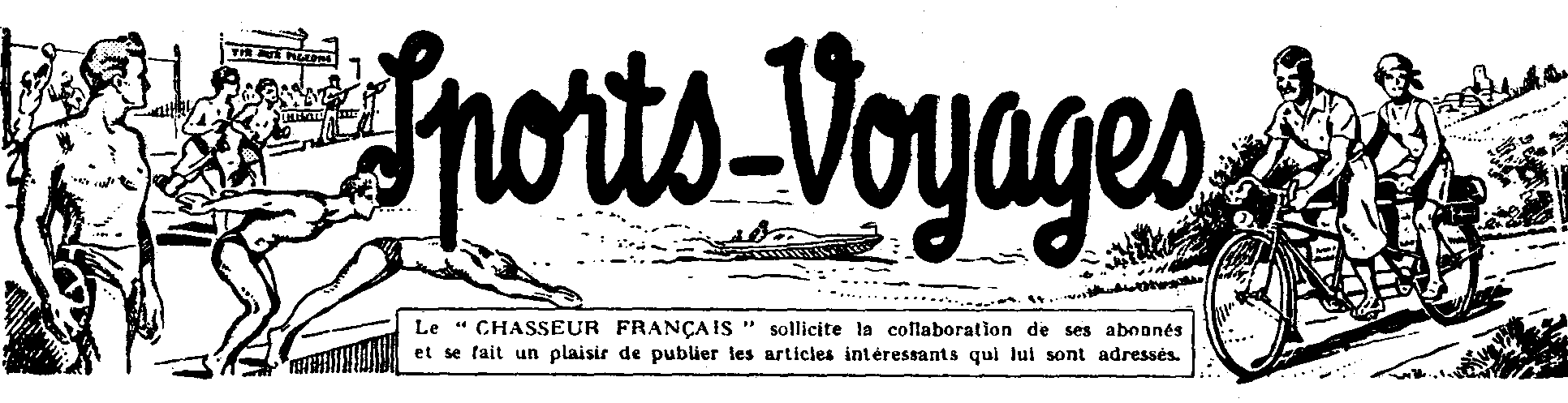| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°605 Janvier 1942 > Page 24 | Tous droits réservés |

|
Cyclotourisme |

|
Au pays des pins.
|
« Pas de côtes ! Pas de côtes ! » Ces mots magiques suffisent à décider les cyclotouristes de deuxième zone, et surtout leurs épouses, à enfourcher les vélos, pour se rendre à Arcachon, à Mimizan, Hossegor ou Biarritz. Pas de côtes ! comme si tout se résumait à des côtes ou à des « non-côtes », surtout quand on a un changement de vitesses permettant, dût-on y mettre le temps, de tout monter sans mettre pied à terre. Pas de côtes ! Vous m’amusez. Et le vent, n’est-ce pas bien pire que les pires côtes. Et l’ennui ? Oui, je dis bien l’ennui ! Je plains les cyclotouristes qui ne font pas entrer dans leurs calculs ce facteur capital et ne se rendent pas compte du rôle énorme que joue le moral en matière de randonnée. Les côtes, le vent, la pluie, le froid, la grosse chaleur ... eh bien ! tout cela passe, tout cela fait partie du programme, vous oblige à vous dépasser en vous dépensant. Or, il n’y a pas d’entraînement meilleur que celui qui consiste à aller un peu au delà de ses forces, très peu, mais un peu. Et puis, enfin, la voûte céleste n’a pas été créée pour être uniformément bleue, et c’est « son droit » d’être balayée de vent ou rayée d’averses. Nos yeux suivent ces sautes d’humeur du ciel. Notre imagination y trouve un aliment. Mais ne rien voir ou voir toujours la même chose, voilà la véritable épreuve. Les pays de pins sont appelés forestiers, mais ne constituent pas des forêts. Quand la route, étroite et sinueuse, passe en pleine sylve colonnaire, je ne nie pas le charme particulier des bois de pins et j’ai assez fait l’éloge des pistes landaises, et j’ai assez écrit sur les étangs, canaux, courants du pays des dunes pour que l’on ne puisse me taxer d’insensibilité à l’égard de ces parages odorants de résine et bruissants de cigales, Mais, quand on quitte les pistes, qui ne mènent pas partout, et qu’on emprunte les routes, quel changement ! Les kilomètres deviennent des lieues. On compte les bornes. L’ennui vous gagne. On se décourage. N’ayant jamais à fournir l’effort d’une montée qui serait suivi du repos d’une descente, on se fatigue beaucoup. La selle vous meurtrit. On change de position ; mains en haut du guidon, mains en bas, droit, courbé. En somme, on bafouille, et il faut que le parcours devienne tant soit peu accidenté pour que l’on retrouve son style. Tous les cyclotouristes éprouvés me comprendront. La route est droite et large. À une double muraille de pins succèdent des étendues déboisées ou brûlées, sans un arbre. Plate infiniment, la voie monotone a toujours l’air de monter un peu. Dix secondes de roue libre et le vélo s’arrête. Jamais d’élan, jamais de repos. Pas de lointains. Pas de rapprochés. Au point de vue photogénique, le pays ne donne absolument rien. Or, nos yeux sont des objectifs. Ils « demandent » des plans, du fondu, du relief, des contre-jour, et plus que tout des sujets nécessitant une mise au point, des premiers plans, ne fût-ce qu’une fontaine ou un mur de clôture bas et moussu, ou une charrue sur le bord du chemin, ou un attelage, mais bien davantage encore le décor d’un village avec sa halle, son clocher et ses vieilles maisons. Cela, même les « philistins » l’éprouvent. Nous ne pouvons nous soutenir, moralement et physiquement, avec le néant. C’est pourquoi je recommande les grandes routes des pays de pins aux courageux, aux stoïques, aux pédaleurs qui ont mis dans leur programme : la lutte pour la lutte. Ils n’ont point tort, mais ils sont très rares. D’ingénieux moralistes ont expliqué tous les malheurs des hommes et des sociétés par la peur de l’ennui. Ce paradoxe n’est qu’apparent. Il y a du vrai dans cet aphorisme. À ceux qui résolument veulent « se dépasser », je conseille donc une journée (et même plusieurs) de deux cents kilomètres en ligne droite, sans une côte, avec des pins à bâbord et à tribord, le soleil sur le crâne, le vent debout, sans que jamais le plus merveilleux de nos sens : la vue, ait à s’employer ni pour repousser la laideur ni pour s’emplir de beauté. Quand ils auront compté deux cents bornes de ce néant, s’ils sont heureux de leur journée, je les saluerai avec stupeur ... mais respect. Henry DE LA TOMBELLE. |
|
|
Le Chasseur Français N°605 Janvier 1942 Page 24 |
|