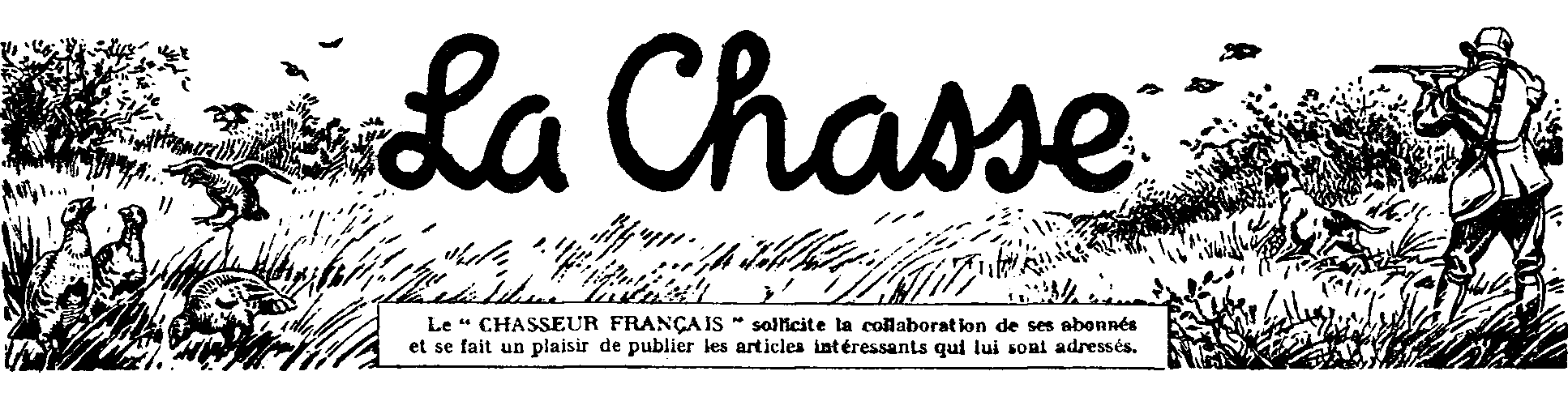| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°606 Février 1942 > Page 71 | Tous droits réservés |

|
À l’affût aux grives |

|
|
Je suis réveillé brusquement par le timbre insupportable de mon réveille-matin ; cinq heures, diable ! J’ai encore sommeil, mais qu’importe ? C’est jour de chasse et il ne faut pas perdre une minute ; vite debout ; une ablution vigoureuse à l’eau froide, quelques mouvements, une, deux ... une, deux ... et voilà le sommeil disparu. La toilette terminée, je descends rapidement à la cuisine où je prépare un stimulant petit déjeuner ; dehors, il doit faire bien froid, car le thermomètre accusait hier soir, à neuf heures, 7° au-dessous de zéro. Dame ! c’est que nous sommes à la fin décembre, et l’hiver, cette année, s’est montré plus précoce que de coutume. La bolée de bon café avalée, j’ajuste déjà ma ceinture cartouchière garnie de douilles pesantes aux couleurs variées, quelques rouges pour le six, des bleues pour le huit, et quelques jaunes chargées au deux, dans le cas où maître Goupil se serait attardé au cours de sa randonnée nocturne ; un coup d’essuyage à l’intérieur de mes canons et je mets en bandoulière mon superbe douze. Les six coups de six heures s’égrènent dans la nuit agonisante quand j’ouvre ma porte ; une bise glaciale et sifflante pique les oreilles et embue les yeux ; sous la lune claire, ma silhouette démesurée fuit devant moi en dansant. Après une petite heure de marche, je serai arrivé sur les « communaux » ; là, une cabane de fougère sèche et tiède m’attend, d’où je dominerai la lisière du bois à ma droite et à ma gauche, en face, à quelque trente mètres, les trois vieux pommiers chargés de gui, où viendront tout à l’heure se gorger, en fêtant le matin, les jolies draines et les litornes grises ; cette perspective fait bondir mon cœur de joie, je ne sens plus le froid. Peu à peu, dans la nuit pâlissante, les formes imprécises se profilent, le hou-hou de la chouette retentit, un chien réveillé en sursaut à mon passage tire sur sa chaîne en poussant des abois discordants ; encore quelque cent mètres et me voilà installé dans ma cabane préparée à la manière d’une hutte. Qu’il y fait bon ! Les côtés, le toit et le fond forment des murs impénétrables à la bise nordique, un siège des plus moelleux m’accueille et me détend ; c’est le moment d’ouvrir l’œil, car déjà le jour pointe, l’horizon se colore des tons les plus doux à l’œil d’un chasseur. Qui n’a goûté avec délices ces jolis matins d’hiver, remplis de charme indéfinissable et de grandiose poésie, lorsque le frimas a poudré les aiguilles des pins noirs sur cet écran rose et bleu et quand, l’œil aux aguets, le fusil en main, une journée s’annonce pleine de promesses et de surprises ! Déjà, il fait jour, quelques ramiers passent au loin, hors de portée ; première émotion. Mais voilà qu’une draine vient se poser à la cime d’un pommier, je retiens mon haleine ... Trop tard, elle est déjà partie. M’a-t-elle éventé ? J’en profite pour changer mon numéro de plomb ; à droite, je laisse le huit et, à gauche, cette fois, je glisse une cartouche chargée au six, car d’autres ramiers passent encore, mais plus près. Dans le bois, un geai semble approcher en direction de ma cabane, on dirait qu’il avance d’arbre en arbre en poussant des piaillements horribles ; que se passe-t-il ? Sans bouger, un coup d’œil circulaire du côté de la lisière à ma droite ; soudain, à une cinquantaine de mètres, une forme sombre remue derrière une touffe de ronces et de genêts, puis disparaît lentement ; le geai continue sa sérénade assommante, son manège m’agace et je suis prêt à envoyer au juger mon coup de six, dans la direction de ce gueulard, quand, subitement, paraît au bord du bois, broutant quelques jeunes pousses, l’air tranquille, un chevreuil des plus authentique ; mon sang ne fait qu’un tour ; vous dire ce qui s’est passé en moi à ce moment précis, je ne m’en souviens pas, mais ce que je puis affirmer, c’est qu’il ne se passa pas quatre secondes avant que mon coup de six, claquant sec dans l’air matinal et envoyé en pleine tête, lui fit faire un brusque recul dans le bois où il s’affala foudroyé. La journée s’annonce pour moi des plus fructueuse ; mon brocart est étendu près de ma cabane, je m’y réinstalle avec fierté, me promettant de ne pas laisser encore s’enfuir l’occasion d’abattre la prochaine grive qui viendra se poser sur l’un des trois pommiers. Au bout d’un petit quart d’heure, mon attente est couronnée de succès, une superbe draine fait son apparition : le temps de fermer ses larges ailes et ... flâh ! la voilà tombée en perdant ses plumes, une deuxième, puis trois, quatre : il est dix heures quand la cinquième, cette fois une litorne, vient s’ajouter au tableau. Le soleil s’est levé, pâle et froid, la bise souffle toujours, un peu moins aigre que ce matin, et je me décide à quitter la hutte et à rentrer déjeûner, afin ce me débarrasser de mon encombrant fardeau. Tantôt, je reviendrai battre le bois avec mon fidèle et infatigable Taillot, excellent bécassier et lapinier de classe. C’est en marquant l’empreinte de mes souliers ferrés sur les chaumes durcis comme de la pierre que je prends le chemin du retour, un retour joyeux, le cœur gonflé d’orgueil, de cet orgueil que tant de chasseurs connaissent aux jours où saint Hubert leur a été exceptionnellement généreux. MARCINI. |
|
|
Le Chasseur Français N°606 Février 1942 Page 71 |
|